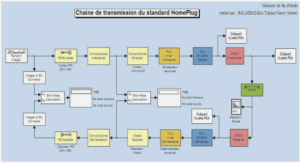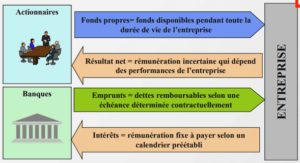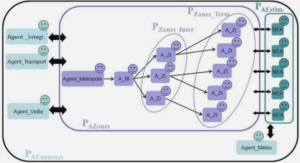« Une verrue dans la ville » ?
Lieux de controverse spatiale
« Cette petite usine un peu moche » « Un espace clôt et hermétique vécu comme un lieu de coupure » « Une verrue dans la ville »
Parmi les nombreuses qualifications de l’usine que j’ai pu écouter au cours de mes rencontres, celle qui m’a le plus marqué est probablement « la verrue dans la ville ». La plateforme chimique perçue comme une entité venant enlaidir profondément l’urbanité du Pont-de-Claix, commune alors condamnée à cohabiter avec cette excroissance hideuse, repoussante que l’on tente désespérément de cacher.
Le tissu urbain du Pont de Claix semble alors se renfermer sur lui-même, à travers cette façade bâtie qui longe le cours Saint-André et dissimule la plateforme. On peut traverser le Pont de Claix sans vraiment se rendre compte que l’usine est là, observant alors une modeste commune dont les aménagements récents du centre-bourg présentent un espace public agréable.
Pourtant, si on est attentif, des porosités sont observables, au détour d’une façade par exemple, laissant apparaitre les ateliers de la plateforme. L’univers de l’usine s’immisce alors dans les lieux de vie des habitants, où une proximité violente vient altérer leur rapport à l’espace public.
Parmi ces espaces de vie contrariés par la présence de l’usine, certains se démarquent, révélant alors des lieux exposés aux conflits spatiaux qui affectent la commune du Pont de Claix
Le parc Simone Lagrange
Se réaproprier les abords de l’usine ?
D’une surface d’un hectare et demi, le Parc Simone Lagrange constitue l’un des plus grands espaces verts de la commune. Il s’inscrit dans le plan de la zone d’aménagement concertée des Minotiers, projet en cours qui se veut renforcer les liens entre la frange Nord de la commune avec la métropole. Le parc relie l’extrémité Sud de la Zac avec la rue Lavoisier, évoquée précédemment car connectée à l’entrée nord de la plateforme. Livré en 2019, ce projet tire son originalité par l’esthétisme particulier de son mobilier peint en rouge. Il est traversé par des allées praticables à pied et à vélo, bordées par des coffrages de pierres et reliées par de petites passerelles en bois. Une zone de jeux pour enfant et un skate-park en ont fait un espace public rapidement approprié par les habitants, transformant alors le caractère désuet de ce lieu probablement jusqu’alors perçu comme trop proche de l’usine. Marquée par sa proximité visuelle avec les premières constructions industrielles, une drôle de scène est alors perçue, lorsque dans le prolongement du skate-park, s’élève la mystérieuse et majestueuse « bulle » de l’atelier HDI 1 de la plateforme. Manifestement, cela ne semble pas déranger les plus jeunes riverains de l’usine.
L’élise Saint-Etienne
Le déclin d’un lieu de culte ?
L’Eglise Saint-Etienne est l’une des premières constructions qui s’est élevée dans le paysage Pontois. A la suite d’une forte croissance démographique de la commune, liée à l’industrie de papeterie qui s’installe aux abords du Drac au début du siècle, elle est érigée en 1864.
Après avoir longtemps constitué un lieu de vie et de rencontre pour les habitants du Pont de Claix, elle est désacralisée en 2005 d’un commun accord entre la commune et le diocèse de Grenoble. Aujourd’hui, elle n’accueille plus le culte, et n’ouvre ses portes qu’occasionnellement pour héberger un festival d’art qui se déroule chaque été depuis une dizaine d’années.
Il est difficile de s’avancer sur les origines de ce déclin, probablement lié à la fois à des mouvances politiques et démographiques qui marquent la commune au cours du XXème siècle et la fermeture des papeteries dans les années 2000. Entre temps, la plateforme chimique est apparue, s’immisçant le long de la frange Est du centre-bourg. Les premiers ateliers de l’usine se sont implantés à quelques dizaines de mètres du clocher, séparés par une fine voie ferrée et par l’enceinte de la déchèterie communale. Il en résulte aujourd’hui un lieu communautaire oublié, délaissé au fil du temps par les habitants et bousculé par l’apparition d’une industrie chimique…
Le cimetière du Pont de Claix
Lorsque l’usine entre dans la ville…
Le cimetière de Belledonne s’inscrit dans cet espace exigu qui sépare l’église Saint-Etienne et l’enceinte du site chimique. D’une superficie de 5000 m², il constitue le plus ancien des deux cimetières de la commune. Sa construction est liée au développement des papeteries Pontoises au cours du XIXe siècle.
Il est desservi par la rue du Souvenir, petite impasse qui longe l’enceinte de l’usine et que l’on atteint en passant devant l’entrée sud de l’usine après avoir traversé la rue de Stalingrad puis la voie ferrée. De l’autre coté de l’enceinte, se dressent les premiers ateliers de l’usine, si proches de la rue que l’on peut parfois surprendre des conversations. Bordé par un parc électrique, le cimetière est séparé de la rue par un long mur de pierre dont la hauteur obstrue la vue. On y accède alors par un grand portail métallique ouvert pendant la journée. L’intérieur dece lieu de recueil se dévoile alors brutalement…
Derrière ces quelques tombes qui occupent l’espace, un atelier de l’usine s’élève et affecte violement l’atmosphère de ce lieu. Majestueux, hideux ? On le savait proche pourtant, mais peut-être pas dans cette mesure. La frontière entre l’usine et la ville ne se perçoit plus, comme si cette structure métallique légère, typique d’une industrie pétrochimique, avait poussé juste là, entre deux tombes du cimetière de Belledonne au coeur même du centre historique de la commune.
L’univers discordant de l’usine
Un imaginaire poétique ?
Au détour d’une façade, en bordure de cimetière ou dans le prolongement paysager d’un parc public, il arrive que l’univers de l’usine s’immisce dans l’espace habité heurtant alors les scènes des vies pontoises. Pourtant, il serait présomptueux de soutenir que cet univers est impartialement laid.
Inscrite dans un paysage montagneux singulier, une certaine poésie de l’usine se dégage des constructions industrielles. La diversité des structures, des volumes, des épaisseurs et des hauteurs dessine un environnement complexe aux ambiances multiples. Les émergences sonores et olfactives du site chimique, et son incidence visuelle dans le paysage, suggèrent un esthétisme du mystère associé au danger. L’usine est vivante, elle respire et vibre au rythme de ses machines. La nuit, de multiples néons illuminent les structures métalliques, tubulures, plateformes et échafaudages. De hautes cheminées se dessinent à l’horizon, d’où s’échappent de majestueux panaches de fumée qui se dispersent dans la pénombre. Un univers presque fictionnel se révèle. C’est ce que réussit à immortaliser Bernard Ciancia dans le reportage coeur d’ouvrier, exposé au musée dauphinois en décembre 2011. Au cours de ce travail photographique qui se veut retranscrire une mémoire ouvrière Iséroise, Bernard Ciancia s’est arrêté au Pont de Claix pour capturer ces lieux de travail singuliers et mystérieux dans lesquels oeuvrent des hommes et des femmes en bleus de travail…
Doit-on alors parler de « verrue dans la ville » ? L’origine de ce que l’on peut identifier comme un conflit spatial au Pont de Claix n’est peut-être pas une laideur intrinsèque de l’univers industriel, mais plutôt son impossible et inéluctable coexistence avec l’urbain. Deux univers humains et discordants cohabitent sur un même territoire exigu. Comment en est-on alors arrivé à un tel constat, à cette proximité si forte de l’usine qu’elle affecte le caractère urbain du Point de Claix ? « L’atelier, la nuit, a des allures de vaisseau spatial. Les tuyauteries, les éclairages, les fuites des purgeurs vapeur… On se croirait dans un décor hollywoodien. Derrière le moindre pilier de béton, derrière les murs de tuyauteries, on pourrait à tout moment croiser Terminator ou Alien. » Jean Pierre Levaray, Putain d’usine, 2008
Histoire du Pont de Claix
Les origines d’une cohabitation difficile
Pour comprendre les conflits spatiaux mis en jeu par cette cohabitation entre la ville et l’usine, c’est d’abord l’histoire du Pont de Claix qu’il faut interroger. Ces deux entités mouvantes dans le temps, ont connu des développements parallèles, mutuellement liés et obéissant chacun à des évolutions politiques et géographiques du territoire.
Le Pont de Claix doit son nom au pont Lesdiguières.
Cet ouvrage qui traverse le Drac est réalisé par le duc de Lesdiguières au cours du XVIIe siècle dans le cadre d’un vaste projet de modernisation de la région grenobloise. Cité parmi les sept merveilles du Dauphiné pour son architecture remarquable, il est aujourd’hui classé monument historique, et devenu l’un des symboles de la commune.
Les premières habitations du Pont de Claix naissent lorsque la riche famille Breton décide de s’installer aux abords du Pont pour y implanter une industrie de papeterie. Lorsque la commune est créée en 1873, Le Pont de Claix n’est qu’un hameau d’un millier d’habitants étroitement lié au développement de cette nouvelle activité. Quelques années après la construction de l’Eglise Saint-Etienne, la gare du Pont de Claix est érigée en 1876 par la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée. Le paysage évolue, et la commune s’ouvre peu à peu sur le territoire à travers cette nouvelle ligne ferroviaire.
L’usine chimique apparait dans le paysage pontois pendant la première guerre mondiale. L’objectif est de produire du chloreet de la soude destinés au développement de gaz de combat, jusqu’ici seulement utilisés par les Allemands. Le choix d’implanter un tel site industriel au Pont de Claix n’est pas anodin. Située loin du front, la commune est connectée à la vallée de la Romanche, territoire connu pour ses nombreuses centrales électriques qui exploitent la « Houille Blanche » – Energie propre provenant des chutes d’eau. Le site dispose également d’une Gare ferroviaire, et une main d’oeuvre locale constituée d’agriculteurs à la recherche de revenus complémentaires. Ayant débuté en septembre 1915, la construction de l’usine « Chlore Liquide » s’achève en juin 1916.
Les premiers bâtiments de l’usine, dont l’emprise ne constitue qu’une petite partie du site actuel, sont édifiés à l’écart du bourg. Ils accueillent les ateliers d’électrolyse au sein desquels sont produits chlore, soude et hydrogène à partir de sels marins. A la différence de constructions industrielles plus récentes que l’on peut observer sur le site, les halles de production et entrepôts de stockage de l’époque présentent une typologie architecturale plus classique, faite de murs plein en pierre et de toits à double pente. Pour les charpentes, le bois est souvent privilégié à l’acier pour sa résistance au sel. L’usine compte alors 350 employés et s’étend sur 18 hectares.
En 1923, la production de gaz de combat n’est plus une nécessité et l’usine est rachetée par l’entreprise Progil qui amorce la diversification des productions. La population de la commune connait une légère croissance liée au développement de la plateforme qui investit dans une politique de logements pour fidéliser ses salariés. L’entreprise acquiert certains terrains à bâtir sur lesquels seront construites des habitations pour les ouvriers et cadres de l’usine. Ces architectures de l’époque, depuis rachetées par des particuliers, marquent aujourd’hui le caractère de la périphérie urbanisée du site.
Un ville trop proche de l’usine, ou une usine trop proche de la ville ?
ATASTROPHE DE TOULOUSE ON POUVAIT L’EVITER
La catastrophe de Toulouse nous choque : ce sont nos collègues, nos copains, nos camarades qui en ont été victimes, et beaucoup ont laissé leur vie au travail.
Cette catastrophe laisse des familles entières dans la peine : familles des salariés, familles populaires, car ce sont toujours elles qui habitent près des zones a risques.
Nous ressentons aujourd’hui un sentiment partagé entre la douleur et la colère. De la douleur parce que nos copains sont tombés mais aussi de la colère car nous sommes certains que cela aurait pu être évité. Ce n’est certainement pas l’accident du site de
Toulouse qui nous apprend que nos usines sont dangereuses, nous en sommes toutes et tous conscients. La réalité nous la dénonçons à longueur d’années dans nos tracts, dans les réunions officielles :[…]
Nous refusons le faux choix entre l’emploi et la sécurité car des copains sont morts et les autres n’ont plus d’usine.
Autre point qui alimente la colère : les usines dans les centres-villes, ou plutôt les centres-villes autour des usines. Qui autorise les constructions si proches des usines à risques ? Qui a autorisé la construction des cinémas, du centre commercial et bientôt du lotissement si proche de notre usine ? Qui est irresponsable ?
PLUS JAMAIS CA!
Tous les moyens doivent être mis en oeuvre afin que toutes et tous puissent vivre et travailler en toute sécurité.
La sécurité dans nos usines, dans toutes les usines, ne doit pas avoir de prix.
Jean Pierre LEVARAY, syndicaliste CGT, militant libertaire, écrit le roman « Putain d’usine » en 2002 . Quelques mois après l’explosion de l’usine AZF à Toulouse, il décrit dans ce récit autobiographique le quotidien d’une classe ouvrière travaillant dans une usine pétrochimique de la région de Rouen.
Dans les annexes de l’ouvrage, apparaissent des extraits de tracts syndicaux rédigés à l’époque par l’auteur. Ci-dessus, un extrait rédigé quelques jours après l’accident de Toulouse, évènement qui à l’échelle du territoire, affectera profondément les populations liées à ce type d’installation industrielle à risque. Outre le discours antipatronal tacite, qui ici n’est pas le sujet, l’auteur dénonce la gestion de ce territoire et remet en cause la proximité étroite et non maitrisée entre une usine à risque et sa population riveraine. L’explosion de l’installation industrielle chimique d’AZF déplore en effet 31 morts dont 9 à l’extérieur du site, des centaines de blessés et l’effondrement de constructions externes proches de l’épicentre. Qui est alors responsable ? L’industriel peut-il avoir développé une activité industrielle en étant conscient du potentiel danger engendré sur les populations riveraines ? Ou plutôt, ignorant l’activité à risque, la commune s’est-elle étendue trop près de l’usine ?
Les sociétés modernes exposées au risque
Le risque est une notion délicate qu’il est important de bien définir pour appréhender les politiques publiques de prévention des risques. On peut l’apprécier comme « l’éventualité d’un événement futur, incertain ou d’un terme indéterminé, ne dépendant pas exclusivement de la volonté des parties et pouvant causer la perte d’un objet ou tout autre dommage ». Le risque est associé à la notion d’aléa et d’incertitude. Il réfère à la probabilité d’occurrence d’un événement dangereux. Il se distingue ainsi de la notion de danger qui est la cause brute d’un dommage.
L’explosion d’un site industriel est un danger, puisqu’elle constitue la cause de dégâts humains, environnementaux et matériels. Le risque caractérise une probabilité d’occurrence de cette explosion qui n’est pas exclusivement dépendante de l’action humaine. C’est donc d’abord un terme technique, qui apparait en France en même temps que la théorie mathématique des probabilités, à travers laquelle des modèles scientifiques d’analyse de risque ont été développés et sont aujourd’hui employés communément dans le domaine industriel.
Il faut comprendre cette notion à travers son évolution temporelle dans le paysage industriel de nos sociétés. Les deux derniers siècles ont été marqués par le progrès technologique, qui, à travers le développement des industries, a permis une croissance économique certaine. En parallèle, à travers les catastrophes industrielles majeures qui ont marqué le XXème siècle, la notion de progrès a peu à peu été associée à la génération de menaces, de dangers et d’atteinte à la sécurité et à l’environnement, principes que l’on peut associer à cette définition du risque. Dans les sociétés modernes, la gestion du risque apparait au coeur d’enjeux politiques et économiques, au sein desquels on constate une rupture de confiance dans la science, devenue incertaine dans la mesure ou le risque n’est pas exclusivement maitrisé par les hommes.
L’indentification de ces nouveaux risques, tristement éveillée par les accidents industriels majeurs, conduit à l’élaboration d’une réflexion commune sur la prévention des risques et sur la protection des territoire exposés. A la suite de la conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (Sommet de Rio, 1992) de nombreux pays instaurent une culture de la prévention dans leurs institutions et adoptent « le principe de précaution ». Cette disposition affirme que «l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable».
Autrement dit, en l’absence de certitudes scientifiques vis-à-vis d’un territoire exposé au risque, il serait impératif d’établir une législation extrêmement précautionneuse qui envisage le pire.
La plateforme du Pont de Claix, site classé Seveso
Au Pont de Claix, la présence d’un tel site industriel, classé Seveso « seuil haut » suscite les mêmes interrogations.
La directive Seveso est le nom générique d’une série de lois européennes qui imposent aux États membres d’identifier les sites industriels présentant des risques d’accidents majeurs, appelés « sites Seveso », et d’y maintenir un haut niveau de prévention.
Datée de 1982, cette directive fait suite à la catastrophe sanitaire de la ville de Seveso (Italie) au cours de laquelle une fuite de produits chimiques a entrainé l’intoxication d’une partie de la population. Elle s’inscrit ainsi dans cette introspection préventive qui semble se caractériser par une progression continue, au gré des progrès techniques, des catastrophes industrielles et des évolutions législatives.
Il est alors pertinent d’interroger la gestion d’un tel territoire à risque, qu’il faut considérer au regard des évolutions législatives qui ont suivi les catastrophes industrielles de Seveso et d’AZF. Pour approfondir ce questionnement, j’ai rencontré des acteurs locaux : Laure, chargée de projet à la direction de l’aménagement urbain du Pont de Claix et Patrick, responsable communication de la plateforme. A travers mes entretiens, j’ai pu appréhender les enjeux politiques et techniques de cette cohabitation et identifier les interactions entre les acteurs de ce territoire de tension dont les responsabilités et les ambitions entrent parfois en compétition.
Concilier risque et développement urbain
D’un point de vue urbain, la plateforme chimique est perçue par la commune comme une contrainte pour se développer. Vécu comme un espace clos hermétique, le site monopolise un tiers de la superficie totale de la commune. Tandis qu’à une époque, l’entreprise de la plateforme participait au développement urbain du Pont de Claix en investissant dans des plans de logements pour accueillir ses salariés, elle constitue plutôt un frein à l’élaboration de projets portés par la commune au cours des dernières décennies.
A la suite des catastrophes chimiques de Seveso (Italie, 1976) et de Bhopal (Inde, 1984) où la fuite d’un isocyanate, de la même famille que les produits manipulés au Pont de Claix, entraine la mort de près de 4000 personnes, une certaine crainte émerge vis-à-vis des de projets de densification urbaine. La commune veut se renouveler et réhabiliter ses plus anciennes habitations pour continuer à faire vivre son centre-bourg. Mais elle fait face à un manque d’instructions réglementaires concrètes, qui rend alors tout projet de renouvèlement difficile voire impossible en raison de réticences législatives encore trop peu détaillées vis à-vis du risque toxique. On reconnait ici le principe de précaution: dans le doute, on ne construit pas.
Au cours de cette période sensible de flottement législatif, vécue par la commune comme une situation immuable paralysant toute ambition de développement urbain, vont émerger des conflits d’intérêts opposant la municipalité à l’industriel.
De son côté l’usine veut limiter l’urbanisation à proximité du site pour protéger son activité en réduisant les risques et nuisances sur les riverains. L’entreprise rachète un certain nombre de terrains dans le centre-bourg et sur les collines de Champagnier, sites particulièrement exposés, qui aujourd’hui seraient peut-être urbanisés sans cet investissement. Ces parcelles périphériques de la plateforme, convoitées et contestées par les deux antagonistes, deviennent progressivement un sujet de tension.
Les échanges de plus en plus difficiles compromettent la collaboration entre l’usine et la ville, qui semble pourtant essentielle dans la gestion d’un territoire soumis au risque industriel. Animés par une règlementation encore inadaptée au Pont de Claix car probablement trop large, l’ambiguïté et le doute s’immiscent dans une gestion du territoire partagée au sein de laquelle une vérité commune ne subsiste plus. C’est peut-être ici qu’une autre forme de danger réside. Lorsque le dialogue est rompu, que chacun avance dans son univers, de part et d’autre de l’enceinte de l’usine, lorsque l’incertitude plane et nous laisse avancer vers la catastrophe, brutale, spontanée, léthale.
Le Plan de Prévention des Risques Technologiques
L’accident d’AZF
Un stock de 300 tonnes de nitrate d’ammonium explose dans une usine de production d’engrais située dans l’aire urbaine de Toulouse. Perçu a plus de 75 kilomètres de son épicentre, le séisme provoqué par l’explosion entraîne des conséquences désastreuses. Le bilan est violent. Parmi les 31 décès, 21 personnes travaillaient sur le site, les 10 autres étaient à l’extérieur. Des centaines de personnes sont blessées gravement, des milliers sont hospitalisées. Un cratère de 50m de diamètre apparaît à la place du dépôt chimique, presque 80 hectares de l’usine sont dévastés. A l’extérieur du site, près de 25 000 logements sont endommagés et plus d’un millier de familles doivent être relogées.
Plusieurs tonnes de produits chimiques se déversent dans la Garonne entrainant la perturbation des écosystèmes. Comme après celle de Seveso en 1976, La catastrophe d’AZF, accident mondial historique, affecte violement le paysage industriel français au début des années 2000. L’existence de ces sites à risques situés à proximité d’aires urbanisées soulèvent à nouveau des interrogations législatives. Pouvait-on éviter l’accident ? Pouvait-on limiter ses conséquences ? Sur qui repose la faute ? La ville ou l’usine ?
|
Table des matières
Introduction
Première partie : Une usine au Pont de Claix : Histoire d’un paysage singulier
Immersion aux abords d’un site chimique
Une balade au Pont de Claix …
« Une verrue dans la ville » ?
Lieux de controverse spatiale
Histoire du Pont de Claix
Les origines d’une cohabitation difficile
Deuxième Partie : Le risque chimique : Réactif limitant d’un renouvellement urbain
Un territoire à risque
Une ville trop proche de l’usine, ou une usine trop proche de la ville ?
Concilier risque et développement urbain
Des intentions discordantes
Le Plan de Prévention des Risques Technologiques
Vers de nouvelles perspectives de développement
Troisième partie : Vivre et travailler au Pont de Claix : Une cohabitation sociale ?
Vivre avec le risque
La posture du Riverain
Traverser la frontière de l’usine
La découverte d’un monde inconnu
L’usine et la ville, lieux de vie des Pontois
Une cohexistence d’abord humaine
Conclusion
Bibliographie