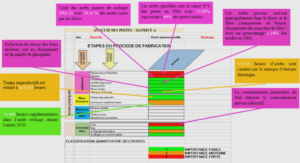Pendant longtemps, l’eau a été considérée comme un bien naturel, un « don du ciel» gratuit, d’exploitation facile, bon marché et pour ainsi dire son accès ne posait aucun problème car à la portée de tout le monde. Le développement qu’a connue et que connaît le monde, les recommandations de l’OMS (qui préconise un accès universel à l’eau), les effets des changements climatiques, font que l’eau soit devenue une denrée très rare et très précieuses. Par ailleurs les pays en voie de développement dont fait partie l’Algérie, ont connu une évolution qui s’est répercutée négativement sur le cadre de vie du citoyen. L’industrialisation massive a en outre conduit à un exode rural très important de ce fait des constructions ont été faites à la va vite au détriment des règles élémentaires d’hygiène, a ce titre l’assainissement était souvent négligé, ce qui a eu pour conséquence la apparition d’égouts à ciel ouvert, exposant ainsi la population aux risques de maladie. Ces différentes pollutions sont très présentes au niveau de la vallée de la Seybouse. Aujourd’hui encore et au cours de nos différentes sorties, nous avons remarqué que les eaux des différents Oueds sont utilisées pour l’irrigation, facilitant volontairement ou involontairement les risques de transferts de pollution. En effet l’eau d’irrigation entraîne avec elle les polluants qui vont se retrouver au niveau des différentes nappes. Pour juguler ces pollutions il devient impératif de connaître la qualité des eaux de l’oued Seybouse et de ses affluents,
Situation géographiques
La région étudiée se situe à l’aval du sous bassin versant de la Seybouse, est traversée par les oueds Kébir Est, Bounamoussa, Seybouse et son affluent principal l’Ouest le Ressoul. Ces oueds proviennent des régions situées en dehors des limites de la zone d’étude. Pour quantifier les apports se faisant par chaque cours d’eau nous nous sommes intéressés aux dépouillements des résultats des jaugeages réalisés.
Notons que d’autres oueds, de moindre importance, traversent également la zone étudiée, il s’agit :
➤ L’oued Meboudja qui draine le lac Fetzara.
➤ L’oued Djefeli et oued Oglat el Feli, affluents de l’oued Seybouse.
Géomorphologie
L’étude géomorphologique donne une idée sur les possibilités aquifères des formations et leurs sources d’alimentation. Au niveau de la région d’Annaba, nous distinguons trois formes morphologiques distinctes, il s’agit de la plaine d’Annaba, le cordon dunaire et les reliefs montagneux qui correspondent à la retombée des djebels Edough au Nord et les massifs de Belleleita au Sud Ouest et Bouhammra au Sud.
Les montagnes
Au contact brutal de la plaine d’Annaba et la mer s’élève l’entité cristallophyllienne du massif de l’Edough témoin des évènements géologiques et tectoniques complexes. La masse principale de ce massif qui a l’allure d’un dôme anticlinal est limitée au sud ouest par la dépression du lac Fetzara, à l’est par la plaine d’Annaba et au nord par la mer. La ligne de crête longue et relativement rectiligne suit une direction sud-ouest, nord-est en débutant de la bordure du lac Fetzara au sud-ouest, s’élève rapidement à plus de 600 m à koudiet El-Rohna, atteint 1008 m à Kef Sbaa (point culminant) puis s’abaisse régulièrement pour s’achever par la presqu’île du cap de garde.
Les principaux versants du massif de l’Edough sont assez dissymétriques : le versant Nord-ouest profondément entaillé par de nombreux oueds descend progressivement après une série de crêtes étagées en direction du nord jusqu’à la mer où se forme le promontoire rocheux de la Voile Noire et du Pain de Sucre. Le versant Sud-ouest dont les lignes orographiques sont encore moins brutales s’abaissent lentement jusqu’à l’oued Aneb. Par contre le versant sud-est est beaucoup plus raide ; sur une distance approximative de 3.5 km entre Séraidi et la vallée de l’oued Oureida on a une dénivelée de 800 m.
D’autre part au sud-est, deux chaînons parallèles séparés par la plaine des Kherazas viennent se greffer au Djebel Edough. Le massif de Boukantas dont le point culminant est à 586 m se prolonge par le Kef N’Sour et les trois mamelons de la ferme Duzer jusqu’à la butte témoin du cimetière israélite. Le Djebel Bellileita (288 m) que termine le massif de Bouhamra jusqu’à la butte de la basilique Saint Augustin. A l’ouest de la zone d’étude, le massif de l’Edough est isolé du djebel Belelieta par une vallée à fond plat qu’empruntent la voie ferré, et la route (R.N.44) il s’agit là d’une fosse Ouest-est d’effondrement entre les Djebels Edough et Belelieta (287 m) ouvrant ainsi une dépression vers la mer Méditerranée.
La plaine de Annaba
La zone d’étude fait une partie de la petite plaine de Annaba qui s’étend entre les coteaux de Annaba, le pied du Djebel l’Edough, les terminaisons du Boukantas et du Bouhamra fait suite à la plaine de kherazas. Autrefois en partie couverte de marécages, elle est aujourd’hui presque entièrement assainie. Les seuls marécages permanents qui subsistent se trouvent au pied du massif de Kef N’Sour à l’endroit du passage de l’ancien lit de l’oued Boudjamaa et à l’entrée de la ville de Annaba entre la butte de la basilique Saint Augustin et le cimentière Israélite.
Le cordon dunaire littoral
C’est une série de dunes sableuses d’origine éolienne et marine qui longent la mer du nord ouest au sud-est depuis la cité Seybouse à l’ouest et El-Kala à l’est. Ces dunes dont l’altitude et la largeur augmentent de l’ouest à l’est isolent la grande plaine de Annaba de la Méditerranée en formant une barrière naturelle qui gêne l’écoulement superficiel des eaux de certains réseaux hydrographiques comme celui du Khelidj du Bou Kamira et de la Mafragh. A l’intérieur du périmètre d’étude ces dunes n’occupent qu’une bande de 500 m à 700 m de largeur qui s’élève au dessus de la mer de 3 m au niveau de la cité Seybouse à 18 m en face de l’aéroport.
Réseau hydrographique
La partie montagneuse, constituée par une ligne de crête longue et relativement rectiligne selon une direction Sud-Ouest, Nord Est, caractérisée par des versants raides constitués généralement de roches dures est sillonnée par un important réseau hydrographique dense et ramifié (chaabets, » cht . Bellareau, cht . Aouech « ) à écoulement torrentiel temporaire. Ces chaabets convergent vers l’aval pour former des oueds dans les eaux atteignant difficilement la mer à l’Est et au Nord Ouest en raison de la faible pente de la plaine et de la barrière dunaire littorale, causant parfois des inondations importantes. La zone étudiée appartient au sous bassin versant de l’oued Boudjemàa. Ce sous bassin forme la terminaison Est du massif de l’Edough et est limité par la ligne des crêtes de Bouzizi, Séraidi, Col des Chacals au Nord et au Nord Ouest, de Bellileita au Sud et au Sud- ouest et de Bouhamra à l’Est. Il forme actuellement un réseau hydrographique indépendant après la déviation de l’embouchure de l’oued Seybouse en 1970 dont il faisait partie. L’oued Boudjemàa est le collecteur principal de ce sous bassin. Il reçoit à la hauteur de l’agglomération de Bouhamra les eaux du canal de Kef N’Sour (collecteur de l’oued Bouhdid, Sidi Harb et Forcha) avant de rejoindre la mer entre la cité Seybouse et le complexe industriel « ASMIDAL ». Avant sa déviation cet oued passait au pied du massif de Kef N’Sour puis sous la butte de la basilique Saint Augustin pour se jeter en mer. Le réseau hydrographique se compose au Sud Ouest par les sous bassins des oueds Forcha, Sidi Harb et Bouhdid qui constituent en aval un cours d’eau unique qui se branche sur l’oued Boudjemàa par le biais du canal de déviation de Kef N’Sour. Le collecteur principal de ces oueds connu sous le nom de oued Dheb coule à présent dans le sens Nord, vers la mer a l’Est, après la déviation qui consistait à le raccorder à l’Oued Boudjemàa à travers les collines de Kef N’Sour et la R.N. N° 44.
|
Table des matières
Introduction générale
Chapitre I : Situation géographique et géomorphologie
I. Situation Géographique
II. géomorphologie
1. Les montagnes
2. La plaine de Annaba
3. Le cordon dunaire littoral
4. Réseau hydrographique
III. Conclusion
Chapitre II : Aperçu géologique
Introduction
I. Cadre géologique régional
1. Le complexe cristallophyllien
1.1. L’unité de base
1.2. L’unité intermédiaire
1.2.1. Les micaschistes
1.2.2. Le marbre
1.3. L’unité supérieure (série des alternances)
2. Les roches ignées
2.1. Le groupe microgranitique
2.2. Le groupe rhyolitique
2.3. Le groupe dioritique
2.4. Le groupe andésitiques
3. Les terrains sédimentaires
3.1. Les flyschs ou grès numidiens
3.2. Les flyschs sénoniens
3.3. Le Mio-Pliocène
3.4 Quaternaire
4. Tectonique et structure du massif de l’Edough
a. Le massif de l’Edough
b. La plaine de Annaba
4.1. Déformations synmétamorphiques
4.2. Déformations tardives
4.2.1. Plis
4.2.2. Failles
5. Minéralisations du massif de l’Edough
II. Conclusion
Chapitre III : Les caractéristiques climatiques
I. Introduction
II. Les caractéristiques climatiques
1. Les stations de mesure
2. Type de climat
3. Les paramètres climatiques
3.1. Les précipitations
A / Les précipitations mensuelles
B / Les précipitations annuelles
3.2. La température
3.2.1. Diagramme Ombrothermique
3.3. L’humidité
3.4. Le vent
4. Le bilan hydrique
4.1. L’évapotranspiration
a) L’évapotranspiration potentielle (ETP)
b) L’évapotranspiration réelle (ETR)
b.1) Formule de Thornthwaite
b.3) Formule de Coutagne
c) Comparaison
4.2. Le ruissellement
4.3. Estimation de l’infiltration
A. La méthode des chlorures
B. La méthode de Thornthwaite
4.4. Calcul du bilan hydrique selon la formule de Thornthwaite
a) Interprétation du Bilan hydrique
III. Conclusion
Chapitre IV : Les caractéristiques hydrologiques et hydrogéologiques
I. L’hydrologie
1. Introduction
2. Etude des hydrogrammes
3. Lissage des hydrogrammes
3.1. Analyse des débits classés et polygones des fréquences
3.2. Régime des débits mensuels
3.3. Ajustement des débits annuels à la loi normale
– Etude de l’écoulement Moyen Annuel
– Débit annuel moyen brut
– Débit moyen annuel spécifique
– Bilan moyen annuel de l’écoulement
3.4. Variation Inter Mensuelle de l’Ecoulement
– Rapport des modules extrêmes (coefficient d’irrégularité)
-Variation interannuelle de l’écoulement
4. Etude statistiques des débits moyens annuels
4.1. Statistiques élémentaires
– Estimation des débits fréquentiels
4.2. Ajustement des séries des débits annuels par les lois de Gauss et de Galton
a) Calcul des débits moyens annuels fréquentiels
b) Variation mensuelle de la lame d’eau écoulée
c) Variation interannuelle des débits moyens mensuels
4.3. Répartition mensuelle et saisonnière de la lame d’eau écoulée
Conclusion générale