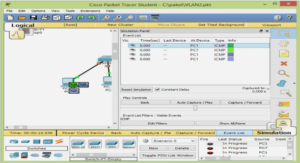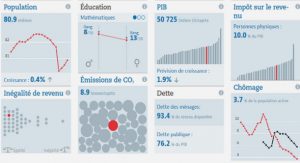Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Forêt de Tapia : un vestige de forêt menacé
La commune d’Arivonimamo est caractérisée par un écosystème spécifique constitué de forêt de Tapia. La forêt de Tapia est typique de Madagascar puisqu’elle est caractérisée par le bois de tapia
La majeure partie de cette forêt de Tapia d’Arivonimamo est sous une gestion communautaire à travers le transfert de gestion (TG) sous le contrat Gestion Locale Sécurisé (GELOSE) depuis 1999 (Soloniaina, 2016).
Cette forêt abrite différentes ressources, entre autres les produits forestiers non ligneux et ligneux, qui contribuent à la production des services écosystémiques et au bien-être de la population locale. Grâce à ces services écosystémiques diverses biens et services forestiers sont produites. Ces biens et services jouent un rôle important dans l’économie locale informelle. (Rakotondrasoa et al., 2012). Les champignons et les fruits constituent une ressource alternative très importante en période de soudure.
A cette formation forestière naturelle s’ajoute des surfaces issues de la propagation des forêts de reboisement de Pinus spp et d’Eucalyptus spp. (Soloniaina 2016).
La colonisation spontanée des espèces de reboisement dont les espèces de Pinus est considérée comme
étant la principale menace des forêts de tapia des hautes terres malgaches (Kull et al., 2005). L’invasion de Pinus spp peut changer les micro-habitats de Tapia, notamment la qualité du sol, pouvant défavoriser les espèces endémiques (Rakotondrasoa et al., 2013). En effet, les Pins ont la capacité de nuire : la qualité de la litière, le processus de décomposition entrainant la mort de la biodiversité du sol (Simberloff et al., 2013). De plus, le fait que les pins atteignent des hauteurs dominantes élevées, ils pourraient diminuer la quantité de lumière disponible dans les peuplements de tapia, entravant leur croissance et le développement de leur régénération (Rakotondrasoa et al. 2013).
En effet, les Pins sont des espèces de tempérament héliophiles et peuvent dominer la strate supérieure au profit des pieds d’Uapaca bojeri (Kull et al., 2005). A Arivonimamo en 2013, sur 240 placettes de 500 m² dans la forêt de tapia, 760 pieds d’arbres exotiques ont été recensés (Rakotondrasoa et al. 2013).
Les pins constituent les résineux les plus répandus à Madagascar dont le Pinus kesiya en est l’espèce la plus utilisée (Bouillet, 1993 in Carriere et al., 2007). Les surfaces reboisées arrivent à d’autres fragments grâce à la faveur de la dispersion naturelle de l’espèce (Carriere et al., 2007). Même si Eucalyptus robusta est aussi une espèce envahissante introduite dans la région, elle présente une densité de régénération inférieure à celle d’Uapaca bojeri au sein du peuplement de tapia ; ce qui n’est pas le cas de Pinus kesyia. (Rakotondrasoa et al. 2013).
Les dimensions sociales de l’invasion biologique
L’invasion des plantes exotiques présente un des grands défis par rapport à la gestion des ressources naturelles (Pearson et al. 2009). En effet, présentant un risque de nuisance à la biodiversité endémique et naturelle, la gestion des espèces envahissantes nécessite une technique adéquate via la compréhension du phénomène.
Pour avoir une maitrise efficace des invasions biologiques, il est nécessaire d’intégrer leur dimension humaine à leur dimension écologique. En effet, l’invasion biologique est un concept hybride associant deux dimensions imbriquées : l’une socio-culturelle, liée aux modes de représentation et de relation à la nature ; l’autre écologique, fondée sur l’analyse de faits biophysiques (Haury et al.2015). Ainsi, une théorie purement biologique des plantes invasives ne permet pas d’expliquer ou de prédire le dynamisme de ces espèces. (Kueffer, 2017).
L’homme joue un rôle crucial à la fois dans l’introduction des espèces exotiques, dans la modification de l’écosystème et du paysage et par conséquent le processus d’invasion et son dynamisme (Shackleton et al.2019). Le premier critère pour assurer un succès de l’éradication est que l’environnement socio-politique de l’éradication est favorable (Vanderhoeven et al., 2011) . Alors, afin d’avoir la capacité de combattre efficacement les invasions biologiques, à part la recherche fondamentale sur les processus d’invasion et ses impacts écologiques, il est nécessaire d’avoir une meilleure compréhension de l’acceptabilité sociale des moyens de lutte (Solarz et al, 2016).
La compréhension des perceptions que porte les gens vis-à-vis de l’invasion permet aussi de comprendre leurs comportements. Du fait que les perceptions se rallient aux attitudes des personnes le discernement des perceptions aide alors à développer une stratégie de gestion efficace pour maintenir, préserver améliorer la biodiversité, les services écosystémiques et bien-être humain (Shackleton et al., 2018).
Dans les invasions biologiques malgré une forte augmentation des recherches, les recherches mondiales se penchent surtout sur les questions écologiques (92% des recherches publiés) que sur les questions socio-économiques (Shackleton, et al., 2018). Ce qui reflète le manque de recherche actuellement sur les perceptions des invasions biologiques.
Notion d’espèce invasive
L’invasion biologique est une notion complexe car elle associe des champs disciplinaires multiples ayant chacun leur propre concept, méthode et échelle d’étude (Fournier, 2018 ; Humair et al., 2014). Les disciplines concernées par cette notion sont l’écologie, l’évolution, la génétique, la biogéographie, la biologie de la conservation, l’éthique et la politique (Fournier, 2018). Toutefois, dans le cadre de cette étude, c’est la notion établie par Wilson et al., (2009) repris par Richardson et al., (2011) relatant qu’une espèce invasive est « une espèce introduite à partir d’une aire biogéographique distincte de celle étudiée et capable d’avoir une descendance fertile, de se multiplier et de s’étendre géographiquement dans sa nouvelle aire de distribution » qui a été adoptée.
L’invasion biologique comporte 3 phases : l’arrivée, l’établissement et l’expansion. L’arrivé correspond à l’introduction de l’espèce directement ou indirectement hors de son aire de répartition naturelle. L’établissement concerne l’adaptation et la naturalisation de l’espèce exotique. L’expansion correspond à la prolifération de l’espèce entrainant des impacts écologiques et socio-économiques (Thévenot, 2013).
Le Pin à Arivonimamo, est favorable au conditions climatiques et pédologiques de la région, déjà naturalisé et se disperse très fortement hors des parcelles de plantations.
Notion de perception
La notion de perception est large car plusieurs théories existent pour l’expliquer. Etymologiquement obtenue du mot latin « perceptĭo », la perception se rapporte à l’action et à l’effet de percevoir des images, impressions ou sensation externe et de comprendre.
Pour Shackleton et al. (2018), elle résulte d’un processus mental individuel selon ses expériences, ses connaissances, ses convictions personnelles. Flamarion (1997) appuie aussi cette théorie en affirmant que la perception relève de l’aptitude de l’individu à synthétiser ses expériences passées et les signaux sensoriels présents. Ainsi, la perception concerne la procédure où les personnes sélectent, organisent, interprètent, sauvegardent et répondent aux informations de ce qui les entourent produisant une construction et impression mentale qui l’aide à construire les comportements et actions (Shackleton, et al., 2018). C’est cette notion qui sera prise comme référence dans le cadre de cette étude.
Plusieurs facteurs peuvent influencer les perceptions des individus sur les invasions biologiques, dont particulièrement la personnalité de l’individu ainsi que de sa socialisation (Shackleton et al. 2018). D’autres facteurs peuvent tout autant l’influencer tels : le contexte socio-culturel, les effets de l’invasion, les caractéristiques de l’espèce, l’individu, les contextes physiques du terroir, les contextes politiques et institutionnels (Shackleton et al., 2018) (cf. Figure 1).
Les perceptions des constructions dynamiques, qui sont influencées par les expériences et les environnements des individus à travers le temps et l’espace (Shackleton et al., 2018). Ainsi, les perceptions s’évoluent dans le temps et dans l’espace en fonction des contextes.
Notion de valeur d’un écosystème
De même que la notion d’invasion et de perception, la notion de valeur est large car plusieurs théories selon les disciplines existent pour l’expliquer.
Selon le Millenium Ecosystem Assessment (MEA, 2005) les écosystèmes ont une valeur car ils maintiennent la vie sur Terre et ses services contribuent aux satisfactions matérielles ou non des êtres humains.
Pour quantifier monétairement la valeur de tout service environnemental, la notion de valeur économique totale (VET) est la variable utilisée (MEA, 2005). La valeur économique totale est un cadre d’évaluation permettant de déterminer l’ensemble des valeurs générées par les biens et services écologiques d’un capital naturel autant marchands que non marchands (Massicotte 2012). Ce concept divise la valeur d’un écosystème en deux catégories : la valeur d’usage et la valeur de non usage (cf. figure 2) (MEA, 2005). La valeur d’usage se réfère aux valeurs de tous les services écosystémiques qui sont utilisés par l’homme pour la consommation ou pour une production. Cette valeur inclue les services écosystémiques tangibles et intangibles qui sont utilisés directement ou indirectement ou des services qui ont des potentielles d’être utilisés plus tard (cf. figure 2) (MEA, 2005).
La valeur de non usage se rapporte aux valeurs intrinsèques de l’écosystème (MEA, 2005). Cette valeur est difficile à évaluer.
ANOVA (Analyse de la variance)
Un ANOVA consiste à estimer si le changement de modalités d’une Variable Aléatoire (VA) qualitative engendre une variation significative des moyennes d’une VA quantitative, le seuil d’erreur α utilisé sera de 5% (Bertrand et al. 2011). L’ANOVA requiert la condition de normalité sur les résidus à tester (Bertrand et al. 2011).
L’ANOVA a été le test utilisé pour tester l’influence de la filière d’appartenance de l’individu sur le revenu des individus.
Le test de Fischer a été utilisé pour tester l’existence de relations entre les variables dans le cadre de l’ANOVA. Le Test de Tukey (HSD) a été employé pour l’analyse des différences entre les groupes (filière) avec un intervalle de confiance à 95%.
Analyse de correspondance multiple (ACM) couplé d’une classification ascendante hiérarchique (CAH)
Un ACM permet de déterminer quelles variables influent le plus sur la dispersion des individus et de donner une représentation des similitudes entre les individus et entre les modalités des variables qualitatives, (Chavent, 2014). Pour caractériser les individus, les variables « Sexe », « Situation Matrimoniale », « Statut foyer », « provenance », « âge », « diplôme », « nombre dans la famille », « revenu annuel », « superficie terrain », « superficie boisée » ont été utilisées dans le cadre d’un ACM.
Ensuite un CAH a été utilisé. Cette classification vérifie les divergences et les ressemblances entre les individus selon les variables aléatoires. De ce fait, des classes avec des individus qui se ressemblent pourront être établies selon les variables aléatoires qui déterminent les ressemblances. Les classes issues de la CAH ont été interprétés à partir des résultats de l’ACM. La distance de Khi-deux (χ²) a été employé pour comparer deux individus décrits par deux points ou deux modalités décrites par deux points. Lors de la CAH aussi, le critère d’agrégation utilisé est la méthode d’agrégation de Ward.
Test de comparaison de k fréquences –
Le test de comparaison de k fréquences a été utilisé sur les paramètres : perception de la principale menace de la forêt de Tapia, perception des effets du Pinus, perceptions du Pin par rapport aux autres ligneux, valeurs perçues pour l’écosystème Tapia et pour l’espèce Pinus sp, préférence en termes d’éradication, action d’éradication afin de savoir si la différence entre les proportions de réponses est significativement différente.
Pour cela, la méthode de Monte Carlo a été adoptée avec 5000 simulations. Les hypothèses à tester sont :
– H0 : les proportions sont égales.
– H1 : les proportions sont différentes.
Test de Khi-deux
Le test de Khi-deux au seuil α=5% a été le principal test utilisé pour tester l’existence de corrélations possible entre les variables liées aux perceptions du Pin par rapport à la filière. Les variables tester avec la filière d’appartenance ont été : la perception de la principale menace de la forêt de tapia, les perceptions sur les effets du Pinus, les perceptions sur le Pin par rapport aux autres ligneux.
Les classes obtenues à partir de CAH de la caractérisation des individus ont été testés suivant le test de khi-deux (α=5%) avec les filières auxquelles les individus sont rattachés afin de vérifier les relations entre l’activité de l’individu et ses caractéristiques.
Le test de Khi-deux a aussi été employé afin de savoir les relations entre connaissance en termes d’éradication, relation avec l’environnement et préférence en termes d’éradication. Ceci dans le but de savoir les variables qui expliquent les préférences en termes d’éradication. Le test de Khi-deux a été utilisé car les variables sont d’ordre qualitatifs.
Ainsi, les hypothèses à tester pour chaque test de Khi-deux employé ont été :
• H0 : les variables à tester sont indépendants, il n’y pas de relation entre les variables.
• H1 : Il existe un lien entre les variables.
|
Table des matières
Table des matières
1 INTRODUCTION
2 METHODOLOGIE
2.1 Problématique et hypothèses
2.1.1 Forêt de Tapia : un vestige de forêt endémique menacé
2.1.2 Les dimensions sociales de l’invasion biologique
2.1.3 Perception de l’invasion de Pinus : une menace ou un atout ?
2.1.4 Hypothèses
2.2 Etat des connaissances
2.2.1 Notion d’espèce invasive
2.2.2 Notion de perception
2.2.3 Notion de valeur
2.2.4 Contextes locaux sur la gestion de l’invasion de Pins
2.3 Zone d’étude
2.4 Méthode de collecte de données
2.4.1 Enquête
2.4.2 Entretiens
2.4.3 Observation directe
2.5 Méthode de traitement et d’analyse des données
2.5.1 Préparation des données
2.5.2 Analyse statistique
2.5.3 Méthode de traitement des données qualitatives
2.6 Synthèse de la démarche méthodologique
2.7 Cadre opératoire
3 RESULTATS
3.1 Partie 1 : Acteurs et perceptions de l’invasion
3.1.1 Caractérisation des acteurs
5.1.2. Analyse des perceptions des individus
3.2 Partie 2 : Valeurs perçues des écosystèmes et stratégie de lutte de l’invasion
3.2.1 Analyse des différentes valeurs attribuées aux écosystèmes
3.2.2 Modes d’applications de la règlementation locale sur l’invasion
3.2.3 Stratégie individuelle de lutte contre l’invasion
3.2.4 Analyse des corrélations entre les valeurs perçues et les stratégies de lutte
4 DISCUSSIONS
4.1 Limites de la méthodologie
4.1.1 ECHANTILLONNAGE
4.1.2 EVALUATION ECONOMIQUE
4.2 Discussions sur les résultats
4.2.1 Sur effets perçu des invasions biologiques
4.2.2 Sur les valeurs perçus des espèces invasives
4.2.3 Sur les facteurs de blocages de l’éradication
4.2.4 Sur le mode de gestion de l’invasion biologique
4.3 Discussions sur les hypothèses
5 RECOMMANDATIONS
5.1 Axe d’orientation 1 : poursuivre et améliorer l’Information-l ’Education-et la Communication (IEC) de la population sur les invasions biologiques
5.2 Axe d’orientation 2 : Mettre à jour la règlementation en vigueur et assurer sa mise en oeuvre 55
5.3 Axe d’orientation 3 : Valoriser durablement les arbres exotiques
5.4 Cadre logique d’intervention pour la gestion de l’invasion de Pin
6 CONCLUSION
7 BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE
Télécharger le rapport complet