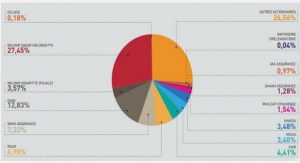Une centralisation intimement liée à la construction de L’État
Historiquement, la construction de L’État nation passe par des politiques de soumission de régions périphériques à un centre urbain plus ou moins étendu comme ce fut le cas en France avec Paris ou encore en Allemagne avec la Prusse . Ces régions s’affirment sur les autres en mettant en place des politiques massives de transferts juridiques, sécuritaires… sur une population située sur un territoire déterminé.
Toutefois, la Tunisie, bien que possédant des caractéristiques similaires à ces modèles (avec une capitale, Tunis, qui contrôle le reste du territoire) ne s’est pas développée de la même manière.
En effet, contrairement aux pays européens précédemment cités, la Tunisie n’a jamais réalisé de politiques de transferts comparables d’un point de vue économique, politique ou juridique. Au contraire, les politiques de transferts étaient caractérisées par une « politique centralisée à moindre coût » passant par des relais ou réseaux bien définis (notables locaux, chefs de tribu…) et non pas directement par L’État. Il y a donc eu privatisation des politiques publiques dans le sens où L’État n’utilisait pas son propre personnel pour mettre en place ses politiques régaliennes sur son territoire. Par conséquent, il n’y avait pas d’investissement direct humain, matériel ou financier de Tunis vers le reste du pays puisque tout se faisait au niveau local : les chefs locaux prélevaient l’impôt pour le Bey, assuraient la sécurité de leur population et réalisaient eux-mêmes les investissements économiques nécessaires. On peut donc dire que « la nation [était] pleinement soumise au Bey de Tunis mais se [gouvernait] elle-même ».
Il y avait donc présence de deux pouvoirs au niveau local : celui du Bey, qui s’exerçait à travers ses représentants locaux (le plus souvent des chefs de tribus) et celui des tribus, qui agissaient de manière plus ou moins autonome.
Le protectorat a toutefois modifié cette situation puisqu’il a mis en place un découpage administratif du territoire avec l’aide de certains pouvoirs civils locaux (majoritairement des tunisois et des sahéliens). Les administrateurs français ont donc pu bénéficier de l’appui d’une partie de la population pour affirmer leur autorité sur les zones rebelles, majoritairement du sud et de l’intérieur. Pour ce faire, ils ont redéfini les limites territoriales des tribus afin de casser leurs pouvoirs et ont initié les premières politiques de transferts publics similaires au modèle français.
Ainsi, la présence française s’est traduite par une réorganisation administrative de L’État au niveau local, avec la mise en place d’institutions représentatives déconcentrées de L’État central (confère Annexe1), mettant ainsi fin au rôle politique bicéphale des chefs de tribus. Cette modification a permis d’asseoir l’autorité du pouvoir central sur tout le territoire, et c’est pour cela qu’elle a été poursuivie après l’indépendance, parce qu’elle permettait de contrôler les régions rebelles de l’intérieur du pays en les soumettant au pouvoir central. Cette soumission était possible du fait de la présence directe d’autorité de la Régence mais aussi grâce aux politiques de transferts économiques, juridiques et sécuritaires qui ont été réalisés sous le protectorat et qui privaient les chefs locaux de leur autorité traditionnelle ; ces derniers n’ayant plus la responsabilité directe du développement et de la sécurité de leur territoire.
La centralisation : un moyen d’affirmation et de contrôle du pour les nouveaux dirigeants tunisiens
Comme nous venons de le voir, le parti libérateur va reprendre le modèle étatique proposé par la France ainsi que certaines de ces valeurs telles que la laïcité, l’unité nationale et une vision de l’État au centre de la société.
Ce modèle a été choisi, car il permettait d’asseoir l’autorité de l’État sur tout le territoire et de lutter contre le tribalisme et les pratiques ancestrales. Il sera d’autant plus facile à imposer que l’intégration nationale était déjà réalisée sous le protectorat et qu’il y avait déjà plusieurs instances représentatives de l’État au niveau des gouvernorats.
Il n’y a donc pas eu de remise en cause du modèle administratif colonial après l’indépendance ce qui explique la centralisation importante du nouvel État. La structure étatique était donc prête lors de la mise en place de la république tunisienne. Il ne restait plus qu’à mettre fin à certains particularismes ethniques jugés incompatible à la création d’un État moderne en redécoupant le territoire de telle sorte que les nouvelles circonscriptions administratives séparent certaines tribus et clans.
Par exemple, l’institution traditionnelle du cheikh (autorité religieuse et politique locale) fut remplacée par celle du chef de secteur, qui tirait sa légitimité de son appartenance au parti.
Dans ce contexte, on comprend que la Tunisie ait, dès le départ, adopté une forme avancée de centralisation qui se caractérisait par le morcellement du territoire en trois niveaux dont le plus important est le niveau régional (le gouvernorat). Ces gouvernorats étaient eux-mêmes subdivisés en délégations qui étaient à leur tour découpées en secteurs. Ce système permettait une présence de l’État central sur plusieurs niveaux, lui permettant d’être au plus près des citoyens.
Ainsi, les communes sont restées « des unités territoriales discontinues ne couvrant pas l’ensemble du territoire mais […] incluses à l’intérieur des gouvernorats » . L’autorité de l’État central sur les communes s’exerçait à travers le gouverneur (Wali), les agences nationales et les directions régionales des départements ministériels. Ces trois instances étatiques encadraient très fortement les communes, le gouverneur étant systématiquement consulté pour chaque décision ce qui annihilait complètement leurs compétences. Les décisions adoptées ne pouvaient donc pas être mises en œuvre sans leur accord. Par exemple, les finances des communes n’avaient de valeur que lorsqu’elles étaient approuvées par les autorités de tutelles, c’est-à-dire par le ministère de l’Intérieur et le ministère des Finances chargés « d’examiner et de suivre les budgets … des collectivités locales, de participer aux études relatives à la fiscalité locale, de procéder à l’ouverture des crédits afférents aux projets locaux… ».
Par conséquent, ces ingérences multiples privaient les collectivités locales d’autonomie puisqu’elles ne pouvaient pas mettre en œuvre librement leurs activités, étant donné que le budget et les dépenses étaient étroitement contrôlés par l’État. Ce procédé permettait à l’État de modifier ou supprimer des mesures aisément, car les ressources propres des communes étaient insignifiantes par rapport aux politiques à mettre en œuvre. Le pouvoir local était donc très encadré par le pouvoir central, représenté au niveau local par les autorités déconcentrées et notamment le gouverneur qui était chargé de « l’administration générale du gouvernorat et du maintien de l’ordre public ».
Effectivement, le gouverneur était « responsable de la mise en œuvre de la politique nationale de développement régional, il propose au gouvernement les mesures de promotion économique qu’il juge appropriées » et depuis 1975, il « exerce la tutelle sur les communes ». Pour accomplir ses missions, il bénéficiait du soutien des délégués, qui étaient chargés d’assister le gouverneur au niveau de leur délégation territoriale. Nommés par décret, ils coordonnaient les services locaux de l’État dans leur circonscription et étaient donc des agents de tutelle à un niveau inférieur puisqu’ils étaient soumis à l’autorité du gouverneur selon la loi du 13 juin 1975.
Le délégué était lui-même assisté par un chef de secteur (omda) chargé d’aider les différents services administratifs, judiciaires et financiers de son secteur afin que le gouverneur puisse accomplir sa mission. Dans ce cadre, le délégué recueillait aussi les doléances des citoyens et les aidait dans leurs relations avec l’administration.
On constate donc que dès le départ, les communes ne disposaient ni des pouvoirs ni des moyens nécessaires pour développer leurs services de manière autonome. Le cadre juridique concernant les services locaux était donc volontairement sous-développé et ces insuffisances traduisaient la conception unitarienne des dirigeants tunisiens de l’époque, qui cherchaient à contrôler toutes les forces présentes sur le territoire.
Ainsi, le choix de la déconcentration en Tunisie se justifiait parce qu’il permettait à la fois de garantir l’unité nationale tout en favorisant la pénétration territoriale de l’État. Il préservait donc « la mainmise de l’administration centrale sur l’ensemble du territoire et correspondait à la culture de pouvoir dominante dans l’administration centrale marquée par son caractère centralisateur et sa dimension autoritaire ». La centralisation était donc le reflet de la volonté des élites du NéoDestour, qui souhaitaient la mise en place d’un nouvel État fort caractérisé par la prégnance du nationalisme, de la modernisation et du développement.
Une centralisation alimentée par la confusion entre l’Etat et le parti unique
Comme nous venons de le voir, la construction de l’État tunisien a été marquée par une forte centralisation qui s’inscrit dans un contexte historique et politique.
Toutefois, l’importance de la centralisation est aussi due à l’emprise du parti unique dans les plus hautes instances de l’État.
En effet, il y a une interaction étroite, voire une confusion entre le personnel du parti et le personnel de l’État en Tunisie. Cette confusion n’est pas propre à la Tunisie puisqu’elle se retrouve dans la plupart des États nouveaux ayant une doctrine socialiste ou proche du socialisme. Dans ces pays, en plus de contrôler l’administration, le parti unique monopolise la réflexion sur les politiques économiques, de développement et d’aménagement du territoire et devient le seul acteur capable de mettre en œuvre des réformes pour le bien de tous. Il est l’ « instrument privilégié de la gestion, de l’organisation et du contrôle de la chose publique et même privée, mais aussi le principal voire l’unique vecteur du changement social et de la construction nationale ».
Ainsi, la centralisation s’explique également par la méfiance des autorités nationales vis-à-vis des pouvoirs locaux et régionaux, qui représentaient aux yeux des nouveaux dirigeants une sorte d’obstacle à l’unité nationale et à la modernisation de l’État. Le nationalisme prôné à l’époque visait donc l’élimination des divisions internes pour renforcer l’unité de l’État. C’est d’ailleurs ce qui ressort des discours des dirigeants politique.
En effet, Bourguiba disait : « Je veux que vous soyez convaincu que cet État c’est votre tribu, c’est la nation toute entière » . Cette doctrine politique, marquée par des idées socialistes voire communistes, est mise en avant par les dirigeants qui rêvaient « non seulement de la création de l’État lui-même, mais également [de] la réforme des relations sociales, en soulignant la nécessité de faire émerger un nouveau « contrat social ». Ce dogme sous-entend donc que l’État n’avait pas vocation à laisser une autorité locale entraver son pouvoir ce qui explique le phénomène de substitution du centre à la périphérie visible en Tunisie.
On constate donc que « les relations politiques et sociales sont interprétées à la lumière d’une histoire qui n’a cessé d’instrumentaliser l’idéal de l’unicité et un imaginaire de l’État fait d’un pouvoir centralisé et de la négation de la pluralité et de l’altérité » . Ce mythe était renforcé par la croyance que la légitimité du pouvoir résidait en son exercice même (« Que Dieu rende victorieux celui qui prend le pouvoir »). C’est d’ailleurs ce principe qui a été utilisé lors de la libération nationale par Bourguiba pour consacrer la suprématie de l’unité nationale et son pouvoir comme l’illustre cette citation : « [la nation tunisienne] que j’ai fabriquée de mes mains pendant une lutte de près d’un quart de siècle, que j’ai créée de toutes pièces à partir d’une poussière d’individus » . De fait, la persistance, voire l’aggravation de certaines disparités régionales a été perçue comme une menace à l’unité nationale et donc comme un problème urgent auquel l’État devait faire face puisque ce dernier tire sa légitimité « de l’idée qu’il était le seul acteur capable de lutter efficacement contre les différentes inégalités ».
Par conséquent, la construction d’un État moderne et développé nécessitait, selon les nouveaux dirigeants, l’affirmation d’un État fort, capable d’imposer des politiques sur tout le territoire via un modèle prônant la centralisation pour assurer le développement de la nation tunisienne. Ce constat est vérifié en Tunisie où les membres du parti, qui étaient les hauts responsables de l’État, interagissaient avec le personnel local même si cela n’était initialement pas prévu dans leurs fonctions avant le congrès du PSD de 1971 (qui double la hiérarchie locale en installant des cellules du parti en charge de superviser le travail des communes). Cette présence du parti à tous les niveaux est le résultat de l’infiltration de la haute administration par les membres du parti, qui ont profité de leur autorité pour contrôler les politiques locales. Ce mode de fonctionnement relevait de l’importance de la doctrine des élites du Néo-Destour, qui avaient du mal à concevoir que l’on puisse agir en dehors des institutions de l’État central. Les autorités locales, dépourvues d’autonomie, ne pouvaient pas prendre de décision importante.
Ainsi, « la Tunisie n’accorde qu’une autonomie relative aux municipalités qui restent étroitement contrôlées par le pouvoir central, à un tel point que les citoyens tunisiens ordinaires en viennent souvent à confondre la cellule locale du parti présidentiel (RCD) et la mairie, adressant leur doléance à l’une ou à l’autre, sans toujours établir de distinction claire entre les deux ».
Le cas des délégués, avant et après la présidence de Bourguiba, illustre bien ce phénomène. En effet, sous Bourguiba, les délégués étaient insérés dans des réseaux organisés par le parti et avaient donc un pouvoir au niveau local important, ce qui n’est plus le cas sous Ben Ali. Le vide créé par la dissolution du parti Néo-Destour, n’a pas été totalement remplacé.
En effet, dans la plupart des cas, les délégués nouvellement nommés se sont retrouvés à mener des responsabilités politico-administratives qu’ils ne maîtrisaient pas d’où l’apparition de nombreuses difficultés, accentuées par le contexte et par le renouvellement de cette catégorie de fonctionnaire . C’est notamment ce qu’explique un ancien chef de cellule du RCD à Sfax :
« Ce n’est pas qu’on a laissé tomber les problèmes des gens, au contraire, moi j’étais mal à l’aise dans mon quartier, car je ne pouvais pas rendre service aux gens, mais qu’est-ce que j’aurais pu faire. Le problème est profond. La fin des élections internes au sein du parti a énormément réduit son efficacité. Moi j’étais au PSD de Bourguiba et je sais comment les choses ont changé avec le RCD. Le fait que le secrétaire général de la fédération n’était plus élu par les militants locaux a fait
beaucoup de mal au parti. Quand je recevais une demande d’un jeune pour une licence, un emploi ou autre, je commençais par aller les voir, eux qui ont des connexions avec tous les responsables dans l’administration. Mais puisqu’ils n’étaient plus élus mais nommés par la direction centrale du parti, ils n’avaient aucune incitation à se bouger » .
Ces derniers n’avaient plus accès aux anciens réseaux qui faisaient fonctionner les collectivités territoriales en achetant la paix sociale, ce qui les exposait directement au mécontentement social des populations qu’ils ne pouvaient plus apaiser.
En effet, « bien que leur rôle soit de coordonner l’exécution des politiques publiques au niveau local, leur quotidien s’est résumé durant les quatre dernières années qui ont suivi la chute de Ben Ali à la gestion du mécontentement de « leur » administré » . Ces derniers se retrouvaient donc dans une situation délicate, puisqu’ils devaient essayer de composer entre les demandes pressantes de la population et la marginalisation des questions sociales au niveau local par les autorités centrales.
Ainsi, l’administration locale était complètement contrôlée par le Parti unique.
Par conséquent, les résultats des élections étaient connus d’avance, les élus étant ceux affiliés au parti, et beaucoup de citoyens se détournaient des affaires publiques à cause de la généralisation de la corruption. Par exemple, les délégués étaient chargés de la gestion et de la réception des plaintes et doléances de la population mais aussi de veiller au développement et à la mise en place de la politique du gouvernement dans leur délégation. Ils représentaient donc l’autorité locale tout en étant sous la supervision des gouverneurs. Toutefois, leur mission ne s’arrêtait pas là puisqu’ils étaient aussi appelés à garantir l’ordre en gérant les conflits sociaux et en relayant les demandes de la population au pouvoir central.
Sous le régime de Ben Ali, ils étaient nommés par le Ministère de l’Intérieur suite à un processus de sélection mené par l’administration centrale du RCD et à une recommandation des comités de coordination du parti. Les délégués étaient donc tous militants du parti et entretenaient des liens étroits avec les chefs des cellules du parti au niveau local, dans les quartiers et différents districts de la ville mais aussi avec le président de la fédération et le secrétaire général du comité de coordination du gouvernorat.
Les réformes décentralisatrices sous l’ancien régime : une déconcentration déguisée
Comme nous venons de le voir dans le chapitre précédent, le contexte général avant et après l’indépendance a favorisé la centralisation de l’État tunisien. Cela était d’autant plus facile que le pouvoir en Tunisie s’est toujours exercé de Tunis sur le reste du pays. Ce constat, conjugué à l’absence de démocratisation, ne pouvait qu’aboutir à une vision tronquée de la réforme de la décentralisation qui se traduira par un renforcement de la déconcentration et donc du pouvoir central. Ainsi, la décentralisation n’avait pas été pensée comme une réforme administrative ou politique mais avait pour objectif de permettre le redéploiement de l’État au niveau régional et local pour mieux contrôler le territoire (I) mais aussi pour mettre en place des politiques économiques plus efficaces afin de limiter les contestations sociales (II). Ce dispositif a été favorisé par la présence de certains acteurs sur place, dont ceux de la coopération internationale (III).
Une réforme qui sert de redéploiement de l’Etat central au niveau régional et local
Les pays ayant une organisation administrative très centralisée sont caractérisés par la mise en place d’un système hiérarchique dans lequel le pouvoir local n’a qu’une marge de manœuvre réduite. Ce système de dominant-dominé peut être remis en cause par la naissance de revendications locales plaidant pour la mise en place d’un système collaboratif et coopératif de type intergouvernemental comme ce fut le cas en France, où des lois ont été progressivement mises en place depuis la IIIᵉ république . En revanche, la Tunisie n’a pas connu de telles revendications et il faudra attendre le remplacement du président Bourguiba pour qu’on commence à parler de « décentralisation ».
Toutefois, cette décentralisation a pris une forme spéciale puisqu’elle n’a pas été le fruit de revendications mais d’une concession du pouvoir central au pouvoir local, ce qui explique en partie la forme déconcentrée qu’elle prendra.
En effet, la décentralisation tunisienne correspond plus à un redéploiement de l’État au niveau local qu’à une véritable réorganisation administrative et territoriale. Elle apparaît donc comme une restructuration des rapports de coordinations entre les différents échelons administratifs se traduisant par une nouvelle délégation contrôlée de pouvoir au profit de l’État central. Ce rapport de force s’illustre par le rôle que jouent les représentants de l’État au niveau local (gouverneur/ délégués), qui exercent un contrôle à priori sur toutes les décisions prises malgré l’autonomie consacrée par la Constitution de 1959, qui dispose que « les conseils municipaux et les conseils régionaux gèrent les affaires locales, dans les conditions prévues par la loi » .
En effet, les réformes administratives ne se sont pas accompagnées d’une hausse significative des recettes de ces collectivités. Or, la délégation de nouvelles compétences nécessite une augmentation des revenus des collectivités locales. Sans cela, on retombe dans un schéma de déconcentration d’autant plus que, comme le dit André Terrazzoni, donner plus de compétences aux collectivités sans leur donner plus de moyens financiers revient à accroître leur dépendance vis-à-vis du centre, sans lequel elles ne peuvent pas concrétiser leurs nouvelles prérogatives.
Cela est particulièrement vrai dans le cas tunisien puisque la majorité des recettes des collectivités proviennent des politiques de redistributions mises en œuvre par l’État central.
De plus, l’État continue à nommer le haut personnel des collectivités locales et ne s’est donc pas désengagé complètement des politiques financières des communes puisqu’il possède toujours des entrées et moyens de pressions avec son pouvoir de nomination de cadres capables d’influencer les politiques à mettre en œuvre. Ce refus de désengagement semble traduire la peur d’une remise en cause de l’État central au niveau régional et local. Pour éviter cela, le pouvoir central cherche par tous les moyens à conserver son hégémonie en n’octroyant aux collectivités que les pouvoirs et attributions qui sont nécessaires à la mise en place de la réforme. De fait, il ne délègue que des compétences ne menaçant pas le pouvoir politique national. C’est ce que prouve la réforme de 1995, qui dispose que le président du conseil des villes ayant plus de 150 000 habitants et 4 millions de dinars de recettes courantes doivent désormais être élus pour pouvoir exercer leur fonction et les conseils doivent désormais appliquer une collégialité de l’exécutif. Afin de confirmer ce gain d’autonomie, la loi organique de 1995 prévoit que le président du conseil ait quelques compétences. Pour ce faire, la loi prévoit un allègement de la tutelle de l’État. Les villes ont donc désormais une compétence urbaine : « la commune se charge d’élaborer ledit plan [d’urbanisme] conformément aux dispositions du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme » même si cette dernière reste soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle. La réforme n’offre donc pas l’autonomie aux communes mais qu’une indépendance relative. Cette mascarade est favorisée par certaines concessions du pouvoir central, comme l’autorisation aux maires de nommer les agents de catégorie A2, A3, B et autres sans autorisation préalable de l’autorité de tutelle, les agents de catégorie A1, la plus importante, étant toujours nommés par le ministère de l’Intérieur.
Les textes juridiques tunisiens consacrent donc la décentralisation à travers une autonomie relative des pouvoirs locaux et régionaux comme il est possible de le voir avec la loi organique n°89-11 qui dispose que « le gouvernorat est une circonscription territoriale administrative de l’Etat. Il est, en outre, une collectivité publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, gérée par un conseil régional et soumisse à la tutelle du ministère de l’intérieur ». L’emploi du mot tutelle dans cette loi signifie que le gouvernorat n’est en réalité pas autonome puisqu’il ne peut pas prendre de décision sans en rendre compte à l’État central.
|
Table des matières
Introduction
Partie 1 : Une réforme qui doit faire face à l’omniprésence historique de l’Etat central
Chapitre 1 : La centralisation : un mode de gouvernance privilégiée en Tunisie
Chapitre 2 : Les réformes décentralisatrices sous l’ancien régime : une déconcentration déguisée
Partie 2 : Une réforme qui doit faire face à des obstacles structurels et conjoncturels
Chapitre 1 : Une réforme en contradiction avec l’aménagement du territoire tunisien
Chapitre 2 : Une réforme qui ne correspond pas à la réalité des communes tunisiennes
Chapitre 3 : Une réforme mise en difficulté par la politisation du processus révolutionnaire
Conclusion
Bibliographie
Table des Annexes
Table des matières
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet