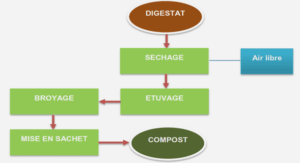Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Du bâtiment à la ville : une approche par les activités
Le second ensemble de travaux que nous avons mis au jour se trouve aux marges d’un champ de recherche relativement étendu de l’ingénierie : l’énergétique des bâtiments, qui vise à évaluer les flux énergétiques qui traversent un bâtiment en fonction de sa forme, des matériaux qui composent ses parois et des installations techniques qu’il abrite (Morel et Gnansounou, 2009). Le domaine, dont les assises théoriques sont physiques, s’est constitué autour du développement de modèles de simulation du comportement thermique et plus largement énergétique d’un bâtiment, afin d’en optimiser la conception (Ratti, Baker et Steemers, 2005, p. 762).
Face à cette entrée, des critiques émergent autour de ces modèles, au-delà des simples techniques de simulation qui y sont mises en œuvre. En effet, la question de l’intégration du bâtiment dans son environnement, en particulier urbain, est jugée insuffisamment prise en compte. Carlo Ratti et al. en font par exemple le constat (Ratti, Baker et Steemers, 2005, p. 762), puis Mindjid Maïzia (2007, p. 79). La principale critique porte sur l’absence de considérations de la morphologie urbaine environnante, qui aurait un impact important sur le fonctionnement thermique d’un bâtiment. Ainsi, il s’agit à nouveau de se concentrer sur le cadre bâti de la ville en lui-même. Toutefois, partant également du rapport du bâtiment à son environnement, quelques travaux récents s’interrogent au contraire sur ce qui se passe au sein de ce cadre, c’est-à-dire sur les activités humaines dont la ville est le lieu. À partir du constat du développement des techniques décentralisées de production d’énergie, ils conceptualisent la ville comme un lieu potentiel de production d’énergie autant que de consommation (Maïzia, 2008). Le modèle prédominant de production centralisée, qui correspond à une mutualisation totale des besoins énergétiques sur l’étendue du réseau de transport et distribution, est alors mis en question puisque des systèmes de production individuels voient le jour.
partir de ces postulats, Mindjid Maïzia soutient l’idée que la mutualisation des besoins d’énergie à des échelles plus locales peut contrer certaines contreparties négatives de l’individualisation des dispositifs de production35 tout en ne contraignant pas à un système totalement centralisé (Maïzia, 2006, 2008). Il cherche ainsi à montrer qu’entre la centralisation et l’individualisation totale, il existe de nombreuses configurations locales de mini-réseaux » qui peuvent s’avérer plus efficace en termes d’usage des ressources énergétiques (Maïzia, 2006).
La question du rapport entre les différents éléments du système urbain est donc posée, mais pas celle des activités qui se déroulent en leur sein. En d’autres termes, chaque partie du système est considéré comme étant identique à sa voisine. Dans d’autres travaux, le même auteur analyse toutefois les potentialités qui ressortent d’une variation temporelle des besoins d’énergie au travers de la mutualisation (Maïzia, 2008, p. 105) : la mutualisation de besoins énergétiques matérialisés par des courbes de charge décalées dans le temps permet de diminuer les pics de consommation et un usage plus efficace des installations de production. Dans ce cadre, l’approche est essentiellement théorique et vise simplement à montrer l’effet de la mutualisation de courbes de charge simplifiées36 décalées dans le temps.
On retrouve alors la question de l’organisation spatiale des activités urbaines en filigrane. En effet, le décalage temporel des besoins énergétiques au sein de bâtiments différents implique que des activités différentes y soient pratiquées aux mêmes instants. L’auteur évoque d’ailleurs cette potentialité dans ses conclusions (Maïzia, 2008, p. 145)37, mais ne l’introduit pas dans sa formalisation du système urbain. Au contraire, Anne-Françoise Marique et al. posent le problème en ces termes en proposant d’étendre le concept de zero-energy building, c’est-à-dire de bâtiment produisant autant d’énergie qu’il n’en consomme, à l’échelle du quartier. Elles expliquent alors que la mutualisation énergétique entre des activités diverses à cette échelle est une façon d’améliorer les possibilités de parvenir à un tel objectif (Marique, Penders et Reiter, 2013 ; Marique et Reiter, 2014). Jean-Marie Alessandrini suit un raisonnement similaire, expliquant que l’urbain, par ses caractéristiques de densité et de diversité, permet de tirer parti de mutualisations de besoins différents (Alessandrini, 2013). Il en fait le constat en s’appuyant sur des exemples d’usages de rejets de chaleur de certaines activités pour le chauffage de bâtiments résidentiels ou de bureaux, qui font par ailleurs écho aux concepts présentés dans la section précédente. On retrouve le même type de considération chez Andi van den Dobbelsteen et Sebastiaan de Wilde qui évoquent la surproduction de chaleur par rapport à leurs besoins des bâtiments de bureaux modernes qui pourrait être récupérée pour les habitations (van den Dobbelsteen et de Wilde, 2004, p. 84).
Dans une perspective cette fois-ci de quantification, une recherche réalisée dans le cadre du PREBAT38 s’intéresse à la même question (Laurent, 2006). Alors que son objectif affiché est prospectiviste quant aux systèmes énergétiques des bâtiments résidentiels, elle touche finalement aux potentiels qui pourraient être mobilisés à l’échelle d’un ilot ou d’un quartier grâce aux complémentarités des besoins de bâtiments à usages différents. Les auteurs analysent ainsi autant la pertinence de la mutualisation des productions que celle de la récupération de flux thermiques. Ils concluent de leur étude que pour que de telles complémentarités puissent être exploitées, l’aménagement du quartier doit être pensé en conséquence, les questions énergétiques devant être intégrées en amont à la réflexion.
Contrairement aux travaux présentés dans la section précédente, il est plus difficile de mettre au jour des filiations entre ceux que nous avons abordés ici. Tout au plus peut-on trouver une similarité dans les conclusions sous forme de critique de l’approche de l’efficacité énergétique à l’échelle du bâtiment qu’ils tirent de leurs recherches : la ville abrite une diversité importante d’activités dont il faut tirer parti par l’échange de flux d’énergie entre elles. Mutualisations et récupérations sont de nouveau perçues comme un vecteur d’efficacité énergétique du système urbain, conçu avant tout comme une agrégation de bâtiments auxquels sont assignées des fonctions typifiées (logements, bureaux, commerces …) et, lorsqu’une quantification est envisagée, des consommations d’énergie standardisées. On relève en outre un point commun important avec les travaux discutés dans la section précédente : les conclusions de ces travaux sont des recommandations pour l’action publique, qui sont centrées sur la planification urbaine qui devrait favoriser une mixité fonctionnelle retenue comme condition nécessaire à la mise en œuvre de ces systèmes.
Des approches diverses pour une conclusion théorique et des recommandations communes
En somme, malgré des points d’entrée différents vers la récupération et la mutualisation d’énergie, les travaux relevés au cours de notre revue de littérature ont de nombreux points communs. Tout d’abord, les résultats de leurs recherches prennent le plus souvent la forme de recommandations aux acteurs des conceptions et productions urbaines et font ainsi fortement écho aux conceptions institutionnelles qui apparaissent dans la partie précédente. Un consensus se forme en particulier autour de l’importance de la mixité fonctionnelle à différentes échelles et l’on perçoit ainsi le rôle central de l’espace dans la mise en œuvre et le fonctionnement des échanges énergétiques considérés.
Toutefois, l’urbain y est simplement considéré comme un espace dans lequel sont répartis de manière hétérogène des points de production et de consommation d’énergie plutôt que comme un espace socialement construit. Les recommandations auxquelles parviennent ces travaux ne se positionnent donc pas face à l’ampleur des transformations que les évolutions qu’ils préconisent impliquent pour les acteurs qui construisent et vivent la ville. En somme, alors que le passage du réseau au post-réseau est pensé, comme nous l’avons vu dans la première partie, en termes de relations entre la technique et les sociétés urbaines, la question des échanges énergétiques alternatifs que sont la récupération et la mutualisation locale n’apparaît dans la littérature existante que sous la forme d’une relation technique-espace.
Ainsi, les enjeux, entre autres, de coordination d’acteurs, de processus de production, de choix techniques, de politiques énergétiques ou encore de stratégies urbaines, liés au développement de ces formes de circulation d’énergie sont passés sous silence. En d’autres termes, construire des principes de planification urbaine ne dit rien de la complexité des processus qui mèneraient à leur mise en œuvre et de ce qu’ils produiraient sur le fonctionnement urbain, ce dont nous entendons précisément faire l’objet de cette thèse.
Un objet spatialisé travaillé par le triptyque société, flux, technique
Le début de ce chapitre nous a permis d’introduire l’objet empirique de notre recherche et de montrer qu’il faisait de manière grandissante partie de la vision du futur énergétique des villes que partagent les acteurs institutionnels. Nous avons alors vu que les approches académiques existantes de la mutualisation et de la récupération énergétiques adoptent une vision matérielle et technique de la ville dans laquelle ces formes d’échange énergétique sont perçues comme un vecteur d’efficacité. Leur diffusion est donc recommandée, sans pour autant que les transformations qu’elles pourraient engendrer quant au processus de production et au fonctionnement des systèmes urbains ne soient discutées. En somme, face à une promotion croissante de ces objets, il n’existe pas à ce jour d’approche de leurs effets autrement qu’en termes d’efficacité énergétique.
Dans cette dernière partie, nous montrons dans un premier temps en quoi cette restriction pose problème, en replaçant l’objet face à la dialectique « réseau » versus « post-réseau » actuellement explorée et en déduisons l’objectif de cette thèse (A). Dans un second temps, nous soutenons qu’un élargissement du regard vers les champs de l’analyse dite sociotechnique » des relations entre ville et énergie d’une part et de l’écologie industrielle d’autre part peut s’avérer fructueuse pour le saisir (B).
Un objet qui brouille les analyses de la coévolution des systèmes énergétiques et de la ville
Les discours institutionnels rapportés jusqu’ici ont, dans leur ensemble, une caractéristique bien particulière : ils se prononcent autant sur la nécessité de sources d’énergie, que sur celle de systèmes techniques spécifiques et d’une organisation de l’espace urbain. Ce sont en effet les sources d’énergie renouvelables et de récupération, décentralisées, qui sont favorisées, ce qui incite à promouvoir des systèmes techniques de récupération et de mutualisation. Dès lors, la mixité d’activités à des échelles diverses est valorisée pour permettre la circulation des flux d’énergie en fonction des complémentarités de productions et consommations. Au total, système énergétique et organisation spatiale des activités dans la ville sont conjointement mis dans la balance.
Partant, il apparaît que ces nouvelles formes de mise en lien de la ville par la circulation de flux d’énergie doivent être construites comme des objets urbains, constitués à la fois de flux d’énergie, d’une infrastructure support de la circulation de ce flux et d’activités (donc d’acteurs) humains qui produisent ou consomment de l’énergie, l’ensemble étant influencé par l’organisation spatiale des éléments qui le constituent.
Une caractéristique fondamentale de cette description est qu’elle ne diffère pas de celle que l’on peut faire des grands réseaux conventionnels, puisqu’eux-mêmes sont constitués de dispositifs techniques et de flux qui, comme l’a montré Thomas Hughes, façonnent la société autant qu’ils sont façonnés par elle (Hughes, 1993). En outre, comme le montre Susan Owens pour l’ensemble du système énergétique (Owens, 1986, 1990) et comme le rappellent plus récemment Andrew Karvonen et Simon Guy (2011), leur efficacité est fortement influencée par l’organisation spatiale de la société. Le même type de relations technique-espace-société se trouve donc au cœur de leur fonctionnement.
Pour cette raison, nous considérons a priori ces formes comme une évolution de la manière de mettre l’urbain en réseau et non nécessairement comme un affaiblissement de la forme réticulaire, distinguant ainsi notre approche de l’hypothèse du post-réseau. De là, le point de départ de cette thèse est l’interrogation qu’un tel processus mène à poser quant aux relations entre la ville (comme système social et matériel spatialisé) et le système qui l’approvisionne en énergie. En effet, nous l’avons vu dans la première partie de ce chapitre, les travaux d’histoire des sciences et des techniques montrent que les grands réseaux centralisés ont eu une importance déterminante sur la façon dont les villes modernes se sont construites (Bocquet, 2006 ; Dupuy, 1984) et sur leur fonctionnement contemporain (Le Galès et Lorrain, 2003). On associe en effet aux grands réseaux centralisés les notions d’uniformité de service, de logique de croissance et diversification de la consommation et de solidarisation du territoire (Offner et Pumain, 1996), autant de caractéristiques qui, émergeant des relations au sein du triptyque technique-espace-société, ont de multiples influences sur le fonctionnement urbain.
Ainsi, par exemple, un affaiblissement des réseaux pourrait entraîner une dégradation des mécanismes de solidarité dont le résultat pourrait se trouver « en contradiction avec des objectifs plus traditionnels de cohésion sociale » (Coutard et Rutherford, 2013, 2015). Il aurait en outre des effets sur la façon de gouverner les villes, au sein desquelles la distribution homogène des services urbains joue un rôle important pour l’assise du pouvoir des gouvernements locaux (Lorrain, 2002a, 2005) ainsi que sur le financement et les modèles d’affaire associés à ces services et à leurs infrastructures pour l’instant favorables à des acteurs historiques nationaux (Saint-André, 2008).
De ce point de vue, les systèmes de récupération et mutualisation d’énergie brouillent les analyses pouvant être menées sur la base d’une dualité réseau/post-réseau. En effet, se fondant sur une logique de relocalisation des productions et de la circulation des flux ainsi que de sobriété des consommations, ils s’appuient pourtant sur le développement de nouvelles infrastructures et connexions. Ils empruntent ainsi à l’un comme à l’autre des idéaux-types, sans être toutefois des « ensembles composites » (Jaglin, 2012) qui formeraient des connexions entre le système conventionnel et des dispositifs décentralisés.
L’objectif de cette thèse est de se confronter à cette ambiguïté. Il s’agit ainsi de comprendre les reconfigurations du rapport entre la ville, les flux d’énergie qui la traversent et la forme réseau qui émergent au travers de ces systèmes urbains. Nous visons en cela à compléter et discuter les appréhensions existantes des relations entre les territoires urbains et leurs systèmes énergétiques.
Des systèmes sociotechniques aux flux : la construction d’un objet entre deux champs de recherche
Alors que nous avons montré que les échanges énergétiques locaux considérés ici pouvaient être analysés dans des perspectives techniques, économiques, métaboliques, organisationnelles et même spatiales, il nous semble pertinent de construire une image synthétique des travaux de recherche qui peuvent contribuer à les saisir. Nous en proposons donc une revue et, surtout, nous mettons en lumière les liens épistémologiques, thématiques ou conceptuels qui les unissent, afin de montrer que notre approche s’inscrit dans un continuum de réflexions quant aux relations qui lient les sociétés humaines et leur environnement physique. Ainsi, de la sociotechnique à la socioécologie, nous nous enquérons de la manière dont sont conceptualisées les relations entre les espaces urbains, les flux qui les traversent et les systèmes techniques qui permettent leur circulation. Nous partons, dans un premier temps, des travaux, au plus près de notre constat de départ, qui analysent les transitions des services urbains dans une perspective sociotechnique pour aller vers l’écologie politique urbaine (A). Dans un second temps, nous partons de l’écologie industrielle, auparavant liée à l’écologie politique urbaine, pour aller vers des travaux récents qui proposent d’analyser des « symbioses urbaines » (B).
De l’analyse des transitions énergétiques urbaines à l’écologie politique urbaine
Les évolutions mises au jour dans le chapitre précédent s’inscrivent, et ce fût d’ailleurs notre point de départ, dans un processus sinon effectif, tout au moins désiré de transition énergétique. Nous avons montré que cette notion recouvre un ensemble aux contours flous de changements sociotechniques des systèmes énergétiques qui approvisionnent les sociétés humaines. Plus particulièrement encore, les changements discutés sont promus en milieu urbain.
L’appréhension des processus de transition énergétique à l’échelle urbaine, comme phénomène sociotechnique, fait justement l’objet de recherches récentes dont Jonathan Rutherford et Olivier Coutard font la revue (Rutherford et Coutard, 2014). Si l’on fait abstraction des travaux qui prennent la ville comme une simple cible de politiques de transition énergétique d’échelle nationale ou supérieure, on trouve alors un ensemble de recherches placées dans le champ des STS (Science and Technology Studies). Ces dernières s’appuient en cela sur des travaux aux fondements plus anciens dont l’objectif est de comprendre les relations entre les sociétés et les systèmes techniques qui permettent leur fonctionnement (Hackett et al., 2008). L’ouvrage séminal de Thomas Hughes (1993), auquel la plupart font référence, met en lumière la complexité et la multiplicité des rapports entre les sociétés et les techniques, en révélant l’importance des dynamiques sociales et individuelles dans l’émergence des systèmes électriques de trois villes d’Europe et d’Amérique du Nord. Il appelle ainsi à considérer techniques et sociétés comme un système et non comme deux ensembles distincts, et montre de cette manière l’intérêt de l’approche sociotechnique.
Dans sa lignée, de nombreux travaux s’intéressent dans cette même perspective à de grands systèmes techniques (Large Technical Systems) (Coutard, 2002a ; Coutard, Hanley et Zimmerman, 2004 ; Mayntz, 1995 ; Mayntz et Hughes, 1988), en particulier à ceux qui prennent la forme de réseaux (Offner, 1996), tels que des réseaux de transport (Mayntz et Hughes, 1988), de chaleur (Summerton, 1992), de télécommunication (Davies, 1996) ou d’eau (Chatzis, 2002). Toutefois, dans ces derniers, les villes ne font pas partie de l’équation en tant qu’objets. Si Thomas Hughes analyse bien le développement des réseaux électriques dans des villes, ces dernières ne sont que le lieu de l’analyse et leur évolution n’est pas commentée. En d’autres termes, leur nature urbaine n’est pas conceptualisée. Elle n’est qu’un élément de contexte.
Parallèlement, en France, des travaux dialoguent avec ce champ mais revendiquent une approche originale (Offner, 1996) puisque portant directement sur l’objet réseau et le confrontant à la ville (ou au territoire). Ainsi, outre les approches historiques évoquées dans le premier chapitre de cette thèse, qui montrent l’importance des réseaux techniques dans le développement des villes européennes et nord-américaines, un certain nombre de recherches visent à comprendre les interactions entre les fonctionnements des villes contemporaines et des systèmes techniques en réseau. Gabriel Dupuy s’intéresse ainsi à la théorie et à la pratique d’un « urbanisme des réseaux » (Dupuy, 1988, 1991) qui place ces systèmes au cœur de la fabrique des villes. Franck Scherrer fait une analyse territorialisée du développement du réseau d’assainissement de Lyon (Scherrer, 1992). Dominique Lorrain analyse l’importance économique des firmes produisant ces réseaux techniques urbains (Lorrain, 1995, 2005). Un groupe de recherche portant sur les relations entre réseaux et territoires est en outre fondé dans les années 1990 et présente ses résultats dans un ouvrage qui s’attache à montrer les multiples relations entre ces deux systèmes (Offner et Pumain, 1996). Cependant, on ne trouve pas dans ces recherches l’idée d’une transformation : au contraire, c’est la très grande stabilité de ces systèmes qui est mise en lumière (Dupuy, 1991 ; Offner, 1993 ; Scherrer, 1992 ; Tarr, 1984).
Ce n’est que plus récemment que l’idée d’une évolution concomitante des villes et des systèmes techniques et, plus précisément, des systèmes énergétiques, est interrogée dans des travaux qui ambitionnent de mener une analyse sociotechnique. Ainsi, partant de la question du changement climatique ou abordant directement les problématiques énergétiques, des recherches mettent une hypothèse au cœur de leurs investigations : celle de l’existence d’un rôle des villes dans les décisions et transformations attenantes aux systèmes énergétiques (Bulkeley et Betsill, 2005 ; Bulkeley, Castán Broto et Maassen, 2014 ; McLean, Bulkeley et Crang, 2015). Elles s’inscrivent en cela dans l’idée plus large que les villes pourraient participer à la formation des transitions sociotechniques (Geels, 2010b ; Hodson et Marvin, 2010 ; Rohracher et Späth, 2013). Un ensemble de travaux analyse ainsi la ville, ou l’échelon local, comme lieu de l’initiation de processus de transition énergétique par la gouvernance et la planification (Coutard et Rutherford, 2010b), les politiques publiques (Lemon, Pollitt et Steer, 2013), l’interaction entre des acteurs et institutions locaux (Hodson et Marvin, 2009 ; Mattes, Huber et Koehrsen, 2015), l’émergence d’initiatives grassroots (Blanchet, 2015), la diffusion de « niches » sociotechniques « bas-carbone » (Bulkeley, Castán Broto et Maassen, 2014) ou la mise en œuvre d’expérimentations (Bulkeley et Castán Broto, 2013).
Toutefois, des critiques sont portées face à une vision normative du changement, sur laquelle s’appuient nombre de ces travaux qui considèrent « la » transition énergétique comme une évolution directionnelle vers des systèmes moins carbonés, alors même que des processus bien différents peuvent être observés, notamment dans les contextes dits « des Suds » (Jaglin et Verdeil, 2013 ; Rutherford et Jaglin, 2015). Ainsi, comme le relèvent Jonathan Rutherford et Olivier Coutard (Rutherford et Coutard, 2014), ce ne sont pas tant les transitions énergétiques urbaines qui sont observées que le rôle des villes dans « la » transition énergétique, vue comme univoque au sein des sociétés humaines, telle qu’elle serait souhaitable.
En outre, mais sans que les deux points ne soient décorrélés, la matérialité de la ville n’est que partiellement prise en compte au sein de ces travaux : Les flux sont donc les grands absents de ces recherches, qui voient la matérialité urbaine principalement sous l’angle des dispositifs techniques. C’est d’ailleurs précisément ce qu’investiguent les travaux sur les niches (Bulkeley, Castán Broto et Maassen, 2014 ; Geels, 2010b) : dans ces conceptions, la ville est vue comme le lieu de l’émergence, de l’expérimentation ou de la diffusion de l’innovation technique, mais les évolutions métaboliques qui peuvent découler de ce changement ne sont pas abordées (Hodson et al., 2012). Dans ce cadre, les recherches de Laurence Rocher sur les politiques et stratégies de la Métropole de Lyon quant aux réseaux de chaleur font exception en reliant explicitement les questions de flux et d’infrastructures (Rocher, 2013).
Néanmoins, la notion de métabolisme utilisée ici, qui désigne un ensemble de flux de matière et d’énergie traversant un système donné (voir Encadré 2.1), n’est certainement pas un angle mort de la recherche sur les relations entre les sociétés urbaines et les « non-humains » (Broto, Allen et Rapoport, 2012). L’ouvrage dirigé par Nikolas Heynen et al. en fait la démonstration : que l’on parle d’eau, d’assainissement ou de nourriture, les auteurs s’efforcent de démontrer l’aspect fondamentalement politique du rapport entre la ville et son environnement physique, dans le but de construire une « écologie politique urbaine » (Heynen, Kaika et Swyngedouw, 2006b ; Swyngedouw, 1996). Les fondements du champ peuvent s’expliquer très simplement au travers d’un parallèle avec les STS. En effet, alors que ces dernières ambitionnent de comprendre les multiples interrelations entre la technique et le social, l’écologie politique urbaine s’attèle à révéler celles qui lient le physique (la « nature ») et le social dans la construction de la ville.
Deux courants d’analyse du changement sociomatériel en discussion : Large Technical Systems et Actor Network Theory
Comme nous l’avons montré plus haut, les champs de l’analyse sociotechnique des transitions énergétiques urbaines et l’écologie industrielle et territoriale tendent à se rapprocher par la mise au jour d’objets aux fortes similarités. Il est alors intéressant de constater que l’on retrouve cette similarité dans les grilles d’analyse mobilisées par les travaux qui se placent à leur frontière, tirées des STS. D’un côté, la filiation de travaux sur les systèmes matériels urbains en réseau fait rarement l’impasse sur les apports du champ de l’étude des Large Technical Systems (Coutard, Hanley et Zimmerman, 2004 ; Coutard et Rutherford, 2013 ; Dupuy, 1993 ; Dupuy et Tarr, 1988 ; Guy et Karvonen, 2011 ; Monstadt, 2009 ; Offner, 1996). De l’autre, une focalisation sur l’innovation ou le changement dans les systèmes techniques est associée à une adoption du cadre de l’Actor Network Theory (Abitbol, 2012 ; Debizet et al., 2016 ; Jiao et Boons, 2014 ; Vernay, 2013).
Pour autant, comme précisé plus haut, ces deux courants émanent de champs de recherche portant sur les sciences et les techniques plutôt que sur la ville. Pourquoi et comment, alors, sont-ils ou peuvent-ils être mobilisés dans l’analyse d’objets urbains ? L’objectif de cette section est précisément d’aborder cette question afin de comprendre comment ces cadres d’analyse48 peuvent nous aider dans notre investigation. Nous les discutons dans l’ordre chronologique de leur apparition, commençant donc par l’approche LTS (1) et poursuivant par l’ANT (2).
Organisation du matériau empirique
Une fois que le matériau empirique est recueilli, ou tout au moins que l’on décide d’en cesser la récolte, se pose la question de la manière dont on souhaite le donner à voir. De notre point de vue, cette interrogation se pose en termes binaires : doit-on organiser le récit des différents processus reconstitués par hypothèses de recherche ou par terrain ?
Dans cette thèse, nous avons retenu la seconde alternative, pour trois raisons. En premier lieu, nous souhaitons de cette manière éviter de devoir présenter en amont les trois études de cas dans un texte qui soit déconnecté d’une lecture par les hypothèses et entraîne un certain nombre de redites. En second lieu, nous souhaitons que les éléments propres à chaque terrain soient plus facilement repérables dans le document et ainsi plus aisément mobilisables pour qui chercherait des éléments factuels propres à l’un d’entre eux. En outre, nous considérons à la suite de Dominique Lorrain que la mise en perspective des études de cas est d’autant plus convaincante que la spécificité de chacun d’entre eux dans son ensemble a été donnée à voir (Lorrain, 2011a, p. 34‑35) : « vouloir faire une comparaison terme à terme condui[t] à écraser cette réalité. L’usage de quelques indicateurs de comparaison n’a de sens qu’une fois compris l’organisation d’ensemble de chaque ville, ce qui en fonde la singularité ». Enfin, comme nous l’avons déjà précisé, notre seconde approche se nourrit de la première, ce qui nous incite à en présenter les résultats après le récit des études de cas.
Ainsi, nous présentons les résultats empiriques en deux temps. Tout d’abord, chacune des trois études de cas fait l’objet d’un chapitre au sein duquel chaque hypothèse est mise à l’épreuve au travers de récits processuels. Cependant, nous ne nous interdisons pas le dialogue entre ces chapitres, notamment lorsque les résultats présentés dans l’un répondent sans équivoque à d’autres évoqués plus tôt. Ensuite, nous faisons une analyse croisée de ces trois études pour faire émerger des résultats plus généraux, que nous mettons finalement à l’épreuve de modèles émergents de recomposition des réseaux énergétiques urbains face au développement des synergies, confrontés également à nos hypothèses.
Un territoire en construction sous l’égide d’une entreprise internationale
Le Val d’Europe est le nom donné au secteur IV (c’est-à-dire le plus éloigné de Paris) de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, en Seine-et-Marne, découpée lors de sa création en quatre secteurs donnant naissance à quatre intercommunalités. Ce dernier est composé de six communes, regroupées à l’origine au sein d’un Syndicat d’Agglomération Nouvelle (le SAN du Val d’Europe) possédant l’ensemble des compétences propres au développement urbain local, en cours. Le territoire urbanisé y est en effet en croissance constante : lorsqu’on observe le Val d’Europe, on observe la ville en train de se faire104. Fin 2015, le SAN devient une communauté d’agglomération.
Une particularité fondamentale du développement de cette zone est l’implication de l’entreprise Euro Disney dans le processus sur une partie importante des fonciers du territoire, selon une convention signée avec l’Etat en 1987 (cf. Encadré 5.2 pour les détails de cette dernière). Le rôle d’Euro Disney n’est toutefois pas celui d’un aménageur : les acteurs locaux lui donnent le nom de « développeur ». L’aménagement du Val d’Europe est en fait mené par deux entités qui partagent locaux et salariés : l’EPAFrance aménage les fonciers sur le territoire faisant l’objet de la convention, qui recoupe en grande partie le Val d’Europe, pour le compte de l’Etat et des collectivités, tandis que l’EPAMarne exerce les mêmes fonctions pour la zone sur laquelle la convention ne s’applique pas. Le rôle de développeur d’Euro Disney consiste à racheter les fonciers aménagés à l’EPAFrance et à leur trouver des preneurs.
Le système énergétique
Contrairement au cas d’ArcelorMittal, et plus généralement des industries, les sources de chaleur fatale au sein des data centers sont bien moins diverses : elles sont nécessairement liées à la production de calories par les serveurs informatiques. Dans cette section, nous en Comme nous le verrons plus loin, cette banque ne souhaite pas que son nom soit publiquement associé à l’opération. Nous l’appellerons donc par la suite « la banque ». présentons l’origine (1) avant d’analyser la manière dont les flux récupérés sont distribués et complémentés pour convenir en nature et en temps aux besoins des usagers (2).
Si nous traitons ici de chaleur, il nous faut avant tout faire un détour par les questions qui touchent à une autre forme d’énergie : ce qui justifie la production de chaleur d’un data center, c’est d’abord sa consommation d’électricité. Cette dernière, de plus en plus médiatisée106, est due au fonctionnement des serveurs qu’il abrite mais également à l’exploitation du bâtiment (sécurité, ventilation et, surtout, comme nous le verrons, climatisation). Les opérateurs de data centers ont d’ailleurs construit un indicateur permettant de quantifier l’efficacité de l’utilisation d’électricité par leurs installations : le Power Usage Effectiveness (PUE) (Yuventi et Mehdizadeh, 2013). Ce dernier est le résultat du rapport entre la quantité totale d’électricité consommée par un data center et la quantité d’électricité consommée spécifiquement par les serveurs qu’il regroupe. Plus le PUE est proche de 1, plus le data center est jugé efficace. La valeur de cet indicateur est très importante pour les opérateurs puisque l’électricité constitue le principal coût d’exploitation d’un centre.
Parmi les plus anciens data centers, il est fréquent de trouver des valeurs de PUE dépassant, parfois largement, la valeur de 2 tandis que les valeurs récentes peuvent se rapprocher de 1,2. L’amélioration de cet indicateur provient principalement des évolutions dans la manière de climatiser les salles. La grande majorité de l’électricité consommée par les serveurs est en effet transformée en chaleur, par effet Joule. Sans traitement particulier, l’air intérieur d’une salle de serveur peut donc atteindre des températures très élevées qui perturbent le fonctionnement des machines ou les endommagent. Elles doivent donc être contrôlées et, dans la très grande majorité des cas, ce contrôle est exercé au moyen d’une production frigorifique, qui consomme de l’électricité. C’est le cas, en particulier, pour le data center de la banque considérée du Val d’Europe.
La salle informatique, c’est quand même un objet qui est très gourmand en énergie. Il faut savoir que le projet, à la base, c’est 23 MW d’électricité. C’est énorme. Ça correspond déjà à une petite ville. On a en capacité 7 MW immédiats mais on peut monter jusqu’à 9 MW de froid, de production frigorifique. Ce qui est quand même assez énorme aussi. »
Les puissances ainsi mises en jeu (23 MW d’électricité au total et 7 MW au moins de production de froid) sont si importantes qu’elles pèsent fortement sur le choix d’implantation des centres, d’autant plus que la disponibilité continue de telles puissances est un des critères fondamentaux de ce choix pour le constructeur du data center : « ça avait d’ailleurs fait partie de l’étude d’implantation des sites. Il fallait qu’on ait la capacité, via ERDF, d’avoir les puissances disponibles, sachant que ce sont des puissances dédiées » (Entretien avec le responsable des travaux de la banque, 10/12/2014). L’appellation « puissances dédiées » fait ici référence au fait que les câbles qui relient le centre aux installations de production d’électricité sont, précisément, dédiés à ce dernier : aucun autre bâtiment ou équipement ne peut y être raccordé. En outre, les puissances réservées au data center dans les installations de production et de distribution sont doublées, pour des raisons de sécurité d’approvisionnement qui correspond à une classification du centre dite « Tier Quatre »107 : « c’est-à-dire que contrairement à ce qui se passe dans les villes et partout ailleurs, où ERDF alimente un câble et on a un câble de secours, là on a deux câbles, et deux câbles qui sont alimentés en permanence. C’est-à-dire qu’on peut basculer de l’un sur l’autre sans problème et on tire d’ailleurs régulièrement sur les deux câbles » (Entretien avec le responsable des travaux de la banque, 10/12/2014).
Outre les installations de distribution d’électricité, cette particularité entraîne la nécessité d’implanter sur le territoire des installations de production supplémentaires : « on a été obligé de doubler le poste source. Ça implique des investissements qui sont lourds. Là, dans le data center, le plus cher ce n’est pas de construire le bâtiment, c’est d’amener l’électricité » (Entretien avec un chef de projets, EPAMarne-EPAFrance 23/01/2015). Pour autant, ces investissements sont pris en charge par le constructeur du data center et ne sont donc pas supportés par la collectivité.
|
Table des matières
PARTIE 1 – Le réseau, mais autrement : de la remise en cause du système de fourniture d’énergie à l’urbain à la figure de la synergie énergétique
Chapitre 1 – Du post-réseau à l’hyper-connexion : la place du réseau dans le futur énergétique des territoires urbains en question
I. Le réseau dans les transitions énergétiques urbaines : un statut ambivalent
II. Mutualisations et récupérations : des outils pour l’évolution des systèmes énergétiques urbains promus dans les discours institutionnels
III. La ville comme un objet physique : une approche purement matérielle dans la littérature académique de l’urbain
IV. Un objet spatialisé travaillé par le triptyque société, flux, technique 56 Conclusion
Chapitre 2 – Sociotechnique et socioécologie de l’urbain : comprendre le changement dans la co-construction des systèmes énergétiques et de la ville
I. Des systèmes sociotechniques aux flux : la construction d’un objet entre deux champs de recherche
II. Posture de recherche : qu’est-ce qu’une analyse sociomatérielle de l’urbain ?
Conclusion
Chapitre 3 – Efficacité, solidarité et croissance : quelles remises en cause des principes et effets de la mise en réseau de l’urbain ?
I. Du réseau centralisé aux synergies : trois hypothèses d’évolution du rapport entre villes et réseaux
II. Une approche en deux temps : des études de cas à la recherche de modèles de réorganisation
Conclusion
PARTIE 2 – Une analyse sociomatérielle de formes alternatives de mise en réseau de la ville
Chapitre 4 – Des minerais au réseau d’agglomération : la récupération de chaleur industrielle à Dunkerque
I. Un système technique hétérogène encadré par un système d’acteurs en recomposition
II. La récupération en deux étapes : de l’indépendance énergétique à l’environnement, des intérêts mouvants pour la synergie
III. Interpénétrations des systèmes techniques et équilibre métabolique du réseau
IV. Vers des échanges plus nombreux et plus diversifiés : le rôle de l’espace en question
Conclusion
Chapitre 5 – Des serveurs informatiques aux radiateurs : data center et réseaux de chaleur au Val d’Europe
I. Le Val d’Europe comme territoire en construction
II. L’exemplarité environnementale et le service public en confrontation
III. Exploiter une synergie face à une double incertitude : quand les tuyaux sont surdimensionnés
IV. Confronter et contourner les incertitudes par la concurrence spatiale des réseaux
Conclusion
Chapitre 6 – Du bâtiment à l’îlot, puis au quartier : la mutualisation énergétique à Lyon Confluence
I. Renouvellement urbain et mutualisation énergétique : une synergie dans un quartier aux enjeux complexes
II. Une synergie comme moyen et non comme but : les îlots à énergie positive en perspective
III. Quand tous les flux ne se valent pas : interdépendances thermiques et électriques à l’échelle de l’îlot et du quartier
IV. Planifier l’autoconsommation à l’échelle du quartier : la mutualisation et la gestion des flux en questions
Conclusion
PARTIE 3 – Une transformation et ses limites : des réseaux de distribution aux réseaux d’« échange »
Chapitre 7 – Les synergies changent-elles la manière de mettre l’urbain en réseau ? Mise en perspective des études de cas
I. Initiation des synergies : des intérêts stratégiques autant qu’opportunistes qui s’accumulent plus qu’ils ne convergent
II. Des systèmes instables à chaque bout des tuyaux : interdépendances de flux et d’infrastructures
III. Un rapport resserré à l’espace mais pas d’interaction directe entre planification spatiale et évolution du réseau
Conclusion
Chapitre 8 – Des modèles de systématisation des synergies en construction et en questions
I. Le modèle du réseau de chaleur « ouvert » : hybridation entre centralisation et échanges multidirectionnels
II. Le modèle du peer-to-peer de l’électricité : le réseau comme infrastructure de mutualisation décentralisée
III. Le modèle du « chauffage numérique » : repenser l’organisation des activités pour optimiser l’usage des flux
Conclusion
Conclusion générale
Bibliographie
Télécharger le rapport complet