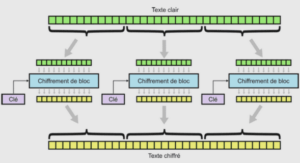Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
La consolidation progressive d’un ordre juridictionnel administratif
La création des tribunaux administratifs, avec des règles d’organisation et de fonctionnement distinctes de celles des juridictions judiciaires, et aussi avec l’existence d’un corps de magistrats administratifs peuvent directement faire croire à l’existence de la dualité juridictionnelle parfaite au Mali. Alors qu’il faut comprendre, que la juridiction administrative malienne est toujours en construction et le chantier n’est pas du tout terminé. En effet, cette dualité est parfaite à la base, mais absente au sommet. La Cour suprême constituant la juridiction suprême de l’organisation judiciaire, dispose en son sein d’une Section qui est la juridiction » administrative suprême : la Section administrative.
Cette construction progressive est illustrée par la récente création des Cour Administratives d’Appel86 ainsi que l’élargissement du nombre des tribunaux administratifs87. A terme, ce processus doit normalement aboutir à la création d’un véritable ordre juridictionnel administratif complètement dissocié de l’ordre judiciaire. Notre étude s’intéressera aussi à ce processus de consolidation du contentieux administratif malien.
Après avoir délimité le champ de notre recherche à travers son contexte, la précision de son objet nous permettra aussi, de bien la situer.
L’objet
La période concernée par l’étude ayant été précisée à travers son contexte, il convient cependant de déterminer le sens du contentieux administratif dans le même contexte (1) et d’expliquer toujours dans le cadre de celui-ci, le juge dont il s’agit (2). L’identification de notre matériau de recherche paraît également utile (3).
Le contentieux administratif malien
Nous avons déjà souligné plusieurs possibilités de définitions du contentieux administratif données par différents auteurs africains et français. Parmi ces définitions, nous avons montré notre adhésion à la définition restrictive de la matière fondée sur la résolution par le juge administratif des conflits occasionnés par l’action administrative ; autrement dit, celle qui écarte les autres moyens de résolution des conflits administratifs. Il ne s’agit pas de revenir sur ce point, mais de savoir l’acception à laquelle répond le contentieux administratif malien.
Il faut d’ores et déjà signaler, que la constitution malienne est silencieuse sur le contentieux administratif. Elle se contente tout simplement de prévoir une Section administrative au sein de la Cour suprême88 , mais ne définit pas le contentieux administratif. Elle précise cependant, qu’une loi organique fixe l’organisation, les règles de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Cour suprême. Par contre, l’existence des tribunaux administratifs n’est pas comme celle de la Cour suprême, qui est directement visée par la constitution. Celle-ci attribue le pouvoir de l’organisation de la justice au parlement, d’où la création législative des tribunaux administratifs89 en particulier et des autres juridictions en général.
Le silence de la constitution nous oblige alors à chercher la définition malienne du contentieux administratif du côté du législateur. En s’attachant ainsi à l’analyse de la loi organique régissant la Cour suprême90 et à la loi portant organisation, fonctionnement et procédure suivie devant les tribunaux administratifs, il ressort que le législateur a opté pour la définition stricte. Il le définit alors, comme la résolution par la Section administrative de la Cour suprême et les tribunaux administratifs, des litiges relatifs aux décisions des autorités administratives centrales et celles des autorités régionales et communales.
En tirant les conséquences de la définition légale, le juge administratif malien opte aussi pour cette acception restrictive de la matière. En effet, le juge administratif se déclare incompétent pour statuer sur des contestations relatives au droit de propriété91 et précise que « le litige opposant un particulier (…) à une société anonyme de droit privé échappe à sa compétence »92.
On comprend donc aisément, que le droit positif malien opte pour une définition restrictive du contentieux administratif et nous confirmons que c’est cette approche que nous retenons pour notre étude. Nous qualifions l’acception malienne de stricte, car la solution intermédiaire est possible, c’est- à-dire la définition peut être ni large, ni stricte. Par exemple, en tenant compte des pays où il existe l’unité absolue de juridiction, mais avec spécialité de contentieux, il existe un droit spécial que le juge judiciaire applique aux litiges administratifs : le droit administratif. Le contentieux administratif de ces pays correspond-il à la définition stricte ? Ou encore à la définition large ? Le problème se présente ainsi : l’application du droit administratif par le juge judiciaire fait qu’il échappe à la définition restrictive. L’existence d’un droit spécial qui est appliqué aux seuls litiges administratifs fait qu’il échappe à la définition large. Ce qui fait que le contentieux administratif de ces pays doit obéir à une définition intermédiaire. Ainsi, il peut être défini comme la solution juridictionnelle des litiges administratifs en application du droit administratif.
Après ces quelques points en appui à la conception malienne, il faut savoir aussi que le contentieux administratif n’est pas formé d’un ensemble monolithique. Il a fait l’objet de différentes classifications sous la plume de grands professeurs de droit. On ne reviendra pas sur ces classifications, mais il s’agit pour nous de déterminer la classification à laquelle le droit positif adhère, ce qui nous servira pour la suite de l’étude.
Les juridictions administratives de base : juge de droit commun
Longtemps juge de droit commun du contentieux administratif, la Section administrative de la Cour suprême n’a désormais qu’une compétence d’attribution en la matière. Cela ne constitue que la résultante normale du remodelage de la structure de la juridiction administrative amorcé depuis 1988 et qui s’est achevé par la mise en service des tribunaux administratifs en 1995. Maintenant, les T.A constituent les juridictions administratives de droit commun et cette compétence est d’ordre publique, le juge doit statuer et les parties ne peuvent y déroger »570. Ils sont ainsi juges de droit commun en premier ressort sous réserve d’appel devant la Section administrative en attendant que les C.A.A soient fonctionnelles.
La loi sénégalaise du 2 février 1984, fixant l’organisation judiciaire fait du tribunal régional une juridiction de droit commun. Même si « cette compétence de droit commun (…) constitue la clé de voûte du système sénégalais d’unité de juridiction »571, elle n’est poutant pas exclusive et connaît des limites au profit de la Cour suprême. Ce qui signifie que des difficultés de compétence ne sont pas aussi exclues entre ces juridictions de l’Administration sénégalaise. Cela est attesté par les arrêts Cheikh Tidiane KANE572 et Yatma SARR c/ l’Etat du Sénégal573.
Contrairement à ce que développe le professeur Gustave PEISER à propos des T.A en France, la principale difficulté ici, ne réside pas dans la délimitation de la compétence territoriale de chaque tribunal administratif574, mais plutôt dans la limite matérielle des compétences entre les tribunaux administratifs et la Section administrative. C’est ce qui motive notre intérêt pour l’étude de la part de compétence des T.A en premier ressort. Celle-ci se résume aux litiges relatifs aux collectivités territoriales (1) et aux actes des autorités régionales et subrégionales (2).
L’inexistence de cadre de communication directe entre le juge administratif suprême et le juge administratif de droit commun
La première question qui peut tout de suite venir à l’esprit face à de telles situations est de savoir ce que le législateur dit en la matière. La réponse peut être très courte, mais significative et pleine de sens. On peut tout simplement répondre par « rien ». En effet, le législateur semble oublier que « la relation des juridictions est davantage de l’ordre de la reproduction que celle du dialogue de position par la nature relative de recherche d’une vérité juridique »591.
Les T.A étant soumis à la jurisprudence de la S.A, ils doivent être à même d’accéder à la philosophie, à la vision intellectuelle et sociale de cette haute juridiction par rapport aux différentes questions de droit administratif malien ou tout du moins les questions nouvelles. Cela facilite la tâche des différentes juridictions administratives subordonnées car en cas de contrariété entre leurs jugements et la jurisprudence de la S.A, elles les verront annulés par celle-ci. Les conseillers de la S.A sont ou doivent être expérimentés. Cela constitue une exigence légale qui impose que « les membres de la Cour suprême, magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif sont nommés parmi les magistrats de grade exceptionnel »592 et en cas d’insuffisance de ceux qui remplissent cette condition, « ils sont complétés par ceux du premier grade »593. Il s’agit alors d’une accumulation d’expérience de quinze ans de service ou tout au moins de dix. Cette expérience capitale détenue par les hauts magistrats doit pouvoir être partagée et ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans un souci de cohérence entre les décisions des juridictions administratives de base et entre celles-ci et celles de la haute juridiction administrative.
Cette communication tant souhaitée entre la haute juridiction administrative et les juridictions subordonnées, peut se manifester sous diverses formes. A défaut de pouvoir se rencontrer physiquement et d’échanger sur des questions majeures de droit administratif, les juridictions administratives inférieures doivent être périodiquement informées de l’activité jurisprudentielle de la haute juridiction. Tel n’est malheureusement pas le cas. Un autre point mérite d’être ajouté aux précédents. Il s’agit de la possibilité pour les T.A d’entrer directement en contact avec la Section administrative par la procédure de la demande d’avis. En d’autres termes, les T.A peuvent-il, en cas de difficultés, saisir la Section administrative d’un dossier pour avis ? Si cela était possible, on ne pourrait évoquer l’inexistence de cadre de communication. La réponse à cette interrogation est alors négative. Les T.A n’ont aucune possibilité de demander l’avis de la Cour suprême pour pouvoir bien trancher une affaire pendante présentant des difficultés sérieuses. À ce niveau, il est en effet un peu étonnant de voir des juges, et même des jeunes juges avec peu d’expérience, voire sans expérience de fond « abandonnés » pour faire face seuls à des litiges administratifs en tous genres.
La particularité de l’ordre juridictionnel administratif fait que les T.A et les C.A.A doivent être très proches de la Section administrative. C’est ce qui a été bien compris dans le système français. On peut résumer en deux les cadres de communication qui existent entre les juridictions administratives subordonnées et la juridiction administrative suprême en France : Primo, c’est la haute juridiction administrative qui va périodiquement à la rencontre des juridictions subordonnées. Selon le professeur René CHAPUS, « pratiquement, chaque année, un conseiller d’État et deux maîtres des requêtes accomplissent une tournée au Cours de laquelle ils s’entretiennent avec les présidents et membres des juridictions (…) et procèdent avec eux à tous échanges de vue et d’information utiles »594. Lorsque c’est la haute juridiction qui va vers les autres, pour travailler, discuter et échanger, le droit administratif en sort consolidé sur la base d’une jurisprudence cohérente. Cette pratique facilite beaucoup plus la communication entre le sommet et la base. Elle donne l’occasion en or aux juridictions subordonnées de poser toutes les questions utiles aux membres de la juridiction supérieure.
Ce cadre de communication fait que les juridictions administratives subordonnées au C.E français lui sont très proches. C’est pourquoi il a été souligné que « d’une façon générale, les diverses juridictions administratives sont beaucoup plus proches du C.E que les tribunaux judiciaires le sont de la Cour de cassation et, par la suite, l’ordre juridictionnel administratif est nettement plus uni que l’ordre judiciaire. (…), l’ordre administratif a une structure circulaire ou concentrique ; on pourrait dire qu’il est un système solaire ; et c’est autour du Conseil d’État qu’il est organisé »595. La principale conséquence est que « la jurisprudence administrative se confond avec celle du Conseil d’État et c’est sans doute un bien, du point de vue de la sécurité des justiciables » 596, d’où le constat de l’unité de la jurisprudence.
Secundo, les T.A et les C.A.A ont un accès direct au Conseil d’État. En effet, ceux-ci peuvent demander au Conseil d’État son avis sur un litige avant qu’ils ne se prononcent là-dessus. Cette procédure ne constitue que l’application du code de justice administrative français qui dispose qu’« avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la Cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’État, qu’examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’État ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai »597. Cette procédure permet aux juridictions subordonnées non seulement de prévenir les possibles annulations des jugements ou arrêts par le Conseil d’État, mais aussi de renforcer leur capacité à mieux faire face à des questions identiques qui leur seront posées dans le futur.
L’absence de communication entre les juridictions subordonnées et la juridiction administrative suprême met les premières dans une position isolée. Elle est source d’incohérence de décisions et donc d’annulations fréquentes des jugements des T.A. Chaque T.A peut être amené à appliquer le droit administratif à sa façon. Les membres de la S.A ne rencontrent que très rarement, sinon ne rencontrent même pas les magistrats des tribunaux administratifs. Cela concerne même le T.A de Bamako qui se trouve dans la même ville que la Cour suprême. Jusqu’en 2013, avec la construction du nouveau siège du T.A de Bamako, il y avait à peine cinq cent mètres qui séparaient le T.A de la Cour suprême. Malgré cette proximité, ces juges ne se voyaient pas dans le cadre du droit administratif. Si tel est le cas du T.A de Bamako, que dire alors de ceux de Kayes et de Mopti qui sont chacune à plus de cinq cent kilomètres de distance de Bamako.
C’est ce qui fait que l’on peut constater parfois une mauvaise connaissance de la jurisprudence de la haute juridiction administrative par les juridictions subordonnées.
La connaissance limitée de la jurisprudence du juge administratif suprême par le juge administratif de droit commun
Si les deux juges, à savoir la Section administrative de la Cour suprême et les tribunaux administratifs, se rencontrent très peu, il n’est pas étonnant que ce qui doit normalement être connu du bout des doigts ne le soit pas. Et qu’est-ce qui doit être connu et par qui ?
Il s’agit de la jurisprudence de la Section administrative. Cette jurisprudence doit constituer un outil de travail incontournable et indispensable des juges administratifs de droit commun. Mais, il faut le dire tout en le déplorant, les T.A ont une connaissance très limitée des arrêts de la haute juridiction administrative.
Peut-on attribuer le problème au législateur parce que les textes régissant les juridictions administratives sont silencieux par rapport au sujet, donc aux lacunes des lois ? Cela serait trop facile même si l’on sait que le législateur est effectivement le premier responsable de ce qui peut être qualifié de sérieuse insuffisance dans l’organisation interne de l’ordre juridictionnel administratif national. Nous rappelons que nous sommes en droit administratif et il n’est pas très aisé de comprendre que le juge administratif suprême se cache derrière l’inaction du législateur pour ne pas agir dans le sens d’une bonne administration de la justice administrative. Cette tâche lui incombe et à lui seul dans de telles situations.
Notre position mérite une précision. En effet, nous ne soutenons pas l’impossible. En d’autres mots, nous ne voulons pas que le juge administratif suprême se substitue au législateur en ordonnant par exemple au juge de droit commun de lui saisir pour avis en cas de difficulté sérieuse pour résoudre un litige comme cela se fait en France. Cela serait trop demander. Ce que nous voulons souligner, c’est que certains petits gestes de bonne volonté peuvent considérablement atténuer les effets du problème. Il peut consister, pour la Section administrative, à envoyer mensuellement ou bimensuellement des copies des arrêts rendus aux tribunaux administratifs. Le fait que la Section administrative ne le fait pas peut être mis tout simplement au compte d’un manque de volonté, car il suffit de le demander et le greffe et la reprographie vont faire le reste du travail. En analysant cet aspect, on peut même penser à une sous-estimation du problème par la Section administrative ou peut-être même qu’elle ne le considère pas comme un problème. La Section pourrait également envoyer quelques conseillers rencontrer les juges des T.A ne serait-ce qu’une fois par an.
Malgré les suppositions, la Cour suprême connaît et comprend que la connaissance des arrêts de la haute juridiction administrative constitue une impérieuse nécessité pour les juges de base pour une cohérence de vue face aux litiges administratifs. C’est pourquoi, elle avait entrepris un moment la collecte annuelle de ses arrêts pour en faire des recueils. Ce travail salutaire a été d’une courte durée. Les juges administratifs de droit commun se servent de ces quelques recueils aujourd’hui pour rédiger leurs rapports.
Peut-on alors reprocher à notre juge administratif de droit commun de mieux connaître la jurisprudence du C.E français que celle de la Section administrative de la C.S ? Cette question est de nature embarrassante et peut nous conduire à une autre étude prévue dans un autre chapitre. Les juges de droit commun ont un accès plus facile à la jurisprudence du C.E à travers la doctrine et à travers l’Internet. Le C.E fait un effort de publications actualisée de ses arrêts et fait en sorte que cette publication soit diffusée au maximum. Dans un souci d’endogénéisation de la matière (droit administratif), il est préférable que la jurisprudence de la Cour suprême soit privilégiée.
Si le conseiller d’État français, M. Michel LÉVY écrit que « la première qualité du juge subordonné est de savoir lire dans et entre les lignes de la jurisprudence du juge régulateur »598 ; encore, faut-il que le juge subordonné ait accès à cette jurisprudence. En effet, le juge subordonné n’est pas en liberté totale, sa marge de manœuvre est très restreinte surtout lorsque la Section administrative a déjà pris une décision dans la matière. C’est la raison pour laquelle on dit qu’« il y a dans le droit administratif français (comme le droit administratif malien) un aspect quasi initiatique ; sans doute en cas de question non jugée, les juges subordonnés retrouvent-ils une liberté provisoire, mais elle est de courte durée, en tout état de cause »599.
Cependant, il faut reconnaître un point, c’est vrai que le juge de droit commun a une connaissance limitée des arrêts de la Section administrative, mais cela n’est pas à lui seul suffisant pour expliquer certains manquements aux règles de répartition des compétences. En effet, si le juge de droit commun n’a pas un accès facile et direct à la jurisprudence de la C.S, il a sur son bureau les lois définissant les compétences de toutes les juridictions formant l’ordre juridictionnel administratif. Ainsi, il connaît les litiges qui relèvent de sa compétence et ceux qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative suprême ou d’une juridiction administrative spécialisée. Cela constitue un autre problème, car le juge de droit commun semble faire exprès pour violer les règles légales qui répartissent les compétences entre les juridictions administratives et particulièrement celles qui partagent les compétences entre les T.A et la S.A.
L’inobservation ostensible des règles de répartition des compétences par le juge administratif de droit commun
Cette inobservation se caractérise principalement par de nombreuses violations par les T.A des règles de répartition des compétences concernant les litiges mettant en cause les autorités administratives centrales (a), mais ces violations doivent être comprises de manière modérée, car il arrive que les tribunaux administratifs respectent lesdites règles (b).
La violation des règles de compétence relatives aux autorités administratives centrales
Titre de rappel, la disposition législative est vraiment précise et ne devrait normalement pas poser de problèmes sur la question suivante : quel est le juge administratif compétent pour connaître les litiges relatifs aux actes administratifs des autorités administratives centrales ? La réponse est simple, c’est « la Section administrative qui est compétente pour connaître (le contentieux) des décrets, arrêtés ministériels ou interministériels »600 donc du contentieux concernant les autorités administratives centrales ou nationales. Ce qui peut sembler impossible à première vue, ne l’est pourtant pas ici. Malgré la réponse du législateur, les T.A ont, à de multiples fois, fait une interprétation erronée de la disposition législative attribuant tout le contentieux des autorités administratives centrales au juge administratif suprême. Nous parlons de tribunaux administratifs en général, mais cela mérite une précision de taille. Il faut comprendre que c’est surtout le tribunal administratif de Bamako qui constitue l’épicentre de ce problème. Cela est dû à sa proximité avec les autorités administratives centrales qui sont pratiquement toutes domiciliées dans la capitale ainsi que la méconnaissance des textes régissant les juridictions administratives par les justiciables.
Ainsi, le T.A de Bamako a, par deux jugements de 2004, reconnu sa compétence à statuer sur un litige concernant la Direction nationale des domaines et du cadastre. Dans le premier jugement, il a ordonné le sursis à exécution d’un acte administratif pris par cette autorité administrative centrale601 et l’a annulé602 dans le second en ces termes : « En la forme : reçoit le recours du sieur Nadio dit Moussa DJIGUIBA comme régulier ; au fond : annule l’acte administratif (…) pour excès de pouvoir ».
Dans le jugement Abdouramane GAKOU, le T.A.B s’est déclaré compétent pour l’examen des décisions n° 551 et n° 544 du 22 mai 2002 et 23 mai 2003 du Directeur national de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dans cette affaire, le juge de droit commun a reçu le recours du requérant comme régulier et le rejette comme mal fondé603.
Dans un jugement du 24 mai 2005, le T.A.B « reçoit la requête du sieur Sékouba SAMAKE comme régulière et la déclare mal fondée et la rejette et dit que l’acte de cession n° 0758 de la Direction nationale des domaines et du cadastre est régulier et produira ses pleins et entiers effets »604. Qu’il la déclare mal fondée ou pas, le juge de droit commun, quel qu’en soit l’interprétation de la réglementation sur le partage des compétences à l’intérieur de l’ordre administratif en vigueur, ne devait pas pouvoir connaître de l’acte d’une autorité administrative centrale.
Par un jugement du 27 août 2003605, le juge de droit commun n’hésite pas à statuer sur un litige opposant un administré au Ministère de la défense et des anciens combattants en matière de contentieux de pleine juridiction. Dans ce cas d’espèce, le juge d’instance a condamné le Ministère à verser une somme importante au requérant au titre de dommages et intérêts. En le faisant, ignorait-il que le Ministre de la défense était une autorité administrative centrale dont le contentieux relevait d’une autre juridiction administrative. Ces jugements démontrent à suffisance le degré élevé du non-respect des dispositions législatives qui encadrent la matière. Aussi, le juge administratif de droit commun n’agit-il pas en violation flagrante de la loi qui régit ses compétences. Est-il nécessaire de rappeler que les T.A constituent les juges des autorités régionales, subrégionales et locales606 ?
Comme peuvent le penser certains juges de droit commun, le texte ci-dessus évoqué n’est point sujet à confusion. De ce fait, il ne peut donner lieu à aucune interprétation permettant aux T.A de s’arroger d’une partie très importante de la compétence de la Section administrative. Si cela concernait un ou deux jugements, la pratique pouvait être considérée comme isolée, mais avec plusieurs jugements, elle ne peut être comprise ainsi. Par ces nombreux jugements, on a l’impression que le juge de droit commun manifeste clairement son intention d’extirper le contentieux des autorités centrales de la compétence du juge administratif suprême.
Ladite violation des règles de répartition des compétences n’est pas absolue
Notre réflexion consiste à démontrer dans cette partie que même si les règles de répartition des compétences ont été à plusieurs fois transgressées, cette violation est en constante régression. Le même juge administratif de droit commun qui reconnaît sa compétence à statuer sur le contentieux relatif aux actes administratifs des autorités administratives centrales, reconnaît celle du juge administratif suprême pour le faire. Il faut signaler que les textes sur la base desquels les T.A ont souvent statué sur des matières relevant de la compétence de la S.A existent toujours et n’ont pas connu de modification substantielle.
Le juge administratif de droit commun donne une illustration parfaite dans l’affaire les héritiers de feu Lahaou TOURÉ de cette reconnaissance de la sphère de compétence du juge administratif suprême en ce qui concerne le contentieux des autorités administratives centrales. Le juge de l’espèce s’est déclaré incompétent en la forme en de termes clairs selon les motifs suivants : « considérant qu’aux termes de l’article 8 de la loi n° 94-006 du 18 mars 1994 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs, le tribunal administratif connaît des recours en annulation pour excès de pouvoir rédigés contre les décisions des autorités administratives régionales ou locales ; considérant qu’en l’espèce, le recours formé par les héritiers de feu Lahaou TOURÉ est rédigé contre des décisions du Directeur national des domaines et du cadastre qui est une autorité centrale ; que de toute évidence, le contentieux de tels actes administratifs ne relève point de la compétence du tribunal administratif »608.
Le juge se déclare non seulement incompétent, mais aussi il le fait vigoureusement et avec des mots très précis : « ce contentieux (…) ne relève point de la compétence du tribunal administratif ».
Bien avant ce jugement, il s’était déjà « déclaré incompétent »609 à statuer sur une requête aux fins d’annulation introduite contre une vente administrative effectuée par une autorité nationale compétente.
L’annulation des jugements violant les règles de répartition des compétences et le règlement des juges
En plus du caractère d’ordre public des règles de compétence à l’intérieur de l’ordre juridictionnel administratif, le juge administratif suprême se base aussi sur les textes qui définissent les compétences de chaque niveau de juridiction pour réguler l’ordre juridictionnel administratif. Il a ainsi fait de l’annulation des jugements méconnaissant ces textes, un mécanisme de règlement des conflits de compétence.
Le législateur a été très avare sur la question de la résolution des conflits de compétence à l’intérieur de la juridiction administrative. En effet, il n’y consacre qu’un seul alinéa d’un article de la loi régissant la Cour suprême relatif à la compétence de la Section administrative642. Selon cet article, « la Section administrative est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des requêtes en règlement de juges dans les contentieux administratifs »643 . Le législateur ne définit pas le règlement de juges, mais, il peut être entendu comme « une procédure par laquelle le juge suprême de l’ordre des juridictions administratives résout les contrariétés de décisions à l’intérieur de la juridiction administrative afin d’éviter les dénis de justice »644.
Le juge administratif suprême quant à lui applique cette disposition selon la définition doctrinale ci-dessus soulignée, d’où l’existence d’une jurisprudence assez instructive en la matière.
Tout d’abord, il y a la jurisprudence Ladji KEÏTA et Djibril DIALLO d’août 2012645. Dans cet arrêt, les appelants demandaient à la haute juridiction administrative d’annuler le jugement n° 529 du 08 décembre 2011 du T.A.B pour incompétence. Mais, le juge dit : « considérant que l’incompétence est un moyen d’ordre public à soulever d’office par la juridiction saisie, en la forme la Cour se déclare incompétente »646. La haute juridiction ne s’est pas déclarée incompétente pour statuer sur le jugement du T.A.B, mais sur le contentieux relatif à un titre foncier et ce, en se conformant à l’article 42 de la loi n° 2012-001 du 10 janvier 2012 écartant toute compétence des juridictions administratives à connaître ce contentieux. Par cette décision, le juge suprême a laissé subsister le jugement du T.A qui a annulé l’acte administratif de vente n° 98-417 du 20 juillet 1998 et a, par la même décision, déclaré la juridiction administrative incompétente à connaître ce genre de contentieux. Il existe alors contrariété de décision entre le jugement du T.A reconnaissant la compétence de la juridiction administrative à statuer sur ledit contentieux et l’arrêt de la Section administrative affirmant le contraire, d’où le déni de justice, car au fond, le jugement continuera à produire ses effets.
Ensuite, il y a l’arrêt Djibril DIALLO de mai 2013647 . Cet arrêt est la suite de l’arrêt Ladji KEÏTA et Djibril DIALLO d’août 2012. Dans cet arrêt, le sieur Djibril DIALLO demande à la Section administrative l’interprétation de l’arrêt n° 336 du 30 août 2012. Selon le requérant, cet arrêt est diversement interprété par les parties en présence, les unes estimant qu’il ne fait que renvoyer la cause au juge judiciaire, les autres allant jusqu’à vouloir faire exécuter le jugement n° 529 du 08 décembre 2011 du T.A.B, estimant à tort, qu’en raison de la décision d’incompétence de la Cour, celui-ci était devenu définitif et créateur de droit pour elles »648.
Le juge va alors statuer sur la requête du sieur Djibril DIALLO dans les termes suivants : que saisie en appel, la haute juridiction ne saurait dans le dispositif de l’arrêt entrepris, se déclarer incompétente sans statuer sur la saisine ; considérant que l’adversaire du demandeur se prévaut du dispositif du jugement d’instance qui lui est favorable, son annulation s’impose logiquement dans la mesure où les T.A ne sont plus compétents en la matière ;
considérant que la Cour, en se déclarant incompétente, sans statuer sur le jugement déféré en appel va créer une situation qui va troubler l’ordre des compétences, le juge civil auquel la loi n° 2012….(donne cette compétence) n’a pas compétence pour annuler un jugement d’un T.A ;
que la Cour de céans ne saurait statuer sur sa compétence sur le fondement de la nouvelle loi sans apprécier la recevabilité de la requête en la forme, or, l’appel contre un jugement d’instance est de la compétence de la Cour de céans comme stipulé à l’article 41 de la loi n° 96-071 ;
qu’en se déclarant incompétent sans statuer sur le jugement n° 529 déféré en appel devant elle, la Cour commet un déni de justice ;en la forme reçoit le recours, au fond interprète l’arrêt n° 336 du 30 août 2012 en ces termes : … par conséquence le jugement n° 529 du 08 décembre 2011 du T.A.B est et demeure anéanti »649.
Enfin, il y a l’arrêt Marie Bernard SANGARÉ650. Les faits sont les mêmes que dans l’arrêt Djibril SANGARÉ. Ainsi, « en se déclarant incompétente sans statuer sur le jugement n° 133 du 04 avril 2009 du T.A.B déféré en appel devant elle, la Cour commet un déni de justice »651. La haute juridiction administrative « en la forme reçoit le recours en interprétation comme régulier ; au fond interprète l’arrêt n° 265 du 19 juillet 2012 en ces termes : … par conséquent, le jugement n° 133 du 04 avril 2009 du T.A.B est annulé »652.
En s’alignant sur l’analyse du juge dans les trois arrêts ci-dessus, lorsqu’il y a contrariété dans l’ordre juridictionnel administratif, c’est le juge administratif suprême qui prend ses responsabilités en corrigeant le déni de justice. C’est un mécanisme efficace dans le règlement des conflits de compétence interne. Cette méthode de règlement de juge ne peut que renforcer la cohésion et l’unité jurisprudentielle de l’ordre juridictionnel administratif.
En se fondant sur l’annulation des jugements qui ne respectent pas la répartition des compétences et la procédure de règlement de juges cumulée au principe du caractère d’ordre public des questions de compétence dont le juge administratif suprême se sert, on peut affirmer, que même si le mécanisme de règlement des conflits internes de compétence n’est pas d’une grande sophistication, il permet tout de même de faire face aux quelques problèmes de conflits de compétence dans la juridiction administrative.
Les différents sujets traiés ci-dessus permettent de comprendre les manifestations de l’ambiguité de notre système d’organisation juridictionnelle. Cependant, cette situation a logiquement des conséquences sur la production du droit administratif qui se fait au sein de notre ordre juridictionnel inachévé ». On peut de prime à bord comprendre que lesdites conséquences ne peuvent être favorables. Le deuxième titre y sera consacré.
|
Table des matières
Introduction
PREMIÈRE PARTIE : L’INCONSISTANCE DE L’APPAREIL JURIDICTIONNEL ADMINISTRATIF
Titre I : Un ordre juridictionnel inachevé
Chapitre I : Une inexistence de juridiction suprême autonome
Chapitre II : Une difficile détermination de la compétence de la juridiction administrative Conclusion du Titre I
Titre II : Un appareil juridictionnel contraignant pour l’enracinement d’un droit administratif
Chapitre I : Les contraintes d’ordre structurel
Chapitre II : Les contraintes d’ordre fonctionnel
Conclusion du Titre II Conclusion de la première partie
DEUXIÈME PARTIE : LES INCERTITUDES DU PROCÈS ADMINISTRATIF
Titre I : Les incertitudes du contentieux de l’excès de pouvoir
Chapitre I : Une restriction dans la mise en œuvre des règles de procédure
Chapitre II : Une rigueur variable dans l’analyse des moyens d’annulation
Titre II : Les incertitudes du contentieux de pleine juridiction
Chapitre I : L’accessible définition des contours du plein contentieux
Chapitre II : Les insuffisances du traitement de la responsabilité administrative
Conclusion du Titre II
Conclusion de la deuxième partie Conclusion générale
Télécharger le rapport complet