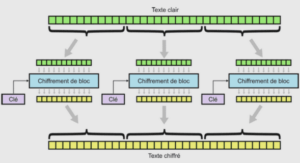Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Classification et nomenclature
Classification ou taxonomie
Issu de l’ordre des Ebénales, le karité appartient plus précisément à la famille des Sapotacées.
PHYLUM : Angiospermes
CLASSE : Magnoliopsida
ORDRE : Ébénales
FAMILLE : Sapotaceae
TRIBU : Mimusopeae
GENRE : Vitellaria
ESPÈCE : VitellariaparadoxaC.F. GAERTNER
SOUS ESPÈCES : ssp. paradoxaetssp. Nilotica
Nomenclature
L’espèce Vitellaria paradoxa est scindée en deux sous-espèces [16] :
– Vitellaria paradoxa subsp.paradoxa, présente, en Afrique occidentale et centrale.
– Vitellaria paradoxa subsp.nilotica, retrouvée, en Afrique de l’Est.
La seconde se distingue de la première par sa plus forte pilosité et ses fleurs plus grandes.
Le karité a plusieurs noms vernaculaires parmi lesquels on trouve : en français «arbre à beurre » ; en anglais « shea butter tree», « sheatree» « bambouk butter tree », « galam butter tree » [16]; en dialecte sénégalais à travers le wolof « ghariti» [17]; en dialecte malien « si yiri» ou « Si » [17]; en dialecte ghanéen « ngu», « tokuti» [17]; en dialecte béninois « sombu», « bulanga», « kareegi», « emin» [17]; endialecte nigérian « tosso», « tubbi» [17]; en dialecte camerounais «oumkouroum», « sap», « kekombichop», « kol», « Karehi», « sougoum», «kadanya», « kelé», « soro», « kire» [17] et en dialectes autochtones «shétoulou» [18 « bhindi», « bindi», « bamia» [8]. II.2.Description de l’arbre [10,19, 20, 21, 22]
Le karité est un arbre trapu de 10 à 15 mètres de hauteur, atteignant rarement 25mètres, à cime puissamment branchue, ramifié, au feuillage sombre et épais en saison de pluies et généralement défeuillé en saison sèche. Son fût est court, de 1 à 2,50 mètres, et a un diamètre qui peut dépasser le mètre.
L’écorce du jeune arbre est gris claire, presque lisse. En revanche, chez l’arbre adulte, elle est gris foncée, particulièrement épaisse, liégeuse, profondément crevassée. Ces crevasses, de 1,5 à 2 centimètres de profondeur, orientées horizontalement et verticalement en plaques rectangulaires, donnent un aspect de peau de crocodile au tronc ; l’écorce protège l’arbre contre les feux de brousse.
Les branches
Les branches, rougeâtres et pubescentes à l’origine, deviennent glabres et recouvertes d’une écorce grise épaisse et résistante. Un latex blanc s’écoule à la moindre blessure [23].
Les branches en fleur sont trapues et conservent les cicatrices foliaires [24].
Les feuilles
Le karité est un arbre caducifolié. Il perd ses feuilles au début de la saison sèche [26].
Ces feuilles sont de couleur vert-sombre, grande et coriace. Elles sont simples, disposées en spirale et groupées surtout à l’extrémité des branches. Elles ont des petites stipules (3-5 mm de long) caduques [27].
Le pétiole peut être glabre ou pubescent. Il mesure 3 à 10cm de long [27].
Le limbe est de forme lancéolée à ovale-oblongue et mesure 10 à 25cm de long pour 4 à 14cm de large. Il a des sommets arrondis à aigus et des bords entiers à ondulés. Sa base est cunéiforme à arrondie [27].
La nervation est pennée avec vingt à quarante paires de nervures secondaires parallèles, qui partent un peu obliquement de la nervure principale [28].
Les fleurs
Les fleurs apparaissent, en saison sèche, immédiatement après la chute des feuilles et la floraison peut s’étaler sur 4 à 8 semaines. L’inflorescence est une ombelle, dense de 20 à 40 fleurs, disposées à l’extrémité des rameaux. Ces fleurs sont blanchâtres, très odorantes, mellifères et hermaphrodites (à la fois mâle et femelle). Elles sont longuement pédicellées (jusqu’à 30mm de long) et à calice pubescent et ferrugineux [34].
La structure florale est complexe : 4 sépales externes roux, pubescents et atteignant 1cm de long ; 4 sépales internes pâles et pubescents ; 8 pétales, aussi longs que les sépales, lancéolés, à bords ondulés ; 8 étamines superposées aux pétales ; 8 staminodes semblables à des petits pétales à sommet en pointe; le petit ovaire pubescent, surmonté d’un style filiforme nettement plus long que les sépales, est divisé en plusieurs lobes uniovulés. [30].
Les fruits
L’arbre de karité peut vivre jusqu’à 3 siècles. Les premiers fruits apparaissent au bout de 15 ans mais l’arbre n’atteindra sa pleine production qu’à partir de 25ans; raisons pour lesquelles, le karité n’a encore jamais fait l’objet d’une culture organisée. La production moyenne est de 15 à 20 kg de fruits frais par arbre [32].
Le karité présente ses fruits sous forme de grappes. Le fruitest une baie qui peut être ovoïde, globuleuse, oblongue à ellipsoïde. Cette baie est initialement verte puis évolue vers le vert-jaunâtre et le brun à maturité [33,34].
La taille moyenne du fruit est de 3 à 5 cm alors que son poids moyen se situe entre 20 à 22g [35].Elle contient généralement, une à deux noix, noyées dans une pulpe charnue, sucrée et comestible [11,24].
Les noix et les amandes
Les noix ont une forme globuleuse ou largement ellipsoïde. Ils mesurent 2,5 à 4,5 cm de long et pèsent, en moyenne 10g. Le tégument de chaque noix est fin, luisant et marqué d’une large cicatrice : il s’agit d’un hile beige clair et mat [24].
La noix renferme une amande dure et blanchâtre. Cette amande est constituée d’une part de deux cotylédons épais, charnus et fortement apprimés et d’une radicule non-exserte d’autre part. La moitié du poids de l’amande est constituée de matières grasses [27].
Usages
Il est fait mention du karité (Vitellaria paradoxa Gaertn. f. de la famille des Sapotaceae) et de ses usages dès le 16e siècle [36]. Le beurre était utilisé dans le domaine alimentaire, cosmétique et médical.
On s’en servait aussi dans les rites traditionnels du fait des pouvoirs mystiques qui lui sont attribués [1].Les utilisations des fruits du karité sont nombreuses et diverses selon les localités et les cultures. Initialement dépendantes des besoins locaux, elles sont devenues aujourd’hui industrielles.
Utilisations traditionnelles
La pulpe du fruit est consommée par les hommes et les animaux. Elle possède une légère action laxative. La décoction des jeunes feuilles est utilisée, en bain de vapeur, contre les céphalées. Les fleurs sont particulièrement recherchées par les abeilles, ce qui favorise l’installation des ruches à proximité de ces arbres et facilite l’apiculture traditionnelle. Au Nigeria les racines de karité sont utilisées traditionnellement comme cure dents [37].
L’écorce aide à traiter les plaies et les diarrhées. Le bois rougeâtre est dur et est utilisé en charpenterie, menuiserie et en ébénisterie [38,39]. Le tourteau est employé comme combustible, engrais et aliment pour animaux. Le latex, quant à lui, entre dans la confection des pièges à glue et d’isolant. Il entre également dans la fabrication de gomme à mâcher. Le beurre de karité joue un important rôle économique tant localement que national et international. Il est aussi utilisé dans l’alimentation, à savoir la confection des sauces, des fritures etc. Il sert dans les produits cosmétiques. Le karité est donc un arbre à usages multiples, qui ne semble pas avoir de déchets puisque toutes ses parties sont utilisées par les populations rurales. Par contre, pour les populations citadines d’Afrique et des pays du Nord, le beurre de karité est le produit le plus demandé à l’heure actuelle [40].
En médecine traditionnelle, le beurre de karité active la cicatrisation des brûlures, des ulcères et des plaies superficielles ; il constitue un excellent anti-inflammatoire cutané et dermique.
La cicatrisation des brûlures en voie de guérison est réalisée par l’application régulière du beurre de karité pour favoriser la desquamation des peaux sèches et prévenir une éventuelle formation de chéloïdes. Ces facultés cicatrisantes déterminent son utilisation dans les circoncisions, excisions etc.
En général, le beurre de karité pur légèrement chauffé, appliqué en massage sur les fesses des bébés, prévient les érythèmes.
Appliqué chaque jour, chez la femme enceinte sur le ventre et les seins, il prévient les vergetures et après l’accouchement, il raffermit la peau.
En fumigation, le beurre est efficace contre les rhumes de cerveau ; le procédé utilisé consiste à disséminer des petits morceaux de beurre sur les braises d’un encensoir perforé au sommet pour permettre la sortie des effluves que le malade respire.
En infusion, mélangé à de l’eau chaude et du thé, il est bu à raison de deux tasses par jour pour guérir la toux et les maux de gorge [41, 42, 43].
En médecine et en pharmacie
Le beurre de karité a été révélé par TELLA A., comme ayant une action décongestionnante en cas de rhinites allergiques sans irriter la muqueuse nasale. Les voies respiratoires se dégagent en moins de deux minutes.
Le beurre de karité est aussi utilisé pour les soins de la peau. Bien que les données cliniques citées par les laboratoires cosmétiques qui commercialisent les beurres de karité soient difficilement vérifiables, de récentes études confirment la valeur thérapeutique de ce produit dans le traitement de certaines affections de la peau. Les substances biologiquement actives du beurre de karité se trouvent dans la fraction insaponifiable. Cette dernière contient des antioxydants comme les tocophérols (vitamine E) et des catéchines.
ALANDER et ANDERSON (2002) et ALANDER (2004) ont identifié d’autres composés spécifiques comme les alcools de triterpène, connus pour réduire les inflammations [44,45].
En fait, dans l’insaponifiable, l’ α- et la β-amyrine permettent de protéger la peau grâce à leurs actions anti-inflammatoires et anti-irritatives. Elles luttent contre les dermites et soulagent les courbatures et rhumatismes [46].
Depuis plusieurs années, le beurre de karité constitue un centre d’intérêt pour l’industrie pharmaceutique.
Ses excellentes propriétés physicochimiques ( bonne consistance, point de fusion élevé, bon étalement), sa stabilité bactériologique, son pouvoir lubrifiant et adoucissant, sa facilité et sa rapidité de pénétration et de libération du principe actif, lui ont conféré une place de choix parmi les excipients utilisés pour la préparation des produits pharmaceutiques à base de corps gras telles que les pommades, les crèmes, les cérats , les onguents, les liniments et les suppositoires [47].
Les utilisations industrielles
Il est utilisé dans les industries agro-alimentaires. En effet, il est employé en confiserie, biscuiterie, pâtisserie et principalement en chocolaterie. On l’utilise comme substitut du beurre de cacao en raison de son point de fusion élevé [48,49]. En cosmétique et en pharmacologie, le beurre de karité entre dans la fabrication des crèmes, des laits de corps, des produits capillaires, des lotions et des savons. Ceci s’explique par ses propriétés hydratante, revitalisante et protectrice, de même que par sa teneur en insaponifiables et en glycérine. Il est employé en pharmacie pour fabriquer des revitalisants et des cicatrisants.
La principale raison de l’intérêt accordé au beurre de karité est la reconnaissance par l’industrie et le consommateur de ses propriétés intéressantes en matière de cosmétique. L’insaponifiable et le latex sont actifs sur la protection de la peau (aet b-amyrine), la cicatrisation (parkéol), la désinfection (lupéol), la stimulation des cellules (a-spinastérol) ; la régénération des cellules (D7-stigmastérol), la prévention des allergies au soleil (latex). Des propriétés hydratantes, anti-inflammatoires, anti-eczéma et antiride ont été également soulignées [50,51].
BSP Pharma, une coentreprise entre le fabricant danois de matière grasses Aarhus Oliefabrik et la compagnie biopharmaceutique Astion, utilise actuellement des insaponifiables de karité pour produire un traitement anti-inflammatoire contre l’arthrite et une crème pour le traitement local de l’eczéma et d’autres lésions cutanées, (notamment dues à l’herpès). BSP Pharma produit aussi un produit « nutraceutique » à base de karité qui a la capacité, cliniquement démontrée, de réduire le cholestérol chez l’homme [52].
Cependant sur le plan économique, le karité est un arbre emblématique des effets de la mondialisation sur les systèmes socio écologiques locaux et les populations qui en font partie. Si le marché des produits issus du karité a été identifié depuis des siècles comme étant un commerce régional, le marché des amandes de karité a connu une croissance forte des volumes commercialises a l’export ces quinze dernières années, bien que ce marche ait commence à se développer dès les années 1960.Ce changement de valeur culturelle et monétaire du karité a notamment entraîné des changements dans les rapports sociaux et les relations de pouvoir autour du karité [53].
Méthode de production du beurre de karité artisanal
Pour accéder à la précieuse matière grasse issue de l’arbre à karité, plusieurs étapes de traitement des noix ont été décrites.
Collecte et traitement des noix de karité
La cueillette et le tri des fruits
Le beurre de karité doit être produit à partir des noix issues des fruits murs tombés à terre pendant la saison hivernale (juin, juillet, aout)[55].En effet, les amandes de karité provenant de fruits cueillis sur l’arbre, avant la maturité, contiennent peu de matière grasse (<30 %),plus d’acide gras libres (0,5 %) et subissent des dégradations de tout genre [56].
Les fruits murs collectés sont ensuite triés, en éliminant ceux qui ont commencé à germer ou à pourrir au niveau du sol, dans le but d’éviter l’altération de la couleur, du goût et de l’odeur du beurre de karité [57].
Le dépulpage du fruit
C’est une opération consistant à éliminer la pulpe, le dépulpage a lieu suivant deux modes essentiels, selon les régions de production :
Le dépulpage après fermentation dans l’eau, soit dans un récipient de grande capacité pendant deux semaines soit dans une fosse réalisée au sol, pendant un mois.
Ce trempage des fruits dans l’eau, qui permet d’éviter leur germination, peut malheureusement provoquer l’activation des enzymes lipolytiques endogènes des noix (lipases, protéases, phénol ases…). L’hydrolyse des triglycérides et une libération massive d’acides gras libres [56].
Le dépulpage manuel ou foulage des pieds, apparait être le meilleur traitement des fruits.
Le traitement des noix
Il consiste en un traitement à la chaleur, suivi du séchage (afin d’éviter la contamination par les moisissures, le séchage des noix après leur traitement à la chaleur doit être immédiat) et du décorticage des noix et enfin, le séchage des amandes. Les sources de chaleur utilisées au Burkina pour le traitement des noix varient selon les régions et permettent de distinguer quatre techniques principales :
-Les noix peuvent être directement séchées au soleil.
-Elles peuvent être bouillies puis séchées au soleil. Cette méthode de traitement des noix est celle qui permet d’obtenir du beurre de karité de meilleure qualité [58]. En effet, selon JACOBSBERG, un chauffage de 80 °C pendant 30 minutes ou à 100 °C pendant 10 minutes détruit la lipase du fruit et inhibe l’hydrolyse de la matière grasse [59]. Il permet également d’éviter la contamination microbienne de l’amande, d’inhiber les lipases exogènes et l’action de la phénolase qui altère la couleur du beurre de karité [55].
-Les noix peuvent aussi subir un fumage au four, directement ou subir un fumage au four après une cuisson à l’eau et un séchage au soleil.
-Il y a aussi l’autre méthode pratiquée qui est un ensilage suivi du fumage ou non. L’avantage de ce séchage au four est l’obtention d’un beurre de karité à taux d’acide faible (1,4 % à 3,6 %).
Le décorticage de noix traitées se fait après une bonne déshydratation, au moment où les amandes se décollent facilement des coques.
Les amandes récoltées sont ensuite triées en fonction de leur aspect (gras ou non), leur couleur, leur fermeté, leur odeur (naturelle, agréable ou non) et la présence ou non de moisissures, de champignons, d’insectes, etc.
Conservation des amandes
Elle doit se faire dans de bonnes conditions de stockage (lieux propres, bien secs et ventilés) pour éviter la ré-humidification des amandes au cours du stockage. Le taux d’humidité doit être le plus bas possible (0,5 %) [60].
L’extraction proprement dite
L’extraction du beurre de karité à partir des amandes se fait par différentes méthodes : artisanale, traditionnelle, semi-industrielle, ou industrielle.
Ainsi dans le cas de notre étude, nous nous intéresserons à la méthode artisanale. Celle-ci est essentiellement composée de deux techniques. La plus répandue, souvent appelée technique par « barattage », utilise l’eau pour émulsionner le beurre et le séparer des résidus solides. Le second procédé se fait par chauffage de la pâte d’amande de karité pour en extraire le beurre par reflux en surface.
Le barattage
Les principales étapes de cette méthode sont :
-Le nettoyage servant à débarrasser les amandes de la poussière, des moisissures et autres impuretés. Cette opération s’effectue par pilage dans l’eau ou par frottage à la main ;
-Le concassage consistant à fragmenter l’amande entre un pilon en bois et une pierre plate ;
-La torréfaction dans le but d’attendrir l’amande par chauffage et de développer l’arôme spécifique du beurre de karité ;
-Le pilage au mortier et le laminage sur meule ou au moulin pour réduire au maximum la taille des particules d’amandes et faciliter ainsi l’extraction du beurre ;
-L’extraction et la purification, phases prépondérantes dans la fabrication, car influençant la qualité du beurre. Après laminage, on ajoute de l’eau dont la température permet d’obtenir un mélange homogène. La performance de l’extraction dépend de la température du mélange, de la qualité de l’eau et du pétrissage ou barattage.
A la fin du barattage, la pâte blanchit et n’adhère plus aux mains. De l’eau est ajoutée à plus de 80 % du volume de pâte, ce qui permet de rassembler le beurre en surface. Le beurre ainsi récupéré est lavé pour enlever les résidus solides et les substances hydrosolubles, puis mis à chauffer pour évaporer l’eau. Enfin, il est laissé en décantation pour la clarification. Pendant cette opération on peut y ajouter des extraits acides (jus de citron, oseille) pour parfaire la clarification [61].
L’extraction par chauffage de la pâte
Cette méthode comporte essentiellement les étapes suivantes :
-le fumage des amandes pour les attendrir et développer l’arôme du beurre.
-le pilage des amandes qui permet l’obtention d’une pâte fluide.
-le chauffage de la pâte dans l’eau constitue la phase d’extraction. Elle s’opère en rajoutant de l’eau à une proportion de 1/3 environ du volume de la pâte. L’ensemble est homogénéisé par agitation. Enfin après un certain temps de chauffage, le beurre qui surnage est recueilli avec précaution et rassemblé pour la décantation [57].
|
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES
I. Beurre de karité : Historique et répartition géographique
I.1. Historique
I.2. Répartition géographique
II. Botanique de l’arbre à karité
II.1. Classification et nomenclature
II.1.1. Classification ou taxonomie
II.1.2. Nomenclature
II.2. Description de l’arbre
II.2.1. Les branches
II.2.2. Les feuilles
II.2.3. Les fleurs
II.2.4. Les fruits
II.2.5. Les noix et les amandes
III. Usages
III.1. Utilisations traditionnelles
III.2. En médecine et en pharmacie
III.3. Les utilisations industrielles
IV- Méthode de production du beurre de karité artisanal
IV.1. Collecte et traitement des noix de karité
IV.1.1. La cueillette et le tri des fruits
IV.1.2. Le dépulpage du fruit
IV.1.3. Le traitement des noix
IV.1.4. Conservation des amandes
IV.2. L’extraction proprement dite
IV.2.1. Le barattage
IV.2.2. L’extraction par chauffage de la pâte
V. Caractéristiques physiques et chimiques :
V.1. Caractéristiques physiques
V.2. Caractéristiques chimiques :
V.2.1. La fraction saponifiable
V.2.1.1. Les acides gras
V.2.1.2. Les glycérides
V.2.2. La fraction insaponifiable
V.2.2.1. Les esters résineux ou alcools tri terpéniques
V.2.2.2. Les phytostérols ou karitéstérols
V.2.2.3. Les hydrocarbures
DEUXIEME PARTIE : TRAVAIL EXPERIMENTAL
I. Objectifs
I.1. Objectifs généraux
II. Matériel
II.1. Matériel pour l’obtention des extraits
II.1.1. Matière végétale
II.1.2. Appareillage
II.2. Matériel pour le test anti-inflammatoire
III. Méthodes
III.1. Caractérisation du beurre de karité
III.1.1. Détermination du taux humidité
III.1.1.1. Principe
III.1.2. Détermination de l’indice d’acide ou d’acidité
III.1.2.1. Indice d’acide
III.1.2.1.1. Principe
III.1.2.1.2 Mode opératoire
III.1.2.2. Indice de peroxyde
III.1.2.2.1. Principe
III.1.2.2.2. Mode opératoire
III.1.3. Extraction de l’insaponifiable (dosage)
III.1.3.1. Principe
III.1.3.2. Mode opératoire
IV. Test d’activité anti-inflammatoire
IV.1. Animaux
IV.2.Test de l’œdème de l’oreille de souris à l’huile de croton
IV.2.1. Préparation des solutions utilisées
IV.2.2. Protocole
IV.2.3. Expression des résultats
V. Résultats
V.1. Taux d’humidité ou teneur en eau du beurre de karité
V.2. Indices d’acide et de peroxyde
V.3. La teneur en insaponifiable
V.4. Résultats des tests anti-inflammatoires
VI. Discussion
CONCLUSION
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Télécharger le rapport complet