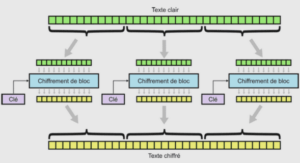l’Interaction Homme-Machine
Le point de départ de cet avant-propos est la définition proposée par le groupe d’étude de l’Interaction Homme-Machine de l’ACM (Association for Computing Machinery). Cette définition regroupe trois notions qui constituent les fondements de cette discipline : les systèmes interactifs, l’utilisateur et le contexte d’interaction.
«L’Interaction Homme-Machine est une discipline consacrée à la conception, la mise en œuvre et à l’évaluation de systèmes informatiques interactifs destinés à des utilisateurs humains ainsi qu’à l’étude des principaux phénomènes qui les entourent.» [HCI] .
Un système interactif est un système dont le fonctionnement dépend d’informations fournies par un environnement externe qu’il ne contrôle pas [Weg97]. Les systèmes interactifs sont également appelés ouverts, par opposition aux systèmes fermés – ou autonomes – dont le fonctionnement peut être entièrement décrit par des algorithmes.
L’Interaction Homme-Machine s’intéresse aux systèmes informatiques interactifs contrôlés par des utilisateurs humains. Du point de vue de la machine, l’humain a beaucoup de défauts : il est indécis, désordonné, inattentif, émotionnel, illogique [Nor94]. Mais il présente une grande qualité : sa capacité d’adaptation. Cette capacité d’adaptation a longtemps contribuée à une vision du progrès centrée sur le développement des capacités technologiques de la machine et se désintéressant totalement de sa relation avec l’humain. A quoi bon se préoccuper de lui, puisqu’il s’adapte si bien à tout ce qu’on lui propose ? Le slogan de l’Exposition Universelle de 1933 illustre parfaitement cette vision : «la Science trouve, l’Industrie applique et l’Homme s’adapte».
Le degré d’interactivité d’un système peut se mesurer au nombre et à la nature de ses échanges avec les utilisateurs. On peut ainsi dire que les premiers systèmes informatiques basés sur l’utilisation de cartes perforées et l’allumage de diodes étaient peu interactifs. L’augmentation de la puissance des ordinateurs a depuis permis l’avènement des interfaces graphiques et l’exécution parallèle de plusieurs tâches, deux éléments qui contribuent de façon importante à l’interactivité des systèmes actuels.
Usages de la vidéo dans les systèmes interactifs
Le téléphone a été mis au point par Graham Bell en 1876. L’ajout de l’image au son a été envisagé dès les premiers essais de liaisons téléphoniques. Dans Les cinq cents millions de la Begum, publié en 1879, Jules Verne décrit ainsi un système de téléconférence de groupe utilisé pour la réunion du conseil de Franceville [BG96]. Dans deux autres de ses œuvres publiées en 1882, Le château des Carpates et La journée d’un journaliste américain, il décrit également un téléphone alliant l’image au son. A la même époque, dans un ouvrage intitulé Le vingtième siècle, Albert Robida décrit le téléphonoscope : un appareil doté d’un écran qui permet à ses utilisateurs de voir un interlocuteur distant mais peut également être utilisé pour assister à des spectacles.
Les prédictions de la fin du dix-neuvième siècle ne se sont pas toutes réalisées. La principale application actuelle de la transmission d’images est la télévision, qui ne correspond qu’à la fonction de diffusion de spectacles du téléphonoscope de Robida. Dans le cadre de cette thèse, nous nous intéressons à son autre fonction, celle qui permet à des personnes de communiquer entre elles grâce à l’image. Nous décrivons dans ce premier chapitre un certain nombre de systèmes existants qui, comme le téléphonoscope, utilisent des flux vidéo pour la communication médiatisée. Ces flux vidéo étant de plus en plus souvent transmis de façon numérique, nous nous intéressons également aux traitements d’images rendus possibles par cette numérisation et à leurs applications pour la communication médiatisée et l’interaction homme-machine.
Situations formelles : visiophone, visioconférence et téléréunion
Le 7 avril 1927, la compagnie américaine des téléphones et télégraphes (AT&T) effectua l’une des premières transmissions simultanées d’images et de son entre New York et Washington en utilisant du matériel de télévision et une liaison radio [TB94]. Trois ans plus tard, le 9 avril 1930, le même type d’équipement fût utilisé pour une liaison cette fois bidirectionnelle entre les laboratoires Bell de AT&T et le siège de la compagnie, tous deux situés à New York. Les laboratoires de AT&T poursuivirent l’expérimentation de la transmission d’images jusqu’en 1956, où ils disposèrent enfin d’un système pouvant utiliser les lignes téléphoniques traditionnelles. Ce premier système était très rudimentaire et ne permettait que la transmission d’une image toutes les deux secondes. Après quelques efforts supplémentaires, AT&T aboutit en 1963 au premier visiophone expérimental : le Picturephone.
Le Picturephone
Le Picturephone était capable de transmettre un signal vidéo noir et blanc sur l’équivalent d’une centaine de lignes téléphoniques classiques. Le son était transmis séparément. La caméra et les hautparleurs étaient montés au-dessus et sur les côtés d’un écran à tube cathodique et un microphone mobile assurait la prise de son. L’ensemble était conçu pour que sa taille soit à la fois compatible avec une utilisation dans un bureau et à la faible résolution que la technique utilisée pouvait transmettre (250 lignes). L’écran était donc petit, 7 pouces de diagonale, et les images un peu floues. De nombreux contrôles permettaient toutefois d’ajuster la réception du signal, la luminosité de l’image et le volume du son. Les utilisateurs pouvaient également se voir et régler la focale de la caméra. Enfin, le système disposait d’un mode « discret » limitant la transmission à la voix.
La bande passante nécessaire à une liaison entre deux Picturephones était si rare que AT&T avait du mal à en faire la démonstration. Le système fut pourtant présenté à l’occasion de l’exposition universelle de Flushing Meadow (New York) en 1964. Le public de l’exposition fut invité à essayer une unité qui était reliée à une unité identique située à Disneyland (Californie). Après avoir essayé le système, chaque utilisateur fut soigneusement interrogé par une agence de marketing dans le but de déterminer le potentiel commercial de ce type de produit. Le résultat de cette enquête ne fut pas celui attendu. Les gens n’aimaient pas le Picturephone. Ils le trouvaient trop volumineux, trop froid et se plaignaient de la taille trop réduite de l’image.
Les laboratoires Bell restèrent pourtant convaincus que le Picturephone était commercialement viable. Les essais continuèrent pendant six années et fin 1970, un service interurbain basé sur un Picturephone de seconde génération fut commercialisé dans plusieurs grandes villes américaines telles que Pittsburgh, Chicago, New York ou Washington. Les cadres de AT&T étaient alors confiants : un million de Picturephone seraient vendus d’ici 1980. Une scène du film 2001 l’odyssée de l’espace [Kub68] illustre bien cette conviction que le visiophone allait révolutionner notre vie quotidienne. Dans cette scène, l’un des personnages utilise un Picturephone pour souhaiter un bon anniversaire à sa fille depuis une station en orbite autour de la Terre . La démonstration technique est impressionnante : la connexion espace/Terre est établie plus rapidement qu’une liaison téléphonique classique et n’est facturée que $1.7 pour plusieurs minutes de communication. Véritable publicité pour AT&T, cette scène ne manque pas de sens comique. Lorsque le père demande à sa fille ce qu’elle veut pour son anniversaire, celle-ci répond « un téléphone »…
Malgré les efforts considérables que AT&T lui consacra pendant plus de 15 ans, le Picturephone n’eut jamais de succès commercial. Après avoir dépensé plus de 500 millions de dollars de développements sur ce projet, la compagnie décida d’y mettre un terme à la fin des années 70, concluant que le visiophone était un « concept à la recherche d’un marché ». Malgré ses améliorations successives, le Picturephone restait imposant, cher, et nécessitait toujours une importante bande passante difficilement disponible.
A la même époque, un premier réseau visiophonique était expérimenté à Paris par le CNET , puis étendu à Lannion par le réseau hertzien [BG96]. Ce réseau, utilisé jusqu’en 1980, desservit jusqu’à 200 postes installés sur les deux sites du CNET et au ministère des PTT. En 1984, le CNET expérimenta la visiophonie à l’échelle d’une ville. Pendant cinq ans, un réseau de fibres optiques permit à 1 400 habitants de Biarritz de communiquer par visiophone. Ce type d’expérience ne fut pas par la suite généralisé, officiellement pour des raisons de coûts. Dix ans après l’expérience américaine, et malgré l’évolution des technologies utilisées, l’idée de visiophone fut une nouvelle fois abandonnée.
Salles de visioconférence
A la fin des années 70, constatant l’échec du visiophone, plusieurs sociétés américaines ont commercialisé des systèmes de communication audiovisuelle non plus à usage individuel mais destinés à des réunions de groupe. L’acquisition et la mise en œuvre de ces systèmes relevaient encore à cette époque de l’acte de foi : le codec coûtait $250 000 à lui seul auquel il fallait ajouter des caméras, moniteurs, microphones, haut-parleurs et généralement l’aménagement d’une salle spécifique pour accueillir tout ce matériel . Un certain nombre de grandes entreprises tentèrent pourtant l’expérience, comptant sur la réduction des frais de déplacement de leurs employés pour financer leurs systèmes.
Ces salles de visioconférence s’avérèrent trop chères, trop complexes à utiliser et manquant de souplesse. Elles nécessitaient ainsi souvent la présence de techniciens et étaient difficilement adaptables au nombre de participants. Le terme visioconférence décrit bien le type d’usages auquel ces salles étaient généralement réservées : des situations regroupant un grand nombre de personnes qui assistent à une présentation formelle faite par un petit nombre d’entre eux. L’idée d’utiliser la vidéo pour des réunions, et non plus des conférences, s’est imposée progressivement, accompagnant la miniaturisation et la standardisation des équipements. Les systèmes sont donc devenus plus simples, plus petits et mobiles.
Systèmes mobiles de téléréunion
Les systèmes mobiles de téléréunion regroupent codec, écran(s), caméra(s), haut-parleurs et microphone(s) sur un meuble qui peut être déplacé . Contrairement aux premiers systèmes de visioconférence, ceux-ci n’utilisent pas de ligne spécialisée mais transmettent le son et l’image sur plusieurs lignes téléphoniques numériques ISDN – ou NUMERIS -, une à trois lignes suffisant à obtenir une qualité plus qu’acceptable.
|
Table des matières
INTRODUCTION
Avant-propos : l’Interaction Homme-Machine
Sujet de cette thèse
Structure du mémoire
CHAPITRE I USAGES DE LA VIDÉO DANS LES SYSTÈMES INTERACTIFS
1. Situations formelles : visiophone, visioconférence et téléréunion
2. L’informel et le quotidien
3. Partage de vues et fusion des espaces
4. Traitement d’images pour l’interaction homme-homme ou homme-machine
5. Résumé du chapitre
CHAPITRE II MEDIASPACES
1. Du Media Space aux mediaspaces
2. Spécificité des mediaspaces
3. Caractéristiques fondamentales des mediaspaces
4. Résumé du chapitre
CHAPITRE III LE WEB COMME INFRASTRUCTURE LOGICIELLE POUR LES MEDIASPACES
1. Choix de l’infrastructure : une affaire de public
2. Le Web
3. Le Web comme infrastructure logicielle pour les mediaspaces
4. Résumé du chapitre
CHAPITRE IV MEDIASCAPE ET VIDEOSERVER
1. Mediascape
2. VideoServer
3. Usages de videoServer
4. Notification, contrôle et adaptation du contenu
5. Résumé du chapitre
CHAPITRE V AU-DELÀ DU NAVIGATEUR : NOUVEAUX CLIENTS ET NOUVEAUX PROTOCOLES
1. VideoClient
2. Nouveaux protocoles pour videoServer
3. Mise en œuvre d’un système de communication basé sur videoServer
4. Résumé du chapitre
CHAPITRE VI VIDEOSPACE
1. Motivations
2. La boîte à outils videoSpace
3. Interface de programmation de videoSpace
4. Applications de base proposées par videoSpace
5. Discussion
6. Résumé du chapitre
CHAPITRE VII PROTOTYPAGE DE NOUVEAUX USAGES DE LA VIDÉO AVEC VIDEOSPACE
1. La main comme télépointeur
2. Vers la téléconvivialité
3. L’environnement informatique vu comme une source d’images
4. Résumé du chapitre
CONCLUSION
Résumé de la contribution
Limites et perspectives