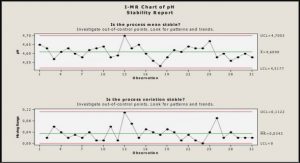DEFINITIONS ET CONCEPTS SUR L’INDUSTRIALISATION
Il est nécessaire de définir quelques mots, d’avoir une notion sur le développement et de savoir l’origine de toutes choses .
Quelques définitions
On va définir les mots qui sont incontournables dans ce thème.
L’industrie
Le mot « industrie » vient du mot latin « industria » qui signifie activité, ingéniosité ou savoir-faire. Il est apparu en Europe Occidentale au XVème siècle, jusqu’au XXème siècle, qui ne signifiait pas seulement les activités économiques mais concernait aussi l’agriculture, les activités artisanales et manufacturières. L’industrie est l’ensemble des activités économiques ayant pour objet l’exploitation des richesses minérales et des sources d’énergie, la transformation des matières premières en produits fabriqués.
L’industrialisation
L’industrialisation est un processus de fabrication de produits manufacturés avec des techniques permettant une forte productivité du travail et qui regroupe les travailleurs dans des infrastructures constantes avec des horaires fixes et une réglementation stricte. L’industrialisation est aussi un processus complexe qui permet d’appliquer à un secteur, à une branche de l’économie, des techniques et des procédés industriels qui apportent rationalisation et hausse de productivité selon Pierre Guillaumat. L’industrialisation du bâtiment est un facteur de productivité. Celle-ci a permis d’absorber ces dernières années la plupart des hausses de prix tenant aux conditions économiques et d’augmenter à coût égal les dimensions .
La consommation de masse
La Consommation de masse est née grâce aux gains de productivité qui ont permis des augmentations régulières de pouvoir d’achat et grâce au développement de la protection sociale, consommation qui est fondée sur l’équipement progressif des ménages en biens, notamment les biens durables.
Ces actions de consommation signifient que le niveau moyen de consommation est très élevé, puisque l’accès du plus grand nombre de consommateurs aux grands marchés, en particulier les marchés alimentaires (hypermarchés et supermarchés), est atteint, ce qui demeure le privilège des sociétés dont la quasi-totalité de la population a un niveau de consommation très élevé. Le modèle américain de la consommation de masse est comme une production de masse et un système de vente de masse qui suppose une disponibilité toujours plus grande de biens dans une culture qui privilégie l’achat et la vente, le désir, le glamour et des identités souples et consuméristes.
La destruction créatrice
La destruction créatrice ou création destructrice désigne en économie le processus de disparition de secteurs d’activité conjointement à la création de nouvelles activités économiques. Étant le mouvement permanent de destructions d’activités liées aux anciennes innovations et de créations de nouvelles activités liées aux nouvelles innovations. Les éléments neufs vont remplacer les anciens. Cette expression est fortement associée à l’économiste Joseph Schumpeter .
Economie duale
L’économie duale est un modèle de l’économie du développement. Initialement, il s’applique aux sociétés où coexistent deux secteurs économiques, un traditionnel : agriculture de subsistance, artisanat et l’autre dit ‘moderne’ et lié au commerce national ou international (plantations, industries extractives). Aujourd’hui, le terme s’applique aussi par extension aux économies en développement où le secteur formel n’arrive pas à créer d’emplois liés aux échanges économiques en nombre suffisant, ce qui maintient ou cause la naissance d’un ample secteur informel.
Notion sur le développement
Selon François PERROUX (1961) le développement : c’est « la combinaison des changements mentaux et sociaux d’une population qui la rende apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel et global » Cette définition met l’accent sur le fait que la croissance économique est différente de ce qu’est le développement.
De son point de vue donc « Le développement englobe des bouleversements plus grands que la simple croissance économique : le développement est par nature un phénomène qualitatif de transformation sociétale alors que la croissance économique est un phénomène quantitatif d’accumulation de richesse ». Alors, le but du développement doit être le progrès technique.
Origines
On va voir l’originalité de deux choses :
La division en trois (3) secteurs
Dès l’origine de la science économique, la division des activités économiques en groupes distincts est apparue utile ou nécessaire ; c’est pratiquement en effet une servitude inhérente à toute connaissance scientifique de diviser le domaine de la connaissance en éléments relativement homogènes sur lesquels porte successivement l’étude. A cet égard, la division classique « production, distribution, consommation », ou la division keynésienne « biens d’investissements », « biens de consommation » apparaissent comme une division en « secteurs ». Mais aujourd’hui, l’on réserve généralement le terme de « secteurs » aux divisions de l’activité économique liées à l’étude de la population active. Le terme de secteurs n’est utilisé dans ce cas que pour des raisons de simplification de la classification des activités économiques. C’est seulement vers 1930 que le terme de secteur est entré dans la Science Economique, comme moyen d’explication de l’évolution de l’économie. L’initiative en revient à Allen-B. Fisher.
La Révolution Industrielle
Avant d’utiliser le terme industrialisation, Adolphe Blanqui est un des premiers à utiliser le terme de Révolution industrielle en 1837 qui est fortement critiqué au siècle suivant. On qualifie d’industrialisation ou de première industrialisation, un phénomène continu d’augmentation de la production industrielle qui fonctionne de manière à peu près identique dans un ensemble de pays d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord entre la seconde moitié du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle. Plus précisément, elle désigne le processus historique du XIXe siècle qui fait basculer une société à dominante agraire et artisanale vers une société commerciale et industrielle, de manière plus ou moins rapide selon les pays et les régions.
Cette transformation, tirée par le boom ferroviaire des années 1840, affecte profondément l’agriculture, l’économie, la politique, la société et l’environnement. Les révolutions industrielles désignent aussi de grands cycles d’innovation qui ont profondément transformé non seulement la production industrielle et son organisation, mais aussi la dynamique économique dans son ensemble. On en recense en général trois : la première débute dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la deuxième apparaît à la fin du XIXe et la troisième commence dans les années 1970. Mais une quatrième se déroulait sous nos yeux.
|
Table des matières
INTRODUCTION
PARTIE I : SOUBASSEMENTS THEORIQUES A L’INDUSTRIALISATION
CHAPITRE I : DEFINITIONS ET CONCEPTS SUR L’INDUSTRIALISATION
Section 1 : Quelques définitions
Section 2 : Notion sur le développement
Section 3 : Origines
CHAPITRE II : REVUE DE LITTERATURE
CHAPITRE III: THEORIES RELATIVES SUR L’INDUSTRIALISATION
Section 1 : Les théories sur l’industrialisation
Section 2 : Les théories de la croissance
PARTIE II : ANALYSE EMPIRIQUE DE L’INDUSRTIE A MADAGASCAR
CHAPITRE IV : RESULTATS SUR L’INDUSTRIE
Section 1 : Etats de lieu de l’économie à Madagascar
Section 2 : Analyse de l’industrie malagasy
Section 3 : Industrie-agriculture
Section 4 : Le rôle de l’Etat
CHAPITRE V : DISCUSSIONS
Section 1 : Par rapport aux théories
Section 2 : Par rapport au revue
CHAPITRE VI : LIMITES ET RECOMMANDATIONS
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE