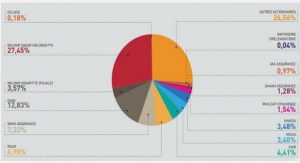Sociologie du développement et politiques publiques
Le cadre conceptuel et théorique
Chaque thèse comporte son lot de difficultés. Les thèses de type monographique soulèvent l’enjeu particulier du développement d’un cadre théorique pertinent. Le but étant d’éviter la construction d’un cadre qui bien qu’intéressant demeure artificiel, voire isolé du sujet de l’étude. Le cadre théorique sert en quelque sorte, de caisse de résonnance – grille d’analyse – à la démarche empirique opérée dans la présente monographie.
Dans une approche hypothético-déductive, le cadre théorique annonce et prépare naturellement la saisie de l’objet de recherche, alors que dans une démarche inductive, une remontée théorique s’impose et le cadre théorique succède au cadre empirique. En d’autres termes, le fait de placer le cadre théorique avant le cadre empirique sous-tend l’idée presque explicite d’une démarche hypothético-déductive. Ce n’est pas le but recherché dans la présente recherche. Il ne faut pas y voir la tentation de jouer indûment avec le couple conceptuel induction et déduction comme procédure de raisonnement et comme mouvements successifs de la démarche scientifique. Cependant, nous voulons circonscrire l’objet de recherche et en découvrir les fondements par l’introduction d’hypothèses exploratoires, lesquelles requièrent une certaine inventivité.
Nous soumettons l’hypothèse que le positivisme sociologique, toujours présent dans la sociologie québécoise, impose en quelque sorte la présentation d’un cadre théorique à rebours du processus de recherche imposé par la démarche monographique elle-même. La forme ainsi dictée crée donc un préjudice potentiellement défavorable au déploiement des observations, des analyses et des conceptualisations propres à la sociologie empirique. Nous soulevons ici un enjeu épistémique et phénoménologique de la construction du savoir en sciences sociales. On ne peut ignorer que la manière de penser la monographie risque parfois de la tuer. Les règles en vigueur, les canaux traditionnels, voire les schémas canoniques obligent à demeurer critique face aux méthodes classiques de penser la monographie en sciences sociales. On peut alors se demander si la pensée classique n’entraîne pas des rigidités contre-productives qui inhibent la construction de la pensée.
Quand bien même, nous pensons qu’une démarche plus inductive semble s’avérer prometteuse en matière de développement régional. Un pan de la présente thèse repose sur une méthode déductive par la construction de concepts systémiques englobants. Pour Bourdieu, le modèle théorique est le seul à posséder un pouvoir explicatif (Quivy et Campenhoudt, 2006, p.129). Nous présenterons quelques concepts théoriques nécessaires à la compréhension de notre objet de recherche, tout en conjuguant plusieurs concepts et hypothèses pouvant couvrir plusieurs aspects du problème à l’étude. La construction d’un cadre conceptuel nous permet d’organiser les concepts retenus et leurs relations en vue de donner une orientation précise à la formulation du problème. Les concepts de développement et de politiques publiques ou encore les sous-concepts de décentralisation et d’institutionnalisme, etc. sont agencés dans notre cadre conceptuel de manière à en saisir la portée. En définitive, la conceptualisation permet de relier le problème de recherche au cadre de référence. L’importance tient au fait de son insertion dans toutes les phases de la recherche. « Le cadre de référence, qu’il soit conceptuel ou théorique s’intègre à la formulation du problème du fait que le problème est inséré dans un réseau de relations entre les divers concepts pertinents susceptibles d’influencer sur l’analyse des données » (Fortin, 2006, p. 97).
Les grands penseurs du développement
De nombreux spécialistes dont les économistes, les philosophes, les historiens et les sociologues furent mis à contribution dans le cheminement conceptuel du développement. Leur érudition a favorisé sa théorisation et a dégagé des principes généraux le concernant. Ces nombreuses études ont indiqué le type de politiques susceptibles de donner vie au développement. Le terme controversé de développement s’est retrouvé « au carrefour d’élaborations académiques, de savoirs d’experts, de savoirs issus de la société civile (associations, syndicats, ONG…) » (Gabas, 2008, p. 45). L’économiste est d’avis que le terme a connu de multiples lieux de production et fut soumis à une double pression le faisant osciller entre deux postures opposées et intenables : le réductionnisme et l’obsolescence » (Gabas, 2008, p. 45). La première posture fait du développement et de la croissance économique des notions synonymes et incontournables. Dans le second, le terme développement est soumis à de multiples lieux de production des savoirs et renvoie à des termes englobants, et à la limite, désuets.
Ce manichéisme conceptuel conduit à interroger comment le concept de développement est apparu et quelles en furent les différentes théorisations. Le concept de « développement » est devenu une référence, voire un sujet central d’étude des politiques publiques dans la mesure où le développement économique advient si les politiques publiques mises en œuvre sont en symbiose avec le modèle conceptuel proposé. Avant que le concept n’apparaisse dans le contexte qui a prévalu dans l’après-guerre, le développement était synonyme de croissance économique, et ce, pendant toute la phase de construction de la pensée économique par les pionniers du développement économique dont Adam Smith (1723-1790) est le précurseur. On le présente comme un farouche partisan du libéralisme économique radical, illustré par sa célèbre parabole de la main invisible. Selon Smith, l’intérêt personnel est manifeste chez l’homme et son désir d’accumuler de la richesse va créer des conflits que l’État doit contrer en fixant les règles d’encadrement. Un thème qu’affectionne Smith est celui lié au capital, à l’accumulation et la croissance économique. Selon Dostaler (2016), il emprunte à l’économiste Turgot, réformateur au service de Louis XVI, l’idée que la richesse qui survivra est celle « qui relie l’accumulation et, donc la prospérité économique, à l’épargne, c’est-à-dire à la transformation du revenu en capital additionnel pour mettre en œuvre du travail productif » (Dostaler, 2016, p. 166). L’auteur interprète que c’est là une des thèses principales de l’économie classique que Keynes se charge de démolir dans Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936), ouvrage dans lequel il rejette non seulement les conclusions de la théorie classique de l’économie, mais aussi les méthodes et la conception.
Le concept de développement fut donc un grand sujet d’étude chez les économistes classiques du 18e et du 19e siècle. À cette époque, l’idée de développement concernait les pays en voie d’industrialisation, là où la croissance de la production, l’accumulation du capital et la division du travail commençaient à se manifester. La division du travail était, selon Adam Smith, le fait fondamental de l’économie. Puis, il cherchera à connaître les raisons qui conduisent les nations vers la prospérité. La publication de son œuvre maîtresse, La Richesse des Nations (1776) a été de « propulser le développement du système économique capitaliste comme l’objet principal de la théorie économique » (Sunkel, 1977 p. 11). Au départ, les premières réflexions sur le développement vont s’attarder à la nécessité de stimuler la croissance économique mesurée par la progression du Produit intérieur brut (PIB).
Le concept de développement n’est pas récent, mais il prendra une actualité nouvelle après la Seconde Guerre mondiale tout en gardant son acception messianique.
Rappelons que l’Europe en ruine, appelle les États-Unis à son secours et laisse en arrière-plan les problèmes économiques du Sud. Le lancement du Plan Marshall (1947) marque le début de la reconstruction de l’économie européenne qui ouvre un débouché gigantesque au système de production de l’Amérique. On verra que la générosité des Américains est rarement éloignée de leurs intérêts. C’est dans ce contexte peu favorable aux préoccupations Nord/Sud que la notion de développement aurait été inventée, notamment lors du discours d’investiture du président des États-Unis, Harry Truman, prononcé le 20 janvier 1949. Le chef du gouvernement stigmatise la majeure partie des pays du monde en les qualifiant de régions sous-développées (Sachs et Esteva, 1996, p. 14). Il n’en fallait pas davantage pour donner au concept un regain d’intérêt, car le président américain affirmait vouloir lancer « un nouveau programme qui soit audacieux et qui mette les avantages de notre pays au service des pays pauvres. Parlant des États-Unis, il souligne l‘avance scientifique et le progrès industriel à mettre au service de l’amélioration et de la croissance des régions sous-développées » (Rist, 2001 p. 118). C’est ainsi que le développement fut propagé par les dirigeants des puissances occidentales avec de nombreuses politiques économiques et sociales, laissant présager l’avènement du bien-être pour les pays sous-développés en particulier. Mais, avec le temps, « l’expression développement s’est vidée de son sens et pourrait se comparer à une méduse ou à une amibe. Elle ne contient plus rien parce que ses contours sont flous; elle est tenace parce qu’elle peut s’implanter n’importe où » (Sachs et Esteva, 1996, p. 21).
Le concept de développement fait l’objet de débat aujourd’hui au sein des facultés de sciences sociales. La diversité des contenus, les multiples réflexions liées à sa définition justifiaient que les sciences sociales s’y engagent de façon critique et vigilante. Malgré la controverse entourant les interprétations protéiformes du concept, Legouté (2001) affirme qu’« il était pratiquement inconnu dans la théorie des sciences sociales comme dans la pratique de la politique économique » (Legouté, 2001, p. 5). Toutefois, les grandes théories socioéconomiques de l’après-guerre ont placé la problématique du développement au centre de la réflexion intellectuelle et politique avec des théories cherchant chacune à se faire passer pour la solution enfin découverte des problèmes de développement » (Rist, 2013, p.15).
L’économie du développement comme discipline universitaire est apparue dès le début des années 1950. Les chercheurs voulurent identifier les causes de la pauvreté et l’absence de développement en accordant autant d’importance aux réalités sociales de l’Afrique qu’aux politiques de développement applicables à l’Occident. S’inspirant des économistes classiques tels que Adam Smith (1723-1790) et David Ricardo (1772-1823) à l’origine des travaux sur le capitalisme, des économistes du développement vont miser sur l’équilibre économique à court terme, et sur l’efficacité dans la distribution des ressources (Beaudet, Haslam et Schaffer, 2008, p. 40). D’autres élargissent leur vision du concept et certains vont considérer l’État comme l’agent principal du développement à qui il incombe de moderniser les sociétés, condition nécessaire à la croissance économique. Certes, en théorie c’est une avancée, mais dans les faits, la croissance reste l’élément clé qui alimente leur réflexion. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, tant les politiques, les sociologues que les planificateurs de tous bords, dont Nahavandi (2000), spécialiste du tiers-monde, pensaient qu’il était nécessaire de moderniser les sociétés même si des divergences existaient quant aux moyens d’y parvenir.
La notion de développement, née en Occident, répand ses valeurs historiquement construites, au reste du monde tout en légitimant les orientations à donner à une société. Cette forme de pensée magique est rejetée par Fairhead, qui, en 2000, décrète que le développement va demeurer fondamentalement une création occidentale perverse, l’Occident a fabriqué le tiers-monde comme il a fabriqué l’orientalisme dans le dessein d’asservir des peuples, de détruire leurs savoirs et de les empêcher de se prendre en main » (Fairhead, cité dans Olivier de Sardan, 2001, p. 736). Malgré les critiques, le concept moderne de développement apparaîtra en 1949 et conditionnera la vision des régions sous-développées selon le modèle occidental. Le discours d’investiture du Président Truman n’avait rien d’une improvisation. Le positionnement idéologique de celui-ci fut appréhendé comme le premier discours de type « messianique », car il traçait aux sociétés et aux hommes la voie vers la délivrance des maux qui les affligent.
Le sous-développement est conçu comme un retard historique, voire une étape, et le développement va consister à rattraper ce retard. « Les rails sont posés (le progrès). La gare d’arrivée est programmée. La locomotive, c’est le développement » (Hours, 2007, p. 701). Le progrès se déploie selon Gilbert Rist (1996) comme une nécessité naturelle et il est consubstantiel à l’Histoire parce qu’assimilé au processus qui induit le changement dans l’évolution naturelle d’une société. La perspective est alors évolutionniste et repose sur la croyance en l’idéologie du progrès dynamisé par le progrès technologique. Une vision unilinéaire et gradualiste du cheminement auquel doivent se soumettre les sociétés humaines pour atteindre une forme d’organisation sociale plus complexe
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les théoriciens néoclassiques et les keynésiens vont réduire les problèmes de développement à la théorie de la croissance, aux imperfections des marchés et au champ de l’économie internationale. Plus tard, l’évolution de la pensée économique se manifeste et les théories du développement vont s’affirmer comme un corpus distinct de l’économie, en admettant l’idée que le développement ne pouvait se réduire à la simple croissance économique (Assidon, 2002). Effectivement, de nombreux auteurs ont affirmé que le développement ne pouvait être aliéné à la croissance en soulignant les différences entre les théories du développement » et celles de la « croissance ». Les travaux empiriques de Jorgensen sur le développement mettront l’accent sur l’équilibre entre l’accumulation du capital et la croissance de la population, alors que dans la théorie de la croissance, l’accent est mis sur l’équilibre entre l’investissement et l’épargne.
Retenons à ce sujet, les définitions des concepts du développement et de la croissance formulées par Perroux (1966). Le développement c’est « d’une part changement de structures mentales et d’habitude sociales d’une population [et] d’autre part changements observables dans le système économique et dans les types d’organisation. […] Il transforme les progrès particuliers en un progrès du tout social ». Quant à la croissance, c’est « l’augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes d’un indicateur de dimension national : le produit global brut ou net, en termes réels » (Perroux, 1966, p. 240). Même s’il distingue la croissance économique du développement économique, F. Perroux admet qu’il est difficile de concevoir un développement sans croissance économique, mais que cette dernière n’engendre pas nécessairement le développement. Le développement, en englobant une dimension sociale (par exemple la répartition de la richesse nationale), est un concept plus large qui introduit même une dimension qualitative alors que la croissance est un processus uniquement quantitatif. Et il ajoute que « les sociétés occidentales elles-mêmes, et leurs parties constituantes, sont, à cet égard inégales quant aux niveaux atteints et quant aux ressorts du développement » (Perroux, 1966, p. 191).
Pour Gilbert Rist (1996), le développement est un « un ensemble de pratiques, parfois contradictoires, qui pour assurer la reproduction sociale, obligent à transformer et à détruire le milieu naturel et les rapports sociaux en vue d’une hausse de production de marchandises destinées, à travers l’échange, en réponse à la demande globale » (Rist, 1996, p. 27-28).
Notons qu’après la Seconde Guerre mondiale, une période prolifique s’annonce et que de nombreuses approches théoriques vont apparaître sur le concept de développement élaboré selon plusieurs niveaux de réflexion. Nous pouvons citer quelques économistes ou écoles de pensée qui ont développé des outils d’étude particulièrement destinés aux spécificités structurelles des pays sous-développés. p. Rosenstein-Rodan (1943) va élaborer le modèle de la croissance équilibrée, A. Hirschman (1984) va lui opposer celui de la croissance déséquilibrée, alors que Nurkse (1953) va développer la théorie des cercles vicieux de la pauvreté. S’agissant de la théorie de Nurske, la pauvreté et le sous-développement sont en relation sine qua non. Autrement dit, les pays sous-développés sont sous-développés parce qu’ils sont pauvres et ils sont pauvres parce qu’ils sont sous-développés. Selon Nurkse, la pauvreté et le sous-développement s’expliquent par la faiblesse des revenus et de l’épargne, et, par conséquent, par le sous-investissement. Mais, comment définir et mesurer la pauvreté quand on sait que la pauvreté est une réalité particulièrement fuyante, et qu’une définition soignée renvoie à une nébuleuse de sens? (Sassier, 1990, p. 8). Si le sous-investissement est l’une des causes du sous-développement (Nurske), Rostow, pour sa part, semble fixer à 12 % le taux de capitalisation nécessaire au décollage des économies sous-développées (Gélinas, 1994, p. 127). En fin de compte, le développement signifiait la capitalisation ou l’accumulation systématique du capital (Lewis, 1954), alors que la croissance est présentée « comme le remède aux inégalités » (Latouche, 2004, p. 81) et cela, quel que soit le pays considéré. Mais Perroux prétend que la croissance n’est qu’un phénomène quantitatif et ne peut être le remède aux inégalités qu’à la condition d’une bonne répartition de la richesse nationale.
Durant les décennies 1950 et 1960, une place centrale sera accordée à l’augmentation des revenus et de la croissance, et les premiers économistes vont se fixer comme objectif principal de poursuivre la croissance sur une longue période pour assurer le démarrage des pays sous-développés. C’est, du reste, la vision sur laquelle les premières politiques de développement furent mises en œuvre. Ainsi, la croissance et l’aide publique au développement seront considérées comme des réponses à la problématique du sous-développement. Les pays du Nord, alors bailleurs de fonds, vont soutenir la croissance économique des pays moins développés. Les premières théories comme la thèse du retard vont s’appuyer sur des données économiques comme variables centrales du développement en présentant une vision du monde basée sur l’industrialisation, la croissance économique et l’augmentation du revenu par habitant. Au plan idéologique, ces théories montraient la voie occidentale comme la solution évidente au sous-développement. Donc, la thèse du retard voyait le sous-développement comme la forme élémentaire ou embryonnaire du développement, un simple retard de nature essentiellement économique. Les mécanismes de croissance qui avaient assuré l’essor des pays industrialisés étaient considérés comme applicables aux pays sous-développés.
Les premières critiques de fond de ces conceptions simplistes de la croissance et du sous-développement ne tarderont pas à suivre dans un certain nombre de grands ouvrages qui feront date dans l’évolution de la connaissance des problèmes. Les données sociologiques du sous-développement seront au fil du temps mises en lumière et vont permettre une meilleure compréhension du phénomène du sous-développement. C’est à juste titre que Goussault affirme que « Le social de la sociologie […] n’est pas le champ des effets pervers de la croissance économique et de ses accompagnements humains » (Hours, 2007, p. 699). On remet donc en cause le revenu comme variable et unique mesure du développement. Le développement, alors synonyme de croissance économique selon l’approche rostowienne sera reconsidérée pendant les décennies 1960 et 1970, et le développement passera d’une notion purement économique à une notion économique et sociale.
Ainsi, la vision du développement s’élargit progressivement et s’éloigne de la pensée unique basée sur des variables économiques. L’idée selon laquelle le développement est davantage que la simple croissance économique ou l’augmentation des revenus fut promue par des chercheurs comme Seers en 1979 qui proposèrent une autre grille de lecture de la pauvreté et du développement. Plusieurs facteurs sont nécessaires selon Seers pour parler de développement, notamment un revenu suffisant, un emploi et l’accès l’éducation et à l’alphabétisation (Seers, cité dans Beaudet, Haslam et Schaffer, 2008 p. 12). Concernant la thèse du modèle hégémonique, W. Sachs va montrer que la vision hallucinatoire du développement a favorisé la pénétration des marchés intérieurs des pays sous-développés, et permis surtout aux Américains d’accéder à une hégémonie mondiale. Ainsi d’ajouter l’auteur, « la pauvreté augmentait dans l’ombre de la richesse; le chômage se révélait résistant à la croissance et les besoins alimentaires n’étaient pas comblés par les aciéries. Il devenait donc clair que l’identification du progrès économique au progrès social relevait de la fiction pure » (Sachs et Esteva, 1996, p. 19-20). Dans cet ordre d’idées, Jean-Pierre Olivier de Sardan constate qu’« il y a du pouvoir caché, parfois ouvertement présent derrière l’aide au développement » (Sardan, 2001, p. 736). Pourtant, le discours manifestement affirmatif de H. Truman, annonçant son Plan d’aide à l’Europe, n’avait rien de suspect. On a cru en l’ouverture altruiste d’un pays riche volant à la rescousse d’un continent en retard de développement.
Le développement selon Armartya Sen
Armartya Sen, prix Nobel, va également aborder le développement sans égard à la croissance et à l’augmentation des revenus. Il place son analyse sous l’angle de la prééminence des libertés politiques et de la démocratie, faisant de la satisfaction des besoins une mesure d’urgence. Son approche de la pauvreté est comprise comme une privation des possibilités d’émancipation. Par conséquent, l’augmentation du potentiel humain, la conscientisation des gens (l’habileté à faire prévaloir leurs droits et leur capacité à accéder aux ressources) est la clé du développement (Sen, 2000, p. 152-153). L’auteur intègre la notion de justice à la définition du développement grâce à la prise en compte de facteurs sociaux. Le développement comme acte de liberté et l‘économie au service du développement humain forment le nouveau paradigme économique élaboré par Amartya Sen. Les thèmes centraux de ce nouveau courant de pensée sont l’emploi, la lutte à la pauvreté et aux inégalités, les besoins fondamentaux, l’éducation, etc. En effet, selon Sen, le développement exige la suppression des principaux facteurs qui font obstacle aux libertés telles que la pauvreté, l’absence d’opportunités économiques comme les conditions sociales précaires ou l’inexistence de services publics. La libre initiative est donc chez Sen un élément constitutif du développement. Pour l’économiste, le développement est largement tributaire de l’engagement et de la manière dont les acteurs sociaux économiques exercent leurs libertés et leurs talents dans leur participation aux décisions politiques concernant leur milieu. Lorsque les savoirs locaux et les réalités locales sont ignorés ou considérés comme des obstacles au progrès rationnel, ils peuvent inspirer des conclusions analogues à celles formulées par le BAEQ pour relancer la Gaspésie sur la voie de la modernité. Prétextant l’absence de conditions justifiant l’implantation d’un pôle de croissance en milieu défavorisé, le BAEQ s’est attaché à une théorie modernisante et négligé l’écoute des besoins exprimés par les Gaspésiens lors de leur enquête/animation. Ainsi, le mode de fonctionnement et le génie de la société rurale ont échappé aux experts. Conséquemment, ils ont ignoré la capacité des agents à faire des choix rationnels. Bref, on a omis la capabilité des Gaspésiens à changer leur milieu.Dans la logique de Sen, c’est du développement à l’envers.Sen articule sa théorie du bien-être en fonction de la capabilité des personnes. Ainsi, l’élaboration des politiques sociales (l’élimination de la pauvreté) et l’évaluation du bien-être, de l’égalité, de la justice sociale devraient se fonder sur la capabilité des personnes, c’est-à-dire leur liberté réelle d’accomplir certains fonctionnements représentant des états et des actions constitutives au mieux-être (well-being). Les fonctionnements qu’évoque Sen, sont des actions que les personnes parviennent à réaliser comme lire, écrire, avoir un travail, être en bonne santé, avoir reçu une solide formation, participer à la vie de sa communauté et ainsi de suite. La pensée progressiste de Sen est en phase avec le fonctionnalisme sociologique et une vision systémique et totalisante de la société. La société forme un tout rassemblant des éléments interdépendants dans une logique globale et le développement résulte d’actions librement posées. L’ouvrage de l’économiste s’inscrit dans une dynamique de théorisation dans laquelle « il associe la rigueur théorique l’analyse concrète et s’attache à remettre en question les idées reçues » (Dostaler, 2016, p. 335). Sen va chercher à refondre les travaux des économistes classiques et néoclassiques en situant l’homme au centre des préoccupations. Il n’est plus question d’apporter des réponses d’efficacité économique, mais sur le plan d’exigences humaines, l’objectif essentiel du développement reste et demeure la réduction des inégalités et de la pauvreté. Selon la Banque mondiale, « les personnes pauvres vivent sans les libertés fondamentales de choix et d’action que les personnes mieux loties considèrent comme acquises » (Bénicourt, 2006, p. 440).
La conception du développement de la Banque mondiale, nullement gauchiste, est proche de celle de Sen, car pour lui, le développement est « un processus d’expansion des capabilités individuelles » (Bénicourt, 2006, p. 435). Tout comme François Perroux, Sen a cherché à montrer que la croissance n’est pas une condition suffisante pour parler de développement. Il apporte au débat, un angle de vue qui va transformer ou reconsidérer les moyens du développement et la compréhension qu’on en a même si les objectifs du développement restent les mêmes. Car, pour la plupart des théoriciens progressistes du développement, la réduction des inégalités et de la pauvreté demeure la priorité. L’approche par la capabilité introduite par A. Sen, a comme nature de pallier les insuffisances qu’il a décelées dans les approches utilitaristes et rawlsiennes de l’égalité (Bénicourt, 2006). Car on ne peut présupposer que le comportement des acteurs économiques et sociaux s’explique uniquement par la maximisation de leurs intérêts matériels. Le développement, selon Sen, renvoie à un processus beaucoup plus complexe, plus noble et multidimensionnel qui englobe le développement des potentialités humaines et l’engagement à lutter contre les inégalités.
Sans travestir la pensée du théoricien du développement humain, le développement est un processus par lequel toutes les potentialités de l’être humain sont mises en valeur. C’est un processus au cours duquel les libertés réelles des individus s’accroissent et les concepts comme bottom-up, « autodéveloppement » ou encore le « développement par la base », etc., vont émerger, d’autant que le but du développement est de leur offrir davantage d’options. La notion d’habilitation (empowerment) est ici centrale, car le développement en tant que « liberté » repose sur des « capabilités » humaines (bonne santé, éducation), sociales (appartenance sociale, capacité de s’organiser) et politiques (participation à la vie de sa communauté et la capacité à représenter les autres).
L’approche manichéenne
D’autre part, les structures mentales « archaïques » ont été souvent évoquées par les théoriciens de la modernisation pour expliquer les blocages du développement de l’Afrique. Leur approche manichéenne opposait terme à terme tradition et modernité comme jadis, l’opposition entre le bien et le mal. À ce propos, Philippe Hugon (1970) reconnaît que la force des traditions sociologiques anciennes peut expliquer que les sociétés africaines soient bloquées. De ce point de vue, Hugon (1970) rejoint Perroux (1966) dont la pensée tient à la fois du changement de structures mentales et d’habitudes sociales d’une population donnée. Alors que Hugon (1970) suggère plutôt l’étude des aspects non économiques pour décrypter les blocages, notamment en Afrique, Perroux (1966) admet pour sa part que les changements tant dans le système économique que dans les types d’organisation étaient également indispensables.Les programmes de développement régional dans le pur esprit de Perroux nous intéressent particulièrement. En effet, Perroux soutient que le développement des collectivités est très largement tributaire des processus d’innovation pour lesquels les pouvoirs publics jouent un rôle majeur (Beaudet, Haslam et Schaffer, 2008, p. 57). C’est pourquoi nous questionnons les politiques publiques pour comprendre les blocages du développement retard de certaines régions à l’intérieur des États développés.
Au Québec, et à l’échelon régional, on constate que le développement retard de la Gaspésie tient davantage du système économique d’antan (économie de subsistance), et des types d’organisation subséquents (domination du capital extérieur) que de structures mentales « archaïques » en soi. La Gaspésie rurale, longtemps appauvrie par une longue période de pêche sous la dépendance de l’élite anglo-saxonne est demeurée ancrée dans ses traditions ouvrières et incapables d’orchestrer une croissance endogène.La Gaspésie a longtemps fonctionné comme une économie fondée sur la rente morutière qui a freiné la diversification de l’économie de la région et par conséquent, son développement. La perte de vitesse de la pêche à la morue, épine dorsale des pêcheries gaspésiennes, ainsi que la faible production agricole, ont ensemble durablement assombri les perspectives d’avenir de la région. Depuis très longtemps assujettie aux logiques capitalistes d’enfermement dans une spécialisation primaire, la Gaspésie n’a pas été en mesure d’accumuler l’épargne rurale et agricole selon l’expression utilisée par Rostow pour insuffler un dynamisme à son économie locale. L’histoire économique régionale de la Gaspésie n’est qu’une composante de l’histoire économique du Québec tout entier, car le Canada français fut longtemps une société coloniale où le rôle du colonisateur fut successivement joué par la France, l’Angleterre, puis par le Canada anglais. Et même la province de Québec fut considérée au plan économique comme une périphérie par rapport à la province de l’Ontario qui, jadis, était le centre; leurs rapports politiques et économiques étaient donc structurés sur le modèle centre vs périphérie. Pas plus que les petites fermes et les PME québécoises n’ont fait le poids face à l’agriculture industrielle dans les prairies et la grande entreprise torontoise et ses environs.Des options politiques étaient donc nécessaires pour desserrer le carcan politico-économique, car « c’est de l’association entre l’action sur les hommes et l’action [exercée] sur les structures que [peut] se développer une action efficace de changement » (Ansart, 1995, p. 282-283). Les racines de la lutte nationale au Québec viennent de loin et elles furent surtout idéologiques. La théorie de la dépendance (dite de rupture) appliquée à la réalité nationale du Québec par les chercheurs canadiens-français va alimenter le débat entourant la lutte en faveur de la décolonisation tant économique, sociale, politique, que culturelle du Québec et de son émancipation du Canada anglais (Warren, 2005, p. 70). La ferveur nationaliste ouvre la porte du Québec sur la Révolution tranquille et la modernité. L’action publique de l’État se traduit par un ensemble de politiques publiques et de mesures (sectorielles et législatives) prises dans le but de restructurer et de moderniser la société québécoise. L’État s’est ainsi substitué au pouvoir du clergé dans la vie collective prenant en main plusieurs domaines comme la politique économique, l’éducation nationale, la santé publique, la démocratisation de la culture, etc. En s’inspirant des théories économiques de Keynes, l’État s’engage dans une démarche interventionniste et participe financièrement à des projets de relance économique. L’État s’érige en principal agent du développement et devient l’outil de planification économique inspiré du socle théorique de Keynes. L’intervention directe de l’État dans l’économie se manifeste concrètement par la nationalisation de l’électricité qui inaugure une autre phase de l’affirmation des pouvoirs publics dans le développement et l’aménagement du territoire québécois. Ainsi, René Lévesque, premier ministre d’alors, déclarait : « L’État doit être, dans le développement et l’émancipation économiques du Québec, plus qu’un participant. C’est nous seuls, par notre État qui pouvons devenir maîtres chez nous ». En 1976, il précise que « sur le plan économique, notre option fondamentale consiste à privilégier les instruments dont nous avons le contrôle (coopératives, État, capital québécois) à ceux dont la maîtrise nous échappe. Son idée est claire, « on ne peut miser uniquement sur un modèle capitaliste traditionnel pour assurer notre développement. Il faut compter sur les institutions d’État et avec le mouvement coopératif » (Lévesque, 1976, p. 13). À l’évidence Lévesque était keynésien.
En effet, Keynes soutenait que les problèmes économiques ne pouvaient être surmontés qu’en s’attaquant aux structures économiques sous-jacentes, laissant entendre une intervention vigoureuse de l’État dans l’économie (Beaudet, Haslam et Schaffer, 2008, p. 45). Pour revenir à l’échelon régional, la centralisation des pouvoirs entre les mains de l’État en matière de développement des régions ressources par des instruments des pratiques et des politiques qui sont définies, a fait peu cas des besoins des ruraux et des propositions des acteurs locaux et régionaux. Certaines régions, pour des histoires économiques différentes, n’ont pu asseoir leur développement économique parce que l’approche du développement régional dont sont porteuses les politiques publiques n’était rarement, sinon jamais, précédée d’analyses empiriques à partir des réalités socioéconomiques des régions concernées. La dépendance économique et l’assistanat que ces politiques publiques structurantes ont généré n’ont pas permis à certaines régions de prendre de front la territorialisation de l’action publique ni favorisé la participation étroite de l’État à l’essor des régions ressources du Québec.
Les disparités interrégionales au Québec vont inspirer les politiques de développement régional visant le rattrapage économique des régions « pauvres », mais surtout oubliées du gouvernement, par rapport aux régions riches. Selon Hours (2007) « le développement est à la fois une aspiration, un programme, une exigence » (Hours, 2007, p. 701). Les gouvernements québécois ont à cet effet adopté une batterie de mesures nationales destinées à réduire les inégalités interrégionales. Le développement régional du Québec reposait sur une préoccupation essentiellement économique, à savoir l’emploi. Ainsi, les politiques à relent économique ont cherché à favoriser la croissance au détriment de l’équilibre régional. Les gouvernements successifs ont estimé que le développement économique se diffuserait vers les régions ressources à partir des pôles urbains. Ces choix institutionnels ont été déterminants dans la tendance à la concentration des activités économiques, notamment dans la région de l’île de Montréal et dans une moindre mesure, dans la région de Québec.La recension des écrits sur le développement permet de voir qu’il y a deux perspectives traditionnelles : la première d’inspiration marxiste, et la seconde d’inspiration libérale. Plusieurs modèles de développement ont été élaborés selon ces deux perspectives qui ont longtemps constitué un champ de recherche conflictuel et un débat théorique. Le développement est une problématique qui ne concerne pas que les pays du tiers-monde, mais toutes les sociétés, et les problèmes sociaux sont différents au Nord et au Sud. Parler de développement, est-ce parler d’alternatives ou s’agit-il d’une manière de faire pénétrer le capitalisme partout? L’économique est-il le plus important?Certes, les données économiques jouent un rôle déterminant en matière de développement. En effet, quand bien même le paradigme de la modernisation intègre différentes disciplines, il reste axé sur l’économie. Le développement vu alors comme un processus de rattrapage culminait avec le discours sur la modernisation; un discours axé sur l’autolégitimation du modèle américain, et sur la diffusion messianique de ce modèle à toutes les nations. Les théories de la modernisation ont fourni une base théorique à la promotion du modèle américain. Ainsi, le modèle de développement des sociétés industrielles avancées devient omniprésent, voire incontournable, dans la réalité des pays sous-développés. Le développement s’est donc imposé aux sociétés humaines et repose pour l’essentiel sur le fameux trickle down effect » ou l’« effet de retombées » (Latouche, 2004, p. 78). Et « la croissance est présentée grâce au trickle down effect, comme le remède miracle aux inégalités » (Latouche, 2004, p.81).
Il faut bien reconnaître que le trickle down effect souvent posé en dogme dans l’économie dominante est contredit dans la réalité, car l’effet de ruissellement fort recherché qui résulterait des changements économiques tarde à venir ou ne vient pas du tout. Donc, le trickle down effect ne devrait plus être considéré comme une réponse adéquate aux problèmes de disparités économiques régionales. Dans cet ordre d’idées, de nombreux auteurs dont Rist, Latouche, Escobar sont sans ménagement envers le concept de développement tout court, car il fonctionne selon eux « comme un instrument idéologique ». Gilbert Rist démystifie le concept en le qualifiant de fiction collectivement partagée et entretenue pouvant l’emporter sur la réalité des pratiques et de leurs conséquences, et le gratifie de violence symbolique d’une croyance (Rist, 2003). La charge de Serge Latouche est tout aussi percutante : « Le développement constitue à la fois une imposture conceptuelle, en raison de sa prétention universaliste, et une imposture pratique, en raison de ses contradictions » (Latouche, 2004, p.73). Escobar n’est guère plus rassurant, pour qui ce concept, porte en lui, l’empreinte de constructions néocoloniales du monde. Devant ces contradictions et ces paradoxes, dont ceux rattachés la création de besoins, à l’accumulation du capital, à la croissance et à la création d’emploi, Latouche suggère simplement de sortir du développement, parce que le développement et l’économie participent du problème, et non de la solution (Latouche, 2004, p. 89). Un certain langage [savant] présente le développement comme étant synonyme de progrès parce qu’il engendre le changement social et le moteur de ce changement, est la croissance économique. Selon plusieurs auteurs le développement ne peut prendre la forme d’un modèle unique, car les valeurs sur lesquelles il repose ne correspondent nullement à des aspirations universelles profondes. C’est pourquoi on a pu évoquer les théories sociologiques de la modernisation avec des changements sur le plan des structures sociales pour amorcer des « styles de développement ».
D’un autre côté, des auteurs comme René Dumont, Samir Amin, Axelle Kabou et Alain Touraine, refusent de considérer le développement comme un phénomène de retard à rattraper, qu’il est abstrait, fonctionnel et situé en dehors de l’histoire. D’autres comme Celso Furtado, Cardoso et A. Gunder Frank, ont critiqué les mécanismes de la dépendance structurelle liés au développement. G. Balandier prévient, pour sa part, de l’ambiguïté et l’ambivalence » et les « dogmes » du développement (Balandier en 1971, cité dans Misse, 2014). Dans une perspective sociologique, Jean-Pierre Olivier de Sardan suggère d’éviter des jugements de valeur sur le développement, et de proposer un point de vue qui tienne compte du concept comme d’un objet auquel l’anthropologie académique devrait accorder une grande attention, car il met en jeu représentations et pratiques, stratégies et structures, acteurs et contextes (Olivier de Sardan, 2001, p. 730).
Une littérature pléthorique traite du développement. Or, ce terme est ambigu et son sens varie selon les auteurs. Il reste que la notion de développement est promue au statut de règle universelle et « l’autorité du concept, son universalisme actuel et notamment son attrait tant au Nord qu’au Sud témoignent de l’aveuglante évidence sur laquelle repose son pouvoir aliénant » (Legouté, 2001, p. 12). Les remises en question du développement se poursuivent parce qu’il y a une connotation économique présente à l’origine même du concept de développement qui prend de l’ascendant sur les autres dimensions. Or, le développement d’une société nécessite une perspective historique et institutionnelle plus large que l’analyse économique stricto sensu. Et c’est cette absence de perspective qui explique en grande partie l’échec de la plupart des stratégies de développement. En faisant l’impasse sur les liens qu’entretiennent les acteurs de la société civile avec leur territoire ainsi que sur les structures sociales locales, les stratégies de développement économique inspirées de modèles théoriques ont, pour la plupart, échoué. D’ailleurs, les acteurs du développement sont parfois conscients du manque de prise de décision fondée sur les faits.
Sociologie du développement
Il faut rappeler que la réflexion sur le sous-développement s’est amorcée à partir de la situation qui prévalait dans les pays pauvres. Pour sortir ces pays du sous-développement, il fallait, n’en déplaise à Latouche, entrer dans le développement, donc, dans la modernisation. Le phénomène du développement qui a consacré la réflexion et la pratique interdisciplinaires est un sujet d’étude central et un enjeu théorique et politique avec l’émergence au plan international de ce que l’on a nommé le sous-développement. Au début des années 60, le sous-développement se définit comme suit : « l’ensemble des blocages qui empêchent le processus d’industrialisation et d’amélioration du niveau de vie de se réaliser dans un pays » (Deubel et collab., 2008, p. 481). Il s’agit d’un phénomène global qui ne peut être analysé de manière valable que par la coopération de toutes les sciences sociales (économie, sociologie, démographie, anthropologie géographique et humaine, psychologie, etc.), car aucune n’est en mesure de fournir elle seule une explication complète (Freyssinet, 1966, cité dans Lombard, 1982, p. 246). Concernant la sociologie du développement, elle a été sollicitée pour mettre en évidence les changements économiques qui doivent favoriser les changements de structure sociale, 60 puis les changements de mentalités (Bastide, 1971, cité dans Lombard, 1982, p. 247). Le problème du développement va donc mobiliser les chercheurs autour de l’aspect économique comme élément explicatif du sous-développement. Donc, ils vont tous orienter leur réflexion sur le problème à partir du champ économique, et ce, au cours des décennies d’avant soixante-dix. D’ailleurs la majeure partie des travaux sur le développement situaient la problématique autour des thèmes de la production, de l’accumulation, de la croissance, et ce, sans référence directe à la sociologie.De son côté, la sociologie n’était pas apte à mener une réflexion approfondie du domaine économique et va alors afficher son handicap majeur par rapport à l’économie. Lombard (1982) fait remarquer que Le Traité de Sociologie, publié sous la direction de G. Gurvitch, était l’œuvre d’économistes, et que pas un seul sociologue spécialiste d’économie n’y figurait. Les économistes du développement selon de Kadt ont même souvent mieux construit leur propre démarche sociologique que les sociologues en dehors du champ du « service social » et des relations industrielles (de Kadt, cité dans Lombard, p. 249). Où en est [alors], la sociologie du développement, s’interroge Y. Goussault, qui nuance par ailleurs l’affirmation de Kadt en reconnaissant non seulement des acquis et potentialités de la sociologie du développement, mais aussi ses aspects aléatoires : insuffisante détermination de son champ, de ses méthodes et de ses références théoriques [etc.] » (Goussault, 1982, p. 238). Les conditions d’émergence de la sociologie du développement sont liées à des aspects économiques des années soixante qui ont marqué les réalités sociales des pays de la « périphérie » (Goussault, 1982, p. 238).La sociologie du développement n’aurait d’autre définition qu’une sociologie au-devant des questions posées par le sous-développement. Le sous-développement n’a pas que des causes économiques, il a aussi des origines non économiques qui intéressent autrement plus la sociologie du développement. Si dans les pays du tiers-monde, on a entre autres évoqué les facteurs socioculturels comme une entrave au développement, alors quels facteurs pourrait-on évoquer pour expliquer la situation des régions en retard de développement dans les pays développés? Pourrait-on réduire le processus de développement de ces régions à de seules conditions économiques et/ou institutionnelles? Même si la réponse à cette question est complexe, les régions en retard de développement répondent elles aussi à la définition suivante du sous-développement.
Le sous-développement se définit comme l’ensemble des blocages qui empêchent le processus d’industrialisation et d’amélioration du niveau de vie de se réaliser dans un pays » (Deubel et collab., 2008, p. 431). La première démarche serait alors d’identifier les blocages (économique, culturel, institutionnel, etc.) qui sont et demeurent une entrave au développement des régions en retard.
Les théoriciens néoclassiques et les keynésiens vont, pour leur part, mettre l’accent sur les blocages économiques, et vont poser les problèmes de développement relativement à la croissance et aux imperfections de marchés. D’un autre côté, on fera appel à la sociologie, l’anthropologie et l’ethnologie du développement pour analyser la dimension sociale du développement. La pluralité des études conduira à l’élargissement du champ de l’économie néoclassique, et de manière pragmatique les stratégies de développement vont converger sur le rôle de l’industrie et de l’État (le keynésianisme interventionniste). Les débats deviennent théoriques et conceptuels, et parfois fragmentés, selon différentes écoles appartenant à une même tradition sociologique. Soulignons quelques spécificités des pensées francophones et anglo-saxonnes en matière de développement. La pensée économique anglo-saxonne est pragmatique, empiriste et va privilégier l’individualisme méthodologique. En effet, l’intérêt de la communauté doit se comprendre comme la somme des intérêts individuels, et ce, à la suite de la réflexion menée par Adam Smith qui, d’une certaine façon, a façonné la pensée économique moderne du monde anglo-saxon. La pensée économique francophone se méfie pour sa part de l’empirisme, et sera plutôt critique et philosophique, holiste et hypothético-déductive.
La pensée économique anglo-saxonne dominante de l’après-guerre était dans la lignée de Keynes, qui lentement s’implantait au Québec. Mais, la décrue de l’hégémonie keynésienne après la Révolution tranquille va conduire à l’essoufflement du Welfare state (État providence), alors mis à mal par les changements de stratégie de l’État en matière de développement. Les politiques néolibérales qui suivirent auront comme conséquence le maldéveloppement notamment dans les régions rurales.
Certes, « dans l’après-guerre, le développement s’est fait « régional » [et appréhendé] comme un processus descendant [top-down], stratocentrique et d’inspiration keynésienne » (Fournis et Dumarcher, 2016, p.12-13). Mais « le nouveau style de développement, qui s’oppose au maldéveloppement, suppose un modèle endogène, une autonomie de décision, la satisfaction des besoins et la prudence écologique » (Hugon, 2008, p. 43), car le développement [contemporain] est d’abord et avant tout endogène et autodéterminé supposant la prise en compte d’un nouvel ordre social juste et équitable porté par un processus de choix démocratique. Albert Hirschman et François Perroux faisaient, pour leur part, la promotion de la croissance déséquilibrée afin de susciter par la suite une croissance généralisée par des effets d’entraînement et de liaison alors que d’autres, comme Ragnar Nurske et Paul Rosenstein-Rodan, considéraient qu’il faut développer une croissance équilibrée par la répartition des investissements dans toutes les branches industrielles afin d’éviter tout déséquilibre. Mais pour Olivier de Sardan, le développement économique est un processus historique déséquilibré, constitué « d’enjeux sociaux importants au niveau local comme au niveau national, et il est tissé d’interactions entre des acteurs relevant de mondes sociaux et professionnels particulièrement hétérogènes » (Olivier de Sardan, 2001, p. 731).
|
Table des matières
INTRODUCTION
Justification de l’étude
Éléments clés de l’étude
Objectif et organisation de la thèse
Objet de recherche
Justification de l’objet de recherche
Chapitre I Le problème du développement de la Gaspésie
1.1 Énoncé du problème
1.1.1 La sous-scolarisation
1.1.2 La stigmatisation
1.1.3 L’infrastructure diocésaine
1.1.4 La rénovation sociale
1.1.5 La mise à l’agenda du développement régional
1.1.6 L’objet de recherche par rapport aux travaux antérieurs
1.2 Question de recherche et hypothèse de travail
1.2.1 Positionnement théorique et question de recherche
1.2.2 Hypothèses de travail
Chapitre II Sociologie du développement et politiques publiques
2.1 Le cadre conceptuel et théorique
2.1.1 Les grands penseurs du développement
2.1.2 Sociologie du développement
2.1.3 Dimension économique du développement
2.1.3.1 Quelques approches du développement
2.1.3.2 Modèle de développement
2.1.4 La dimension politique du développement
2.1.4.1 L’influence partisane
2.2 Qu’est-ce qu’une politique publique?
2.2.1 Éléments constitutifs des politiques publiques
2.2.1.1 Identification formelle des politiques publiques
2.2.1.2 La mise en oeuvre des politiques publiques : la décentralisation dans tous ses États
2.2.1.3 La décentralisation administrative
2.2.1.4 La délégation
2.2.1.5 La décentralisation politique
2.2.2 Cadre d’analyse des politiques publiques
2.2.2.1 Efficacité des politiques publiques
2.2.2.2 Le système d’acteurs dans l’élaboration des politiques
2.2.2.3 Modèle séquentiel de la politique publique
2.3 Conclusion
Chapitre III Cadre méthodologique
3.1 La monographie
3.2 La « pensée bricoleuse »
3.3 Instruments d’observation et collecte de l’information
3.3.1 L’observation documentaire
3.3.2 Les sources documentaires classiques
3.3.3 L’observation directe
3.3.4 L’observation indirecte
3.3.5 Des indicateurs sociographiques
3.3.6 Les journaux régionaux
3.3.7 L’objectif des entretiens compréhensifs
3.4 L’apparition du sujet, de l’agent et de l’acteur
3.5 Conclusion
Chapitre IV Genèse et persévérance du malaise gaspésien
4.1 Introduction
4.2 Une région en difficulté
4.3 Les Micmacs : l’économie de subsistance
4.4 Conflit entre Gaspésiens et Acadiens : réel ou imaginaire?
4.5 Présence française : développement vs peuplement
4.5.1 Des marchands venus d’Europe
4.5.2. Deux entrepreneurs s’imposent
4.5.3 Pierre-Denis de La Ronde
4.5.4 Denis Riverin, l’homme de la Gaspésie du Nord
4.6 La Gaspésie sous domination anglo-normande: l’empire Robin
4.6.1 Monopole et subordination
4.6.2 L’assujettissement par le troc
4.6.3 La Révolte
4.6.4 La répression
4.6.5 La société gaspésienne s’organise
4.7 Le malaise contemporain
4.7.1 La hantise du dépeuplement
4.7.2 Sentiment général de crise
4.7.3 Les Trente Glorieuses (1945-1975)
4.7.4 Le malaise prend forme
4.7.5 L’expression discursive de la crise
4.7.6 La grande marche de 1957
4.7.7 Forillon, le traumatisme
4.7.8 Chandler 1991
4.7.9 Sainte-Anne-des-Monts 2007
4.8 Conclusion
Chapitre V Sociographie de la région gaspésienne
5.1 De quelle région parle-t-on?
5.1.1 Gaspésie, une et divisible
5.1.2 La région géospatiale
5.1.3 Le multiethnicité gaspésienne
5.1.4 La région culturelle et identitaire
5.1.4.1 Pauvre, mais divertissante
5.1.5 La région économique et sociale
5.1.5.1 La région sociale
5.2 Sociographie
5.2.1 Le langage des chiffres
5.2.2 Une crise démographique
5.2.2.1 Indice de fécondité
5.2.2.2 Le vieillissement
5.2.2.3 Espérance de vie
5.2.3 Une crise économique
5.2.3.1 Les fondements de l’économie
5.2.3.2 Le produit régional brut
5.2.3.3 Le revenu disponible par habitant
5.2.3.4 Indicateurs de la population active
5.2.3.5 Indicateurs du niveau de scolarité de la population
5.2.4 Conclusion
Chapitre VI Les modèles économiques portant sur la Gaspésie jusqu’à la Révolution tranquille
6.1 Le catholicisme social
6.1.1 Ross, « le libérateur »
6.1.2 Désenclaver la péninsule
6.1.3 Formation des agriculteurs et des pêcheurs par l’action collective
6.1.4 L’arrimage de la terre et de la forêt
6.1.4.1 Plans Vautrin et Gordon-Rogers
6.1.5 Le rayonnement politique de Ross
6.2 La restauration sociale et le modèle minvillien
6.3 L’expérience de Grande-Vallée
6.4 Le Keynésianisme et les politiques publiques des années 1940 à 1960
6.4.1 Godbout et le réformisme libéral
6.4.2 Le règne de Maurice Duplessis
Chapitre VII Les modèles contemporains de développements
7.1 Des gestes d’émancipation
7.1.1 La Révolution tranquille (1960)
7.1.1.1 « Le début d’un temps nouveau »
7.1.1.2 Démocratisation de l’éducation
7.1.2 Modernisation de l’État et développement économique
7.1.3 « New public management » et « public value »
7.2 Le modèle économique du BAEQ
7.2.1 L’animation de la controverse
7.2.2 Gaspésie, la « sous-région »
7.2.3 Les « villages sacrifiés »
7.2.4 Politiques publiques et développement régional
7.3 Le gouvernement Bourassa I : La création d’emplois
7.3.1 Encadrer le développement
7.4 La concertation, développement par le bas
7.4.1 Des initiatives venues de l’Est
7.4.2 Le rôle du gouvernement fédéral dans le développement régional
7.5 Le modèle Higgins-Martin-Raynauld (HMR)
7.5.1 Montréal, pôle de croissance
7.6 Le gouvernement René Lévesque
7.6.1 Développement économique et décentralisation
7.6.2 Lévesque, ministre d’État
7.6.3 La symphonie inachevée
7.6.4 Début de l’occupation du territoire : Les MRC
7.7 Le gouvernement Bourassa II : La concertation
7.7.1 L’entrepreneuriat régional
7.7.2 L’État Partenaire, l’État Provigo
7.8 La Réforme du ministre Picotte
7.8.1 L’État partenaire : Stratégies horizontales et verticales
7.8.2 Stratégie horizontale et verticale : l’ambiguïté
7.9 Gouvernement Parizeau
7.9.1 Développement par le bas
7.9.2 La société civile, acteur du développement local
7.9.3 Accueil favorable
7.10 Gouvernement Charest : réinventer l’État et la région
7.10.1 Nouveau paradigme : La région comme acteur
7.10.2 Le partenariat
7.10.3 Les CLD sous tutelle
7.10.4 Le CLD de la Haute-Gaspésie, version 2003
7.10.5 La Conférence régionale des Élus (CRÉ) ou la fin des illusions?
7.11 Pauline Marois sur les traces de Bernard Landry
7.11.1 Plan de relance: un engagement gouvernemental
7.11.2 La Stratégie économique du gouvernement Marois
7.11.2.1 Une approche sociale-démocrate?
7.11.2.2 Des exemples
7.12 Commentaires sur les fondements des politiques publiques
7.12.1 Continuité et rupture
7.12.2 Le développement local dans la tourmente des politiques publiques
7.12.3 En 2014, la rupture
7.12.4 Institutionnalisme et encadrement du développement
7.12.5 La construction du modèle institutionnel
Chapitre VIII Développement et innovation sociale : le retour de l’acteur
8.1 L’engagement des acteurs
8.1.1 La mission sociale des acteurs
8.1.2 L’orientation du développement selon la TAE GÎM
8.1.3 L’entrepreneuriat, une culture en développement
8.2 Innovation sociale et entrepreneuriat
8.3 L’entrepreneuriat social innovant
8.3.1 État du projet
8.4 Le modèle endogène
8.4.1 L’opposition top-down – bottom-up
8.4.1.1 Les étapes
8.4.1 Modèle hétérodoxe de développement
8.4.2 Changement de paradigme
8.5 Le tandem État-MRC
8.6 Le savoir local
8.7 La formation permanente
8.8 Le capital patient
8.8.1 Le réengagement de Desjardins en Gaspésie
8.9 Péréquation interrégionale et protection du territoire
8.9.1. Pauvreté et justice sociale
8.9.2 La protection du territoire
8.9.3 La politique nationale sur la ruralité
8.10 Conclusion
CONCLUSION GÉNÉRALE
BIBLIOGRAPHIE
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet