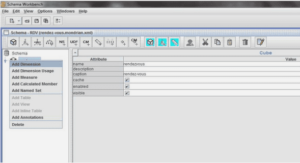Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Direction Etudes Economiques et Statistiques (DEES)
La Direction Etudes Economiques et Statistiques où nous avons effectivement réalisé notre recherche et avons acquis des connaissances non négligeables à notre formation, a pour mission de suivre l’évolution des prix pétroliers et de la conjoncture économique internationale et nationale, de suivre l’approvisionnement nationale en produits pétroliers, de gérer et maintenir à jour les bases de données relatives aux flux d’hydrocarbures et aux installations. Ses missions nous ont permis d’orienter notre thème sur le secteur pétrolier aval : la vérité de prix est-elle une réalité à Madagascar ?
Direction Administrative et Financière (DAF)
La DAF est chargée de l’Administration générale interne de l’OMH. Elle veille au bon fonctionnement de l’office. A ce titre, elle est chargée d’assurer la gestion optimale des ressources humaines, financières et matérielles del’office.
Direction Réglementation et Coordination (DRC)
La DRC est responsable de l’élaboration des divers textes réglementaires du secteur, des activités juridiques et de la coordination des activités du siège avec les délégations régionales. Elle est également chargée du suivi et de l’évaluation des ctivitésa de l’OMH ainsi que de la communication interne et externe de l’office.
Direction Normalisation et Contrôle (DNC)
La DNC a pour attribution l’édiction des normes techniques applicables aux installations et produits pétroliers à Madagascar, le contrôle de la qualité des produits mis à la commercialisation et également le contrôle des installations.
Eventuels comportements des sociétés de distribution pétrolière
Compte tenu de la structure du marché décrite précédemment, les décisions des entreprises présentes dans le marché pétrolier malgache sont terdépendantesin. Chaque compagnie sait que ses choix, en prix ou en quantités, influenceront ceux des autres, et qu’elle subira à son tour les effets des décisions prises par ses concurrents.
En ce qui concerne les prix, deux types de phénomènes sont souvent observés : une rigidité considérable, due « peut être », à des formes diverses d’ententes 12 ou bien, au contraire, des « guerres de prix13 », se traduisant par des fluctuations brusques et fréquentes, à la hausse comme à la baisse.
La multiplicité des comportements possibles de ces compagnies et la difficulté de prendre en considération toutes les réactions éventuelles desconcurrents, ne permettent pas de trouver une théorie générale susceptible de déterminer l’équilibre du marché malgache.
Une illustration inspirée de la théorie des jeux fera comprendre les difficultés de construire cette théorie générale. GDP, Jovenna, Total et SMPS ne peuvent pas se communiquer entre elles, compte tenu de la législation malgache. Devant procéder simultanément à une augmentation de leurs prix à la pompe suite à une hausse du coût de s importations, ils sont confrontés à une demande relativement élastique .
Comportement coopératif
Les conditions d’oligopole du marché pétrolier malagasy sont telles qu’elles facilitent un accord entre les compagnies de distribution qui en font partie. Ces dernières ont intérêt à établir en commun15 un prix qui assure le maximum de profit pour l’ensemble de l’industrie plutôt que d’adopter des prix individuels. C’est ainsi que d’u ne part, une rigidité apparente des prix à la pompe est quelques fois constatée malgré la baissedes principaux paramètres16 des prix (cf. figure n°2 ci-après).
Les marchés physiques au comptant
On distingue autant de types de pétrole brut que de gisements. Toutefois, il n’y a que 7 principaux marchés physiques qui reflètent chacun les prix de plusieurs bruts. Le marché de Rotterdam est le plus important, il traite des pétroles bruts et des produits du pétrole.
Le marché méditerranéen traite des bruts d’origine russe, libyenne ou iranienne. Les qualités y sont hétérogènes (aussi bien des doux que des sulfurés, des légers que des lourds).
Le marché du Golfe du Moyen-Orient traite essentiellement des bruts de la République d’Oman et des Emirats Arabes Unis. Les bruts d’Arabie Saoudite sont peu vendus sur ce marché physique. Le marché de l’Extrème Orient importe la majorité de ses bruts depuis le Moyen Orient. Il traite de manière limitée les exportations de bruts d’origine malaysienne et indonésienne.
Le marché des Etats-Unis traite la grande majorité des pétroles produits aux Etat-Unis dont le West Texas Intermediate (WTI), l’Atlantic North Slope (ANS) et quelques origines d’Amérique latine.
Le marché de la Mer du Nord est composé des origines de la Norvège et du Royaume-Uni presque exclusivement, dont le Brent est le plus traité.
Le marché d’Afrique de l’Ouest traite une partie de ses exportations pour les bruts du Nigeria (Forcados et Bonny Light) et de l’Angola bien que la majorité des bruts d’origine africaine sont négociée en référence à certains contrats à terme.
Les produits du pétrole sont traités en tout premier lieu sur le marché de Rotterdam. Néanmoins, plusieurs marchés régionaux sont également importants : le marché de Singapour, celui du Golfe Persique, celui de la zone Méditerranéenne et celui du Golfe du Mexique. La position géographique de ces marchés est à mettre en relation avec les capacités de raffinage de ces zones (soit a contrario une faible capacité et donc pas de marché pour l’Afrique par exemple).
Depuis les années 1970 et la nationalisation des moyens de production de pétrole brut, la vente de brut s’opère soit d’Etat à Etat, soit par contrat d’Etat à société pétrolière, soit d’Etat à négociant qui revend le pétrole sur les marchés mondiaux. Ces stratégies de commercialisation font le plus souvent références à des formules de prix basées sur les cours internationaux. Depuis le milieu des années 1990, les prix des marchés physiques qui servaient de référence, sont de plus en plus souvent remplacés par les cours négociés sur les marchés à terme.
La formation des prix
Depuis la fin des années 1980, les prix indiqués dans les contrats commerciaux du pétrole brut sont généralement déterminés par une formule spécifique au brut vendu. Cette formule est basée sur un ou plusieurs cours de référence. Par exemple, une formule simple pour obtenir le prix d’un brut X pourrait être la suivante : Prix brut X = Prix brut référence + Différentiel.
Le différentiel ou facteur d’ajustement dépend de plusieurs variables, différence de qualité, différence de possibilités au raffinage et différence de coût du transport.
La formule utilisée pour calculer le prix du brut X est donc déterminée par quatre facteurs :
– Le point de vente (qui influe sur le coût du transport) .
– le choix du prix de référence (ce choix est souvent dicté par la destination et la qualité du brut vendu : un brut léger et doux à destination de l’Europe aura comme prix de référence le Brent, à destination des Etats-Unis la référence sera le West Texas Intermediate) .
– un facteur temps qui renvoie à l’intervalle de temps entre la date de chargement et la date où le prix est définitivement fixé .
– un ajustement correspondant à la différence de qualité et de lieu de livraison par rapport au brut de référence.
Les bruts internationaux de référence
Le prix du Brent est généralement la référence mondiale bien que les volumes échangés soient bien en-dessous de ceux du Saudi Arabian par exemple. D’après l’Intercontinental Exchange, le prix du Brent est utilisé pour fixer le prix des deux tiers des pétroles bruts vendus mondialement. Dans le Golfe Persique, le brut Dubaï est utilisé comme référence pour fixer le prix de vente d’autres bruts de la région à destination de l’Asie. Ceci est dû au fait que le Dubaï est l’un des rares brut vendu dans le Golfe Persique qui soit vendu au comptant et au « détail » alors que bon nombre d’autres bruts sont liés par des contrats de vente à long terme.
Aux Etats-Unis, le brut servant de référence pour les transactions est le West Texas Intermediate (WTI). Cependant, les prix cotés au New York Mercantile Exchange font aussi référence à un brut « fictif » qualifié de « light sweet crude » qui peut être n’importe quel brut américain ou étranger qui répond aux caractéristiques d’un brut léger et doux.
Jusqu’en 2005, le panier OPEP donnait un prix de référence calculé par l’OPEP à partir de sept prix de bruts produits par ses Etats membres : Arab Light d’Arabie Saoudite, Dubaï des Emirats Arabes Unis, Bonny Light du Nigéria, Saharan Blend d’Algérie, Minas d’Indonésie, Tia Juana Light du Vénézuela et Isthmus du Mexique. Lorsque l’OPEP publiait ses objectifs en terme de prix, elle fait référence à ce panier.
|
Table des matières
Partie I ANALYSE QUALITATIVE
Chapitre 1. PANORAMA DU SECTEUR PETROLIER AVAL
A. Vue d’ensemble de l’environnement après la privatisation
1. Brève présentation de l’OMH
a- Direction Etudes Economiques et Statistiques (DEES)
b- Direction Administrative et Financière (DAF)
c- Direction Réglementation et Coordination (DRC)
d- Direction Normalisation et Contrôle (DNC)
2. Ressources
B. Structure du marché pétrolier malgache
1. Nature de la concurrence dans le marché pétrolier malgache
2. Eventuels comportements des sociétés de distribution pétrolière
a- Comportement coopératif
b- Comportement concurrentiel
Chapitre 2. Revue contradictoire des littératures sur la vérité de prix et l’oligopole
A. La vérité de prix
1. Bref rappel
2. Synthèse illustrée des résultats des principaux travaux d’analyses axés sur la formation des prix dans divers marchés pétroliers.
B. Le prix, le rendement et les ventes en oligopole vus par des Grands Auteurs
1. Bref rappel
2. L’équilibre de Cournot et les imperfections de Christoph Kolm
3. La règle du prix focal d’Eastman et Stykolt
4. Concurrence Imparfaite et variabilité du Taux de Marge
Conclusion transitoire
Partie II ANALYSE QUANTITATIVE
Chapitre 1. La structure des prix à la pompe
A. Les déterminants des prix à la pompe des produits pétroliers à Madagascar.
1. Les prix internationaux du pétrole brut
a- Les marchés physiques au comptant
b- La formation des prix
c- Illustrations
d- Les prix de référence
i- La collecte des prix.
ii- Les bruts internationaux de référence
iii- Les cotations sur les marchés à terme
2. Le taux de change
a- Approche générale
b- Le système de change
c- La relation entre le taux de change et le prix des produits pétroliers
B. Les principales composantes des prix à la pompe
1. Prix Référence Frontière (PRF)
2. Passage Logistique
3. Frais et Marge de Distribution
4. Taxes & Redevances
C. La structure moyenne des prix de janvier 2002 à novembre 2010
Chapitre 2. Modélisation et analyse
A. Construction du modèle
1. Emission des hypothèses
2. Définition des variables
3. Méthode d’évaluation
4. Le taux de change pass through
B. Résultats et discussions
1. Vérification des hypothèses
a- Hypothèse H1 ou corrélation entre X et W
b- Hypothèse (H2) ou corrélation X-Y
c- Hypothèse H3 ou corrélation W-Z
2. Discussions et recommandantions
CONCLUSION
ANNEXES
LISTE DES HYPOTHESES
LISTE DES TABLEAUX
LISTE DES FIGURES
LISTE DES ABREVIATIONS
BIBLIOGRAPHIE ET WEBLOGRAPHIE
Télécharger le rapport complet