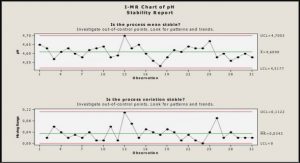Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
LA GEOLOGIE
La géologie de la Commune de Ndiaganiao s’inscrite dans celle du département de Mbour qui appartient au bassin sédimentaire Sénégalo-mauritanien. Ce bassin présente environ une superficie de 340000km2 et couvre la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie et la Guinée Bissau.
Le département Mbour est couvert par l’éocène inférieur (Yprésien) avec le dépôt de marnes à attapulgite et sépiolite. L’Yprésien se poursuit par un calcaire dur, rose à intercalation marneuse ; sous des recouvrements quaternaires. L’histoire géologique de Mbour sera dès lors presque exclusivement continentale, mise à part quelques transgressions quaternaires. La fin du tertiaire est marquée par le dépôt du continental terminal sous un climat aride. Un retour à des conditions tropicales humides au pliocène supérieur provoque la formation d’une cuirasse latéritique.
Le quaternaire ancien est marqué par une alternance de climats arides et pluvieux. Ces alternances de phases sèches et humides ont façonné un glacis d’épandage gravillonnaire avec une sédimentation partielle de granules ferrugineuses (BASSENE, 2000).
La transgression Inchurienne n’a laissé semble- t-il aucune trace dans la région de Mbour. Puis intervient une période de régression importante sous un climat subaride, marquée par le creusement des vallées dans le substratum éocène.
La transgression Oulipienne pénètre entre les dunes rouges jusqu’au niveau plus 5m, remaniant les sables et argiles d’altération ; elle est jalonnée par une lumachelle à arcasouillis (BASSENE, 2000). La régression pré-flandrienne, peu importante durant une période plus aride est marquée par le dépôt de dunes jaunes continentales et le remaniement des dunes rouges. La petite transgression flandrienne, enfin, voit le dépôt des minéraux lourds et la mise en place du cordon dunaire littoral dunkerquien. Ainsi, le relief est mollement ondulé, subhorizontal. Il s’agit d’un glacis à pente très faible entaillé par l’érosion.
L’HYDROGRAPHIE ET HYDROGÉOLOGIE
L’hydrographie
L’hydrographie de la collectivité locale de Ndiaganiao n’est pas tellement développée et est caractérisée par l’absence de cours d’eau pérennes à l’exception du bas fond de Nay Guityr. Le réseau hydrographique est saisonnier et dépend de la pluie. La Commune compte beaucoup de mares temporaires. La répartition des mares dans les bas fonds matérialise la désorganisation du réseau hydrographique typique du sahel avec l’apparition du phénomène d’endoréisme dû à la segmentation du réseau. Les bas fonds de Ndiaganiao appartiennent au bassin du Tararé qui est aujourd’hui une vallée fossile du bassin arachidier dont l’évolution des composantes, selon Sarr (2007), est « liée à la dynamique morphopédologique, avec le comblement de la vallée. Les bas fonds du Tararé correspondent aux reliques d’un réseau hydrographique qui a drainé pendant longtemps le bassin versant, aujourd’hui vallée fossile ».
Les mares contribuent à l’approvisionnement en eau du bétail et des exploitants maraichers et sont représentées à Sandock par les mares de Jongol et de Ndingler qui peuvent garder leurs eaux pendant 6 mois. Alors que dans la zone de Ndiaganiao, on retrouve celles de Nay guityr et de Njakin et dans la zone des Bas – fonds, on a plusieurs mares qui fonctionnent de 4 à 6 mois dont les plus importantes sont celle de Guil Fakhad à Guélor Sérère, celle de Jim lin et enfin celle de Guéli.
L’hydrogéologie
Les eaux souterraines correspondent aux nappes souterraines du Paléocène, du continental terminal, aux nappes intermédiaires. Elles sont fortement utilisées pour l’approvisionnement en eau des populations. Elles sont exploitées à partir des puits, des forages et des céanes. Le paléocène est presqu’affleurant dans une bonne partie de Ndiaganiao et plus précisément au niveau des nombreux points d’eau (puits et forages).
Le paléocène et le continental terminal sont les principales sources d’approvisionnement en eau des populations. La nappe du Maastrichtien, nappes de bonne qualité et considérées comme la réserve d’eau la plus importante de la région de Thiès, n’est captée dans la commune de Ndiaganiao.
Cependant, ces ressources en eau plus particulièrement celles du Paléocène sont fortement affectées par la salinité d’où leur caractère peu saumâtre dans certaines localités de Ndiaganiao, Sandock et des Bas-fonds.
RELIEF ET SOLS
Le relief du Sénégal est très peu accidenté. Il est constitué par des plaines et des cuvettes que surplombent quelques massifs dans la région de Thiès. Elles portent le nom de bassin sédimentaire qui est un ensemble de terres basses avec des sols de natures différentes.
Le relief.
Le relief est quasi plat mais atteint des altitudes tournant autour de 25 mètres. Il présente des zones de basses altitudes dans sa partie septentrionale vers Guélor, Ndame qui se situent dans la zone communément appelée zone bas fonds.
Les sols
Selon PELISSIER (1996) 7« Les facteurs pédologiques commandent avec une beaucoup plus grande netteté la répartition des cultures et le dessin des terroirs dans la région occidentale du pays serer. Cependant il est soumis à l’influence du climat et aux facteurs locaux (SARR, 2007). Trois(3) types de sols sont retrouvés dans la zone : les sols Dior, Deck et les sols Deck Dior. Ils sont inégalement répartis dans les trois secteurs de Ndiaganiao.
• Les sols Dior
Ce sont des sols ferrugineux tropicaux caractérisés par une texture sableuse. Ils sont meubles et présentent une faible capacité de rétention de l’eau. Ils sont fortement affectés par le lessivage et l’érosion. Ce sont des sols pauvres en matière organique et en humus. Ils sont utilisés pour la culture de l’arachide, du petit mil « souna » du niébé et de la pastèque. Ces sols plus ou moins dégradés nécessite un amendement avec de l’engrais chimique ou organique. Ils représentent 20% de la superficie de Ndiaganiao et 80% pour les zones des bas-fonds et de Sandock (PLD-Ndiaganiao, 2009-2015).
• Les sols Deck
Ils représentent 30% de la superficie de Ndiaganiao et 70% pour les zones Sandock et des bas-fonds. Ils sont imperméables et présente une grande capacité de rétention. Selon Pélissier (1996), ces « sols sont chimiquement moins démunis que les sols Dior… ». Ils sont favorables aux activités telles que le maraichage, l’horticulture et la culture du sorgho. Ils sont surtout rencontrés au niveau des bas fonds, plus généralement toutes les zones déprimées vers lesquelles tend à s’orienter le drainage.
• Les sols Deck-Dior
Ce sont des sols hydromorphes. Ils sont de texture argilo humifère. Ils sont favorables à l’arboriculture (culture du manioc), du sorgho et au maraîchage. Ils constituent 10% de la superficie de Sandock contre 20% pour la zone des bas-fonds et 50% pour celle de Ndiaganiao. Ces sols offrent des potentialités hydro-pédologiques qui attirent les maraichers et favorisent le développement de l’activité maraichère dans la zone de Ndiaganiao.
L’ACCES AU FONCIER
La commune de Ndiaganiao est constituée en grande partie de sérère et est essentiellement agropastorale. Le développement de l’agriculture er de l’élevage dépend largement des ressources naturelles telles que l’eau et les terres. Jadis l’appropriation des terres revenait aux premières personnes à les défricher ou à mettre du feu. C’est ce mode d’appropriation des terres que P. PELLISSIER appelle « droit de feu et droit de hache. Ces propriétaires de la terre qu’on appelle communément «lamans » léguaient ses terres à leurs héritiers qui pouvaient les mettre en valeur, les prêter ou les louer aux dépourvus. Cependant les bas fonds échappaient à ce mode d’appropriation, ils étaient réservés au bétail.
Ces terres étaient peu convoitées par les paysans et elles étaient réservées aux bétails. Ce n’est qu’à la suite de la crise de l’agriculture que les bas fonds ont suscité un grand intérêt auprès des populations entraînant une ruée sans précédent. Cette situation est souvent à l’origine des creusets de rivalités ou de conflits de toutes sortes entre les éleveurs et les agriculteurs.
Cependant, la loi 64-46 du 17 juin 1964 portant sur le domaine national apporte une autre approche dans la gestion foncière au Sénégal. En effet la création des communautés rurales par la loi 72-25 du 19 Avril 1972 vient consolider cette loi en stipulant que la terre appartenait à celui qui l’a exploitée au cours des trois dernières années. Avec la mainmise de l’Etat sur les terres qui se traduit par le pouvoir de les réaffecter à une entreprise privée, une ONG ou une quelconque personne, les populations restent toujours inciter à faire obstacle face à une pareille éventualité. Les bas fonds recèlent d’énormes potentialités agronomiques conditionnées par la nature des sols et présentent des enjeux actuels et futurs. Les terres des bas fonds sont souvent considérées comme des extensions des champs destinés à l’agriculture pluviale et font l’objet de propriété. Ainsi les parcelles cultivées dans ces bas fonds sont acquises par héritage, prêt, location ou par attribution. En effet 70% des maraichers sont propriétaire de leur parcelle. Cet héritage leur donne des avantages de revaloriser les bas fonds en implantant des arbres. Les propriétaires des terres prêtent ou louent des parcelles aux autres exploitants n’ayant pas de terres. Cela est lié aux rapports sociaux et aux affinités qui existent entres les populations. Les exploitants qui ont acquis leur parcelle par prêt ou location se concentrent surtout sur la préservation de leurs cultures et n’ont pas le droit d’implanter des arbres, de creuser des puits ou des céanes où ils veulent sans l’avis du propriétaire.les prêts représentent 28% alors que les exploitants qui louent des terres ne font que 1%. Les aménagements des parcelles sont déterminés même par le mode d’appropriation des terres. Ces aménagements sont surtout les moyens de protection des périmètres, la diversification des sources d’eau et même l’amendement des terres. Ce qu’il faut signaler aussi c’est l’acquisition des parcelles qui découle d’un achat ou d’une attribution de terres aux maraichers. Cependant ces modes d’appropriation de terres est insignifiant et représente chacun 1%. C’est le G.I.E de MBOG YAY8 qui a acquis des terres par attribution.
LES PARAMETRES CLIMATIQUES
Il s’agit des paramètres climatiques qui permettent de déterminer le climat d’une zone. : Régimes des vents, température, la pluviométrie, l’insolation et l’évaporation constituent les éléments du climat que nous analyserons dans cette partie. Leur évolution et leur distribution résultent de la conjonction de trois facteurs : facteur cosmique, facteur météorologique et les facteurs géographiques9.
Pour l’étude des ces paramètres nous avons utilisé la station de Mbour et le poste pluviométrique de Ndiaganiao. La station de Mbour enregistre tous les paramètres cités ci-dessus. S’agissant des précipitations, nous avons travaillé sur toute la série c’est-à-dire de 1950 a 2013. Par contre pour les autres paramètres, nous avons travaillé sur la période allant de 1984 à 2013 c’est à dire depuis que la station, jadis poste pluviométrique a commencé à enregistrer ces paramètres. C’est ainsi que nous avons choisi la moyenne des 30 dernières années. Pour le poste pluviométrique de Ndiaganiao nous avons utilisé toute l’étendue de la série
Les vents
Le régime des vents à Ndiaganiao est analysé à partir des moyennes mensuelles des directions dominantes de janvier à décembre à la station synoptique de Mbour d 1984 à 2013. La direction et la vitesse du vent dépendent de la circulation générale de l’atmosphère. L’analyse de cet élément climatique permet de comprendre son influence sur les ressources naturelles telles que les ressources en eau et les sols. Il s’agit donc d’une étude qui nous permet de distinguer les différentes caractéristiques des vents durant les deux saisons de l’année.
La saison sèche : de novembre à fin mai, pendant cette période, la zone est parcourue par l’alizé maritime de direction Nord à Nord-Ouest, issu l’anticyclone des Açores. Son parcours océanique lui confère une fraîcheur et une humidité qui abaissent les températures, tout en apportant du brouillard et de la rosée. Ce flux intéresse surtout la façade maritime du Département de Mbour. Ce vent humide ne peut générer de pluies à l’exception des pluies de heug. Ce flux atteint parfois la Commune. A coté de ce flux on note la présence de l’harmattan ou l’alizé continental de direction Nord-est à Est. Il est issu de la cellule Saharo-libyenne. Il se caractérise par une grande sécheresse et des amplitudes thermiques accentuées. Il s’accompagne de brumes sèches et d’une forte capacité d’évaporation. C’est un flux d’air chaud et sec qui augmente les températures dans la zone de Mbour et de Ndiaganiao pendant cette période. Il est à l’origine des fortes pertes des ressources en eau de surface qui sont à la merci du mécanisme l’évaporation.
La saison des pluies : le mois de mai marque l’infléchissement de la vitesse moyenne de vents. L’installation de l’hivernage est notée dans le département de Mbour et dans la Commune de Ndiaganiao à partir du Mois de Juin. C’est pendant cette période que la mousson commence à circuler dans la commune. La mousson est un vent chaud et humide issue de l’anticyclone de Sainte- Hélène et dévié par la force de Coriolis en franchissant l’équateur. Son parcours maritime lui donne un grand potentiel d’eau qui génère des précipitations. La vitesse des vents diminue jusqu’à atteindre sa valeur minimale en septembre avec 2.0m/s. Dans l’hémisphère nord, la mousson prend une direction S-E – N-O après avoir traversée l’équateur géographique sous l’effet de la force de Coriolis.
Les températures
La variation saisonnière des températures est analysée à partir des valeurs caractéristiques moyennes mensuelles à la station de Mbour de 1984 à 2015. L’analyse s’est faite à partir des températures moyennes maximales (TX), des températures moyennes minimales (TN), des températures moyennes mensuelles (TM) et l’amplitude thermique (AM).
La température moyenne annuelle est de 27.2°C et l’amplitude thermique annuelle est de 13.5°C. La figure montre une évolution bimodale des températures. L’évolution des températures maximales(TX) montre deux maximums et deux minimums. Le maximum principal est enregistré au moi de Mars avec 36.2°C et le maximum secondaire est enregistré au mois de Novembres avec 35.9°C alors que le minimum principal intervient en Janvier et le minimum secondaire en juin.
Les températures moyennes minimales augmentent régulièrement passant de 16.3°C au mois de Janvier à 24.4°C au mois d’Aout soit une augmentation de 8.1°C. L’évolution des températures moyennes minimales connait un maximum qui intervient au mois d’Aout et un minimum au mois de janvier. L’évolution de la moyenne des températures est presque identique à celle des températures moyennes maximales mais dans ce cas précis, le maximum principal intervient au mois de Mars (27,3°) alors que, le maximum secondaire intervient en octobre avec 28,7°C Quant aux minimas, l’un intervient en janvier (24.9°C) et l’autre en mars (26.8°C). L’amplitude thermique suit l’évolution des températures maximales. Elle atteint sa valeur maximale au mois de mars (17.9°C) et la minimale en août (8.0°C).
La pluviométrie
Elle est liée à un ensemble de facteurs et détermine la quantité des ressources en eau. Les données analysées sont celles de la station synoptique de Mbour et du poste pluviométrique de Ndiaganiao sur toute leur étendu. Pour la station de Mbour, l’analyse porte sur les moyennes mensuelles de 1950 à 2013 et pour le poste pluviométrique de Ndiaganiao, l’analyse des moyennes mensuelles porte sur la période allant de 1980 à 2013.
La figure montre deux saisons, l’une pluvieuse et qui commence en Juin et se termine en Octobre et l’autre sèche de novembre à Mai au niveau de la station de Mbour et de Ndiaganiao. L’évolution moyenne mensuelle des précipitations révèle que le mois d’août est plus pluvieux pour la station de Mbour avec 251mm et pour le poste de Ndiaganiao avec 201.7mm. L’évolution moyenne mensuelle des pluies nous a fait remarquer que pour la station et le poste qui se suivent de l’amont à l’avale, le mois d’octobre qui marque la fin de l’hivernage est plus pluvieux que le mois de juin qui annonce le début normal de l’hivernage.
Le poste pluviométrique de Ndiaganiao se particularise par de faibles cumuls mensuels de précipitation comparé à la station de Mbour. Cette tendance traduit l’insuffisance des précipitations dans la Commune. Cette pluviométrie déficitaire entraîne le problème de recharge des nappes souterraines, la présence à une longue durée des mares et pose aussi une problématique en terme d’accès et de disponibilité en eau. Cette situation impacte négativement sur la mise en valeur maraicheres dans la zone.
L’Insolation
L’insolation moyenne journalière est de 8h/J. Elle connait une évolution bimodale avec un maximum principal qui intervient au mois d’Avril et un maximum secondaire au mois novembre. Les minimums principal et secondaire interviennent respectivement au mois de janvier et d’Aout.
En avril, le soleil arrive au zénith et contribue fortement à l’augmentation de l’insolation qui y atteint son maximum. Les mois les plus ensoleillés sont février, mars, avril et mai et c’est pendant cette période que les températures les plus élevées sont enregistrées. C’est la période de la canicule. La baise des valeurs de l’insolation à partir du mois de juin et se poursuit jusqu’au mois de septembre s’explique par la couverture nuageuse et les précipitations. Les mois d’aout et de septembre enregistre les valeurs les plus petites cela s’explique par une forte couverture nuageuse et les fortes précipitations tombent dans la zone durant ces mois, alors que la reprise de leur hausse est due aussi à l’arrêt des précipitations et de la disparition de la couverture nuageuse.
L’humidité relative
La pluviométrie et les facteurs thermiques déterminent cet élément du climat. La figure montre une évolution unimodale avec un maximum et un minimum. L’humidité moyenne annuelle est de 65%. L’humidité moyenne maximale H(x) à Mbour connaît une évolution régulière de Janvier à Septembre alors que l’humidité moyenne minimale suit presque la même évolution, c’est-à-dire, elle augmente de Janvier en Août.
Les valeurs maximales sont enregistrées pendant la saison pluvieuse alors les minimales arrivent en saison sèche. Pendant l’hivernage, la chute des précipitations et la couverture nuageuse expliquent la hausse de l’humidité relative moyenne qui augmente jusqu’à 82% en septembre. Tandis qu’en saison sèche l’harmattan et l’importance de l’insolation sont à l’origine de la baisse de l’humidité relative.
L’Évaporation
L’évaporation Piche moyenne annuelle est de 4.6mm. Son évolution suit celle de la température maximale et de l’insolation. Elle s’oppose à l’évolution de l’humidité relative. Elle augmente considérablement durant la saison sèche pendant laquelle les températures sont élevées. Le maximum est enregistré en février avec 7.4 mm. C’est pendant cette période que la plus part des mares de la Commune de Ndiaganiao s’assèchent et que les « Céanes » se tarissent. Le minimum intervient au mois de Septembre avec 1.8mm. Pendant cette période de l’année, l’atmosphère est chargée d’humidité à cause des précipitations et que les températures sont faibles.
LA FLORE ET LA FAUNE
La flore
La répartition spatiale de la végétation est fonction de plusieurs facteurs. La combinaison de facteurs climatiques, pédologiques, topographiques, hydrographiques et autres est importante dans la répartition des paysages végétaux. La Commune de Ndiaganiao présente une formation végétale de type savane arbustive et arborée. Elle est caractérisée par une composition floristique diversifiée allant d’un important tapis herbacé vers une population d’arbres assez consistante et sans oublier les nombreuses colonies d’arbustes.
La richesse du tapis herbacé composé d’une diversité de classes de graminées a énormément contribué à l’essor de l’élevage dans la zone. Les espèces d’herbes rencontrées sont le Cenchrus biflous (xaxam), Eragrostis ciliaris, le « lasobam » le « selen », la striga, Dactyloctenium aegyptium, Chlorus prieurii, Pennisetum pedicullatum. Combrétum micrantums (quinquéliba), Combrétum glutinosum, Guiera senegalensis (nguer), le « kaskar », le « mboss », le jujubier ou Zizyphys mauritiana, le « sump » ou Balanites aegyptiaca, le henné ou, le Moringa oleifera etc.
La population d’arbres constituant l’essentiel des productions forestières est composée en majorité de « Gang », de « New » pommier du cayor ou Parinar microphylla, de « Venn », de « kad » Accasia albida, de baobab ou « gouye »(Adansonia digitata), Tamarindus indica, Eucalyptus alba etc.
Suite aux pressions anthropiques liées à la recherche de bois, à l’agriculture qui s’opère de plus en plus sur toutes les terres et aux aléas climatiques, le couvert végétal tend à disparaitre. Cette situation a rendu précaire le secteur de production du bois de service et constitue, du coup, une menace de disparition d’espèces végétales utiles et de toutes les espèces dont leur survie y est liée.
La faune
Suite à la dégradation des ressources naturelles, en particulier la végétation due aux aléas climatiques mais aussi aux pressions exercées sur les terres à la recherche d’espace cultivables, la faune sauvage tend à disparaitre. Les grands reptiles se font rares. Les singes et les lapins existent dans la zone des bas fons mais ils sont menacés par les actions anthropiques dont particulièrement les carrières de Diack à cheval entre les Communes de Ngoundiane et Ndiaganiao. La faune est très diversifiée avec la présence des rongeurs et plus particulièrement le rat palmiste et l’écureuil et des oiseaux (tourterelles, hérons, charognards).Autrefois, on comptait dans la faune des hyènes, des biches, des singes, des crocodiles etc. Et actuellement dans la vallée de Nay Guityr, on soupçonne parmi la faune aquatique des crocodiles et de fortes colonies de poissons.
PEUPLEMENT ET ORGANISATION SOCIALE
L’étude de cette partie vise la connaissance sur le peuplement du point de vue de son histoire, de sa taille, de sa répartition, sa densité et sa structure
Historique du peuplement de la Commune de Ndiaganiao
La Commune de Ndiaganiao appartient à « l’ancien royaume du « Djégém » qui était une zone mal connue par les voyageurs Européens. Les premiers européens avaient du mal à accéder à l’intérieur de ce territoire. La Commune de Ndiaganiao était un territoire gouverné par des lamanes10. Elle ne relevait ni du Damel du Cayor, ni du Teigne du Baol, ni du Bour Sine. Les premiers habitants seraient des récalcitrants des royaumes du Sine et du Bal. Ils auraient trouvé sur leur emplacement actuel une zone tampon qui n’était contrôlée par aucun royaume. Ils espéraient ainsi y vivre dans la tranquillité, sans domination aucune. Jaloux de leur liberté, ils n’avaient alors, avant l’arrivée des colons, ni roi, ni chef suprême, ni armes.
L’Installation des populations du jegem remonte au XIIème siècle et est faite, suite à trois vagues successives :
– la première vague de population : Les Soos / Sereer coosan
Dès le XII éme, il est noté l’installation de ces populations nommées Soos dans le Baol.
Des auteurs se sont intéressés à la question du peuplement de la Sénégambie. Henry Gravrand soutient que ces Soos étaient des Socés (Soninké ou Sarakholé ou Malinké…) et furent les premiers à établir dans cet espace. Ces Soos étaient venus du Gabu ou du soudan et seraient installés avant le XII éme siècle (Séne, 2008).
Il faut donc dire que, vraisemblement, avant le XII éme siècle, une première vague de Sereer Coosan ou Soos venant de la vallée du fleuve Sénégal était installée dans la région du jegem. Cette dernière fut suivie d’une autre venant de la même vallée.
– la deuxième vague de populations
Ces Sereer ont vécu ensemble avec les wolofs, les Hal Pulaaren, les Lébu, Soninké dans la vallée du fleuve Sénégal avant leur migration dans les régions du sud : le cayor, le Bawol, le siin… leur séjour dans la vallée est confirmé par Gravrand, qui affirme que, les sereer «vivaient dans le Tagant ou vallée du fleuve Sénégal avec les Toucouleurs, les Peulhs, les Lébous avant leur exode vers le sud ».
– la troisième vague de populations comprend deux groupes : les Socés et les Sereer du Siin. Les Guellewar parvinrent à imposer leur autorité aux Sereer et fondèrent des dynasties qui
sont à l’origine des royaumes du Siin et du Saloum. Au Siin, la première capitale fut Mbissel avec comme premier roi Méissa Wali Ndione (SENE, 2008).
L’organisation traditionnelle
La compréhension de la vie sociale dans surtout dans la Commune à majorité sérère ne peut être appréhendée de façon plus ou moins claire que par la connaissance de l’organisation familiale qui porte le soubassement de la cellule de base. Il convient de distinguer dans les familles sérères la cellule constituée par les membres issus de la même lignée paternelle et celle constituée par les membres issus à leur tour de la lignée maternelle.
A l’époque, La Commune de Ndiaganiao était un territoire neutre gouverné par des Lamanes. Elle ne relevait ni du Damel du Kayor, ni du Teigne du Baol, ni du Bour Sine11. Les populations étaient sous l’autorité de ces « Laman ».
Actuellement, à la tête de chaque village est nommé un chef de village communément appelé « Diaraf 12». La dévolution du pouvoir qui, jadis, était patrilinéaire est Le chef de village joue les premiers rôles de la justice. S’il ya conflit entre populations ou entre familles, entre population et éleveurs ou s’il ya vol, il convoque une réunion et est assisté par les chefs de quartiers et les notables. Il sert d’intermédiaire entre l’État et la population car il transmet les convocations venant de justice.
LA STRUCTURE DE LA POPULATION
Dans cette partie, il s’agit de mettre l’accent sur la répartition ethnique, religieuse et de la répartition par sexe et par âge de la population.
La composition ethnique
Sur le plan ethnique, les Sérères occupent 73% de la population. Ils sont les premiers occupants de la zone et sont plus regroupés que les autres. Les Wolofs représentent 13% et les poulars composés de peuls nomades et de toucouleurs représentent 11% de la population. Ils sont les derniers occupants de la zone. Ils s’activent dans le commerce laitier et animal. Ils sont en majorité installés dans la zone de Sandock en particulier dans le village de Soussoung.
« Venant du Ferlo, ils ont fui les conditions de vie drastiques consécutives aux sécheresses, les manques d’eau et la famine ; quant aux toucouleurs, ils sont attachés à l’agriculture et au commerce de tissus » (SENE, 2010). Les maures, les diola et les manding représentent 3%.
Composition religieuse
Du point de vue religieux, la population de la Commune de Ndiaganiao est majoritairement musulmane. L’islam, le christianisme et l’animisme constituent les trois principales religions que pratiquent les populations. Les musulmans constituent 80%. Et les chrétiens représentent 10% en majorité sérères et en fin les animistes représentent 10%. Dans le passé, l’animisme était fortement représenté. Aujourd’hui avec l’évolution de l’islam et du christianisme, sa pratique a constamment diminué.
La structure par âge et par sexe
La structure de la population montre que le sexe ratio est en faveur des femmes qui représentent 51,2% (26620 femmes) contre 48,8% d’hommes (25359 hommes)13. Quant à la structure par âge, la population est relativement jeune avec une proportion de 49,22% de la population totale. En effet ce caractère jeune de la population s’est fait senti dans la mise en valeur maraichère.
L’évolution et la répartition spatiale de la population
La population était estimée en 2000 à 34 887 habitants. Selon le Recensement Générale de la Population et de l’Habitat de 2002 (RGPH-2002), la Commune comptait 40815 habitants. Elle est passée de 46806 habitants en 2008 (ANSD). En 2009, la population de Ndiaganiao était estimée à 47996 habitants alors qu’en 2012 elle était de 51979. C’est une population marquée par une évolution rapide et les tendances de cette évolution montrent que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. La densité de la population en 2012 est de 137 habitants au km2. La distribution des villages est homogène et l’habitat est de type groupé même si on rencontre en quelques endroits un habitat dispersé.
En effet, des 38 villages de la Commune de Ndiaganiao, 5,3 % des villages ont une population comprise entre 100 et 300 habitants ; 13,1% de 300 à 500 habitants ; 26,3% se situent entre 501 et 1000 habitants et seuls 8 villages ont respectivement plus de 2000 habitants14.
LE CADRE SOCIO-ECONOMIQUE
L’agriculture et l’élevage constituent un secteur primaire et sont au cœur de l’utilisation des ressources naturelles. En plus de ce secteur nous notons le secteur secondaire à travers l’artisanat et le secteur tertiaire à travers le commerce.
LES ACTIVITES ECONOMIQUES
L’agriculture
Elle constitue l’activité socio- économique la plus importante. Elle est essentiellement vivrière, pluviale et traditionnelle. L’agriculture constitue la principale activité qui assure le bien être des populations. Le système de culture est dominé par les cultures de subsistance. Elle est destinée à l’autoconsommation. Les principales spéculations sont le mil, le sorgho, l’arachide, le niébé, le bissap Elles de type extensive, familiale, manuelle et dépend des conditions pluviométriques et de la nature des sols.
Cependant, elle reste confrontée à de nombreuses contraintes surtout d’ordre climatique, pédologique et technique. L’outillage agricole est rudimentaire et manuel.
Ces contraintes ont conduit à une baisse de la production du mil et de l’arachide. Face à cette situation, les populations ont tourné vers les bas fonds pour y pratiquer le maraichage pour minimiser les risques et garantir la production.
Le maraichage demeure aujourd’hui une activité palliative et constitue une réponse aux problèmes que rencontre l’agriculture pluviale. Pour déterminer son importance dans la commune, nous avons enquêté 246 ménages maraichers. Ces enquêtes portent sur le système de culture, le système de culture poste récolte et les contraintes de mise en valeur.
Malgré son importance, le maraîchage reste confronté à un manque d’eau et une gestion inefficace liée à la vétusté des moyens utilisés dans la mise en valeur maraichère. Certains creusent des céanes pendant la saison sèche mais ces dernières se tarissent souvent avant la maturité des spéculations. Cette forme d’agriculture peut consommer des quantités importantes d’eau. Cependant, certains exploitants arrosent avec des seaux et de l’arrosoir.
L’élevage
L’élevage constitue la deuxième activité économique. Elle est pratiquée durant toute l’année et reste associée à l’agriculture. Toutes les ethnies sont par excellence des éleveurs mais les Sérères et les peuls en sont majoritaires. L’élevage revêt une importance particulière dans la vie socio-économique des populations. « Le troupeau à d’abord une signification et une fonction socioreligieuse. Il représente le bien familial par excellence, le symbole en même temps le garant de la prospérité matérielle de ses propriétaires, le gage de leur rang social et de l’influence dont ils jouissent »15. PELISSIER ajoute que « si le septel est un bien intangible, jalousement gardé, il est instrument associé à la vie quotidienne et surtout au fonctionnement de la combinaison agricole » Le bétail est estimé à 40 000 têtes (Enquêtes DP, Décembre 2008). Il est constitué de 16 373 têtes d’Ovins ; 10 204 caprins ; 640 porcs, 8 674 bovins, 1904 équins, 2 192 Asins16.
L’élevage est de type extensif avec un système de gestion traditionnel. En effet tous les agriculteurs sont des éleveurs autrement dit, des agropasteurs car, il existe une parfaite intégration entre l’agriculture et l’élevage. Cette intégration fait apparaitre l’importance de l’élevage dans la vie socio-économique. Force est de signaler que presque tous les maraichers sont des éleveurs et d’agriculteurs. Non seulement l’élevage est un moyen traditionnel de thésaurisation mais il produit du lait qui participe à l’amélioration des plats et aux dépenses quotidiennes. Le bétail est utilisé pour l’entretien de la fertilisation des sols et la pérennité des champs. La Commune a introduit l’insémination artificielle du bétail surtout dans la zone de Sandock. Cette action a conduit à une diversification des races et à la production de lait. La Commune compte 4 abreuvoirs fonctionnels desservis par les forages et six (06) parcs de vaccination fonctionnels. Il existe différent mode d’alimentation du bétail par les maraichers. Ainsi 61.2% des maraichers font le gardiennage et 30.6% ma divagation contre 8.2% qui font la stabulation.
Cependant l’élevage reste confronté à d’énormes difficultés qui entravent son développement. La longue saison sèche conduit au manque de fourrage et le tarissement précoce des points d’eau conduisent les éleveurs à de la transhumance vers le Diolof et Saloum à la recherche de fourrage et d’eau. En dépit de ce problème, le vol de bétail constitue une grande entrave au développement du secteur.
|
Table des matières
AVANT PROPOS
INTRODUCTION GENERALE
PROBLEMATIQUE
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE DE NDIAGANIAO
CHAPITRE I : LE CADRE BIOPHYSIQUE ET HUMAIN
CHAPITRE II : LE CADRE SOCIO-ECONOMIQUE
DEUXIEME PARTIE : RESSOURCES EN EAU ET GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES
CHAPITRE III : LES RESSOURCES EN EAU
CHAPITRE IV : GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES
TROISIEME PARTIE : LE MARAICHAGE ET SES CONTTRAINTES
CHAPITRE V : LES BAS FONDS ET LE SYSTEME DE CULTURE MARAICHERE
CHAPITRE VI : LE SYSTEME POSTE RECOLTE
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE
Télécharger le rapport complet