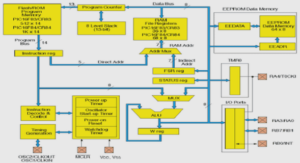Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Un rôle socio-économique en relatif déclin depuis le 20ème siècle
La première partie de ce chapitre analyse les facteurs du déclin économique relatif de la filière oléicole depuis le 20ème siècle. La question des arbres -et plus spécifiquement de la dimension symbolique des oliviers en Palestine- a très largement inspiré les travaux des politologues et des anthropologues. Les aspects économiques de l’olivier, envisagé comme un facteur de production au sein d’une filière agricole, ont en revanche été très peu étudiés, sinon pour les rapporter à des enjeux plus politiques (le commerce transnational de l’huile d’olive au service de la paix) (Benhayoun et al. 2007). C’est finalement dans des mémoires de master (Giroud 2007b ; Vuille 2012), que l’on peut trouver une analyse économique de la filière oléicole. Néanmoins, en portant sur des aspects à la fois très récents et d’importance secondaire à l’échelle de la filière (commerce équitable, production bio, etc.), ces travaux ne permettent pas de saisir les transformations plus profondes de la filière oléicole dans une perspective historique.
Les oliviers sont aujourd’hui présents sur l’ensemble des Territoires palestiniens. Ils sont prédominants au nord de la Cisjordanie tandis que d’autres types d’activités agricoles ont été privilégiés dans les autres régions des Territoires palestiniens. Le sud de la Cisjordanie favorise la vigne et l’élevage, tandis que les zones côtières et Gaza cultivent majoritairement des agrumes (citronniers, orangers …) (AMODESP 2002). Néanmoins, en raison du manque de terres disponibles pour le pâturage ou encore de la rareté des ressources en eau pour l’irrigation, ces activités tendent à se réduire progressivement au profit de la culture de l’olivier, moins contraignante. Désormais, les oliveraies regroupent environ 10 millions d’oliviers18, qui représentent 60% des surfaces agricoles et 80% des plantations d’arbres fruitiers dans les Territoires palestiniens, soit 881 000 dunums19 (88 100 hectares) (NIRAS 2011). Le secteur oléicole représente aujourd’hui jusqu’à 20% du PIB agricole et contribue à alimenter, de manière irrégulière, la capacité exportatrice de la Palestine. Par ailleurs, cette culture fournit un revenu complémentaire à près de 100 000 familles. Pourtant, l’oléiculture n’a pas toujours occupé cette place dans la société et l’économie palestinienne.
Trois principaux facteurs marquent les mutations économiques que la filière a subies depuis le 19ème siècle : le déclin des industries de savons à l’huile d’olive, la fermeture successive des grands marchés d’exportation et le recul de la consommation locale. Après avoir décrit chacun de ces facteurs, j’analyserai les grandes recompositions de l’oléiculture qui en découlent au sein de la société palestinienne.
La disparition du secteur des savons à l’huile d’olive depuis 1930
Le premier choc auquel la filière oléicole a été confrontée est l’extinction progressive de l’industrie palestinienne du savon, à partir des années 1930. La fabrication des savons à l’huile d’olive était à l’origine un artisanat familial, concentrée dans les villages. Grâce à une relative stabilité politique dans la région et le regain de demande européenne portée par les mouvements de conquêtes napoléoniennes, elle est devenue au début du 19ème siècle une véritable industrie, regroupant pas moins de trente savonneries dans la seule ville de Naplouse. Profitant d’un essor sans précédent entre 1790 et 1823, les manufactures exportaient dans la plupart des pays de la région (l’Empire ottoman, le Yémen, la Syrie mais surtout l’Égypte) et jusqu’en Europe (Canaan 1927). Marwan Buheiry rapporte que les exportations via le port de Jaffa sont ainsi passées de 33 600 Livres sterling en 1889 à 124 000 en 1891 (Buheiry 1981). Le dynamisme de la filière était tel que les approvisionnements en huile d’olive accaparaient l’essentiel de la production de Naplouse et du nord de la Cisjordanie. Ils se sont même étendus ensuite jusqu’à St Jean d’Acre et Saïda au Liban (Jaussen 1927 : 288). Parfois, l’huile d’olive était même importée de plus loin, comme de Grèce en 1901 (Buheiry 1981).
Pour répondre à l’explosion de la demande en huile et circonscrire les importations des pays voisins, les producteurs palestiniens se sont alors mis à planter massivement des oliviers. Cette culture, déjà largement présente dans la région, s’est profondément développée à cette occasion. Ce phénomène s’est manifesté par exemple en 1930, à l’occasion d’un regain du secteur des savonneries. Les producteurs plantèrent alors 100 000 dunums (10 000 hectares) supplémentaires d’oliveraies, en sus des 475 000 déjà existants. Mais le temps que ces jeunes plants d’oliviers ne deviennent productifs, la tendance du marché des savonneries s’était inversée.
En effet, la filière connaît à cette époque le début d’un profond déclin. Plusieurs facteurs contribuent à expliquer cette « Nakba du savon »20 (Bontemps 2009a). Il y a tout d’abord l’augmentation de la production de savons à l’huile dans les pays voisins, qui concurrencent durement le savon de Naplouse voire usurpent son identité. Les marques de savons de Naplouse n’étaient alors pas encore protégées contre ces contrefaçons. Cette production concurrente, moins regardante sur la qualité de l’huile et des intrants, pouvait être vendue à des prix bien inférieurs. À cela s’ajoute à partir de 1922 la concurrence de l’industrie mécanisée des Juifs ayant migré en Palestine, produisant de manière industrielle des savons l’huile. L’usine Shemen par exemple, dispose d’un capital quasi équivalent à celui de l’ensemble des savonneries de Naplouse. Les manufactures locales, à l’inverse, refusent de mécaniser leur procédé de fabrication (Jaussen 1927 : 260). Parallèlement, des pays comme la Syrie et l’Égypte instaurent une taxe à l’importation des savons à l’huile dans les années 1930, à une époque où le cours de l’huile ne cessait de grimper, et pesait déjà fortement dans le coût de revient. La combinaison de ces facteurs a fini par avoir raison du dynamisme du secteur (Graham-Brown 1982 ; Bontemps 2012).
Aujourd’hui, il ne subsiste plus qu’une poignée de savonneries palestiniennes, et presque toutes importent leur huile d’olive d’Italie. Malgré les taxes à l’importation, celle-ci revient moins chère que sur le marché local (respectivement 1 200US$ la tonne contre 2 000US$ en 2004). Le qelî, une plante désertique utilisée pour la saponification, a également été remplacé par de la soude caustique importée d’Allemagne. Le jift, résidu solide de la presse des olives, n’est plus utilisé pour alimenter les chaudières. Les savons à l’huile d’olive, eux-mêmes, sont tombés en désuétude à partir des années 1990. Ils ont été largement remplacés dans les foyers par des savons et shampoings industriels de la marque Dove ou Panthène par exemple (Bontemps 2012). Dès lors, les producteurs palestiniens ont perdu rapidement leur principal débouché, et une grande partie des oliviers plantés a en partie perdu sa raison d’être. La filière oléicole s’est alors retrouvée structurellement en surproduction.
Les fermetures des principaux marchés d’exportation régionaux depuis 1990
Le deuxième facteur affectant le dynamisme de la filière oléicole a trait au contexte politico-commercial à l’échelle régionale. Les marchés régionaux représentent des opportunités importantes pour écouler la surproduction d’huile d’olive palestinienne. Cependant, pour des raisons de politique extérieure et/ou protectionniste, l’accès aux principaux débouchés régionaux du marché oléicole palestinien a été rompu ou fortement entravé depuis une trentaine d’années.
L’effacement des marchés des pays du Golfe
Les pays du Golfe ont constitué un débouché privilégié pour les exportations d’huile palestinienne à partir des années 1930. L’huile partait à destination de la population de ces pays consommateurs mais non producteurs d’huile d’olive. À partir des années 1970, elle partait à destination de la diaspora palestinienne qui travaillait massivement dans la région (notamment les pays du Golfe), alors en plein boom économique grâce au développement des marchés pétroliers. On compte alors à cette période près de 500 000 Palestiniens au Koweït, 180 000 en Arabie Saoudite et 70 000 aux Émirats Arabes Unis (Laurens 2011). Cette diaspora considère que la consommation d’huile d’olive palestinienne constitue une manière d’entretenir un lien fort avec le pays d’origine. Il s’agit même pour Anne Meneley (2008), d’une façon de partager symboliquement un repas avec sa famille restée dans son pays d’origine21. Pour ces différentes raisons, les pays du Golfe constituaient pour l’industrie oléicole palestinienne un marché dynamique et en pleine croissance.
En 1990 néanmoins, l’Irak de Saddam Hussein envahit le Koweït voisin. À l’inverse d’une large coalition de 34 États arabes et occidentaux, les dirigeants palestiniens se rangent non pas au côté de ce petit pays attaqué, mais du côté irakien. L’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et son chef de file Yasser Arafat pensent alors s’attirer le soutien d’une grande puissance régionale pour obtenir plus de poids dans les négociations avec Israël. Cependant, l’armée irakienne est rapidement défaite par la coalition, et le pari palestinien se révèle être une lourde erreur stratégique. D’une part, les Palestiniens perdent tout crédit dans les pays du monde arabe, et donc tout appui financier que leur versaient ces pays en soutien à la « cause palestinienne ». D’autre part, les Palestiniens perdent une part importante de leurs débouchés commerciaux dans la région. Un grand nombre d’entre eux fuient les pays du Golfe ou en sont chassés22. Les pertes économiques sont énormes, aussi bien en termes de remises envoyées par la diaspora palestinienne chassée des pays du Golfe, que de marchés d’exportation. La filière oléicole subit de plein fouet ce revers économique (Meneley 2008).
Un lent déclin de la consommation d’huile d’olive
Le marché local représente naturellement le premier débouché pour l’huile d’olive produite dans les Territoires palestiniens. La quantité consommée localement s’élève en effet 12 000 tonnes en moyenne par an, variant entre 15 000 et 9 000 tonnes respectivement les bonnes et les mauvaises années.
L’huile d’olive occupe une place incontournable dans la cuisine palestinienne. Elle est historiquement un ingrédient essentiel de la plupart des recettes, consommée dans de très nombreux plats (musakhan, makloube, humus, etc.). Dans leur très grande majorité, les Palestiniens manifestent peu d’intérêt à la qualité telle que définie par les standards internationaux ; ils sont habitués à une huile plutôt rance, à forte acidité et au goût très prononcé. Les dépenses en huile se font généralement sur une base annuelle sous forme de tanakés, bidons en plastiques d’une contenance standard de 16 kilos (unité de mesure plus commode pour évaluer une quantité d’huile au poids, soit environ 16 litres). Ces tanakés sont non étiquetés, sans label, ni date d’expiration, ni mention de l’origine ou du niveau d’acidité. La transaction repose encore aujourd’hui sur la confiance auprès d’un producteur ou d’un moulinier (dans respectivement 49% et 17% des cas ), auxquels l’acheteur est habitué, souvent de longue date (Paltrade 2005 : 24).
Le marché local a connu peu de changement dans sa manière de fonctionner et les caractéristiques de l’offre d’huile d’olive sont pour l’essentiel assez proches de ce qu’elles étaient au milieu du 19ème siècle : même type d’embouteillage en tanakés, mêmes acteurs, mêmes circuits de distribution, etc. Pourtant, la prédominance de l’huile d’olive dans la culture alimentaire palestinienne est progressivement mise à mal par l’arrivée de nouvelles habitudes de consommation. Le marché local est animé par deux tendances peu encourageantes. La première concerne l’apparition d’habitudes alimentaires plus occidentalisées – majoritairement parmi la clientèle la plus aisée. La deuxième est la concurrence accrue d’autres huiles végétales (huile de palme, de colza, de tournesol…), principalement parmi la clientèle la plus pauvre. Ces deux tendances font reculer la place relative de l’huile d’olive sur le marché palestinien.
Le développement d’une clientèle aisée dans les Territoires palestiniens peut être synonyme d’un désintérêt relatif pour l’huile d’olive. Par exemple, ce type de clientèle tend à délaisser progressivement les courses sur les marchés ou chez les épiciers de quartier. Elle se rabat progressivement depuis la fin des années 2000 vers des supérettes, sinon de véritables Malls conçus directement sur le modèle américain (grandes allées pour les caddies et omniprésence de la publicité, abondance de produits diversifiés, galeries marchandes, bars et fast-foods à proximité…), au sein des grandes villes comme Ramallah ou Naplouse27. Dans ces nouveaux lieux de vente (au nombre de quatre en Cisjordanie en 2011) apparaissent des plats cuisinés et de nombreux produits d’importation qui nécessitent beaucoup moins d’huile d’olive que la préparation des plats habituels palestiniens. Par ailleurs, on y trouve relativement peu d’huile d’olive, un produit moins adapté à ce canal de distribution, sinon sous forme de petites bouteilles qui reflètent une baisse de la consommation de ce produit. L’entreprise adossée à l’ONG PARC a ainsi vu ses ventes en bouteilles de petit format augmenter de 800% entre 2008 et 2009 : bien que ce chiffre soit à relativiser puisque ce canal de diffusion était quasi inexistant auparavant, il révèle une préférence croissante des consommateurs pour les petits contenants d’huile d’olive (Jazairi 2010 : 25). La société basée à Naplouse Al Anabtawi, l’un des premiers distributeurs d’huile d’olive en Cisjordanie, a quant à elle écoulé 14 000 tonnes d’huile de graines (huile de tournesol, de colza…) en 2010 dans les magasins palestiniens, contre à peine 50 tonnes d’huile d’olive la même année28.
La concurrence grandissante des huiles de graines se manifeste de manière toujours plus évidente, notamment parmi la clientèle la plus pauvre. La présence de ces huiles sur le marché palestinien n’est pas nouvelle, mais elle s’est accrue dans les années 1990 avec la signature du Protocole de Paris29 (1994) qui a accentué la pénétration des importations israéliennes sur le marché palestinien. Depuis, leur consommation n’a cessé de croître, au point de remplacer complètement l’huile d’olive dans de nombreux ménages (OXFAM 2002 : 21). L’huile de graines, de soja ou de tournesol, est vendue pour environ 5 shekels (1 euro) le kilo. Elle constitue par conséquent une concurrence sévère face à une huile d’olive qui s’affiche elle à 20 ou 30 shekels (4-6 euros) le kilo sur le marché local.
Cette tendance à la substitution est à la fois causée et accélérée par la dégradation du pouvoir d’achat des Palestiniens, mis à mal par la situation politique qui assombrit les perspectives économiques. De 14% en 2000, le taux de chômage est monté à 26% en moyenne durant les années de la seconde Intifada (2000-2005), taux auquel il se maintient encore aujourd’hui (Farsakh 2005). Un taux de pauvreté élevé et une insécurité alimentaire chronique se maintiennent chaque année (voir Annexe 2, carte 6). L’insécurité alimentaire30 touche deux Palestiniens sur trois dans les Territoires palestiniens, et davantage encore dans la seule région de Gaza (CNUCED 2012). Dans ces circonstances, la consommation d’huile d’olive devient un luxe pour nombre de familles qui n’en produisent pas elles-mêmes, dans les zones urbaines notamment. Au mieux, elles se contentent de mixer de l’huile d’olive avec d’autres huiles végétales, bien moins chères (FAO 2007 : 63). Selon un rapport de la FAO, 29% des ménages palestiniens confrontés à la crise économique réduisent la quantité de nourriture achetée et 32% se tournent vers des produits alimentaires de moindre qualité (FAO 2010 : 16). L’effet de la pauvreté sur les niveaux de consommation a été contenu dans un premier temps par la baisse du prix de l’huile d’olive pendant la seconde Intifada, permettant aux ménages de continuer à s’en procurer. Mais les cours de l’huile d’olive sont progressivement remontés après la seconde Intifada dans certaines localités tandis que la pauvreté persistait, rendant l’huile encore moins accessible.
On peut attribuer à l’huile d’olive palestinienne une double fonction alimentaire identifiée par la sociologue Claire Lamine dans ses travaux sur les usages de l’huile de palme rouge dans certaines communautés du Cameroun (Lamine 2006). L’huile d’olive palestinienne possède à la fois une fonction de « condiment identificateur irremplaçable » qui donne au plat une saveur caractéristique qui le rend reconnaissable parmi tous, et une fonction de « matière grasse de cuisson substituable », notamment pour cuire ou frire les ingrédients. C’est précisément pour ce second usage que les huiles de graines, moins coûteuses, sont de plus en plus privilégiées par les Palestiniens depuis une quinzaine d’années. Si le premier usage se maintient pour des raisons culturelles en Palestine, le second, bien plus significatif en termes de quantités utilisées, est quant à lui en net recul.
Ainsi, qu’elle soit pauvre ou aisée, la clientèle palestinienne manifeste des habitudes de consommation qui laissent peu de marge de progression à l’huile d’olive sur le marché local. La tendance est même résolument négative, puisque la consommation annuelle par habitant est passée en 20 ans de 10kg à 4kg par an (Benhayoun et Lazzeri 2007 : 108). L’huile d’olive s’apparente de plus en plus soit à un produit de luxe, soit à une production autoconsommée. Un rapport de l’institut statistique palestinien, le Palestinian Central Bureau of Statistics, révèle qu’en 2010 la consommation mensuelle moyenne d’huile d’olive par ménage est bien supérieure dans les zones rurales (2,3 litres), donc productrices, que dans les zones urbaines (1,8 litre) ou dans les camps de réfugiés (0,8 litre) (PCBS 2010). Inversement, la consommation moyenne d’huile de tournesol est de 2 litres dans les camps et 2,2 litres dans les villes, contre seulement 0,4 litre dans les campagnes.
L’épineuse question du prix de production, de vente et d’achat
Le marché oléicole palestinien est affecté depuis une quinzaine d’années par une forte variabilité de la production mais aussi du prix de l’huile. Ces irrégularités freinent les investissements des entreprises privées, réticentes à s’engager devant les nombreuses incertitudes qui pèsent sur leurs prévisions commerciales. Le prix moyen de l’huile au kilo a en effet pu varier de 24 shekels (4,40 euros) en 2000 avant le début de la seconde Intifada à 17 shekels (3,40 euros) en 2004, pour remonter ensuite progressivement.
Des oliviers nombreux et indésirables aux yeux des Israéliens
Lors des principales vagues d’immigration juive en Palestine (alya en hébreu) au cours du 20ème siècle, les nouveaux arrivants ont constaté la présence d’oliveraies très anciennes, sur des terrasses construites en pierres et à la main par plusieurs générations de Palestiniens. Ce « patrimoine agricole » discréditait manifestement la thèse véhiculée jusque-là par le mouvement sioniste, selon laquelle la Palestine était « une terre sans peuple pour un peuple sans terre » (Muir 2008 ; Sanbar 2004 : 117). C’est suite à la création de l’État d’Israël que les arbres fruitiers vont faire l’objet de destruction par les Israéliens, tout d’abord par centaines de milliers de dunums dans les villages arabes d’Israël (Benvenisti 2000a) mais aussi et surtout dans les Territoires palestiniens depuis les conquêtes de 1967.
Christine Pirinoli envisage ces destructions d’oliviers comme un moyen pour les Israéliens, d’« arracher l’un pour mieux implanter l’autre » (Pirinoli 2002 : 80). Le premier objectif est tout d’abord de « dé-signifier » ce qui lie les Palestiniens à la terre, en supprimant dans le paysage tout ce qui dénote leur enracinement dans le territoire. Les arrachages sont ainsi pratiqués pour leur forte dimension politique et symbolique à l’encontre des Palestiniens. « Arracher les oliviers signifie s’en prendre à l’Autre dans sa référence même, non seulement dans la représentation qu’il se fait de lui-même mais encore dans ce qui l’institue et le fonde » (Picaudou 2006 : 30). L’anthropologue Aïda Kanafani-Zahar souligne d’ailleurs la dimension profondément déstabilisante que revêt pour les Palestiniens la destruction de leurs arbres51 : L’arbre meuble la nature, rassure, signifie l’appartenance (…). Couper ses arbres à quelqu’un c’est lui signifier son départ, la destruction de la maison est bien secondaire. Couper un arbre, c’est affamer, briser une résistance » (Kanafani-Zahar 1999 : 49-50). (Facchin 2012)
Le deuxième objectif poursuivi est de permettre aux Israéliens d’évoluer dans un environnement qui doit leur paraître familier. Comme l’ont montré de nombreux auteurs, ils façonnent le paysage de la « Terre Promise » pour que celui-ci corresponde aux représentations qu’en a dressées le mouvement sioniste (Poulantzas 1980 : 114 ; Cohen 1993 ; Bardenstein 1999 ; Abufarha 2008). Or, les oliveraies constituent à leurs yeux des « témoins indésirables de la présence de l’Autre » (Falah 1996). Il en résulte un « cruel paradoxe » souligné par Weizman et Segal : Tout ce qui rend ce paysage « biblique », – ses habitants traditionnels, la culture en terrasses, les oliveraies, les constructions en pierre et la présence des troupeaux- est le fait des Palestiniens, que les colons juifs sont venus remplacer. Et pourtant, ceux-là mêmes qui cultivent les « oliveraies », et rendent ce paysage biblique sont exclus du panorama. Les Palestiniens sont là pour créer le décor, puis ils n’ont plus qu’à disparaître » (Weizman et Segal 2004).
L’iconographie sioniste vise d’ailleurs à servir d’objet de propagande : des commandes sont passées aux photographes juifs pour qu’ils rendent compte dans leurs clichés d’une terre marécageuse ou désertique. Ils doivent véhiculer le message selon lequel les Israéliens viendraient faire revivre la terre, avec l’objectif de faire « fleurir le désert ». Les Palestiniens sont complètement absents de cette iconographie, sinon pour apparaître comme des paysans pauvres aux techniques archaïques, et auxquels de bienveillants patrons juifs fourniraient du travail (Sivan 2010 ; Benvenisti 2000a).
La reconfiguration du paysage par Israël s’inscrit dans une politique plus large de judéisation de la Palestine et, partant, de « désarabisation » (Sanbar 2004 : 225) de la terre. Dans ce cadre, les Israéliens rayent les villages arabes des cartes publiées, donnent des noms bibliques aux nouvelles localités juives pour leur conférer un semblant d’authenticité, voire replantent des oliviers millénaires, arrachés à des Palestiniens, au cœur de ces localités (Benvenisti 2000a ; Pirinoli 2005 ; Schulz et Hammer 2003). Les Israéliens peuvent ainsi revendiquer une présence ancienne et continue sur cette terre.
L’olivier et son symbole deviennent ainsi un enjeu et un instrument du conflit, au cœur des processus d’extension de l’occupation pour les uns et de résistance pour les autres. C’est ce que l’on peut qualifier de « guerre des arbres » (Braverman 2009). Les Israéliens remplacent les oliviers arrachés par d’autres qui, soit n’ont aucun lien avec la population palestinienne, soit sont censés représenter la présence du peuple juif. Le pin, élevé au rang de symbole national par les Israéliens (Barthe 2013), couvre ainsi une surface croissante du territoire (Zerubavel 1996 ; Laborde 2010). En tout, près de 250 millions d’arbres ont été plantés par le seul Jewish National Fund depuis 1901. L’enjeu paysager est tel que le travail de la Société pour la Protection de la Nature en Israël est reconnu par l’État israélien comme effort de guerre (Selwyn 1995).
Quand il n’est pas possible d’ « effacer » complètement les symboles palestiniens comme l’olivier, les Israéliens tentent de se les approprier. Le site Internet de l’office de tourisme d’Israël insiste ainsi sur le lien indéfectible entre les oliviers et le pays :
Une colombe portant un rameau d’olivier est un des symboles historiques du peuple juif et de l’État d’Israël. La colombe est un symbole de paix, et la branche d’olivier représente les liens étroits entre le peuple juif et l’olivier méditerranéen. Ces deux éléments symbolisent également le lien entre le jeune État et son histoire vieille de deux mille ans »52.
L’Erat d’Israël a initié depuis 2002 une « route de l’olivier – Israël », pour guider le touriste sur les traces des anciens pressoirs et hauts lieux de l’oléiculture, présentés comme israéliens ». Un festival de l’olivier a également été créé au nord d’Israël. Le Jewish National Fund a par ailleurs planté de nombreuses oliveraies en Israël, en les présentant comme un symbole de l’enracinement de la population juive sur cette terre (McKee 2013). En Cisjordanie, la colonie de Shilo a fait de même depuis les années 2000, et s’est dotée d’une presse de taille industrielle qu’elle propose de faire visiter à ses clients israéliens. D’autres colonies avoisinantes l’ont suivi en Cisjordanie.
Les arrachages d’oliviers au cœur du conflit
Si les premiers arrachages d’oliviers par les Israéliens datent des années 1940, ils n’étaient à l’origine qu’un phénomène assez ponctuel. Ils ont pris en revanche un caractère quasi systématique à partir des années 2000. L’organisation palestinienne ARIJ estime à 2,5 millions le nombre d’arbres arrachés depuis 1967 (toutes espèces confondues), avec une accélération dramatique depuis quelques années puisque 1,5 million l’ont été entre 2000 et 2008. Ces arrachages concerneraient plus de 800 000 oliviers, dont 550 000 sur la seule période 2000-2008 (Palestinian Ministry of Agriculture 2008).
Deux types d’acteurs sont à l’origine de ces destructions d’oliviers : l’État d’Israël et les colons israéliens. Le plus souvent, il s’agit selon les autorités israéliennes d’une mesure dite « de sécurité »53 (Braverman 2009). L’objectif serait notamment de dégager le tracé de la route de la « barrière de sécurité », prévu pour courir sur plus de 700 Km. Officiellement, les impacts de cette politique seraient très secondaires. Selon le ministère israélien des Affaires étrangères : Le plus souvent possible, la clôture de sécurité se situe sur des terres en friche, afin d’éviter de causer un préjudice à l’agriculture. Les agriculteurs palestiniens auront accès à leurs champs grâce à des barrières spéciales prévues dans la clôture. Les arbres affectés par la construction de la clôture seront replantés »54.
En réalité, toutes les institutions palestiniennes et internationales ont dénoncé les profonds impacts du Mur sur les terres agricoles. Dès 2004, la Cour de Justice Internationale a déclaré illégale la construction du Mur avant d’ordonner, sans succès, le démantèlement de cet édifice. Elle estime que : 100 000 dunums [environ 10 000 hectares] des terres agricoles les plus fertiles de la Cisjordanie, confisquées par les forces d’occupation israéliennes, ont été détruites pendant la première phase de construction du mur, entraînant la disparition de très nombreux biens, notamment de terres agricoles, d’oliviers, de puits, d’agrumeraies et de serres, dont des dizaines de milliers de Palestiniens étaient tributaires pour leur survie55 ».
Je n’ai par ailleurs trouvé aucune trace des replantations mentionnées, ni dans la presse ni dans les témoignages de mes enquêtés. Lorsque les oliviers arrachés ne se situent pas sur le tracé du Mur, leur destruction est justifiée par un souci de protéger les abords des routes ou des colonies. Les Palestiniens sont en effet accusés par Israël d’utiliser leurs oliveraies comme « base arrière » quand ils lancent des attaques contre des objectifs israéliens. Les oliviers sont de ce fait assimilés par l’armée israélienne à des « soldats ennemis » (Braverman 2009).
L’émergence du symbole de l’olivier en Palestine
Il est déjà arrivé par le passé que la situation politique nationale influence la construction de la mémoire et de l’identité collective palestinienne. Par exemple, les paysans ont longtemps été oubliés ou dénigrés dans les historiographies palestiniennes, écrites par les élites intellectuelles urbanisées (Doumani 2006). Ce fut le cas jusqu’à ce que l’exode massif de 1947-1949, ne transforme la situation : depuis, les « paysans » incarnent idéalement la figure, centrale et fédératrice, de l’attachement indéfectible à la terre perdue (Swedenburg 1990 ; Stein et Swedenburg 2005). « La perte de la terre étant l’événement le plus marquant pour la grande majorité des réfugiés, la figure du paysan symbolise de manière idéale ce lien naturel » à la terre perdue, aux valeurs palestiniennes « authentiques » qu’il convient de préserver en exil » (Pirinoli 2002 : 76).
Les arbres constituent le symbole par excellence de cette relation supposée charnelle entre la « terre nourricière » et le paysan qui lui est dévoué. Puisque le nationalisme est une idéologie relative à l’appropriation d’un territoire donné, les notions de nature et de paysage sont donc propices pour véhiculer ses idées. Aussi, les populations utilisent souvent le symbole des arbres pour exprimer leur enracinement au territoire. Cette métaphore apparaît pour eux comme un moyen puissant de clamer un droit historique sur leur sol (Schulz 2003 : 15). Les arbres occupent ainsi une place privilégiée dans les récits, iconographies et emblèmes nationaux de très nombreux pays (le cèdre au Liban, le cyprès au Bhoutan, le palmier royal à Cuba, l’érable au Canada, le hêtre au Danemark, le yellowwood en Afrique-du-Sud, le pin en Israël, etc.).
Dans les Territoires palestiniens, trois types d’arbres ont été successivement mobilisés comme emblème national : le figuier de barbarie, l’oranger et, finalement, l’olivier59. Leur usage dans la rhétorique palestinienne nationaliste a évolué au gré des transformations politiques du conflit israélo-palestinien (Abufahra 2012).
Avant 1948, le figuier de barbarie symbolisait les communautés paysannes palestiniennes. Il était considéré comme une incarnation de ses propriétaires, car il véhiculait l’image d’une espèce résistante et coriace, mais aussi douce (pour ses fruits) et généreuse. Son nom en arabe, saber, signifie patience. C’était une espèce prédominante à l’époque de la Palestine mandataire, servant à délimiter les terrains et donc à séparer ou fédérer les communautés villageoises entre elles. Il était défendu de récolter les fruits des figuiers d’un Je ne reviens pas ici sur le coquelicot, symbole du sang versé par les martyrs dans l’iconographie nationaliste palestinienne. Voir à ce sujet les travaux de Nasser Abufahra, cité plus haut. autre village, en revanche on le faisait ensemble au sein de sa communauté. Le figuier de barbarie appartient à la famille du cactus, par conséquent, leurs fruits sont aussi appréciés qu’ils sont difficiles à atteindre. Leur dégustation faisait ainsi l’objet d’un rituel où se retrouvaient toutes les générations autour des patriarches, lors d’un temps festif de rassemblement. Le symbole de ce cactus est revenu au goût du jour dans les années 1990, avec les études et monographies sur les villages détruits, dans lesquelles les auteurs sont marqués par cette espèce qui reprend vie malgré la volonté des Israéliens de les éradiquer. Il s’agit alors du même symbole, mais à qui l’on confère désormais une nouvelle signification, celle de la résilience des Palestiniens face à leur déracinement passé.
Progressivement, à partir des années 1950, c’est l’oranger qui a fait son apparition comme symbole national des Palestiniens. Quelques années plus tôt en 1930-1940, le secteur des oranges originaires de Jaffa et sa région, avait connu une croissance exceptionnelle sur les marchés d’exportation (d’abord ottoman puis européens), et la filière était en pleine expansion. Dans les années 1920, ce secteur est largement dominé par les Arabes (les pionniers juifs s’intéressent peu aux activités agricoles). La surface qu’ils cultivent passe de 29 000 dunums en 1923 à 298 000 en 1939. L’expédition d’oranges de Jaffa vers l’Angleterre a longtemps représenté le tout premier poste d’exportation, loin devant le deuxième poste que constituaient les savons à l’huile d’olive. Si aujourd’hui, les statistiques agricoles palestiniennes apparaissent souvent « hors olives », de manière à ne pas fausser l’image de la réalité par le poids prédominant du secteur oléicole, elles étaient dans les années 1920-1940 présentées « hors agrumes » pour les mêmes raisons60. L’oranger était donc une source de prospérité, mais aussi de fierté pour leurs propriétaires palestiniens (Laurens 1999 : 127-129). La population tout entière considère l’orange comme l’ambassadrice et le panneau publicitaire du pays. Comme le remarque l’historien Mustapha Kabha, la référence aux orangers avait même été envisagée par les Palestiniens, à la fin des années 1920, pour apparaître sur le futur drapeau de la Palestine lorsque le pays gagnerait son indépendance (Sivan 2009). Un important bouleversement survient pourtant quand, en 1948, le tout jeune État d’Israël s’empare de Jaffa et confisque toutes les orangeraies de la côte : il dépose la marque commerciale « orange de Jaffa » et en fait l’emblème du « nouvel Israël »61. Dans l’imaginaire collectif, le nom de « Jaffa » renvoie désormais davantage à la marque d’oranges israéliennes qu’à la ville d’origine palestinienne dont elles sont issues. Se sentant dépossédés de leur arbre fétiche, les réfugiés Palestiniens réagissent en présentant l’oranger comme le symbole même de la spoliation de leur terre. Cet arbre devient pendant plusieurs décennies
À l’époque, l’huile d’olive n’apparaît même pas dans les tableaux statistiques des exportations, sinon sous la forme des savons à huile.
L’image de l’orange de Jaffa est devenue tellement indissociable de celle du pays, qu’elle se retrouve détournée au cœur des affiches des mouvements anti-occupation « Boycott-Désinvestissement-Sanction ».
l’icône allégorique de leur identité, le vecteur de mémoire d’un âge d’or que les Israéliens auraient annihilé. Le réalisateur français Eyal Sivan revient sur cette histoire et la popularise dans son film « Jaffa : la mécanique de l’orange » (Sivan 2009).
L’olivier, quant à lui, fait une apparition tardive sur la scène politique palestinienne, à partir des années 1980. Si l’accélération de la « guerre des arbres », étudiée plus haut, en est un facteur explicatif important, il est également nécessaire d’opérer un changement d’échelle pour en comprendre l’origine. Suite à l’invasion du Liban par Israël en 1982, l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) s’enfuit du pays, où elle s’était installée. Il s’ensuit un décentrage du pouvoir de l’OLP depuis les camps de réfugiés et l’intelligentsia du Liban ou de la Jordanie, vers les morceaux de Palestine demeurés « intacts » [i.e. vierges de toute agression israélienne] » (Tamari 2011 : 67). Les cadres exilés de l’OLP, principalement originaires de la côte où prévaut la culture des oranges, ont alors cessé d’être la figure centrale de la résistance et les producteurs iconographiques et discursifs dominants. Ce glissement s’est fait au profit des acteurs et des organisations de la résistance locale, qui n’avaient pas fui la Palestine après la Nakba62. Originaires de l’intérieur des terres, en Cisjordanie, ils étaient quant à eux familiers de la culture des olives, et c’est par conséquent cette culture qui a progressivement pris le dessus comme arbre national de référence (voir à titre d’illustration l’Annexe 3 regroupant les iconographies politiques palestiniennes à ce sujet).
Le recours à ces symboles communs, figuier, oranger ou olivier, permet d’unifier une nation en dépit de son éclatement et sa déterritorialisation : ils transcendent les différences sociales ou géographiques pour servir de ciment identitaire national (Abufarha 2012). Ces arbres ont successivement recouvert le statut de mythe depuis 1948, au sens où l’entend Roland Barthes : « Chaque objet du monde peut passer d’une existence fermée, muette, à un état oral, ouvert à l’appropriation de la société. » (Barthes 1957 : 216). Dans les Territoires palestiniens, les supports symboliques changent avec le temps, mais tous expriment une forme d’attachement indéfectible du peuple à sa terre. Néanmoins, parmi tous ces symboles, c’est celui de l’olivier qui a connu l’expression la plus vive, qui perdure encore aujourd’hui, en raison d’un processus de patrimonialisation unique par sa forme et son ampleur dans les Territoires palestiniens.
|
Table des matières
CHAPITRE 1 : Une filière oléicole palestinienne en constante mutation depuis le 20ème siècle
1. Un rôle socio-économique en relatif déclin depuis le 20ème siècle
2. L’émergence d’un nouvel emblème politique depuis les années 1980
3. De nouveaux acteurs pour une nouvelle organisation de la filière depuis 1990 ?
Conclusion du chapitre 1
CHAPITRE 2 : Repenser l’adaptation de l’économie au régime d’occupation israélien
1. La politique de séparation israélienne dans les Territoires palestiniens
2. De l’adaptation à l’appropriation d’un système de contraintes
Conclusion du chapitre 2
CHAPITRE 3 : L’aide au développement, outil et finalité des programmes d’exportation oléicoles
1. Une adhésion mitigée au projet d’exportation de l’huile palestinienne
2. Un intérêt marqué pour le marché de l’aide internationale
Conclusion du chapitre 3
CHAPITRE 4 : Les opportunités politiques et commerciales du tourisme oléicole
1. Des séjours variés, une forme commune de soutien aux Palestiniens
2. Les oliviers, un vecteur privilégié de solidarité internationale depuis la fin des années 1990
3. Les oliviers, une niche touristique depuis le milieu des années 2000
Conclusion du chapitre 4
CHAPITRE 5 : La solidarité pro‐palestinienne à l’épreuve du marché
1. D’innovants partenariats associatifs et commerciaux
2 Les dessous du marché de la solidarité : plongée dans un univers concurrentiel
Conclusion du chapitre 5
Conclusion générale
Table des matières
Table des figures et tableaux
Bibliographie
Télécharger le rapport complet