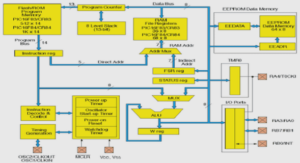Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Comment peut-on être Français ?
La nationalité relève du droit (Weil, 2002 : 10). Or, les catégories juridiques sont apparues insuffisantes pour faire l’objet d’une prémisse sociologique pertinente dans la mesure où elle est soumise à des évolutions, des cas particuliers et des objets limites. En effet, « le droit français à la nationalité est constitué de l’accumulation de dispositions adoptées sous des influences diverses (…) [qui] n’était en aucun cas le décalque d’une quelconque conception de la nation » (Weil, 2002 : 272). Pour que sa recherche demeure indépendante, le sociologue ne peut donc pas fonder sa recherche sur ce seul critère qui relève de l’État et de l’administration, inscrit dans une période et un espace déterminé. C’est pourquoi ce sont avant tout les représentations que les individus se font de leur nationalité qui m’ont intéressé pour choisir la population interrogée. Mes premières intuitions ont été contrariées par le terrain dans la mesure où l’objet étudié – les situations des enseignants français hors de France – se sont révélées beaucoup plus complexes que je ne le pensais au départ. Cette familiarité apparente ne doit pas être trompeuse. Elle accentue la nécessité d’interroger à la fois les données administratives et la relation entre le chercheur et les sujets qu’il interroge (Schütz, 1987 ; Devereux, 1980).
Les récits de vie des Français hors de France soulignent d’emblée l’ambiguïté d’une identité nationale dont la difficulté réside dans une unification de la diversité. Cette diversité est rapidement apparue sur le terrain. Rechercher des Français à l’étranger, c’est s’exposer au jeu des apparences et de la présentation de soi. L’apparence physique, certains aspects d’ordre biologique ou des signes extérieurs comme les accents ou les allures sont évidemment des critères qui sont écartés d’emblée en sociologie pour définir les individus. La discipline s’est justement constituée pour lutter ardemment contre les explications biologiques des comportements en expliquant la construction sociale des représentations et la complexité des trajectoires individuelles. Il ne s’agit donc pas de laisser supposer la moindre pertinence à des préjugés d’ordre « raciaux », « culturels » ou « civilisationnels ». Il ne s’agit pas de nier les différences de grandes catégories, mais d’éviter les généralisations excessives. Ces catégories ne sauraient constituer d’autres attributs que l’identité sociale imposée par l’étiquetage et les formes de discriminations que ces catégories représentent dans certaines interactions sociales.
La distinction est subtile et parfois trompeuse entre un touriste et une personne résidente. Un examen plus approfondi accentue la difficulté lorsqu’il s’agit de délimiter les sentiments d’appartenance. Une enseignante, qui ne figure pas dans la liste des entretiens par respect pour son désir de ne pas en faire partie, a eu une réaction de rejet lorsqu’au cours d’une soirée dans un bar espagnol, l’un de ses collègues que j’avais interviewé, lui a suggéré de participer à mon étude. Elle refusait toute catégorisation d’appartenance nationale. Par extension, elle refusait toute identification à une catégorie unique, que ce soit le fait d’être enseignante, le fait d’être française et le fait de vivre à l’étranger : toutes ces catégories étaient vraies dans son cas, selon un point de vue extérieur. Mais elles ne pouvaient être prises séparément de sa subjectivité ne pouvant pas être défaites de ses propres représentations d’elle-même. Ainsi, ma catégorie a priori d’enseignant français à l’étranger était invalidée. Pourtant, il fallait bien parvenir à définir les contours de mon objet de recherche. Le débat avec cette jeune femme a souligné que l’idée de relier le séjour « hors de France » au terme « étranger » était une catégorie a priori remise en cause par la diversité des appartenances. Elle repose sur un présupposé essentialiste qui réduit l’identité personnelle dans une seule et même nationalité, se bornant à la socialisation des personnes circonscrite à l’intérieur des frontières nationales. Devant la difficulté de synthétiser les multiples appartenances dans un rapport spatio-temporel immédiat, tant elles sont changeantes et prises dans un entrelacs de divergences, ne sommes-nous pas tous, dans une certaine mesure, à un certain moment, sous un certain aspect, étrangers à nous-mêmes ? La conscience de soi, en tant que mémoire individuelle et représentation révèle ainsi un être qui n’est déjà plus. Dans cet imaginaire conscient reconstituant une réalité passée, le moi pourrait être un autre que lui-même (Descombes, 2013). En effet, « avec la notion freudienne d’inconscient, (…) l’étranger n’est ni une race ni une nation. (…) Inquiétante, l’étrangeté est en nous : nous sommes nos propres étrangers – nous sommes divisés. » (Kristeva, 1988 : 268). Autrement dit, puisque la conjonction de l’espace et du temps qui constitue le monde réel ne nous permet pas d’être en même temps notre être et notre conscience d’être, notre identité est toujours une reconstruction a posteriori d’une identité plus ou moins désirée. Dans cette perspective, il n’est pas étonnant que certains enseignants venus de France ne souhaitent pas se présenter au sociologue comme étant français.
Les cas de personnes ayant une double nationalité accentuent certains a priori essentialistes. Il ne faudrait pas réduire ce type de questionnement au contexte marocain. Un cas limitant les frontières du sujet a été rencontré à Londres. Nina (31 ans, enseignante de français dans une école publique britannique, Franco-Britannique, née à Londres) a hésité à participer du fait de sa double nationalité. Elle a participé à l’entretien par complaisance et m’a donné des informations précieuses sur ses conditions de travail et l’organisation du système d’enseignement britannique. Mais elle n’avait jamais vécu en France, y séjournant seulement pendant les vacances. Elle a fait toute sa scolarité au lycée français de Londres, mais conserve un léger accent avec des intonations britanniques, de nombreux anglicismes ou des mots anglais au milieu des phrases en français. Finalement, cette jeune femme oscillait entre volonté et réticence puisqu’elle ne se sentait pas vraiment concernée par les critères de l’annonce de « recherche d’enseignants français à Londres ». J’avais insisté sur le fait que son sentiment de ne pas appartenir aux catégories prédéfinies me permettrait justement de préciser mes catégories. Le cas de Nina suggère l’ambivalence d’une scolarisation dans un établissement français à l’étranger pour les personnes binationales. D’un point de vue strictement administratif, la jeune femme est bel et bien française : binationale, elle possède la nationalité française. Cependant, elle n’a jamais vécu en France. Ainsi, n’ayant pas effectué de déplacement depuis la France, son cas ne peut pas m’intéresser individuellement, sauf pour les renseignements concernant les conditions professionnelles dans le système scolaire britannique. Ce cas peut ainsi être apparenté aux Pieds Noirs du Maroc, qui, de nationalité française, n’ont jamais vécu en France de manière durable. Pour les doubles nationaux vivant hors de France, la France est un pays étranger, un pays imaginé par les récits familiaux et un pays visité pendant les vacances.
Deux problèmes se posent alors dans la subjectivité du rapport à l’espace et au temps. Cette dimension a des incidences sur l’analyse des représentations spatiales et des pratiques quotidiennes. D’une part, une analyse réflexive de ma propre situation sur le terrain m’a permis de définir ma conscience de ma situation sur le terrain comme modèle à confronter à la réalité des autres acteurs. Ainsi les différents sentiments d’étrangeté sont-ils en rapport étroit avec les représentations subjectives de l’espace. En questionnant ma propre expérience par rapport à celle des acteurs rencontrés, j’ai remarqué la nécessité d’observer ma position d’enquêteur que je considérais comme étant « à l’étranger » par rapport aux situations de personnes rencontrées qui se sentaient chez elle hors de France. Dès lors, l’expression « Français hors de France » plutôt que Français à l’étranger est apparu plus recevable. D’autre part, les représentations de l’étranger soulèvent la question de la mémoire collective, notamment familiale. Au fur et à mesure des entretiens et de mes réflexions, j’ai essayé d’approfondir la question des pratiques migratoires transgénérationnelles. J’ai pris conscience que l’appartenance à la nation française était une donnée récente dans mon histoire familiale. Telle qu’elle m’a été transmise, celle-ci a été marquée par les déplacements dans la génération de mes grands-parents. Du côté maternel, ces déplacements se sont effectués de Pologne vers la France (en région parisienne) durant la vague migratoire des années 1920. La lignée paternelle prend ses racines en Grèce dans une communauté qui aurait migré vers la Corse à la fin du 17ème siècle – le nom de famille de ma grand-mère Regazzacci-Stephanopoli en a conservé l’héritage avec la racine Corse, Reggazacci, accolée à une racine grecque « corsisée », Stephanopolous. Puis, une partie de cette communauté s’est dirigée vers l’Algérie française, vers les années 1870. Le déplacement de mon grand-père, né en Lorraine en 1919, vers l’un des trois département d’Algérie pendant la Seconde Guerre mondiale, assurait la pérennité de l’ancrage familial dans la région, jusqu’à leur expulsion en 1962, après l’indépendance de l’Algérie, mon père étant alors âgé de dix ans. Ce bref aperçu généalogique, effectué au cours de mes enquêtes de terrain, a permis de situer ma propre histoire au sein de la population cible afin de démarquer ma propre représentation de la temporalité migratoire de celle des personnes rencontrées. Cette digression autobiographique montre que ma propre migration s’inscrit dans un parcours échelonné sur plusieurs générations où la France n’a peut-être été qu’une étape de transit. Sans être systématique, mon cas est loin d’être singulier. L’expérience hors de France interroge ainsi le sentiment d’appartenance nationale : hors de France, un Français est-il toujours aussi Français ? Était-il vraiment Français avant son départ ? À l’épreuve du terrain, le sentiment d’appartenance prend des allures plus subjectives et individuelles qui relativisent la possibilité d’une identité collective fondée sur l’appartenance nationale.
Les difficultés de recensement des Français hors de France
Le manque de données statistiques est le premier obstacle auquel se confronte le recueil d’informations générales concernant les Français hors de France. La difficulté pour catégoriser cette population peut s’expliquer par leurs nombreux déplacements : l’imprévisibilité de la durée du séjour, l’évolution de leur activité principale (professionnelle, touristique ou suivi de conjoint), leur liberté de circulation. Mais ces éléments ne seraient pas insurmontables pour les administrations consulaires s’il y avait une volonté de connaître précisément les flux de circulation de ses ressortissants. Encore faudrait-il qu’elles en aient les moyens. C’est donc le faible intérêt politique de relever ce type de données qui apparaît comme la raison principale de cette lacune. La non obligation de s’inscrire sur les registres consulaires et la réduction du recueil d’informations demandé (état civil minimal : noms, prénoms, sexe, date d’entrée) en témoignent. Chaque année, les enquêtes de la Maison des Français de l’Etranger15 tentent de combler cette lacune. Mais leur base de données reposant sur un corpus de volontaires répondant à un questionnaire par internet ne possède ni la légitimité ni l’exigence de la méthode scientifique.
Un autre moyen serait de passer par les registres locaux. Outre les difficultés d’accès à ce type de données, qui ne font pas toujours l’objet d’une publication officielle, le manque d’homogénéité des critères de recensement en fragilise la pertinence. Dans les cas étudiés, le Maroc mesure par nationalité, tandis que la Grande-Bretagne considère des régions géographiques. Au Maroc, l’état civil, la résidence et l’activité sont relevés lors du contrôle à la police des frontières, mais les chiffres sont présentés différemment entre le recensement de population et le registre de titres de séjour pour travailler légalement sur le territoire marocain (Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2004 à Casablanca). Or, ces chiffres sont imprécis puisque certains Français s’établissent et travaillent sans autorisation officielle au Maroc, c’est-à-dire sans titre de séjour, au salaire local payé en liquide, notamment dans le secteur associatif, ou dans des établissements d’enseignement privé marocain.
En Grande-Bretagne, la liberté de circuler et de travailler rend quasiment impossible l’exactitude des données. Les catégories de recensements des principaux instituts statistiques (National Statistics et IPPR – Institute for Public Policy Research) sont présentées selon la région de résidence (EU citizens), et selon que le séjour des ressortissants nécessite ou non un visa. Par ailleurs, les données disponibles par nationalité correspondent aux données des registres du consulat français. Ils ne nous apportent donc pas de précisions supplémentaires. Quoiqu’il en soit, bien que la Grande-Bretagne ne figure pas dans l’espace Schengen, le contrôle d’identité à la frontière n’exige pas de justifier l’objet du voyage. Il semble donc difficile de mesurer la durée de séjour et d’estimer l’activité principale des 3,5 millions de Français qui traversent la Manche chaque année. Le critère de la durée de séjour n’est pas suffisant. Un examen approfondi par entretiens montre que certaines personnes considérées comme touristes par les administrations sont en fait des résidents permanents. J’ai rencontré quatre personnes à Casablanca qui ont connu cette situation au moins une fois durant leur séjour. Avec d’autres Français – en particulier des jeunes Volontaires Internationaux en Entreprise (VIE), dont le contrat ne nécessite pas de titre de séjour officiel – ils font des allers-retour réguliers dans les territoires espagnols de Ceuta et Melilla, en Espagne ou en France pour renouveler leur visa touristique de trois mois.
Dans un rapport au sénat qui compare les pays européens et leurs émigrés, Garriaud-Maylam (1997 : 6) a déjà souligné « l’absence de données quantitatives fiables sur la distribution spatiale et temporelle de ces migrations européennes ». Les estimations se font par recoupements entre les données des pays d’accueil et les chiffres des nationaux inscrits auprès des consulats. Mais elles sont souvent faussées, soit par le cas de personnes ayant une double nationalité qui ne déclarent pas toujours leur nationalité d’origine, soit par la prise en compte du lieu de naissance sans considérer la nationalité d’origine, soit par la compilation des départs annuels sans recueillir le lieu de destination.
Des pratiques quotidiennes appliquées à l’enquête
La démarcation entre mes pratiques, en tant que chercheur sur le terrain, et celles des autres, la population étudiée, s’inscrit dans un cadre spatial et temporel d’organisation du quotidien. Cette organisation s’inscrit dans différents champs au sens que Bourdieu donne à ce concept (1984), c’est-à-dire un espace de luttes. Sur le plan professionnel, j’ai pris soin de rester dans le champ scientifique qui me concerne particulièrement, et non dans le champ des acteurs de l’enseignement au Maroc et au Royaume-Uni. Cette posture a été évidemment ambivalente et redéfinie constamment pour assurer un va-et-vient entre les différents champs. Cette ambivalence est d’autant plus marquée si l’on considère l’espace social dans son ensemble, au sein duquel les champs sont eux-mêmes en lutte. Acteur de l’écologie urbaine, cette sous-section décrit comment je me suis arrangé pour mettre en œuvre un quotidien dans la compétition locale au sein des espaces urbains de Casablanca et de Londres. C’est avant tout ma place dans cette compétition qui me démarque concrètement des acteurs. L’objectif étant de viser un objet de connaissance, l’organisation se devait d’être focalisée sur le déploiement des contours de l’objet. Autrement dit, ce sont toutes mes pratiques qui se sont orientées vers l’objet de mon attention : les enseignant français à à l’étranger : qu’est-ce qu’un enseignant ? Qu’est-ce qu’un Français ? Que signifie l’étranger ?
Sur le terrain j’ai répondu aux besoins de l’enquête par une panoplie de tactiques : « du fait de son non-lieu, la tactique dépend du temps, vigilante à y « saisir au vol » des possibilités de profit. (…) Il faut constamment jouer avec les évènements pour en faire des « occasions ». » (Certeau, 1990 : XLVI). En effet, « les tactiques misent sur une habile utilisation du temps16 » (Certeau, 1990 : 63). Le maintien de ma position de chercheur dans un entre-deux a été une posture qui transgresse les codes sociaux pour ouvrir la possibilité de visiter différents mondes sociaux sans s’attacher à l’un en particulier et en jouant habilement avec les appartenances. Sur un plan général, chaque séjour de six mois sur chacun des sites a été réalisé en deux temps : de septembre à décembre 2012, puis de janvier à mars 2013. À Casablanca, mon visa touristique renouvelé tous les trois mois a maintenu le caractère informel de ma visite, vis-à-vis des services administratifs français et marocains. Les fêtes de fin d’année m’ont permis de couper le séjour en deux et de renouveler mon visa touristique. À Londres, il n’y avait pas de contraintes administratives, mais les contraintes financières des loyers londoniens et les vacances d’été ont marqué une coupure qui m’a permis de commencer l’analyse des données recueillies à Casablanca. Quatre domaines de la vie quotidienne ont imposé des choix décisifs dans le maintien d’une posture d’entre-deux dans la relation avec le terrain : le logement, la rémunération, les activités sociales et les déplacements. Premièrement, j’ai choisi de vivre dans un hôtel bon marché (90 dirhams par nuit, soit environ 8€) dans un quartier populaire et touristique de Casablanca, près du Marché Central et de l’ancienne médina. Ce quartier de la ville m’a permis d’avoir ce regard à la fois proche et distant de la population cible. Ainsi, j’ai pu facilement me rendre sur les sites d’observation et aux lieux de rendez-vous fixés pour les entretiens, tout en évitant une relation trop proche, qui aurait masqué d’autres facettes de la ville. J’ai écarté les opportunités de vivre dans un quartier plus central par rapport à la population cible. Différentes opportunités de location d’appartement ou de colocation ont été envisagées, notamment avec un enseignant. Mais l’immersion par alternance m’a semblé préférable dans la mesure où elle m’a permis de saisir les différents mondes sociaux dont se compose la ville et favorisé des moments propices à l’analyse des expériences vécues. Mes interactions quotidiennes avec les réceptionnistes, les cafetiers, les restaurateurs et les commerçants marocains ont été précieuses car elles m’ont permis de percevoir le quotidien dans l’environnement urbain à Casablanca. Ce lieu d’habitation a été également un refuge indispensable, calme et sécurisant, où j’ai pu mettre en œuvre la partie imaginative du terrain et élaborer les expériences au cours de l’enquête. A Londres, durant la première période, d’avril à juin 2013, j’ai loué une chambre de 15m² en colocation dans un quartier au sud de la ville (Southwark), pour environ 800€ par mois (£155 par semaine) par le biais d’une agence française contactée avant mon départ. Durant la deuxième période, de septembre à décembre 2013, j’ai logé dans un appartement de 50m² dans le Nord de Londres, à Islington. Opportunité fréquente à Londres étant donné les déplacements fréquents de certains habitants, une amie américano-britannique m’a sous-loué son appartement pendant une mission humanitaire en Éthiopie pour la même somme que la petite chambre précédente. Ainsi, j’ai remarqué que la pratique en matière de logement différencie le chercheur et la population étudiée par les finalités de leur action. Cela ne m’a pas empêché de chercher un appartement sur chacun des sites. Mais en tant que chercheur, j’ai cherché un appartement pour avoir des informations sur une partie de mon objet d’étude : le prix de l’immobilier, les quartiers de résidence, leur réputation, etc. tandis que les acteurs effectuent des démarches similaires dans le but de trouver un endroit où résider.
Deuxièmement, un travail rémunéré s’est imposé dès mon arrivée dans chaque ville. Les indemnités de chômage couvrant une partie des frais à Casablanca, puis ma bourse de mobilité à Londres, n’étaient pas suffisantes pour assurer les objectifs de l’enquête. J’aurais pu chercher un emploi dans l’enseignement pour avoir un accès direct à une partie de la population cible. Mais ce choix comportait plusieurs contraintes. Exercer ce métier, adopter une posture professionnelle nouvelle et exigeante risquait d’absorber du temps et de l’énergie, ce qui risquait de ronger la partie réflexive de ma recherche. À Casablanca, cela aurait nécessité des démarches administratives et un engagement à long terme pour obtenir une carte de séjour, rompant avec le cadre temporel prédéfini pour le projet. À Londres, j’étais moi-même confronté à la concurrence des nombreux Français à la recherche d’un emploi dans l’enseignement. Dans les deux cas, la pratique quotidienne vers un lieu de travail m’aurait restreint à un seul type d’expérience sociale diminuant les possibilités de percevoir d’autres monde sociaux, d’autres lieux, d’autres écoles. Ce faisant, je n’aurais pas pu avoir une vue d’ensemble des différentes situations sociales et professionnelles. À Casablanca, j’ai donc effectué l’accompagnement individuel de deux élèves français scolarisés au lycée français dont j’avais rencontré les parents dans le cadre d’une association. Cela m’a permis de me sentir immergé sans nuire à l’organisation rigoureuse de ma recherche. Je suis parvenu à réitérer avec deux élèves franco-britanniques du lycée français rencontrés par le biais d’une des agences françaises de soutien scolaire à Londres. Dans chacun des cas, ces expériences m’ont permis des points d’observation différents sur les activités des enseignants au lycée et sur la vie quotidienne de différents quartiers de la ville et d’autres secteurs d’activités par des entretiens informels avec les parents d’élèves.
Troisièmement, toutes mes activités sociales étaient incluses dans mon travail de recherche. Le temps réduit d’expérience auprès des acteurs m’a permis d’élaborer une analyse réflexive au fur et à mesure de l’enquête. Par exemple, la participation bénévole dans une association d’accueil des Français à Casablanca a été problématique. Les opportunités de participer ou d’organiser des activités régulières ont rapidement émergé, mais l’association n’était en lien avec mon objet de recherche que dans la mesure où elle incluait de nombreux parents d’élèves et quelques enseignants parmi ses centaines d’adhérents. Par souci de rigueur, j’ai limité mon engagement à deux heures d’accueil toutes les deux semaines pendant les trois premiers mois, puis je m’en suis progressivement distancié pour me concentrer sur d’autres relations et d’autres activités en lien avec la population cible. L’objectif était à la fois une prise de contact avec des informateurs et une connaissance générale du terrain : la vie à Casablanca, l’enseignement français du point de vue des parents d’élèves français, la présence française perçue par d’autres professionnels, etc. Les autres activités sociales concernent les moments ponctuels partagés avec des enseignants ou d’autres personnes rencontrées au fur et à mesure (amis, famille, chercheurs, étudiants, quidams, etc.).
Quatrièmement, les modes de déplacement ont représenté une dimension considérable dans des villes où la circulation est difficile. À Casablanca, j’ai privilégié la marche dans un périmètre maximal de cinq kilomètres, réservant le bus pour des trajets repérés au préalable et ponctuellement, le petit taxi et le grand taxi (taxi collectif). À Londres, les transports sont tellement onéreux, que j’ai exploré le plus souvent la ville grâce à un vélo d’occasion acquis dès mon arrivée. Choix pragmatique et méthodologique, ces modes de déplacement ont permis tantôt une lenteur et, hormis dans certains de cas de forte circulation, une disponibilité psychique pour apprécier l’expérience de la ville, tantôt une confrontation aux différents modes de déplacements locaux. À Casablanca, en éprouvant ma présence en tant que minorité visible, j’ai perçu l’évolution des interactions avec les quidams au fur et à mesure que mon comportement se modifiait par ma connaissance des lieux et des codes d’usage. J’ai remarqué progressivement mon passage à l’anonymat. Sur chaque site, les premières semaines ont représenté une phase d’exploration afin de percevoir les différents mondes sociaux à travers le paysage urbain et pour prendre quelques repères spatiaux. Par la suite, au fur et à mesure des rencontres, mes trajets se sont diversifiés et ancrés sur quelques routines vers les bibliothèques, certaines écoles que j’avais ciblées, les lieux de résidence de mes élèves, des cafés, bars ou pubs londoniens. Mes modes de déplacement se sont aussi diversifiés au fur et à mesure de mon apprentissage des lieux.
L’accès au terrain et à la population, une expérience méthodique
La justification de ma posture durant l’enquête, en lien avec mes pratiques quotidiennes, ainsi que la description des difficultés rencontrées sur le terrain et l’explication des ajustements entrepris contribuent à la rigueur du protocole de recherche. La plupart des réflexions méthodologiques concernant l’accès au terrain et la posture d’enquêteur ont pour origine le premier terrain de la comparaison, effectué à Casablanca, prolongeant la première enquête à Rabat en 2010. Le choix des enseignants doit être situé par rapport au reste de la population française résidant à l’étranger. C’est une population apparemment homogène selon le critère de la profession qui la situe dans une population plus large (Hammersley et Atkinson, 1983 : 41). En tout, sur les deux terrains, en deux séjour de six mois répartis sur quinze mois, j’ai rencontré environ 250 personnes parmi lesquelles environ un tiers correspondaient à mes critères de recherche (enseignants français en déplacement hors de France) dont 52 ont accepté un entretien : 32 personnes à Casablanca et 20 personnes à Londres (voir annexe 2). Ces rencontres désignent toutes les interactions avec des Français, plus ou moins brèves, plus ou moins fréquentes. Chacune de ces personnes recensées dans mon journal de terrain résidait sur le site d’enquête au moment de la rencontre et exerçait une fonction soit professionnelle, soit en recherche d’emploi, ou était marié(e) à une personne ayant un emploi, Français(e) ou d’une autre nationalité. Ainsi, les enseignants français se situent dans une population plus large de personnes qui ont fait le déplacement de France vers Casablanca ou Londres.
Percevoir le terrain, une expérience sociale réajustée
« Percevoir » un terrain, c’est le voir, le sentir et l’écouter avec une attention aiguë. C’est mettre au travail son psychisme pour qu’il soit disponible, flexible, adaptable aux situations présentes. C’est se laisser porter intuitivement par les opportunités en suivant un fil conducteur structuré par le cadre spatial et temporel prédéfini par la problématique de recherche. Quelle(s) situation(s) entre(nt) dans le cadre de ma recherche ? Quel(s) point(s) d’observation semble(nt) pertinent(s) ? Percevoir est une tâche fatigante, car cela demande une attention permanente et un questionnement incessant de soi-même et de la problématique.
En arrivant à Casablanca, je me suis d’abord laissé porter par l’évidence apparente de rencontrer des enseignants dans le lycée français le plus important de la ville, qui recense environ un tiers de la population cible. Mon désarroi n’a pas tardé lorsque le proviseur m’en refusa l’accès. Mon imagination était alors sollicitée pour « élaborer des stratégies de recherche dont la caractéristique fondamentale sera l’adaptabilité aux contingences du terrain » (Strauss, 1992, 55). Mais la première approche a été infructueuse. Dès les premiers jours de mon arrivée à Casablanca, j’avais déposé une lettre de demande pour effectuer une enquête au sein de son établissement. La même requête ayant été acceptée à Rabat quelques années plus tôt, j’étais assez confiant. Lorsque je me suis rendu sur les lieux pour obtenir une réponse, la secrétaire de direction m’a informé de son refus catégorique en précisant que sa décision était ferme et définitive sachant qu’il avait le « pouvoir suprême ». J’aurais pu tenter un recours en faisant appel à l’institut de recherche en sciences sociales de Rabat ou à mon université d’origine afin de faire valoir mon projet. Mais il m’a semblé tout aussi judicieux de poursuivre mon enquête en faisant preuve d’imagination et en considérant ce refus comme une donnée observable. En effet, ce positionnement institutionnel a marqué une des limites de l’accès au terrain. Face à cette fermeture de l’un des points d’accès au terrain le plus évident, il m’a fallu trouver d’autres informateurs qui m’ont permis de pénétrer dans le monde social étudié. Ces limites (boundaries) et ces gardiens (gatekeepers) ont été autant d’aspects à considérer au cours de l’enquête (Hammersley et Atkinson, 1983 : 63). En effet, ils ont révélé certains enjeux du terrain, ainsi que les degrés de surveillance et de contrôle du milieu étudié (Hammersley et Atkinson, 1983 : 65). Plus tard, cet événement a été un support à la relation avec quelques enseignants de l’établissement rencontrés ailleurs par leur aide, leur soutien et leur avis sur la réaction de leur chef d’établissement.
Cette réponse négative, ayant brisé quelques espoirs, m’a laissé dans le désarroi pendant plusieurs jours. Mettant ma patience à l’épreuve, elle a indiqué la nécessité d’attendre pour se mettre en relation avec le terrain. Les rencontres avec des Français n’étant pas enseignants se sont succédées. Dix jours plus tard, suite à l’annonce diffusée dans une école primaire par une documentaliste de l’institut français de Casablanca rencontrée lors d’une soirée, un enseignant d’une école primaire française (François-Xavier) m’a contacté pour mon premier entretien. Il n’y a pas eu d’effet de « boule de neige » (snowaballing), puisque celui-ci ne m’a pas mis en contact avec d’autres personnes. En revanche, j’ai sollicité des associations de Français hors de France et me suis concentré sur une activité bénévole dans l’une d’entre elles dans l’espoir de faire quelques rencontres. Lors d’une soirée « Saucisson, vins, fromages » dans une villa près de l’océan Atlantique, j’ai dévoilé naïvement ma recherche à un groupe de trois personnes avec qui je bavardais spontanément. Deux d’entre elles enseignaient dans des établissements francophones à Casablanca. Mais tandis que l’une a été intéressée, l’autre m’a confondu avec un journaliste dont l’enquête aurait posé problème à certains de ses collègues participants. J’ai donc tenu à défendre mon travail sociologique en insistant sur l’anonymat des personnes et la longue durée de l’enquête, tandis que j’ai donné mes coordonnées à sa collègue (Lisa) que j’ai rencontré quelques semaines plus tard.
Les différentes situations d’enquête requièrent des comportements flexibles afin de s’adapter aux variations des rencontres. Il s’agit d’appliquer la présentation de soi selon Goffman dans différents contextes pour les besoins de l’enquête (Hammersley et Atkinson, 1983 : 51). L’exemple le plus significatif a été cette rencontre avec une enseignante (Amélie) durant laquelle j’ai joué avec l’ambiguïté de mes identités pour prendre contact. Dans le contexte de l’association, devant des personnes à qui je n’avais pas encore révélé mes objectifs de recherche, je me suis présenté selon mon statut de nouvel arrivant dans la ville à la recherche un emploi dans l’enseignement. Mais une fois le contact pris, je lui ai dévoilé mon projet par un mail dans lequel je lui ai proposé de participer à mon enquête en m’excusant de ma manière de procéder. Soucieuse de me rendre ce service, elle a accepté cordialement, m’ouvrant les portes d’un réseau social correspondant à ma recherche. Le terrain s’est ouvert encore un peu plus par le biais d’autres associations et par un groupe de jeunes Français, Volontaires Internationaux en Entreprise (VIE). J’ai exploré pendant deux mois des situations qui m’ont fait prendre conscience d’une partie du réel que je n’avais pas imaginée : des enseignants, titulaires de l’Éducation nationale en France ou non, exerçant dans des établissements privés marocains. Au cours de cette exploration, un directeur d’école, que j’avais contacté par l’intermédiaire d’une enseignante (Lisa) m’a gracieusement ouvert les portes de son établissement afin que je puisse y effectuer des observations. Enthousiasmé par la possibilité d’un échange intellectuel, il m’a présenté l’établissement comme un terrain à fort potentiel heuristique, susceptible à lui seul de faire l’objet d’une thèse. Par crainte d’une immersion trop profonde dans une monographie d’école, j’ai négocié mon action entre son enthousiasme, mon souhait d’observer des enseignants français en situation professionnelle et la représentation de l’espace prédéfinie à l’échelle urbaine. Ces dernières ne m’ont pas permis de me focaliser sur un seul cas. J’ai donc profité de cette aubaine pour effectuer sept demi-journées d’observations et de rencontres dans cette école, dont trois en classe. Puis j’ai continué mes pérégrinations en recherchant une variété de situations la plus large possible. Chacune de mes excursions urbaines a été ciblée, soit pour connaître l’espace urbain, soit dans l’espoir d’étendre un réseau de contacts pertinent. Par exemple, lors d’une visite au Club Alpin Français de Casablanca, un après-midi, j’ai rencontré par un hasard circonstancié, une enseignante d’Éducation Physique et Sportive qui faisait une séance d’escalade sur le mur du club (Murielle).
Cette posture ambiguë a toutefois posé quelques difficultés. Être disponible et à l’écoute peut sembler curieux du point de vue de certains acteurs. Un jour où j’étais en avance pour un rendez-vous avec un enseignant d’école maternelle (dont l’entretien n’a pas été retenu, faute d’informations suffisantes), dans un établissement où j’allais pour la deuxième fois, je l’ai attendu quinze minutes devant le portail, puis dans la cour de l’école après avoir reçu la permission d’entrer du gardien. J’ai attendu patiemment l’heure de sortie de classe dans un coin de la cour où des centaines d’enfants couraient dans tous les sens. Une enseignante de l’école (avec laquelle je n’ai pas effectué d’entretien), que je croisais pour la troisième fois ce jour-là, entre l’entrée, la cour, puis le couloir de la salle de classe où j’avais rendez-vous, m’a demandé ce que je faisais ici. Je lui ai expliqué que j’avais rendez-vous avec cet enseignant. Elle m’a expliqué ensuite qu’elle s’était méfié « de voir quelqu’un d’étranger dans l’établissement, car dans ces cas-là, on se demande quel enfant il va kidnapper ». Je n’avais jamais pensé pouvoir être suspecté de vol d’enfant ! L’enseignant en question m’a ensuite fait attendre pendant une heure pour finalement me proposer un repas avec ses collègues et ne m’accorder qu’un quart d’heure d’entretien en présence de ses enfants alors que nous avions convenu d’une heure. Avant le repas, dans la salle de détente, je me suis présenté comme chercheur devant le regard interrogatif de huit de ses collègues. L’un d’entre eux me tourna le dos et quitta la salle en maugréant « moi, je ne répondrai à aucune question ! ». Trois d’entre eux l’ont suivi et sont allés manger dans la pièce à côté. Ces quelques exemples montrent les difficultés de se faire accepter en tant que chercheur, même dans un milieu social dans lequel j’avais présupposé un certain intérêt pour la recherche. Même lorsque le terrain ne présente pas de risques particuliers, le chercheur se doit d’instaurer une relation de confiance avec les personnes en présence. Certaines d’entre elles, sans mauvaise pensée, se sont qualifiées elles-mêmes de « cobayes », de « rats de laboratoires » ou d’« objets d’étude ». Le vocabulaire ainsi employé a traduit, malgré lui, les représentations des acteurs de la relation avec le chercheur qui les étudie. Finalement, entre acceptations et rejets, j’ai appris à maintenir ma posture et à négocier avec eux, en usant de stratégies pour entrer en relation avec mon terrain, de manière flexible, me rendant psychiquement disponible. L’analyse progressive des perturbations émotionnelles s’est avérée indispensable. La relation avec ce terrain m’a finalement permis de transgresser l’interdiction d’entrer dans le principal lycée français de la ville. Après plusieurs entretiens avec des enseignants en dehors des murs, j’ai estimé que la salle des profs de cet établissement était un point d’observation incontournable. J’ai donc profité de l’invitation innocente d’une enseignante à l’intérieur du lycée pour un entretien (Christiane). Ce pas franchi, j’avais repéré les lieux pour entrer par l’accès des enseignants de manière spontanée, profitant de mon apparence familière auprès des gardiens. J’ai pris d’autres rendez-vous qui m’ont ainsi permis de passer deux ou trois heures par jour pendant deux semaines en salle des profs. Un enseignant (avec lequel je n’ai pas eu d’entretien)
à qui j’avais expliqué ma recherche, alors qu’il pensait que j’étais membre du personnel, a eu ces mots très justes : « c’est peut-être mieux de ne pas être venu dès le début : cela t’a évité d’être pris dans cette grosse machine ! ». Je crois qu’il a eu raison, car ces quinze jours ont fourni une importante quantité d’informations : les situations d’enquêtes et les entretiens successifs dans un temps relativement court ont été éprouvants. L’organisation de mon quotidien de recherche a été ainsi bouleversée. Ne laissant guère de place à la réflexivité nécessaire pour réguler mes émotions, analyser mes perturbations et imaginer la suite de l’enquête, il m’a fallu « échapper au raz de marée du travail de terrain » (Xavier de Brito, 1994 : 162). Ainsi, cette posture m’a permis d’utiliser l’imagination comme un « mécanisme d’ajustement » (Strauss, 1992a : 69).
La spontanéité attentive, penser à partir du sens commun
Puisque la relation est un échange symbolique de considérations sauvegardant l’estime de soi et de l’autre, les échanges se sont faits de manière spontanée. Les invitations au café ou pour un repas ont été des dons qui n’ont pas nécessairement relevé d’une affinité particulière. L’entretien a peut-être été perçu comme un espace de parole pour ceux qui s’y sont livré. Le discours leur a permis de prendre de la distance avec son vécu. J’ai offert cette possibilité alors qu’en retour, j’ai enregistré et sélectionné des informations, recueilli des données et pris des contacts. Certains ont souligné les effets de cette relation qui s’est enclenchée. L’une (Sophie), titulaire d’un diplôme de psychologie avait « l’impression de passer de l’autre côté » par rapport à sa formation. Un autre, enseignant et psychologue scolaire (Stéphane) a dit que l’entretien « n’a pas été désagréable, cela a été comme une thérapie ». Un autre (Hulot17) a dit devant moi à ses collègues en ironisant qu’il « fallait se méfier car [je] savais faire parler ». Enfin, un dernier (Aurélien) a dit devant moi à ses collègues sur un ton mêlé de plaisanterie et d’étonnement : « heureusement, que nous avons été interrompus (une collègue était venue le chercher pour un rendez-vous), parce que j’avais commencé à lui parler de ma mère ! ». L’interprétation de chaque interaction pour déceler l’équité de la relation entre eux et moi m’a semblé vaine. L’échange s’est fait selon une reconnaissance mutuelle dans laquelle je ne peux pas présupposer de la valeur du don et du contre-don sans que l’autre me l’ait communiquée (Ricoeur, 2004 : 330). En revanche, il a été indispensable d’être attentif aux signes explicites ou implicites que les personnes rencontrées ont renvoyé, et ce, afin de le réajuster. Loin de nuire à la recherche d’informations, cette attitude n’a pu que l’encourager. Chaque entretien a été riche d’informations même lorsque le discours m’a semblé décalé. J’ai fait fi de mes sentiments en prenant une posture d’écoute professionnelle et en laissant le discours se dérouler. Savoir écouter, c’est savoir se taire pour libérer la parole de l’autre, quoi qu’il dise. Écouter, c’est éviter de poser des questions tout en relançant, si nécessaire, sur les mots ou les thèmes abordés. C’est s’effacer en tant que sujet. Je me suis identifié à certains discours et pas à d’autres. Parfois j’ai eu l’impression d’être face à un miroir me renvoyant à mes propres expériences (Cécilia, Hulot et Arthur à Casablanca ; Estelle et Aude à Londres). D’autres fois, des situations concrètes, des recoupements, des connaissances en commun m’inscrivaient alors dans le mince réseau d’individus dans le monde qui partageaient cette expérience (Maïlys, Cécilia). À deux mille kilomètres de chez moi, je rencontrais des camarades de classe de certains amis ou des anciens étudiants de mon université. Donner la parole à l’autre, c’est éviter d’être parasité par le temps qui passe, l’environnement, le dictaphone ou la prise de notes. Outre le dictaphone, je n’ai jamais pris de notes et n’ai jamais pris de papier devant moi, sauf lorsque j’estimais devoir « faire sérieux » devant mon interlocuteur. Écouter, c’est reformuler une idée abstraite pour être sûr d’avoir bien compris le sens des mots employés. C’est demander des exemples concrets que cette idée évoque. Écouter, c’est resituer le discours dans un contexte lorsque la personne évoque un souvenir. C’est aussi, en fin d’entretien, confronter son interprétation et sa compréhension du discours dans un échange avec la personne qui a livré une partie de son récit de vie.
La relation au terrain m’est alors apparue comme une sorte de psychanalyse pour moi-même, mettant en œuvre ma propre réflexivité. En analysant ma relation au terrain, j’ai mis du sens sur mes expériences. J’ai élaboré ma pensée en écrivant, seul face à mon ordinateur, et me suis confronté à autrui par l’échange avec les acteurs ou avec certains de mes collègues. J’ai puisé mon imagination en confrontant mes expériences avec celles des autres. J’ai construit ainsi une dialectique entre le moi et le monde lors de la transcription des discours, longues heures éprouvantes mais temps essentiel pour forger mon analyse en travaillant les renvois du discours à ma propre conscience et m’en absorber afin d’en dégager des concepts qui se sont ‘affinés progressivement. Pour longue et fastidieuse que soit cette étape, je ne saurais la déléguer à un collaborateur (Bertaux, 1980). L’enjeu, pour être scientifique, a été de distinguer le général du particulier : le moi et les autres et les parties de moi communes aux autres. Mais alors à quels autres ? La rigueur scientifique a consisté à montrer la complexité du monde au-delà de moi, tout en situant mon moi dans cette complexité. Il s’agit de « faire entrer dans la définition du « réel » le contact entre l’observateur et l’observé » (Merleau-Ponty, 1964 : 33).
Ainsi, mon avis sur un sujet concernant les acteurs a varié selon la situation et le positionnement de mon interlocuteur. Par exemple, la baisse des primes d’éloignement des enseignants titulaires d’un poste de détaché au Maroc était ardemment défendue par certains syndicalistes et dénigrée par d’autres. Au cours des entretiens, quatre personnes l’ont évoquée de manière différente. J’ai été d’accord avec chacune d’entre elles au moment de l’interaction. En tant qu’acteur, cette posture aurait pu être considérée comme un certain opportunisme, une indécision ou une incapacité à se positionner. En tant que chercheur, cela a été un outil de compréhension en se mettant à distance des enjeux des acteurs. Ma préoccupation a été de tordre mon opinion pour recueillir des avis divergents sur la question afin d’en comprendre le fond et de l’utiliser comme matériau empirique. C’est par une pratique entre mes expériences sociales et mon imagination que les différents discours ont été décodés selon la position des acteurs, y compris la mienne en fonction de mes pratiques spatiales et des analyses de mes relations sociales en termes de démarcation. J’avais bien un fondement moral qui m’aurait permis d’émettre un avis sur la question, mais ce n’était pas mon rôle. Selon moi, il s’agissait plutôt de contextualiser le positionnement de l’acteur dans son discours par la confrontation à d’autres perceptions.
Comparer l’expérience londonienne à partir de Casablanca
La spécificité du terrain à Londres a tenu au fait que c’était la deuxième partie de la comparaison. Il s’agissait de cibler la population en fonction du panel de population retenu à Casablanca, afin d’être au plus près du terrain déjà effectué. La difficulté a donc été de trouver un éventail aussi large de situations que celui obtenu à Casablanca.
Toutefois, la variété de situations à Londres a été plus large qu’à Casablanca, notamment au niveau des établissements fréquentés (privés, publics, institut français…). Concernant l’institut français, davantage d’enseignants français sont à Londres par rapport à Casablanca où les profs de Français Langue Étrangère étaient en priorité Marocains du fait de la francophonie et du principe de préférence nationale à l’embauche. A Londres, la législation est différente, puisque le pays n’est pas francophone et ne connaît pas les mêmes enjeux en termes d’emploi de la population locale. La population d’enseignants français à Londres peut sans doute être estimée à plusieurs milliers. Il sont environ 4000 selon Garriaud-Maylam (2004), ce que confirment mes estimations à travers les données de la National Statistics et des avis recueillis auprès de différents fonctionnaires de l’ambassade, unanimes pour dire qu’il serait impossible de la chiffrer de façon exacte. Il s’agissait donc de ne pas se perdre dans cette foule potentielle d’interviewés, mais d’en saisir quelques aspects significatifs. La précédente enquête à Casablanca m’ayant fourni des contacts au lycée Charles de Gaulle, j’ai choisi de commencer par ce biais et de tenter de les élargir par la suite.
Une autre difficulté, perçue dès les premiers jours, a été la taille de la ville et de ses apparences. Casablanca était déjà une grande ville où il fallait, dès le départ, tenir compte des difficultés d’orientation. À Londres, s’ajoutait le coût des transports en commun, que j’ai rarement utilisé, ayant rapidement opté pour le vélo. Certes, ce moyen de transport n’a pas été le plus approprié pour s’immerger dans la vie locale, mais il a été le moins onéreux, et parfois aussi rapide. Il s’agissait de prendre en compte cet élément comme un biais dans mon regard sur la ville, et d’être attentif aux témoignages que j’ai recueillis sur les transports en commun et plus rarement, sur la conduite en voiture.
Enfin, étant donné la taille de la ville et le nombre d’activités, il était indispensable d’organiser ma vie quotidienne dans le cadre de mon enquête. Face aux multiples offres culturelles ou de loisirs et aux possibilités de rencontres qu’offre la grande ville, l’enjeu était de bien choisir les activités en fonction de la problématique. Il s’agissait donc dans un premier temps de « me poser » et de prendre des repères géographiques, ainsi que de travailler sur mes représentations. Dans ce premier temps, les activités de l’institut français m’ont semblé adéquates, puis celles des associations de Français se sont révélées fructueuses, bien plus indispensables à Londres qu’à Casablanca.
Je n’ai pas eu l’impression de m’impliquer moins sur le terrain londonien qu’à Casablanca, pourtant, j’ai eu le sentiment que celui-ci m’entraînait moins dans des réseaux déjà constitués. Les enseignants vivent-ils dans des réseaux si étroits qu’ils sont difficiles à pénétrer ? Ou ces réseaux sont-ils si diffus que je ne parvenais pas à y accéder ? Des observations que j’ai pu faire et des entretiens que j’ai obtenu, les Français de Londres m’ont paru moins disponibles. Certes à Casablanca les enseignants sont occupés et préoccupés par leur vie personnelle, leur vie de famille et leurs soucis quotidiens, mais la position sociale privilégiée des Français les place dans une situation plus décontractée qu’à Londres où la compétition est permanente. En fait, à Casablanca, quoique les enseignants soient sous pression pour le travail, leur vie quotidienne apparaît moins trépidante. À Londres, il semblerait que la pression s’exerce à la fois dans le travail et dans le quotidien. Cette observation peut être renforcée par l’analyse de l’organisation sociale de l’espace et la place qu’y occupent les enseignants. À Casablanca, la plupart des Français occupent une position privilégiée. Nombreux sont ceux qui ont la décontraction des nantis, quoique quelques-uns n’aient pas de personnel de maison. Le fait d’être français leur accorde une légitimité qui facilite des accès sur le plan professionnel et dans le quotidien. Dans les établissements scolaires, la compétition est rude pour les élèves et leurs parents. S’il est vrai que les enseignants travaillent beaucoup à Casablanca, ils peuvent souvent décharger certaines tâches quotidiennes à leur personnel de maison. De plus, la géographie de la ville et leur pouvoir d’achat leur permettent généralement un certain confort, résidant près de leur lieu de travail et près de l’école de leur enfant. En outre, la scolarisation des enfants y est moins onéreuse. À Londres, le contexte est bien différent. Les enseignants français sont noyés dans la dure compétition de la ville, que ce soit pour leur logement ou la scolarisation de leurs enfants. La ville étant plus étalée et les loyers du centre-ville étant à des tarifs exorbitants, le temps passé dans les transports est plus long. Rares sont les enseignants qui ont les moyens de payer du personnel de maison, à moins d’avoir un conjoint qui travaille dans un secteur rémunérateur. Pour ceux qui ont eu le privilège d’avoir obtenu une place dans un établissement français, les frais de scolarité sont moins onéreux ou sont pris en charge par un système de bourses. Mais tous les autres sont immergés dans la sévère compétition scolaire de la ville où les frais de scolarité peuvent être une part importante du budget. On ressent une pression plus forte, à laquelle s’ajoute peut-être une assimilation à la mentalité anglo-saxonne du working hard qui incite à travailler beaucoup ou tout au moins, à montrer que l’on travaille beaucoup.
Les enseignants paraissaient donc moins disponibles à Londres qu’à Casablanca, d’où un nombre plus restreint d’entretiens. Deux raisons principales peuvent être mises en avant : l’anonymat dans la ville, la dispersion des réseaux et une tendance générale au repli sur la sphère privée. En effet, l’absence de visibilité des Français empêche, par exemple, que l’on reconnaisse un enseignant dans la rue à sa manière de se vêtir ou de se comporter, comme c’est parfois le cas à Casablanca ; la participation quotidienne à une compétition dans laquelle ils sont directement inscrits à Londres les rend moins disponibles pour répondre à un entretien ; des mentalités et un climat qui incitent au retranchement dans l’entre-soi et dans la sphère privée et, une ambiance qui les rend sans doute plus indifférents.
Un protocole de recherche au service de l’imagination sociologique
L’ethnographie est une méthode de recherche destinée à « rendre plus familier ce qui nous paraît originellement étrange » (Laplantine, 1996 : 15). Malgré une apparente familiarité et certaines affinités, les Français hors de France me sont apparus étranges. La démarcation entre moi et les acteurs s’est révélée dans l’organisation quotidienne de l’espace et du temps. La sélection rigoureuse des moments d’observation, des rencontres avec les informateurs, l’enregistrement des entretiens, la prise de notes ont été échelonnés au cours des journées et des semaines (Hammersley et Atkinson, 1983 : 46-50). Il s’agissait d’alterner des périodes d’expérimentation avec des périodes d’imagination afin de « fuir momentanément la réalité » (Strauss, 1992 : 69) pour opérer des mécanismes d’ajustements et de monter en généralité au fur et à mesure de la collecte des données.
Ces moments de repli ont permis d’analyser les « déformations dues à la subjectivité » du chercheur en relation avec son terrain affectant sa perception et ses réactions (Devereux, 1980 : 17 ; 75).
Le terrain a été un espace produit, représenté et vécu selon trois formes : l’espace de représentation, les représentations de l’espace et les pratiques spatiales (Lefèbvre, 1970 : 49). Prenons l’exemple de l’espace délimité à Casablanca, capitale économique du Royaume du Maroc située sur la côte Atlantique. Le « Grand Casablanca » est la région administrative qui constitue le continuum de l’agglomération urbaine sur un périmètre d’environ vingt kilomètres, comptant près de quatre millions d’habitants. Dans cet espace de représentation conçu par les administrateurs et constamment mis en mouvement par les évolutions des populations, l’enquête s’est limitée aux lieux de travail, d’habitat et d’activités sociales : autant de pratiques spatiales des enseignants français et de points d’ancrage pour repérer une population cible, estimée à six cents personnes. Vingt établissements scolaires francophones ont été répertoriés dans un périmètre d’environ sept kilomètres autour du port et de l’ancienne médina, centre historique de la ville. Les lieux d’habitation des personnes rencontrées et leurs trajets quotidiens ont élargi l’espace de la recherche à une vingtaine de kilomètres, de Mohammedia à Dar Bouazza. Ce territoire vécu, considéré comme des représentations de l’espace a pu être étendu à l’échelle nationale et internationale par les contacts à distance (internet, téléphone), ainsi que les déplacements physiques en France, au Maroc ou dans des pays tiers. Cette définition de la situation dans l’espace et dans le temps a servi de cadre de référence au projet de recherche, tout en restant adaptable aux réalités de l’enquête.
Pour voir ce qu’ils ne voient pas, regarder les enseignants de loin, les échanges avec d’autres personnes – Français, Marocains, élèves, parents d’élèves et autres informateurs rencontrés parfois au hasard – ont permis d’alimenter la théorie par des aspects non expérimentés ni par les enseignants ni par moi. Il s’agissait de chercher des acteurs impliqués dans la recherche et non de s’y impliquer en tant qu’acteur. Cette posture a entraîné une relation flottante, labile et diluée dans le temps avec les acteurs observés, ce qui a pu poser quelques problèmes pour moi-même ou pour eux. Cette attitude solitaire a été différente du « deuil solitaire : le travail fou étant une manière de combler un vide immense et de sortir du désespoir en prenant intérêt aux autres (…) » (Bourdieu, 2004 : 93). C’est plutôt une solitude calculée, régénératrice et productive, qui a stimulé
Un recueil de données in situ pour comparer les significations
Casablanca et Londres, un choix nécessaire pour une approche globale
Si l’idée de départ de cette thèse était d’approfondir mes investigations auprès des Français au Maroc, le choix des terrains a requis une certaine méthode. Tout d’abord, il s’agissait de circonscrire l’espace étudié. Il aurait été pertinent d’explorer différentes situations à l’intérieur du Maroc. La situation d’étranger dans des villes historiques de la période coloniale, comme Casablanca et Rabat diffère profondément de celle des villes impériales du centre comme Fès ou Meknès, des villes du Nord comme Tanger ou du Sud, plus touristique, comme Marrakech et Agadir. Une partie du terrain ethnographique à Casablanca a consisté évidemment à situer la spécificité de la capitale économique sur le territoire marocain. Par souci de commodité, il était donc préférable de limiter cette étude à un seul espace urbain dans un même pays en essayant d’en comprendre la spécificité. Le choix de Casablanca a reposé sur le fait qu’elle regroupe près de la moitié des Français inscrits sur les registres consulaires au Maroc. Le lycée Lyautey, ainsi que les multiples établissements scolaires homologués, de même que ceux de l’Office Scolaire et Universitaire International (OSUI), offraient un potentiel intéressant pour recueillir suffisamment de situations variées, que la découverte sur le terrain a fait progressivement émerger. Les autres villes n’ont, le plus souvent, qu’un seul établissement en gestion directe reconnu par l’Agence de l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) et peu ou pas d’établissements de l’OSUI ou privés homologués18.
Cependant, l’ambition initiale de comprendre la population française à l’étranger dans l’espace mondial ne pouvait se limiter à un seul pays. Certes, ce choix aurait permis une description plus profonde de la situation au Maroc, mais le terrain ayant déjà été partiellement exploré au cours des précédentes enquêtes et la volonté d’élargir la perspective d’analyse m’ont incité à explorer un autre terrain. La méthode comparative est la seule recevable pour s’élever au général après avoir observé et décrit le particulier de manière aussi exacte et complète que possible (Durkheim, 2010 [1895] : 194). Si la construction des types provient de l’analyse des concordances et des divergences entre les terrains d’observation, la manière de mettre en pratique la comparaison au cours de l’enquête est restée relative à l’objet observé et à la subjectivité du chercheur. La démarche d’enquête a demandé une période de terrain suffisamment longue pour se mettre en situation, établir une relation avec les acteurs pour constituer un corpus significatif et varié, rechercher les récurrences et écouter les acteurs pour comprendre les significations de leur langage et le sens de leurs codes. Il semblait donc plus raisonnable de ne pas multiplier les terrains et de se limiter à deux sites pour y passer environ six mois sur chacun d’eux. C’était bien suffisant en matière d’organisation.
Parmi les 130 pays accueillant un établissement scolaire français de l’AEFE, le choix restait vaste. J’ai écarté les autres pays du Maghreb, arabo-musulman et d’Afrique pour ne pas restreindre ma recherche à une seule région du monde parmi des catégories classiquement établies par « aires culturelles » ou par continent. Pour gagner en profondeur, le choix de Londres offrait le potentiel heuristique de renverser les catégories du sens commun. Préalablement mis en concurrence avec d’autres possibilités, les cas de Montréal (Canada, Québec) et Sao Paulo (Brésil) avaient été évoqués, de même que l’île de la Réunion comme région étrangère par l’éloignement malgré son appartenance administrative à la France. Ces cas, tous aussi pertinents les uns que les autres, auraient pu faire l’objet d’une enquête. La première nécessité a été d’ordre pratique. Mon amie américano-britannique vivant à Londres depuis plusieurs années pouvait m’héberger lors de mes deux séjours de préparation. La proximité géographique et la langue facilitaient également la vie quotidienne sur le terrain. Mais rétrospectivement, l’idée venait sans doute d’une continuité par rapport à l’enquête effectuée à Rabat durant laquelle des enseignants m’avaient suggéré que les comportements et la position sociale des enseignants au Maroc pourraient être intéressants à observer à Londres.
Impérialisme et colonisation, les déterminations socio-historiques de l’objet
La comparaison entre Casablanca et Londres correspond à l’intuition à partir de laquelle cette recherche a émergé. Elle permet notamment de confronter, l’observation empirique et les représentations à partir des effets du passé colonial de la France et de ceux de la concurrence avec un pays voisin européen. Certes, la comparaison entre la situation des Français au Maroc et en Algérie, par exemple, aurait sans doute pu mettre en évidence les spécificités de chaque histoire coloniale et les différences dans les situations actuelles. De même, les situations à Madrid ou à Berlin auraient également permis d’aborder des déplacements intra-européens et de comparer la présence des établissements scolaires français dans un espace social post-colonial et dans un espace social européen. En effet, il ne s’agit pas seulement d’analyser les trajectoires des individus et leur déplacement, mais aussi de comprendre leur position sociale sur le marché scolaire et dans l’espace social et urbain. Finalement, la reconstruction intelligible de la comparaison est toujours délicate si elle ne se distingue pas d’un discours de justification d’une réalité construite personnellement par le chercheur ou socialement. Cela dit, si cette construction est sociale, alors la réalité prend une tournure sociologique intéressante. À force de chercher les raisons de mon intuition et de tenter de les justifier par divers moyens artificiels à l’instar les données socio-économiques et démographiques telles que les indices de développement humain, du produit intérieur brut ou de la population française établie, c’est en relisant mes premiers entretiens à Rabat en 2010 que je retrouvais deux remarques auxquelles ma recherche pouvait permettre de mettre du sens. La première, formulée par un enseignant en histoire-géographie (Thibaut, voir annexe 1), suggérait que la population d’élèves du lycée français étant différente au Maroc et en Angleterre. Il serait intéressant de comprendre pourquoi les lycées de Rabat et Casablanca concentrent majoritairement l’élite marocaine alors que les lycées de Madrid ou Londres sont plutôt une offre parmi d’autres. Une autre remarque a été faite par une enseignante en français (Francine, voir annexe 1), mariée à un homme marocain, rencontrée dans leur maison de Kenitra en 2010. Elle évoquait l’histoire coloniale à laquelle il fallait « faire attention ». Au collège français de Kenitra, elle décelait des comportements d’enseignants français envers leurs collègues marocains marqués par « des petites réflexions un peu racistes » qui la choquaient. Elle suggérait alors que le passé colonial était ancré dans les mentalités et les représentations pour expliquer ce type de comportement. Elle supposait alors que ces comportements seraient différents en Angleterre où l’histoire n’est pas marquée par cet héritage colonial.
Mes déplacements successifs et les échanges que j’ai eus sur les différents sites au sujet de mes choix comparatifs ont renforcé le caractère franco-centré de ces choix. Conformes à une problématique de recherche concernant les Français de l’étranger, ces choix suivent des représentations du passé colonial et des vestiges de la rivalité Franco-Anglaise. Les remarques de mon entourage proche ont suggéré que partir à Londres était une forme de « traitrise », partir « chez l’ennemi », cet « ennemi au moins depuis la Guerre de Cent ans ». Ces discours auraient pu conserver une place anecdotique si je n’avais pas observé sur le terrain les rivalités dans le sport (foot, rugby), dans les médias (le fameux French bashing anglais19) ou encore des titres d’ouvrages, lors de mes premières recherches bibliographiques : La France et le Royaume-Uni. Des ennemis intimes (Tombs Robert, Tombs Isabelle, 2006) ; Histoire de l’anglophobie en France, de Jeanne d’Arc à la vache folle (Guiffan, 2004) ; L’entente glaciale. Français-Anglais : les raisons de la discorde (Roudaut, 2004).
L’enseignement francophone dans l’espace mondial
Au fur et à mesure des deux enquêtes de terrain, j’ai découvert l’élargissement de la problématique. Il ne s’agissait pas de se restreindre à une analyse des trajectoires individuelles pour interroger les variations de la nationalité et le sentiment d’appartenance à la nation française après un séjour à l’étranger. Il s’agissait de situer ces trajectoires dans un contexte socio-historique mondial. Bien que leurs liens aux institutions françaises à l’étranger soient variables selon leur situation personnelle, professionnelle et selon le contexte d’accueil, les enseignants français représentent ce « vecteur irremplaçable du rayonnement de la langue et de la culture françaises20 ». Qu’ils s’en revendiquent ou non, selon des formes hybrides et à des degrés variables, ils appartiennent à une certaine idée de la francophonie (Wolton, Mandigon, Yannic, 2008) dans la mesure où ils se déplacent avec leur langue maternelle, et une mentalité partiellement héritée de leur socialisation primaire au sein de l’école républicaine. L’exportation de l’école française montre à la fois la spécificité des valeurs républicaines et le caractère impérialiste de son histoire. Les enseignants français à l’étranger sont donc intéressants par leurs trajectoires individuelles et les représentations symboliques qu’ils véhiculent à des degrés divers et dans des formes variées. Par leur fonction d’enseignants, ils occupent une place spécifique dans le corps éducatif mondial. Dans la mesure où l’acte d’éduquer peut être considéré comme une action politique, la sociologie de l’école est une sociologie politique (Dubet, 2008 : 26). Ainsi, la sociologie des acteurs de l’école française à l’étranger ne peut être déconnectée des enjeux de la sociologie politique mondiale auxquels ils participent activement.
A Casablanca et à Londres, les institutions scolaires françaises sont considérées dans leur rôle de « pivot », c’est-à-dire, jouent le rôle d’un centre d’intérêt fixe dans l’espace « qui produit certaines formes de relations qui se groupent autour de lui » (Simmel, 1999 : 616). Autour des établissements scolaires français à l’étranger gravite localement toute une population locale, nationale et internationale, que ce soit par le personnel enseignant, administratif ou technique, les élèves, les parents d’élèves et les différents intervenants. L’enjeu sociologique est de cerner quelle position cette population occupe dans l’espace local urbain et quelles sont les représentations symboliques de ce centre d’attraction par rapport à d’autres pôles de même type. Lors de mon précédent séjour au Maroc, en 2010, une association de parents d’élèves marocains a organisé un colloque à Rabat sur « l’avenir de l’enseignement français au Maroc », qui suggérait l’importance des décisions politiques concernant l’enseignement français à l’étranger en recueillant différents avis sur ses impacts au niveau local. Les acteurs soulignaient notamment les effets de l’augmentation des frais de scolarité pour l’accessibilité des élèves, les Marocains en particulier. À Londres, les enjeux étaient bien différents et concernaient davantage la population française établie dans la capitale britannique. Une conférence organisée en décembre 2013 par la représentante des Français d’Europe du Nord à l’assemblée nationale, révélait les enjeux des institutions scolaires françaises en termes de places pour les élèves. La communauté française ayant fortement augmenté à Londres ces dernières années, les places disponibles sont largement sollicitées, et, par conséquent, les établissements ne peuvent pas accueillir toutes les demandes. Plusieurs questions se posent alors sur chacun de ces terrains. Quels sont les profils socio-économiques et nationaux des élèves et des parents d’élèves ? Quels est la position des établissements français sur le marché scolaire ? Quel est la position sociale des enseignants ? Quelles sont les représentations des écoles françaises dans l’espace local ? Ainsi, les trajectoires des enseignants ne constituent que la partie émergée de l’iceberg dans la mesure où leur analyse permet de comprendre à la fois les données objectives et subjectives du problème des Français hors de France, c’est-à-dire, autant les problèmes structurels que les structures des représentations, car « c’est précisément le caractère duel de la société en termes de facticité objective et de signification subjective qui détermine sa « réalité sui generis » (Berger et Luckmann, 2011 : 66-67). Ainsi, l’articulation des trajectoires individuelles des enseignants et de la position des établissements scolaire français hors de France relie la sociologie des migrations et la sociologie de l’éducation. L’ethnographie des enseignants français se rapproche ainsi d’une ethnographie de l’école dans la mesure où elle s’accorde à étudier, par l’observation – ici à l’échelle de la ville – le contexte dans lequel évoluent les institutions scolaires elles-mêmes et leurs acteurs : « L’ethnographie de l’école se doit d’être holiste. Elle se doit de montrer comment l’éducation est liée à l’économie, au système politique, à la structure social locale et au système de croyances des personnes dont s’occupe l’école21. » (Ogbu, 1981 : 6). Ainsi, les entretiens ne se sont pas restreints aux discours des acteurs directement impliqués, mais aussi à celui des acteurs qui environnaient la position des enseignants : administration, élèves, parents d’élèves, et dans la mesure du possible (mais trop rarement) le personnel technique et les informateurs extérieurs aux établissements. Ce faisant, j’ai essayé de contextualiser les discours et les situations rencontrées pour comprendre les liens de l’école avec les autres acteurs locaux, qu’ils soient institutionnels, collectifs ou individuels. De cette manière, l’analyse s’étend à l’ensemble de la société locale afin de percevoir non seulement la place qu’occupent les écoles françaises dans les représentations et dans la pratique, mais aussi « comment les forces sociétales, y compris les croyances et les idéologies de la société plus large, influencent les comportements des participants dans les écoles. » (Ogbu, 1981: 13). En cela, ma participation en tant que professeur particulier auprès de quelques élèves des lycées français ou en tant que bénévole dans des associations ainsi que ma participation quotidienne dans la vie urbaine locale ont fait office d’une manne dans la collecte de données. De même, la rencontre avec des enseignants exerçant en dehors des établissements français à l’étranger a étendu l’éventail des situations et des représentations afin d’élargir le potentiel de généralisation ; d’où l’importance de se situer soi-même aux frontières de différents mondes sociaux dans l’espace étudié pour percevoir des enjeux globaux dans la mesure où l’élargissement des perspectives permet au chercheur de saisir « les liens entre le processus de scolarisation et les systèmes culturels plus vastes » (Ogbu, 1981: 14).
Mais il ne faut pas s’arrêter là si l’on prétend saisir des enjeux mondiaux à partir de l’étude d’une population ancrée localement. Certes, le choix des capitales économiques des pays sélectionnés étaient opportun dans la mesure où il permettait un recueil de données plus large. Mais le choix de ces pôles est également heuristique car il permet de saisir une population locale ancrée dans l’espace mondial. Ce présupposé repose sur la conviction que la sociologie mondiale n’est pas seulement produite par des acteurs invisibles et des structures transcendantes (Hardt, Negri, 2001), mais par des acteurs réels, ancrés localement dans des routines liées à la résolution de problèmes quotidiens, dont l’éducation et la scolarisation des enfants sont des préoccupations majeures. Ainsi, les grandes villes sont le lieu de « centralisation de la mondialisation [étant donné qu’] il n’y a pas d’individus ou d’entreprise entièrement dématérialisés. » (Sassen, 2009 : 114-115). Il s’agit donc de situer l’école au coeur de pratiques ancrées localement et de représentations comme autant de paysages qui symbolisent l’espace social mondial (Appadurai, 1996 : 71). Il ne s’agit pas pour autant de contester le « nationalisme méthodologique » puisque cette étude en est conditionnée, dans la mesure où elle focalise une population nationale, française, vivant hors de France. La finalité est justement de saisir toute la complexité de la perspective nationale par une confrontation à partir de l’analyse de la réalité empirique des individus représentant la nation hors de ses frontières. La sélection franco-centrée, axée autour des institutions françaises à l’étranger et située socio-historiquement dans deux ancrages locaux spécifiques fait émerger le caractère relatif de la nation française (Anderson, 1983 ; Hobsbawm, 1990).
Cette étude traite donc, d’un point de vue « nationaliste », la complexité des pratiques et des représentations ancrées localement d’un point de vue mondial par l’étude de deux sites (Marcus, 1995). Il peut s’agir d’une ethnographie comparative entre migration et éducation qui a sélectionné deux sites stratégiques. Si la mise en parallèle de Casablanca et Londres peut paraître induite par une intuition française, elle ne peut pas pour autant se réduire à cette perspective. C’est une question d’échelle d’analyse. Ainsi, la similitude entre les deux villes tient à leur position particulière d’interface entre le territoire national et l’espace mondial, d’où l’orientation de leurs activités vers l’extérieur (King, 1990: 39). C’est une comparaison entre deux villes mondiales, non selon les termes quantitatifs de la géographie économique (Sassen, 2001), mais selon les termes qualitatifs entre une ville à l’histoire coloniale située à la périphérie de l’économie mondiale et une autre située coeur de celle-ci (King, 1990: 37).
L’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE)
Les établissements scolaires peuvent être hiérarchisés selon leur proximité avec la mission diplomatique. Les établissements de l’AEFE22 sont en lien direct avec les ambassades de France et les ministères français concernant l’enseignement en maternelle, primaire et secondaire. Différents statuts leur confèrent plus ou moins d’autonomie financière et de gestion. À l’opposé, les établissements de droit local, public ou privé, peuvent accueillir des enseignants français. Les établissements d’enseignement supérieur et les universités y sont mentionnés à titre indicatif. De même, les organismes de soutien scolaire et le Centre National d’Enseignement à Distance (CNED) occupent une position particulière mais non négligeable, surtout à Londres.
Créée en 1990, l’AEFE est l’opérateur de l’État pour l’enseignement français à l’étranger. Placée sous la tutelle du Ministère des Affaires Étrangères23 (MAE), l’AEFE assure le suivi et l’animation du réseau des établissements d’enseignement français à l’étranger qui ont reçu une homologation de la part du ministère de l’Éducation nationale (MEN), quel que soit le statut des établissements (établissements gérés directement par l’AEFE, établissements conventionnés, établissements partenaires). Sa création tend à mettre en réseau des établissements dispersés et de renforcer les liens avec la métropole. Par exemple, le conseiller culturel de l’ambassade de France à Rabat est chargé de la politique de rayonnement culturel de la France au Maroc. Sa mission est d’appliquer les règles administratives du Ministère de l’Éducation Nationale à l’étranger (échelons, notations, etc.), d’où le détachement d’un inspecteur d’académie auprès du Ministère des Affaires Étrangères pour l’articulation entre les deux ministères. Pour ses établissements, l’AEFE joue un rôle équivalent à un rectorat d’académie en France. Il y a vingt-trois inspecteurs de l’Éducation nationale répartis dans le monde pour gérer un secteur. Ce sont également des zones d’examens à l’intérieur desquelles les enseignants sont amenés à se déplacer pour les évaluations du baccalauréat. Le découpage administratif est effectué en fonction du nombre d’élèves. Par exemple, le Maroc représente un secteur à lui seul, tandis que la zone Moyen-Orient/Péninsule indienne s’étend de la péninsule arabique jusqu’à Pondichéry, en Inde.
L’agence a notamment pour objet, en tenant compte des capacités d’accueil des établissements :
– d’assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l’éducation .
– de contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers .
22 Les sigles et termes spécifiques ne seront pas systématiquement redéfinis. En cas de doute, se reporter au glossaire (Annexe 2).
23 Le ministère prenant différentes appellations selon les gouvernements, je préfère conserver cette dénomination large.
– de contribuer, notamment par l’accueil d’élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises .
– d’accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d’enseignement français à l’étranger.
Le financement de l’AEFE est assuré par le budget de l’État. Elle gère l’ensemble des ressources humaines et financières apportées par l’État au fonctionnement des établissements d’enseignement français à l’étranger. Elle met en place une politique de bourses scolaires pour les familles françaises afin de les aider à financer la scolarité dans les établissements français à l’étranger et elle alloue des bourses aux élèves étrangers les plus brillants de son réseau qui viennent étudier en France (Cordery, Lepage, 2014).
Dans les établissements qu’elle gère directement et dans les établissements conventionnés, elle recrute, rémunère et inspecte les personnels titulaires de l’Éducation nationale. L’AEFE accorde des subventions aux établissements scolaires et met en œuvre des plans de formation continue à destination de l’ensemble des personnels du réseau. Sa gouvernance est assurée par un conseil d’administration. Les subventions allouées à l’Agence en 2014 sur les programmes de l’action extérieure de l’État s’élèvent à 535,3 millions d’euros, ce qui représente environ la moitié des frais de fonctionnement, le reste étant financé par les frais de scolarité versés par les parents d’élèves. L’enseignement français à l’étranger est le premier réseau d’enseignement dans le monde par son ampleur. Depuis la rentrée de septembre 2014, le réseau scolarise environ 330 000 élèves, dont 206 000 étrangers et 124 000 Français. A titre de comparaison en 2013, les réseaux allemand, espagnol et italien ont scolarisé respectivement 79 500, 40 100 et 30 000 élèves. Le réseau de l’enseignement français à l’étranger est présent dans 135 pays et compte 494 établissements scolaires homologués, c’est-à-dire faisant l’objet d’un arrêté interministériel qui atteste de la conformité aux programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles d’organisation applicables en France aux établissements de l’enseignement public. Parmi ces établissements, certains sont en gestion direct (EGD), tandis que la plupart sont conventionnés ou partenaires. En 2012/2013, Casablanca recensait sept établissements EGD, dont cinq écoles primaires et deux établissements secondaires soit 7000 élèves, dont 4200 français et binationaux ; neuf établissements partenaires, soit 7700 élèves, dont 209 Français et binationaux, parmi lesquels quatre sites de l’OSUI-MLF : trois écoles primaires et un collège-lycée, soit 2900 élèves dont 61 français et binationaux. Au total, ce sont 14 700 élèves, dont 4400 Français et binationaux. A Londres, le réseau des établissements AEFE compte environ 5600 élèves, dont plus de 4000 au lycée Charles de Gaulle, qui accueille des élèves de la maternelle à la Terminale, dont 88 % de Français ou Franco- Britannique, 6% de Britanniques et 6% d’internationaux. Il n’y a pas d’établissement partenaire, mais les établissements conventionnés se multiplient devant l’accroissement des demandes.
Administrés et gérés directement par l’AEFE, les Établissements en Gestion Directe sont constitués et organisés en services déconcentrés de l’Agence. Le lycée Lyautey à Casablanca et le lycée Charles de Gaulle à Londres font partie des 74 Établissements en Gestion Directe dans le monde. Le lycée Lyautey compte environ 3 500 élèves, dont environ 35% de Français/binationaux ; 60% de Marocains ; 4% d’élèves internationaux. C’est l’un des lycées français les plus importants en nombre d’élèves dans le monde, avec le lycée de Londres et celui de Madrid. Au Liban, le réseau accueille un nombre élèves plus important que celui du Maroc, mais ce sont essentiellement des établissements homologués, donc les relations diplomatiques sont moins fortes qu’avec le Maroc. Ils regroupent un collège et un lycée sur le même site, ainsi qu’une école maternelle et primaire à Londres. A Casablanca, cinq écoles primaires et maternelles sont en gestion direct, tandis que Londres en compte trois. Les deux collèges forment les élèves au Diplôme National du Brevet (DNB). Les deux lycées préparent les filières du baccalauréat général (Scientifique – S, Littéraire – L, Sciences Économiques et Sociales – SES). A Casablanca, s’ajoutent une filière technologique (Sciences et Technologies de Gestion – STG) et deux filières professionnelles (Baccalauréat Professionnel Métiers du Secrétariat et Métiers de la Comptabilité). Les deux établissements proposent des filières avec option Internationale : le Diplôme National du Brevet avec option Internationale (DNB – I) et le Baccalauréat Option International (OIB). Le lycée de Londres contient également une section Européenne avec renforcement d’un cours de langue et civilisation à partir de la Quatrième (espagnol, allemand, italien ou russe) et une section Britannique (210 élèves à partir de la Troisième) qui prépare aux examens du GCSE et A-Level, diplômes britanniques pour lequel le lycée français est agrémenté par l’Ofsted, le service d’accréditation britannique pour les établissements éducatifs.
Une des spécificités des établissements français hors de France repose sur l’enseignement des langues et sur les sections internationales. Dans les établissements français du Maroc, l’enseignement de la langue et de la culture arabe, l’histoire, la géographie et les institutions du Maroc sont obligatoires de la classe de Grande Section de Maternelle à la Terminale pour les élèves Marocains et double nationaux ayant la nationalité marocaine, à raison de 3 à 5 ou 8 heures par semaine, selon le niveau et l’option choisie. Pour les élèves français ou ayant une autre nationalité, l’apprentissage de la langue et la culture arabe est obligatoire de la maternelle à la Cinquième. Il est optionnel à partir de la Seconde, il est sanctionné, pour les élèves qui le souhaitent, par l’option internationale du brevet et du baccalauréat. Les sections internationales des lycées de l’AEFE s’inscrivent dans le cadre officiel des instructions et programmes de l’enseignement public français. Les élèves reçoivent les mêmes enseignements que leurs camarades et passent les mêmes épreuves, affectées des mêmes coefficients, aussi bien au baccalauréat qu’au brevet. En revanche, les enseignements de première langue vivante et d’histoire-géographie portent sur un programme approfondi et les connaissances acquises sont évaluées, au cours du brevet et du baccalauréat, par des épreuves ayant des coefficients spécifiques24. A Casablanca comme à Londres, l’Option Internationale du Baccalauréat permet la poursuite des études dans l’enseignement supérieur français avec une éducation réellement bilingue. Cette option apparaît comme étant réservée à une minorité d’élèves ayant les dispositions et la motivation pour s’inscrire dans une véritable double culture25.
Les établissements partenaires:
Les 264 établissements homologués par l’Éducation nationale, dits « partenaires » du réseau de l’AEFE, sont, soit signataires d’un accord de partenariat spécifique avec l’AEFE, soit inclus dans un accord de partenariat collectif. C’est le cas notamment des établissements de l’Office Scolaire et Universitaire Internationale (OSUI), composante de la Mission Laïque Française au Maroc. Gérés par des associations ou des fondations, ils disposent de la pleine autonomie de gestion et recrutent directement leurs personnels d’encadrement et d’enseignement. Ils peuvent disposer de personnels titulaires du ministère de l’Éducation nationale, si ces personnels obtiennent un statut de détachement administratif. À Casablanca, tous les établissements homologués qui ne sont pas en gestion directe, sont des établissements partenaires.
L’Alliance Israélite Universelle, créée en 1860, est une structure confessionnelle, qui intervient dans le domaine de l’enseignement et de la promotion de la culture juive. Son objectif demeure la diffusion d’un judaïsme tolérant et ouvert sur le monde moderne. L’Alliance concourt également à promouvoir la langue et la culture françaises à l’étranger. Son action s’appuie sur son réseau d’écoles en France et à l’étranger. L’AIU est implantée principalement en Israël, au Canada, au Maroc, en Suisse, en Espagne et en Belgique. Elle recense 19 300 élèves dans 54 établissements, dont quatre sont homologués par l’Éducation nationale au Maroc et sont ainsi des établissements partenaires de l’AEFE. En 2012, le collège-lycée Maïmonide à Casablanca a scolarisé environ 243 élèves dont treize Français.
Répartition quantitative des enseignants français et population cible
Face au manque de recensement administratif, cette étude se contente de présenter quelques estimations issues des données de terrain, ainsi que la répartition des personnes rencontrées. La part des enseignants hors de France reste marginale par rapport à l’ensemble des enseignants en France. Parmi les enseignants de l’éducation nationale – environ 870 000 titulaires dans le primaire et secondaire – près de 6 500 ont un contrat avec un établissement de l’AEFE (environ 0,75%), ce qui est inférieur au rapport total de la population française en France et hors de France (environ 2 à 4 % selon les estimations). Certes tous les volontaires au départ n’obtiennent pas un poste, le nombre de places étant limité. De même, parmi les enseignants en métropole, certains ont pu avoir eu une expérience à l’étranger, mais étant donné la rotation des effectifs, il serait bien difficile de les recenser. Les enseignants non titulaires de l’Éducation nationale augmentent considérablement la population cible hors de France mais sont particulièrement difficiles à compter.
Dans l’ensemble, on peut estimer qu’il y a environ 600 enseignants français à Casablanca et peut-être 4000 à Londres, tous statuts et tous établissements confondus. Parmi les cinquante-deux personnes retenues, vingt-trois exerçaient dans un Établissement en Gestion Directe de l’AEFE (respectivement dix-huit à Casablanca et cinq à Londres). En effet, sans être représentatif, l’objectif a été de rendre compte de la variété des situations possibles sur chaque site. Or, les établissements en gestion directe de l’AEFE recrutent plus de la moitié des enseignants à Casablanca et à peine 10% à Londres (environ 320 personnes). Les établissements partenaires et conventionnés sont signifiés par treize personnes (respectivement neuf personnes à Casablanca et quatre à Londres). La répartition des enseignants au sein des autres organismes d’enseignement est assez éparse, mais tente d’avoir un aperçu de chaque situation dans toute sa complexité, en prenant en compte les cas de pluriactivité, en particulier à Londres (voir les situations professionnelles dans l’Annexe 8).
Une hiérarchisation des statuts professionnels
Quatre cas de figure ont été rencontrés concernant le statut professionnel. Au sein de l’AEFE, les statuts des personnels exerçant au sein du réseau de l’enseignement français hors de France sont définis par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 200227, relatif à leur situation administrative et financière. Selon l’article 2 de ce décret, les fonctionnaires sont « détachés » ou « expatriés » auprès de l’AEFE « pour servir à l’étranger dans le cadre d’un contrat qui précise la qualité de résident ou d’expatrié, la nature de l’emploi, les fonctions exercées, la durée pour laquelle il est conclu et les conditions de son renouvellement. Les types de contrat sont arrêtés par le directeur de l’agence après consultation du comité technique ». Un autre cas de figure au sein de l’AEFE est celui des enseignants en contrat local. Non titulaires de l’Éducation nationale mais ayant un diplôme requis et leur résidence principale sur place, ils peuvent être recrutés avec un contrat local (c’est le cas de Karine, par exemple). Les contrats locaux concernent également les recrutés locaux qui ne sont pas Français. Ils ne font pas partie de la population cible. En dehors du réseau AEFE, des personnels titulaires de l’Éducation nationale peuvent exercer dans des établissements non homologués ou étrangers par l’intermédiaire d’une mise en disponibilité. Enfin, le quatrième cas de figue concerne les enseignants non titulaires de l’Éducation nationale qui n’exercent pas dans le réseau AEFE. Certains ont été rencontrés à Casablanca (Boris, Marie, Étienne) et ce sont sans doute les plus nombreux à Londres, mais aussi les plus difficiles à rencontrer du fait de leur immersion. C’est pourquoi, la plupart des personnes rencontrées à Londres sont dans ce cas. Afin d’articuler ces cas de figure, les contrats sont présentés selon une tendance du plus proche au plus distant des institutions français et selon une hiérarchisation en termes de confort économique. Ainsi, le contrat d’expatriation précède les différents statuts de détachement, puis viennent les contrats locaux. Cette hiérarchisation a l’avantage de mettre en évidence la réalité sociologique des enseignants français hors de France. En effet, elle souligne que la première catégorie, celle des expatriés, regroupant également les détachés (ou résidents), souvent mise en avant dans les discours public et le langage ordinaire, est en fait la catégorie la moins représentée quantitativement.
Des expatriés au sommet d’une stratification professionnelle
Les personnels expatriés (environ 1150 dans le réseau) sont recrutés pour un contrat d’une durée de trois ans, renouvelable expressément deux fois pour une durée d’un an. Ils sont nommés sur des postes destinés aux missions d’encadrement, de formation, de coordination et d’inspection. Une lettre de mission est jointe à leur contrat. Outre leur rémunération indiciaire, les personnels concernés perçoivent une prime d’expatriation. Ils sont recrutés par l’AEFE à Paris, après avis de la commission consultative paritaire centrale compétente. Au Maroc, le nombre de postes expatriés a été réduit de douze postes entre 2010 et 2013, passant de 39 à 27. Pour des réseaux importants comme le Maroc ou l’Espagne, l’AEFE permet aux expatriés de prendre un poste de résident à la fin de leur contrat, au cas où leur conjoint(e) ait un emploi sur place. A Londres, comme partout en Europe, les postes d’expatriés ont été progressivement supprimés dans l’enseignement. Il reste quatre postes de direction d’établissement sous ce type de contrat. Tandis qu’en France, les directeurs des écoles primaires ont une décharge de quelques heures de cours pour assurer leur fonction, les postes de direction des écoles primaires hors de France ont une décharge complète, ce qui veut dire qu’ils n’interviennent pas en classe. La décharge complète de classe pour un poste de direction est obligatoire à partir de douze classes. Ils sont considérés comme des supérieurs hiérarchiques par les autres enseignants, non comme des collègues car ils sont susceptibles de mettre la note annuelle ou de signer le rapport d’inspection.
Ce statut peut être considéré comme le sommet d’une stratification sociale dans le corps enseignant hors de France. En effet, il est l’objet d’importantes dissensions avec certains syndicats au sein des établissements de l’AEFE en raison de la prime d’expatriation qui peut atteindre trois fois le salaire français et le double d’un salaire de résident. Pour certains syndicats, la charge de travail supplémentaire qui incombe à ce type de contractants ne justifie pas les écarts de salaire avec les titulaires de postes de résident et de contrat local, en particulier les recrutés locaux marocains. Il est également à l’origine de l’image de l’enseignant expatrié séjournant dans des conditions luxueuses, en particulier dans des pays où les revenus locaux moyens sont faibles comme c’est le cas au Maroc. Enfin, des abus sont suspectés concernant des renouvellements de postes facilités par l’acquisition d’un poste du même type dans un autre établissement de l’AEFE. Du point de vue des contrats locaux, Français ou Marocains, l’écart de salaire peut être perçu avec amertume dans la mesure où ce type de contrat (environ 10 000 dirhams par mois) peut être cinq ou six fois inférieur à un salaire d’expatrié. Ces écarts de salaire et de statut au sein des établissements scolaires ne sont pas négligeables car ils peuvent être à l’origine de malaise, de conflit, voire de comportements cyniques.
Les différents statuts des titulaires de l’Éducation nationale
Le contrat de résident diffère en fonction du statut de l’établissement d’accueil. Les personnels résidents (environ 5 350) sont recrutés par l’AEFE. Au Maroc, leur nombre est passé de 704 à 716 entre 2010 et 2013, les postes d’expatriés supprimés ayant été convertis en poste de résidents. Les « résidents » sont recrutés par l’Agence après avis de la commission consultative paritaire locale compétente, quand elle existe, et sur proposition du chef d’établissement. Il s’agit d’un comité piloté par le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC), présidé par le conseiller culturel de l’ambassade. Elle a lieu après réception de dossiers de candidatures qui sont envoyées directement au service de l’ambassade venant de France ou ailleurs au sein du réseau de l’AEFE. Il s’agit d’une commission paritaire semblable aux mouvements inter-académiques au niveau national. La sélection est présentée aux syndicats qui donnent leur avis sur certains choix. Les résidents sont donc des titulaires de l’Éducation nationale qui signent, après recrutement, un contrat de travail avec l’établissement, ce qui pose parfois problème puisque les enseignants doivent ainsi se mettre en disponibilité pendant trois mois avant d’être éligibles pour le contrat qu’ils vont signer. Celui-ci dure trois ans et se renouvelle par tacite reconduction. Le proviseur renouvelle ou non le contrat au bout de trois ans à la demande de l’enseignant. Il n’y a pas de limite dans le temps, ce qui est parfois remis en question dans la mesure où l’éloignement peut créer certaines déconnexions de l’Éducation nationale. Pour d’autres, l’objectif est d’avoir des équipes stables au sein des établissements hors de France où les rotations de personnel sont déjà importantes. Les enseignants résidents à l’AEFE ont une Indemnité Spécifique de Vie Locale (ISVL) calculée selon le quotient familial avec un pourcentage de base et des avantages familiaux. Les syndicats soulignent régulièrement la faiblesse de cette prime, surtout pour des personnes qui restent peu de temps, et le manque d’alignement sur l’augmentation des tarifs locaux, notamment des loyers (même à Casablanca). Les négociations sont d’autant plus âpres que l’AEFE est soumise à des restrictions budgétaires depuis plusieurs années. L’établissement rembourse une partie de la masse salariale à l’AEFE qui paye les enseignants. Ceux-ci reçoivent leur salaire à 60% en euros et 40% dans la monnaie locale. Le taux de remboursement est différent selon le statut des établissements, en Gestion Directe ou conventionné.
La prime ISVL et les avantages familiaux n’existent pas dans les établissements homologués puisque le salaire est négocié entre l’employeur et le salarié au moment de la signature du contrat. Il est généralement indexé selon la qualification et la certification sur les revenus que l’enseignant aurait eu pour le même poste à l’AEFE. Les détachements dans les écoles homologués et à l’OSUI sont des détachements administratifs, c’est-à-dire que la carrière de l’enseignant continu, ainsi que les cotisations pour la retraite. Le statut de détaché implique dans tous les cas que l’Éducation Nationale s’engage à réintégrer son personnel en cas de retour en France.
Les Titulaires Non Résidents (TNR) sont mis en disponibilité. Leur carrière est mise entre parenthèses. C’est le cas de certains contrats locaux, le plus souvent pour suivre leur conjoint(e), de certains directeurs d’établissement dans le secteur privé non homologué à Casablanca ou d’enseignants dans un organisme de soutien scolaire désireux d’avoir une expérience à Londres, notamment pour améliorer ses compétences en anglais. Les autres contrats locaux sont recrutés sur place par l’établissement : ils ne sont pas titulaires de l’Education Nationale, mais ils sont diplômés d’une licence, d’une maîtrise ou d’un Master.
|
Table des matières
Introduction
Prémisses de l’objet de recherche
L’émigration française : socio-histoire d’un impensé
Mémoire coloniale, histoire et sociologie
Enseignement à l’étranger, éducation et réflexivité
Première partie : Méthodologie et stratification professionnelle
Chapitre 1 – D’une angoisse de l’identité nationale à une méthode de connaissance sociologique
1.1) Premières intuitions : un rejet de l’identité nationale
1.1.1) Les débats sur l’identité nationale vus du Maroc
1.1.2) Comment peut-on être Français ?
1.2) Pratiques de terrain
1.2.1) Les difficultés de recensement des Français hors de France
Tableau 1 : Tableau comparatif des Européens à l’étranger
1.2.2) Des pratiques quotidiennes appliquées à l’enquête
1.3) L’accès au terrain et à la population, une expérience méthodique
1.3.1) Percevoir le terrain, une expérience sociale réajustée
1.3.2) La spontanéité attentive, penser à partir du sens commun
1.3.3) Comparer l’expérience londonienne à partir de Casablanca
1.3.4) Un protocole de recherche au service de l’imagination sociologique
1.4) L’objectivation des analyses et la généralisation par comparaison
1.4.1) La démarcation entre chercheur et enquêtés : des degrés d’affinités
1.4.2) Les difficultés de l’objectivation
1.4.3) Construction des profils
1.5) Un recueil de données in situ pour comparer les significations
1.5.1) Casablanca et Londres, un choix nécessaire pour une approche globale
1.5.2) Impérialisme et colonisation, les déterminations socio-historiques de l’objet
1.5.3) Une exploration globale
1.5.4) L’enseignement francophone dans l’espace mondial
Chapitre 2 – La diversité professionnelle des enseignants hors de France
2.1) Les organismes d’enseignement
2.1.1) L’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE)
Les Établissements en Gestion Directe (EGD)
Les établissements partenaires
La Mission Laïque Française (MLF)
Les établissements conventionnés
2.1.2) L’enseignement scolaire hors AEFE
L’enseignement privé non homologué
L’enseignement public local
Les organismes de soutien scolaire et le CNED
L’enseignement supérieur
2.1.3) Les centres d’apprentissage de la langue française
Instituts français et centres culturels français
Alliance française
Le programme FLAM
Enseignement privé des langues
2.1.4) Répartition quantitative des enseignants français et population cible
2.2) Une hiérarchisation des statuts professionnels
2.2.1) Des expatriés au sommet d’une stratification professionnelle
2.2.2) Les différents statuts des titulaires de l’Éducation nationale
Tableau 2 : Récapitulatif des conditions de départ et de séjour du détachement
2.2.3) Le contrat local, reflet de la diversité des situations professionnelles
Les recrutés locaux à l’AEFE
Les enseignants recrutés localement dans les organismes locaux
2.3) La hiérarchisation locale des établissements scolaires
2.3.1) Une sélection des élèves substituant l’excellence des enseignants
2.3.2) Un enseignement servant de distinction sociale
2.3.3) Un bilinguisme inégal
2.3.4) Des organismes d’enseignement dans une compétition libérale
Deuxième partie : Une dispersion échappant aux identités collectives
Chapitre 3 – Expatriation et migration : les deux faces d’une même pièce
3.1) Les embarras de l’expatriation
3.2) Les significations de l’expatriation
3.2.1) L’expatriation comme statut professionnel
3.2.2) La communauté expatriée
3.2.3) Conjoint/conjointe d’expatrié(e)
3.3) La patrie des pères et la patrie du coeur
3.3.1) La patrie au prisme de l’ethnicité
3.3.2) L’expatriation, un sentiment de dépaysement
3.3.3) La mobilité socio-spatiale, une expérience subjective de l’altérité
3.3.4) Les frontières subjectives de la patrie
Chapitre 4 – Des prédispositions au départ à la réalisation de soi
4.1) Conceptions de l’espace et du temps dans l’analyse des parcours
4.2) L’angoisse liée à la mémoire collective
4.2.1) Une histoire nationale construite par des flux migratoires
4.2.2) Un cadre national générant une angoisse identitaire
4.2.3) L’expérience de la pluralité et des variations de la nation
4.3) Réinventer ou conserver la nation, une affaire de famille
4.3.1) La reproduction d’une migration familiale
4.3.2) L’invention de soi à partir des expériences familiales
4.3.3) Le processus de déclenchement du départ
Chapitre 5 – L’entre-deux : une réponse à l’angoisse, une révolte contre l’identité
5.1) Le départ, une action délibérée pour résoudre une question existentielle
5.1.1) L’angoisse devant soi-même
5.1.2) La révolte contre une place assignée
5.2) Le déplacement, la libération d’une angoisse
5.2.1) L’identité, un embarras partagé
5.2.2) L’expatriation, un changement de place
5.2.3) Un changement ordinaire ou extraordinaire
5.3) Typologie des enseignants français hors de France
5.3.1) Les difficultés de la typologie
5.3.2) Exemples et limites de typologies rapportées à l’objet
5.3.3) Proposition de typologie
Les internationaux
Les expérimentateurs
Les affinitaires
Troisième partie : Le statut symbolique des enseignants français dans l’espace mondial
Chapitre 6 – L’intégration en contexte local : pratiques langagières et fonction sociale
6.1) L’intégration, d’une adaptation idéalisée aux réalités des langages
6.1.1) Apprendre la langue locale, entre nécessité et effort mesuré
6.1.2) Les nuances de l’adaptation socio-culturelle
6.1.3) Le bilinguisme, une ouverture relative à l’apprentissage
6.2) La fonction symbolique des enseignants français
6.2.1) Au Maroc, des agents intermédiaires du pouvoir local
6.2.2) En Grande-Bretagne, des représentants de la culture de l’ennemi
Chapitre 7 – Des pratiques entre expansion et repli
7.1) Des pratiques à plusieurs échelles : une tendance à l’expansion
7.1.1) La réorganisation des routines à l’échelle locale
7.1.2) Une expansion relative
7.2) Pratiques de repli et esprit d’ouverture
7.2.1) Les relations locales, une domination relative au contexte et à la profession
7.2.2) Les conditions du processus de repli communautaire
Chapitre 8 – Les enseignants hors de France : idéal républicain et diversité culturelle
8.1) L’enseignant, une forme universelle
8.2) Nécessités et limites de l’ouverture
8.2.1) La relation éducative, une ouverture nécessaire
8.2.2) Une ouverture limitée par le contexte local
8.2.3) Les caractéristiques universelles de la relation éducative
8.3) Des enseignants porteurs de valeurs
8.3.1) L’éducation francophone : liberté de conscience et esprit critique
8.3.2) L’éducation républicaine à l’épreuve de la critique
8.3.3) Ni Républicains ni Français : éducation et société ouverte
Conclusion
Bibliographie
Télécharger le rapport complet