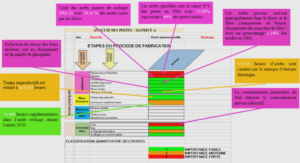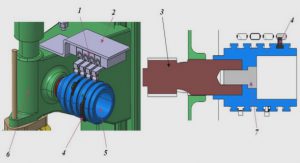Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Facteurs de risques cardio-vasculaires
Un facteur de risque cardio-vasculaire peut être défini comme un état clinique ou biologique qui augmente le risque de survenue d’un évènement cardio-vasculaire donné. Ils sont classés en facteurs de risque modifiables et non modifiables.
Un marqueur de risque n’a pas de responsabilité causal démontré dans la survenu des complications. Cependant, sont taux augmente à mesure qu’évolue la maladie. C’est donc un témoin du risque
Les facteurs de risques non modifiables
l’âge
Du fait du vieillissement artériel, on assiste à des anomalies de vasorégulation endothéliale, un remodelage de la matrice extracellulaire et des calcifications de la paroi [35]. Il est considéré comme facteur de risque cardio-vasculaire à partir de 50 ans chez l’homme et 60 ans chez la femme selon les recommandations de la HAS [69].
Le genre
Avant 70 ans, deux tiers des infarctus surviennent chez les hommes. Cette différence diminue chez la femme après la ménopause et disparaît après 75 ans. L’influence des œstrogènes naturels explique la plus faible incidence des complications de l’athérome chez la femme que chez l’homme [35, 6].
les antécédents familiaux
Seuls les accidents cardio-vasculaires précoces sont à prendre en compte, c’est-à-dire avant 55ans chez un homme et avant 65ans chez une femme.
Ne seront considérés comme significatifs que les accidents survenus chez le père, la mère ou un parent du 1er degré [6].
Les facteurs de risques modifiables
L’hypertension artérielle (HTA)
Selon l’étude de Framingham, son risque relatif est de 8 pour les AVC, 3 pour la maladie coronaire, 3 pour l’Artériopathie oblitérante des membres inférieurs et plus de 5 pour l’insuffisance cardiaque congestive [35].
Les dyslipidémies
Une dyslipidémie est une anomalie du bilan lipidique (taux sanguin des lipides). Cette anomalie porte le plus souvent sur le cholestérol (HDL-cholestérol, dit « bon » cholestérol ou LDL-cholestérol dit « mauvais » cholestérol), et/ou sur les triglycérides.
L’hypercholestérolémie est un facteur de risque majeur des maladies cardio-vasculaires. Elle est l’une des principales causes de l’athérosclérose. Elle a un risque relatif de 3 pour les maladies coronaires, plus important que pour l’artériopathie et les AVC [35].
Le tabagisme
Plus d’un décès cardio-vasculaire sur dix dans le monde peut être attribué au tabagisme, ce qui représente la plus importante cause de mortalité cardio-vasculaire évitable [56]
Il a été établi par l’étude INTERHEART [59] que le tabagisme est le deuxième facteur de risque de l’infarctus du myocarde derrière les dyslipidémies.
Il représente aussi le facteur de risque majeur des artériopathies oblitérantes des membres inférieurs (AOMI) avec un risque qui augmente graduellement en fonction de la consommation [3].
Le diabète
Tout patient diabétique (de type I ou II) doit être considéré comme à haut risque cardiovasculaire [6].
L’existence d’un diabète multiplie par deux à trois le risque d’insuffisance coronaire, d’ischémie myocardique silencieuse, d’accidents vasculaires cérébraux chez les hommes. Chez les femmes, l’existence d’un diabète multiplie ces risques par 3 à 5. De la même façon, il multiplie le risque d’artérite des membres inférieurs par 4 chez les hommes et par 6 chez les femmes ; avec une augmentation majeure du risque d’amputation, multiplié de 10 à 20. Il multiplie par trois le risque cardiovasculaire absolu [67].
Les autres facteurs de risques
L’obésité, la sédentarité, le stress, la maladie rénale chronique, le syndrome métabolique, les facteurs alimentaires (l’excès de consommation d’alcool, de sel, le régime hypercalorique, la consommation insuffisante de fruits et légumes)
Les marqueurs de risques
L’hyperhomocystéinémie, la C réactive protéine ultrasensible (CRP-us), les facteurs pro-thrombotiques (fibrinogène, inhibiteur de l’activateur du plasminogène, l’hyperlipoprotéinémie A ou Lp(a), l’indice de pression systolique.
Nosologie Cardio-vasculaire
Définition et Généralités
La nosologie est la définition et classification des maladies. L’idée de classer les maladies à l’instar des espèces animales et végétales apparut au XVIIIe siècle sous l’influence des travaux de Linné [147].
En attendant, les traités de médecine contemporaine renoncent aux vieilles classifications (de Vogel, Cullen, Sagar, Plouquet, Pinel, Raige-Delorme) ; ils n’exposent pas simplement les affections suivant un ordre alphabétique, traitent des maladies soit suivant leurs étiologies et mécanismes (infection, intoxication, allergie, sclérose), soit par organes et grandes fonctions (cardiopathies, bronchopneumopathies, endocrinopathies…) [147].
Principaux groupes nosologiques cardio-vasculaires
Hypertension artérielle et ses complications cardio-vasculaires
Hypertension artérielle
L’hypertension artérielle est une élévation anormale des pressions artérielles systolique et/ou diastolique. Toute personne âgée de 18 ans ou plus ayant une pression artérielle systolique ≥ 140 mmHg et/ou une pression artérielle diastolique ≥ 90 mmHg est hypertendu.
La définition de l’hypertension artérielle est donc la même chez le sujet jeune et la personne âgée. Toutefois, chez la personne âgée de 80 ans ou plus, une pression artérielle systolique inférieure à 150 mmHg est acceptable [77].
En dehors des situations d’urgence, on ne peut parler d’hypertension artérielle que lorsque les chiffres tensionnels restent élevés à 2 consultations distinctes effectuées à 1 ou 2 semaines d’intervalle, chez un sujet couché ou assis, en relâchement musculaire depuis au moins 5 minutes, loin d’un repas, d’une prise d’alcool ou de cigarettes.
Sur le plan épidémiologique, plusieurs études observationnelles ont montré que la morbidité et la mortalité cardio-vasculaires ont une relation continue avec la pression artérielle systolique (PAS) aussi bien qu’avec la pression artérielle diastolique [94, 95].
Dans un article publié en 2005, Kearney et al. ont estimé que près d’un milliard d’individus dans le monde étaient hypertendus en 2000 et les projections pour 2025 font état de plus d’un milliard et demi d’hypertendus [21].
La prévalence de l’HTA chez l’adulte augmente avec l’âge, le sexe et la corpulence du sujet ; cependant, pour un même âge et une même corpulence, cette prévalence est différente selon les pays : par exemple, chez les sujets de 35-64 ans, elle est de 27,8% aux Etats-Unis, 55,3% en Allemagne, 37,7% en Italie, 46,8% en Espagne [70].
En Afrique, il s’agit également d’une des préoccupations majeures avec des fréquences hospitalières élevées, aussi on peut retrouver les taux suivants : 41%
à Libreville (Gabon) et à Ibanda (Nigéria), 21 ,5% à Abidjan (Côte d’Ivoire), 31% au Mali [17]. Ces données, diverses qu’elles soient, témoignent de l’importance grandissante de l’hypertension artérielle en Afrique du fait de sa prévalence élevée.
Au Sénégal, en 2010 une étude a été menée dans la ville de Saint Louis (Sénégal) avec une prévalence élevée d’HTA à 46% [2] ; En 2011, une étude a été réalisée à Darou Mousty (Sénégal) [118] qui retrouvait 22,15 % de sujets hypertendus et à GUEOUL en 2012 la prévalence était de 46,4% [75].
Dans 95 % des cas, l’hypertension artérielle n’a pas de cause curable et entre dans le cadre de l’HTA essentielle ou primaire. Elle est souvent associée à d’autres facteurs favorisants [109]. Dans 5 % des cas, l’hypertension artérielle est secondaire à une cause [109]. Si l’on ajoute à ce nombre important d’hypertendus, la grande prévalence d’une pression artérielle élevée dans la population [79,157], l’on comprend que l’hypertension artérielle ait été classée comme la première cause de décès à travers le monde [55].
Les hospitalisations pour l’hypertension artérielle peuvent être décrites en deux situations particulières :
-Augmentation brutale de la pression artérielle avec son corolaire de retentissement aigüe ;
-Le retentissement au long cours de l’hypertension artérielle sur le cœur définissant la cardiomyopathie hypertensive.
Les Urgences hypertensives
Définition
L’urgence hypertensive est définie par [61]:
– une élévation aiguë de la pression artérielle, généralement supérieure à 180 mm Hg pour la pression systolique et/ou supérieure à 110 mm Hg pour la pression diastolique, chez un sujet traité ou non par des antihypertenseurs. Toutefois, une élévation tensionnelle rapide en deçà de ces valeurs peut constituer une urgence hypertensive s’il existe une souffrance viscérale, en particulier chez la femme enceinte ;
– une complication concomitante grave, récente ou imminente, mettant en jeu le pronostic vital.
Ainsi une pression de 170/110 mm Hg réalise une urgence hypertensive chez l’enfant ou la femme enceinte non hypertendue jusque-là alors que des chiffres nettement plus élevés sont souvent observés dans l’hypertension chronique sans contexte d’urgence.
C’est donc la notion de souffrance viscérale qui prime et justifie l’urgence thérapeutique [61].
Atteintes cardio-vasculaires
Œdème aigu du poumon
L’œdème aigu du poumon traduit une extravasation de liquide d’origine plasmatique à travers la membrane alvéolo-capillaire, d’abord dans le tissu interstitiel puis dans le compartiment alvéolaire. Cette extravasation est la conséquence d’un dépassement paroxystique des mécanismes d’évacuation du liquide extravasculaire par la circulation lymphatique.
L’œdème pulmonaire de type hémodynamique est lié à une augmentation brutale de la pression hydrostatique capillaire moyenne dépassant 25 à 30 mm Hg.
Sur le plan épidémiologique l’œdème aigu du poumon cardiogénique est responsable d’environ 1 million d’hospitalisations ces 10 dernières années [135,128]. L’incidence et la prévalence vont augmenter en Occident d’ici 2025 avec le vieillissement de la population. Le pronostic reste sombre, la mortalité hospitalière varie de 10 % à 29 % [128].
Insuffisance coronaire
C’est une maladie des artères qui vascularisent le cœur ayant pour conséquence une ischémie myocardique. On distingue classiquement l’angor et l’infarctus du myocarde.
Dissection aortique
La dissection aortique est un clivage longitudinal de la paroi aortique au niveau du média par irruption de sang le plus souvent à partir d’une ou plusieurs brèches de l’intima. Deux grandes classifications sont retenues celles de DE BAKEY qui comporte trois types et de STANFORD qui comporte deux types A et B [148].
Sur le plan épidémiologie, son incidence annuelle est d’environ 3 cas pour 100 000 personnes et de 1,5 décès pour 100 000/an aux USA [66]. Classiquement, son incidence est faible (entre 0,5 et 5/100000/an en Europe), mais avec une fréquence croissante en Afrique [87,32].
Le pronostic est redoutable en Afrique avec une mortalité atteignant 70 % la première semaine [87].
Cardiomyopathies hypertrophiques
Les myocardiopathies hypertrophiques sont caractérisées par une hypertrophie de cause inconnue du myocarde touchant préférentiellement le ventricule gauche et en particulier le septum inter ventriculaire. La forme sporadique atteint préférentiellement le ventricule gauche et en particulier le septum inter ventriculaire. Sa prévalence est de 1/500 Plus souvent les hommes que les femmes, vers l’âge de 30-40 ans [34]. La forme familiale atteint quant à elle plus fréquemment les femmes et survient plus précocement.
La mort subite reste le risque majeur de cette maladie que ce soit pour la forme obstructive ou la forme non obstructive. Son incidence est inférieure à 1% par ans. La cardiopathie hypertrophique est la cause principale des morts subites chez le sportif jeune aux Etats-Unis [34].
Cardiomyopathie restrictive
Moins fréquente que les deux précédentes, il s’agit d’une atteinte myocardique par diminution de la compliance sans dilatation ventriculaire. Elle a une présentation clinique voisine de celle de la péricardite chronique [91].
Le cours évolutif de la maladie est très difficile à prévoir [88]. On peut opposer les formes latentes ou stables cliniquement pendant de longues années aux formes à aggravation rapide aboutissant en quelques mois à une déchéance myocardique irréversible. Le taux de mortalité à un an varie de 10 à 30 %, la mortalité en 5ans de 25 à 80% [88].
Les causes de mortalité sont l’aggravation progressive de l’insuffisance cardiaque qui devient réfractaire aux thérapeutiques symptomatiques et la mortalité par mort subite qui représenterait 30 à 40 % des décès [88].
Plus rarement la mort est liée à la survenue d’une complication thrombo-embolique devenue plus rare depuis les indications larges des traitements anticoagulants.
Ces complications surtout thrombo-emboliques et pouvant toucher les territoires variés (cerveau, reins, membres). Les embolies pulmonaires sont également fréquentes et sont une cause d’aggravation brutale de l’insuffisance cardiaque.
Dysplasie arythmogène du ventricule droit
Elle est caractérisée par une atrophie des myofibrilles du ventricule droit remplacée par un tissus fibro-adipeux à l’origine d’arythmies ventriculaires graves [90].
Elle est responsable de mort brutale chez les personnes jeunes et les athlètes. C’est une forme de cardiomyopathie (littéralement, maladie du muscle cardiaque) d’origine non ischémique intéressant prioritairement le ventricule droit [52].
Il n’existe pas de signe pathognomonique. Le diagnostic est établi, depuis 1994, sur la combinaison de critères majeurs et mineurs. Le diagnostic requiert deux critères majeurs, ou un critère majeur et deux critères mineurs, ou quatre critères mineurs [105].
Les complications sont principalement les troubles du rythme cardiaque (tachycardie et fibrillation ventriculaire, fibrillation auriculaire, les risques thromboemboliques, la défaillance cardiaque). La complication la plus redoutable est la mort subite [52].
Formes secondaires des cardiomyopathies
Il s’agit de cardiomyopathie où une étiologie est nettement individualisée.
Schématiquement les principaux groupes étiologiques sont :
• Les myocardites : d’origines virales, bactériennes ou parasitaires ;
• Les cardiomyopathies d’origine endocrinienne : hyperthyroïdie, diabète, acromégalie, syndrome de Cushing ;
• Les maladies du système : le lupus érythémateux aigu disséminé, la polyarthrite rhumatoïde ;
• Les troubles métaboliques et nutritionnels : l’avitaminose, déficit en sélénium et en vitamine E, insuffisance rénale chronique ;
• Les cardiomyopathies de surcharge : hemochromatose, la sarcoïdose, la maladie de whipple, l’amylose, les glycogénoses.
Cardiomyopathie du péripartum (CMPP)
La CMPP se révèle par des symptômes et des signes cliniques d’insuffisance cardiaque au cours des dernières semaines de la grossesse ou dans les six mois qui suivent l’accouchement. Son diagnostic est un diagnostic d’élimination, quatre critères devant être réunis selon les recommandations de la National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI) et l’Office of Rare Diseases :
-Le développement de la maladie au cours du dernier mois de la grossesse ou des 5-6 mois suivant l’accouchement ;
– L’absence d’une cause d’insuffisance cardiaque identifiable ;
– L’absence de pathologie cardiaque identifiable avant le dernier mois de la grossesse ;
-La démonstration d’une dysfonction systolique du ventricule gauche à l’échocardiographie.
L’étiologie de la CMPP est inconnue. Plusieurs facteurs sont évoqués dans sa genèse sans qu’aucune étude n’ait pu établir formellement leurs rôles dans la survenue de la CMPP. Parmi ces facteurs on peut citer: les facteurs génétiques et nutritionnels, l’auto-immunité humorale, la drépanocytose, l’insuffisance coronaire.
Cependant d’autres éléments méritent d’être retenus du fait d’un mécanisme physiopathologique plus ou moins élucidé :
-les conditions de vie défavorable ;
– le travail physique intense jusqu’au terme de la grossesse ;
– la vasodilatation et l’augmentation du débit cardiaque liées aux variations climatiques et à l’ablution à l’eau chaude sous certains cieux responsables de surcharge volumétrique cardiaque ;
– la myocardite virale à entérovirus et à coxsackies virus B ;
– la multiparité : elle semble augmenter le risque de myocardite ;
– le régime riche en sodium : il augmente la volémie et le liquide extracellulaire ;
– l’auto-immunité cellulaire, elle est contre le myocarde : due à l’exposition aux antigènes fœtaux qui induiraient des anticorps à tropisme cardiaque ;
– les variations hormonales du péri-partum : la baisse du taux d’œstrogène dont l’inotropisme est démontré expérimentalement, l’augmentation de la prolactine qui, expérimentalement, accroit la volémie, ont été incriminées ;
– la grossesse gémellaire, l’obésité, la tocolyse prolongée, l’âge supérieur à 30 ans et les formes familiales.
Actuellement, d’autres facteurs sont évoqués tels une myocardite, qu’elle soit virale, auto-immune ou idiopathique ; un déficit en micronutriments tel le sélénium.
La dernière hypothèse évoquée est le stress oxydatif de la grossesse et l’implication de la prolactine.
|
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE
I-Épidémiologie des maladies cardio-vasculaires
I.1- Dans le monde
I.2- En Afrique
I.3- Au Sénégal
II- Facteurs de risques cardio-vasculaires
II.1- Les facteurs de risques non modifiables
II.1.1- l’âge
II.1.2- le genre
II.1.3- les antécédents familiaux
II.2- Les facteurs de risques modifiables
II.2.1- l’hypertension artérielle
II.2.2- les dyslipidémies
II.2.3- Le tabagisme
II.2.4- Le diabète
II.2.5- Les autres facteurs de risques
II.2.6- Les marqueurs de risques
III- Nosologie Cardio-vasculaire
III.1- Définition et Généralités
III.2- Principaux groupes nosologiques
III.2.1.1- Hypertension artérielle
III.2.1.2- Urgences hypertensives
III.2.2- Maladie coronaire
III.2.3- Pathologie valvulaire rhumatismale
III.2.4- Maladie veineuse thrombo-embolique
III.2.5- Myocardiopathies
1-Cardiomyopathie dilatée
2- Cardiomyopathies hypertrophiques
3- Cardiomyopathie restrictive
4- Dysplasie arythmogène du ventricule droit
III.2.6- Péricardites
III.2.7- Troubles du rythme et de la conduction
III.2.7.1- Troubles du rythme
III.2.7.2- Troubles de la conduction
DEUXIEME PARTIE PATIENTS ET METHODES
1-Type d’étude et période d’étude
2- Cadre d’étude
3- Critères d’inclusions
4- Paramètres étudiés
5- Analyse statistique
RESULTATS
2- Répartition des patients selon le genre
3- Répartition des patients selon les groupes nosologiques
4- Répartition des principaux groupes nosologiques selon le genre
5- Répartition des patients par groupe nosologique selon les années
5.1- Répartition des patients hospitalisés pour hypertension artérielle selon les années
5.2- Répartition des patients hospitalisés pour cardiopathie ischémique selon les années
5.3- Répartition des patients hospitalisés pour valvulopathie selon les années
5.4- Répartition des patients hospitalisés pour endocardite selon les années
5.5- Répartition des patients hospitalisés pour myocardiopathie selon les années
5.6- Répartition des patients hospitalisés pour bloc auriculo-ventriculaire selon les années
5.7-Répartition des patients hospitalisés pour maladie veineuse thromboembolique selon les années
6- Récapitulatif des principaux groupes nosologiques selon les annés
7- Evolution entre les patients hospitalisés pour les principaux groupes nosologiques
7.1- Evolution des hospitalisations entre l’association (hypertension artérielle et cardiopathies ischémiques) et l’association (valvulopathies et endocardites) valvulopathies et cardiopathies ischémiques
7.3- Evolution des hospitalisations entre les patients atteints de valvulopathies et d’hypertension artérielle
7.4- Evolution des hospitalisations entre patients atteints d’hypertension artérielle et cardiopathies ischémiques
COMMENTAIRES
I-Commentaires sur la méthodologie
II-Commentaires sur les résultats
1- Hypertension artérielle
2- Cardiopathies ischémiques
3- Valvulopathies
4- Endocardites
5- Myocardiopathies
6- Maladie veineuse thrombo-embolique
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Télécharger le rapport complet