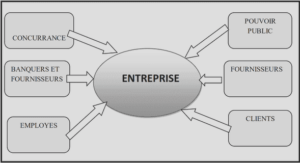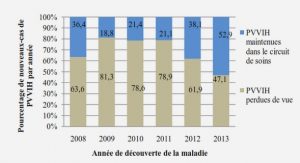Structure du Centre Culturel
Français de Groningue : moyens humains et matériels :
Une trentaine de personnes travaillent pour le Centre Culturel Français de Groningue, sous la direction de Monsieur Hervé FRANÇOIS, en poste depuis septembre 1995.
Outre son directeur, qui occupe le poste durant 4 ou 6 ans, cet institut emploie un coopérant (qui reste un an et demi ou deux ans) comme secrétaire général, une secrétaire, une personne chargée de l’accueil et de l’organisation pratique des cours dispensés par le CCF, un animateur culturel, un aide-bibliothécaire à mi-temps, une aide-documentaliste à mi-temps.
Pour le fonctionnement des cours, le CCF emploie, à temps partiel, une responsable pédagogique qui s’occupe de la conception et du suivi des cours de FLE, ainsi que des personnes chargées de cours.
Une partie de ces personnes sont néerlandaises : c’est le cas pour l’animateur culturel, le bibliothécaire, la secrétaire et les personnes chargées de cours. Les autres sont français. En revanche, seul le bibliothécaire ne pratique pas le français.
Depuis 1989, le CCF est installé dans les locaux de l’université. Il est situé au premier étage du bâtiment qui abrite les facultés de Lettres et de Droit, dans le centre de Groningue, les autres facultés et l’école de commerce (Hanzehogeschool) étant implantées à la périphérie de la ville.
Les locaux mis à la disposition du CCF par l’université sont constitués :
-d’un local d’environ 70 m2 où sont installés bibliothèque, service de documentation et secrétariat;
-d’un bureau situé dans un couloir voisin, qu’occupent le directeur et le secrétaire général.
Le mobilier est également essentiellement celui que l’université met à la disposition du Centre Culturel.
Si le directeur, le secrétaire général et la secrétaire travaillent tous dans un bureau, les autres membres du personnel travaillent dans la partie » publique » du Centre où se trouve la bibliothèque. Ainsi deux personnes sont présentes le matin, et quatre l’après-midi (l’aide-6 bibliothécaire et l’aide-documentaliste ne travaillant tous deux que l’après-midi). Parmi elles, l’animateur culturel n’a pas de contact avec le public.
Les moyens électroniques sont répartis comme suit : le CCF possède trois ordinateurs Pentium, un ordinateur 486, un ordinateur réservé à l’usage de l’aide-bibliothécaire et un ordinateur dédié à la consultation du catalogue informatisé par le public.
L’un des Pentium est installé dans le bureau de la secrétaire, les deux autres sont installés dans le bureau de la direction. Ces derniers sont dotés de cartes son, et l’un d’entre eux d’un lecteur de cédéroms. L’ordinateur 486 est utilisé par l’animateur culturel.
En outre, le bureau de la direction est équipé d’une imprimante, de même que le bureau de la secrétaire.
Les logiciels que les membres du CCF peuvent utiliser sont ceux dont l’université dispose.
Chacun (exceptés les chargés de cours au CCF) possède un compte personnel et peut demander à l’université de lui installer certains logiciels (par exemple Access) en plus des logiciels installés sur tous les comptes. Tous fonctionnent avec l’interface Windows 3.11 pour Worksgroup et possèdent au moins Word Perfect, Word, Netscape, une adresse électronique (e-mail).
Le CCF n’a pas d’autres bases de données qu’Internet et un Minitel réservé à l’usage du personnel. Il ne possède pas non plus de scanner.
Les moyens audiovisuels sont constitués d’un poste de télévision, d’un moniteur, d’un magnétoscope, du matériel nécessaire pour effectuer le montage de films, d’un vidéoprojecteur et de deux projecteurs de cinéma 16mm installés dans le théâtre universitaire.
Le CCF reçoit les chaînes du câble et dispose d’une antenne parabolique lui permettant de capter TV5 international, Arte, Canal + international, et les radios publiques françaises (France Inter, France Info, France Culture, etc.). Il y a aussi des lecteurs de cassettes utilisés par les chargés de cours, et une chaîne hi-fi. Par ailleurs, l’université met à disposition des postes de télévision et des magnétoscopes pour les cours du CCF.
Liens avec l’Ambassade
Du point de vue juridique et administratif, le Centre Culturel Français dépend de l’Ambassade de France à La Haye.
Les grands champs de l’action du CCF sont définis en tenant compte des orientations générales dictées par l’Ambassade et le Ministère français des Affaires étrangères. Les différents instituts français implantés aux Pays-Bas : la Maison Descartes d’Amsterdam, l’Institut Français de La Haye, le Centre Culturel Français de Groningue, l’Alliance Française de Rotterdam, auxquels s’ajoutent d’autres Alliances Françaises réparties sur le territoire néerlandais, informent l’Ambassade et les autres instituts français des Pays-Bas de leurs projets, et rendent compte des actions menées. L’objectif est de disposer d’un réseau cohérent, où tous suivent la même ligne directrice et essaient de pratiquer le plus possible la coopération. Par exemple, les intellectuels invités par la Maison Descartes donnent parfois par la même occasion une conférence à Groningue, grâce à la coopération entre la Maison Descartes et le CCF de Groningue.
Les personnels de l’Ambassade sont chargés de réfléchir aux divers aspects des relations établies entre les deux pays, qu’il s’agisse de la coopération universitaire, des questions linguistiques… . Ils ont aussi pour mission de donner une impulsion à des projets dans les instituts français du réseau, et d’aider ces derniers à réaliser certaines de leurs actions.
L’Ambassade compte en particulier des attachés linguistiques et une personne chargée de la coopération universitaire.
En outre, elle emploie un informaticien chargé de régler les problèmes informatiques, et responsable de la maintenance du réseau et de la mise à jour du site Internet de l’Ambassade.
Il peut, en fonction des demandes, se déplacer dans les instituts français des Pays-Bas pour y former à l’utilisation de l’informatique.
Liens avec l’université de Groningue
Le Centre Culturel Français de Groningue est une structure intégrée à l’université : il est hébergé gratuitement dans les locaux de la faculté de Lettres. Les charges d’exploitation sont assumées par l’université. Des salles sont mises à la disposition du CCF pour ses cours, le ciné-club et certaines manifestations culturelles ponctuelles.
Le personnel est en partie pris en charge financièrement par l’université. De plus, l’aide-bibliothécaire travaille à mi-temps pour le CCF et à mi-temps pour la bibliothèque universitaire de Lettres.
Le CCF est connecté gratuitement au réseau informatique de l’université, qui s’occupe de l’installation et de la maintenance matérielles et logicielles. D’autre part, le service informatique de l’université propose aux employés du CCF de suivre des stages de formation à l’utilisation de l’informatique, destinés au personnel de l’université.
Le CCF participe à la vie de l’université, d’une part par ses interventions dans certains cursus (français, droit, communication), d’autre part par la présence de sa bibliothèque et de son service de documentation. Ses collections d’ouvrages et de CD sont intégrées dans le catalogue informatisé des bibliothèques universitaires de Groningue.
Le CCF entretient des relations privilégiées avec l’une des bibliothèques universitaires : la bibliothèque de Lettres, avec laquelle il souhaite rechercher la meilleure coopération et la plus grande complémentarité possibles. Cette bibliothèque fournit au CCF un mi-temps d’aide-bibliothécaire. Elle autorise l’inscription de l’aide-documentaliste, qui n’est pourtant pas employée par l’université, aux stages de formation destinés au personnel des bibliothèques universitaires, à des tarifs préférentiels. Enfin, sa directrice est prête à aider le CCF dans son travail de réflexion sur sa bibliothèque et son service de documentation.
La mission du stage : objectifs et contexte
Depuis 1996, le Centre Culturel Français de Groningue est engagé dans une réforme d’ensemble, qui tend à redéfinir les champs et les modes d’action de l’établissement. Dans ce contexte, une réflexion de fond sur la bibliothèque du Centre, ainsi que sur le traitement de l’information et sa diffusion auprès d’un public à cibler s’imposait.
Le CCF a fait appel à un stagiaire pour réaliser cette mission, qui se décline en deux volets :
-réalisation d’un audit du centre de documentation et de la bibliothèque : analyse du fonds, du fonctionnement, du matériel et des outils à disposition, des locaux ; analyse des besoins des utilisateurs actuels et potentiels ;
-proposition de solutions pour une meilleure adaptation aux besoins du public et un meilleur fonctionnement de ce service, dans le cadre d’une coopération avec l’université de Groningue.
La réalisation de cette mission doit s’inscrire dans la ligne de la réforme poursuivie par le CCF de Groningue ; il faut donc connaître les activités et les grandes orientations choisies par cet institut, ainsi que les directives de l’Ambassade concernant la stratégie de développement du CCF et du réseau des Affaires étrangères aux Pays-Bas.
Il faut en outre tenir compte du fonctionnement du CCF en interne, des compétences et de la motivation du personnel.
Recueil des informations
Après avoir été testé par deux étudiantes, le questionnaire a été distribué à des étudiants, et laissé en libre accès au centre documentaire du CCF pour le public fréquentant le CCF à cette période de l’année.
La distribution a été faite pendant les cours, pour deux raisons :
1. dans la mesure où les personnes à interroger sont ciblées en fonction de la filière qu’elles suivent, le meilleur moyen de les atteindre est de leur donner le questionnaire en cours ;
2. il est plus sûr de ne pas laisser les étudiants emporter les questionnaires chez eux, dans une période de préparation des examens et peu avant les vacances d’été, si l’on veut récupérer les questionnaires ; de plus, le sujet de l’enquête ne les touche pas nécessairement de très près. Le moyen le plus efficace est de distribuer les questionnaires en début de cours et de les récupérer à la fin du cours. Ce mode de distribution a pour inconvénient de ne pas laisser beaucoup de temps pour remplir le questionnaire. Les réponses aux questions ouvertes seront vraisemblablement assez superficielles, à moins que la personne interrogée ait déjà réfléchi à ces questions.
Comme, à la date à laquelle la distribution du questionnaire a commencé, une partie des enseignements universitaires étaient achevés, il n’a pas été possible d’interroger tous les étudiants ciblés. Il a été distribué dans des cours du département de Langues Romanes (RTC) suivant un cursus de français ou en première année d’études, dans des cours des départements de Communication et d’Organisations Internationales. En revanche, les cours des départements de Droit et d’Histoire étaient déjà terminés.
Résultats
128 questionnaires exploitables ont été remis, les autres étaient insuffisamment remplis pour fournir des informations. Dans l’ensemble, les personnes interrogées ont répondu aux questions fermées mais rarement aux questions ouvertes. S’agissant de ces questions, le nombre de réponses suffit cependant pour les exploiter, d’autant plus que souvent les
réponses sont similaires. D’autre part, tous n’ont pas répondu à toutes les questions auxquelles ils étaient priés de répondre. D’autres enfin ont rempli les quatre parties du questionnaire ; les réponses qu’ils ont données dans la partie IV, qu’ils n’étaient pas censés remplir, ont tout de même été retenues : elles apportent des éléments d’information.
Très peu ont répondu à la question n° 15, car ils n’en ont pas compris le sens : il s’agit d’une erreur de traduction. Il n’est donc pas possible de mesurer le degré de satisfaction des utilisateurs des dossiers documentaires thématiques. Aucun croisement avec la question n° 15 n’a donc été réalisé pour le tri croisé.
Le questionnaire a été encodé à partir des réponses obtenues (cf annexe V). Pour les questions ouvertes, l’ensemble des réponses a été examiné, de façon à dégager des réponsestypes (elles doivent apparaître au moins cinq fois pour être retenues).
Les résultats du tri à plat et du tri croisé sont en annexes VI et VII.
Avant de tirer des conclusions sur cette enquête, il convient d’évaluer la portée et les limites des réponses rassemblées. L’examen de certaines réponses et du tri croisé le permettent.
Beaucoup d’étudiants interrogés suivent ou ont suivi une formation poussée en français (plus de 50%). Et environ 50% des personnes interrogées font partie du département de Langues Romanes (RTC). La part des demandes exprimées et des informations apportées par des étudiants de RTC est donc importante.
Le tri croisé permet d’autre part de conclure que :
-on a plus de chances de connaître et de fréquenter le CCF si l’on est étudiant au département de Langues Romanes ;
-on a plus de chances de connaître et de fréquenter le CCF si l’on est avancé dans les études ;
-on a plus de chances de connaître et de fréquenter le CCF si l’on maîtrise la langue française.
Par conséquent, on devrait logiquement recueillir plus d’informations de la part d’étudiants de français avancés dans les études. Cependant, les étudiants jeunes (première ou deuxième année) sont plus nombreux dans la population des personnes ayant répondu (plus de 60%). Ce sont donc globalement les intérêts et les besoins des étudiants de français de tous âges qui pèsent le plus lourd dans les résultats.
Cela limite la portée du questionnaire, qui devait permettre de toucher des étudiants issus d’horizons divers. Les informations retirées de l’observation faite au CCF (fonds et fonctionnement) et des entretiens ont plus de valeur que les informations apportées par ce questionnaire.
Le public
Si l’on ne cible pas de public, il est impossible de créer un profil de collection et de donner une identité au CCF. Or un centre de documentation ou une bibliothèque ne peut présenter un véritable intérêt, donc être fréquenté, que si l’on sait ce que l’on peut y trouver.
Dans un environnement riche en bibliothèques bien fournies et d’équipement moderne, il faut déterminer les besoins non encore satisfaits.
Le CCF étant implanté dans l’université, les universitaires constituent logiquement le public essentiel. Il faut en tenir compte pour le choix du public visé. Le public ciblé est constitué de deux types de personnes : d’une part les personnes à qui le CCF se doit d’apporter un service documentaire, d’autre part les personnes ayant des besoins non encore satisfaits. Les premières sont les Français vivant dans la région ainsi que les professeurs et élèves du CCF. Les secondes sont les universitaires et étudiants manquant de données sur la France. Toute l’université ne s’intéresse pas à la France. Ce sont principalement des étudiants et enseignants rattachés aux départements de Langues Romanes, d’Organisations Internationales, de Communication et de Droit qui sont susceptibles de s’intéresser à notre pays.
Le fonctionnement
Le mode de fonctionnement défini doit tenir compte du fait que le personnel du CCF travaillant pour le centre documentaire a dans l’ensemble peu de compétences. Les personnes du CCF amenées à travailler pour le centre documentaire (aide-bibliothécaire, aidedocumentaliste, directeur) ont intérêt à mutualiser les tâches : travailler collectivement sur les différentes tâches à effectuer pour la gestion des fonds. Pour la même raison, ils ont également intérêt à s’appuyer sur des professeurs de l’université pour les commandes, puisque ces derniers ont l’habitude de faire ce type de travail pour les bibliothèques universitaires et se sont dits prêts à suggérer des titres à acquérir.
L’existence d’un réseau documentaire français dépendant de l’Ambassade de France et la présence à la Maison Descartes, tête de ce réseau, d’un personnel de bibliothèque qualifié, justifie de demander de l’aide à ces personnes.
Bref, il faut compenser les manques de compétences du personnel en s’appuyant sur le maximum de partenaires.
Le fonctionnement du centre documentaire sera optimisé si le CCF développe avec les professeurs de l’université la concertation la plus poussée possible. De cette façon, il aura plus de chances de répondre aux besoins des enseignants, de leur être utile.
La « publicité »
Le Centre Culturel Français de Groningue est dans l’ensemble mal connu, y compris au sein de l’université où il est pourtant installé depuis longtemps. Peu d’étudiants connaissent son existence ; les professeurs savent qu’il y a un Centre Culturel Français, mais ils connaissent mal ses activités. Il est donc nécessaire et impératif que le CCF mette en place une politique de communication efficace.
|
Table des matières
Introduction : le sujet d’étude et ses enjeux
I. La problématique
1.1. Le Centre Culturel Français
1.1.1. Missions du CCF
1.1.2. Structure : moyens humains et matériels
1.1.3. Liens avec l’Ambassade
1.1.4. Liens avec l’Université de Groningue
1.2. La mission du stage : objectifs et contexte
II. Connaissance du terrain
2.1. L’observation du fonctionnement du CCF en interne
2.2. Le système universitaire et l’université de Groningue
2.3. Les partenaires actuels du CCF pour la bibliothèque : le département de RTC et la bibliothèque universitaire de Lettres
2.4, Les autres bibliothèques de Groningue
2.5, Le réseau documentaire des Affaires étrangères aux Pays-Bas
2.6, Les priorités fixées par l’Ambassade, et le soutien à en attendre
III. L’audit
3.1, Objectifs et choix méthodologiques
3.2, Observation du fonds et du fonctionnement de la bibliothèque et du centre de documentation
3.3, Les entretiens
3.3.1. Guide d’entretien
3.3.2. Résultats
3.4, Le questionnaire
3.4.1. La construction du questionnaire
3.4.2. La grille d’analyse
3.4.3. Le recueil des informations
3.4.4. Résultats
3.5. Synthèse des résultats
IV. Les objectifs majeurs dégagés
4.1. Le public
4.2. Les collections et la documentation
4.3. L’espace
4.4. Le fonctionnement
4.5. La « publicité »
V. Propositions pour la bibliothèque et le service de documentation
5.1, Réaménagement de l’espace
5.2, Propositions pour la bibliothèque
5.2.1. Politique pour les collections
5.2.2. Proposition de classification pour les livres
5.2.3. Répartition du travail pour les acquisitions futures
5.2.4. Développement du multimédia
5.3, Propositions pour le service de documentation
5.3.1. La mise à disposition des documents au public
5.3.2. Le développement d’Internet
5.4, La question des liens avec les autres bibliothèques du réseau des Affaires étrangères aux Pays-Bas
VI. Réflexions pour une meilleure insertion des fonctions informatives du CCF dans l’université
6.1. Le CCF et la coopération universitaire : un chantier nécessaire
6.2. Resserrer les liens avec le département RTC : comment intégrer F utilisation du CCF dans les cours de français ?
6.3.Etablir des liens avec les autres départements
6.4. Se faire connaître : comment ?
6.5. Participer à des grands projets universitaires
Conclusion
ANNEXES
Annexe I : Classification de base suivie par les universités néerlandaises
Annexe II : Classification suivie par le CCF jusqu’en juin 1997
Annexe III : Guides d’entretien
Annexe IV : Questionnaire
Annexe V : Questionnaire encodé
Annexe VI : Tri à plat du questionnaire
Annexe VII : Tri croisé du questionnaire
Annexe VIII : Classification proposée pour le CCF
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet