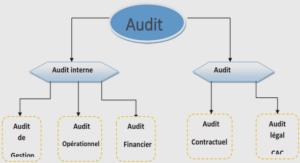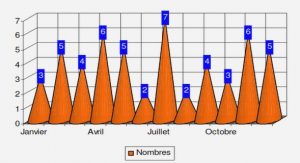Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Morphologie et cycle évolutif
Au cours de leur cycle biologique les plasmodies changent sans cesse d’aspect et de taille par suite d’alternance de phases de croissance et de phases de division.
Ce cycle évolutif se fait en deux phases chez deux hôtes successifs :
– La phase de multiplication asexuée ou schizogonique qui se déroule chez l’homme.
– La phase de multiplication sexuée ou sporogonique qui s’effectue chez l’anophèle femelle.
*Cycle chez l’homme
Au cours d’une piqûre de l’homme, l’anophèle infestée injecte avec sa salive et dans un vaisseau sanguin, la quasi-totalité des sporozoïtes localisés dans ses glandes salivaires.
Ces éléments filiformes de quelques micromètres de long envahissent rapidement tout l’organisme et pénètrent activement et indifféremment dans différents types cellulaires où leur développement avortera. Seuls les survivants ayant gagné le foie et franchi la barrière constituée par les cellules de kupffer pourront poursuivre leur cycle qui se déroulera suivant deux phases : la phases hépatique et la phase érythrocytaire.
Ö La phase hépatique : après pénétration dans l’hépatocyte le sporozoïte se transforme en trophozoite; élément de quelques micron mètres de diamètre et uninucléé.
Deux possibilités s’offrent alors aux trophozoïtes :
Certains évoluent immédiatement jusqu’à maturité, les autres restent sous forme uninucléée ; forme dormante appelée hypnozoïte.
– Evolution non retardée : le trophozoïte se divise formant en une à trois semaines un schizonte mature ; volumineuse cellule plasmodiale de 40 à 100 micromètres contenant quelques milliers de noyaux déformant l’hépatocyte hôte et repoussant son ou ses noyaux en périphérie. A maturité le schizonte hépatique ou corps bleu éclate et libère des mérozoïtes ; formes uninucléées qui initieront la phase érythrocytaire.
– Evolution retardée : le trophozoïte hépatique grossit légèrement mais reste sous forme uninucléée.
Ces hypnozoïtes seront activés à des époques différentes, donnant alors lieu à une schizogonie hépatique « classique » à l’origine de rechute de Plasmodium vivax ou Plasmodium ovale ou reviviscence schizogonique.
Ö La phase érythrocytaire : les mérozoïtes pénètrent chacun dans une hématie par endocytose, se transforment en trophozoïte qui va grossir et subir une division de son noyau pour donner un schizonte érythrocytaire qui se charge de pigment malarique.
La multiplication des noyaux dont chacun s’entoure d’une plage cytoplasmique forme un schizonte mûr ou corps en rosace qui libère après éclatement du globule rouge des mérozoïtes qui vont recoloniser d’autres hématies.
Le cycle de maturation des schizontes varie selon l’espèce entre 48 et 72 heures rendant compte de la périodicité variable de la fièvre.
Après plusieurs cycles schizogoniques, certains mérozoïtes, au lieu de devenir des schizontes, vont donner dans les hématies des éléments sexués ; les gamètes mâles et femelles ; initiateurs de la phase sporogonique chez l’anophèle.
*Cycle chez l’anophèle :
Lors de son repas sur un sujet infecté, l’anophèle femelle absorbe des plasmodies. Les éléments asexués ; trophozoïtes et schizontes sont digérés. Seuls les gamétocytes poursuivront leur développement. Rapidement par expulsion des corpuscules chromatiniens, le gamétocyte femelle se transforme en macrogamète.
La microgamétocytogénèse ou exflagellation est plus lente : le noyau se divise, donne naissance à huit microgamètes flagellés très mobiles qui vont rapidement à la rencontre du macrogamète.
La fécondation donne naissance à l’ookinète ; œuf mobile qui traverse la paroi de l’estomac formant alors à l’extérieur de sa face externe l’oocyste.
Libérés par éclatement de l’oocyste mur, les sporozoïtes gagneront avec prédilection les glandes salivaires de l’anophèle.
Ce cycle dure entre 10 à 40 jours.
Les vecteurs
Les vecteurs du paludisme humain appartiennent à l’ordre des Diptères, à la famille des Culicidae, au genre Anophèles.
Au cours de leur cycle évolutif, les anophèles se présentent sous quatre stades successifs : œuf, larve, nymphe, adulte ou imago.
Les trois premiers stades sont aquatiques tandis que les adultes ont une vie aérienne. Seules les femelles piquent pour puiser dans le sang de l’homme les protéines nécessaires au développement de leurs ovaires.
Quelques 60 espèces ont été répertoriées, vectrices majeures du paludisme avec prédominance en Afrique de deux espèces :
-Anophèles funestus
-Anophèles gambiae
Réservoirs de virus
Le réservoir de virus est représenté par l’homme malade, l’anophèle infesté mais aussi pour Plasmodium malariae par certains singes.
Réceptivité de l’homme au paludisme
Il n’existe pas d’immunité naturelle vis à vis du paludisme, tous les hommes sont réceptifs.
Il est cependant établi une résistance chez certains sujets.
On distingue : une résistance innée et une résistance acquise.
Ö La résistance innée est liée aux anomalies érythrocytaires à savoir ; le trait drépanocytaire, l’α thalassémie, la β thalassémie et le déficit en glucose 6.P.D
Ö La résistance acquise se manifeste chez les sujets vivant en zone d’endémie et qui sont soumis à des infections répétées. C’est une immunité relative et réversible.
Mode de contamination
La transmission se fait habituellement par la piqûre de l’anophèle femelle infestée.
Il existe aussi deux autres modes de contamination :
– la transmission materno-fœtale ;
– la transmission accidentelle lors de transfusion sanguine
Facteurs favorisants
Il s’agit de facteurs physiques et de facteurs individuels.
2.6.1. Les facteurs géographiques et climatiques
Ö La température : Selon l’espèce de Plasmodium la température optimale de développement varie:
– 15° à 30°c pour Plasmodium vivax et Plasmodium malariae,
– 20 à 25°c pour Plasmodium falciparum
Ö L’humidité : elle favorise la longévité du vecteur
Ö La pluviométrie : La forte pluviométrie entraîne une multiplication des gîtes larvaires favorisant ainsi la pullulation des anophèles.
2.6.2. Les facteurs individuels
Ö La grossesse : La baisse de l’immunité au cours de la grossesse expose la femme enceinte à un paludisme grave.
Ö L’age : les enfants de 0 à 5 ans sont plus exposés par absence de prémunition. Les personnes âgées sont également fragilisées devant la maladie.
Répartition géographique
Les exigences bioécologiques du cycle expliquent la répartition du paludisme :
– Plasmodium falciparum est cosmopolite mais avec une nette prédominance dans les régions tropicales surtout en Afrique tropicale sub-saharienne.
– Plasmodium vivax : est répandu dans la zone sub-tropicale
– Plasmodium malariae : dans les pays tropicaux
– Plasmodium ovale rare en Afrique tropicale et en Asie.
Modalités épidémiologiques
Plusieurs indicateurs sont utilisés pour évaluer cette endémie.
Il s’agit :
⇒ Chez l’homme :
o De l’indice splénique (IS) qui est le pourcentage de sujets porteurs de splénomégalie dans une population. On l’apprécie chez les enfants de 2 à 9 ans non soumis à une chimioprophylaxie,
o De l’indice parasitaire (IP) qui est le pourcentage de sujets examinés ayant des hématozoaires dans le sang
o De l’indice gamétocytique qui est le pourcentage de sujets porteurs de gamétocytes dans leur sang.
On a pu isoler quatre niveaux d’endémicité :
En zone d’hypoendémie ; moins de 25% de sujets infectés
En zone mésoendémique ; 26 à 50% de sujets infectés
En zone d’hyperendémie ; 51 à 75% de sujets infectés
En zone d’holoendémie ; plus de 76% de sujets infectés.
⇒ Chez l’anophèle :
o L’indice sporozoïtique : c’est le pourcentage au niveau d’une population d’anophèles disséqués qui présentent des sporozoïtes dans les glandes salivaires
o L’indice oocystique : c’est le pourcentage d’anophèles femelles porteuses d’oocystes dans la paroi de l’estomac.
Ces deux indicateurs permettent d’étudier le niveau de transmission.
Physiopathologie ( 3, 4 )
La fièvre : correspond à l’éclatement des rosaces qui libèrent dans le torrent circulaire du pigment malarique qui se comporte comme une substance pyrétogène.
– Si l’éclatement des rosaces est asynchrone : la fièvre est irrégulière ou apparemment continue ;
– Si synchrone = fièvre intermittente tierce ou quatre.
L’anémie : résulte avant tout de la lyse des hématies parasitées mais aussi de la lyse de certaines hématies saines par mécanisme immunologique.
La splénomégalie et l’hépatomégalie : au bout d’un certain temps d’évolution, témoignent de l’hyperactivité et de la congestion de ces organes.
L’ictère : par défaut de conjugaison de l’hémoglobine dans l’hépatocyte.
Le neuropaludisme : par séquestration des érythrocytes parasités dans les capillaires cérébraux entraînant une anoxie cérébrale. Des perturbations métaboliques sont aussi incriminées.
Fièvre bilieuse hémoglobinique : par phénomène immunoallergique.
Symptomatologie (1,3,4,5)
Cinq tableaux cliniques ont été décrits.
Accès de primoinvasion
Il apparaît chez le sujet neuf, non immun
– Incubation : 7 à 21 jours parfois plusieurs mois :
– Invasion : fièvre progressivement croissante qui devient continue, en plateau ou à grandes oscillations irrégulières avec plusieurs pics par journée atteignant 39-40°, troubles digestifs : nausées, vomissement, diarrhées.
Non ou mal traité cet accès va évoluer vers la guérison, l’accès palustre simple ou vers l’aggravation.
Accès intermittent ou accès palustre simple
Il est caractérisé par la succession de trois stades précédés : céphalées, nausées et débute brutalement en fin de journée ou la nuit et dure une dizaine d’heures.
– Stade de frissons : agité de violents frissons, le malade se plaint d’une sensation de froid intense, la température s’élève à 39°, la rate s’hypertrophie, la pression artérielle s’abaisse.
Durée : 1heure
– Stade chaleur : les frissons cessent, la peau est sèche et brûlante, la température atteint 40-41°c, la rate toujours palpable diminue de volume.
Durée : 3 à 4 heures
– Stade de sueur : des sueurs abondantes baignent le malade, la température baisse brusquement avec une phase d’hypothermie, la pression artérielle se relève ;
Durée : 2 à 4 heures.
Il est suivi d’une sensation d’euphorie, de bien être.
Ces accès se répètent et le rythme est variable selon l’espèce ; tous les deux jours : fièvre tierce pour Plasmodium falciparum, ovale, vivax ou tous les trois jours : Fièvre quatre pour Plasmodium malariae.
Non ou mal traité l’accès évolue vers la guérison ou vers l’aggravation.
Accès pernicieux et accès graves ou compliqués
Ce sont des urgences médicales nécessitant un traitement rapide et efficace.
L’accès pernicieux ou neuropaludisme se définit par l’existence de signes neurologiques aigus au cours d’un paludisme à Plasmodium falciparum réalisant ainsi un tableau d’encéphalopathie aiguë fébrile avec :
– Fièvre élevée à 40-41°C ;
– Un coma souvent profond ;
– Des convulsions ;
– Des signes méningés ;
– Hypotonie généralisée ;
– Aréflexie ostéotendineuse ;
– Confusion mentale parfois.
Le paludisme grave se définit selon l’O.M.S par la présence de formes asexuées de Plasmodium falciparum à l’examen sanguin et d’un ou de plusieurs des dix manifestations majeures suivantes :
1. Neuropaludisme : coma stade II ou plus ;
2. Crises convulsives généralisées répétées ;
3. Anémie grave (hémoglobine < 5-6 g/dl) ;
4. Œdème pulmonaire (ou syndrome de détresse respiratoire) ;
5. Hypoglycémie (<0,4 g/l)
6. Collapsus circulatoire;
7. L’hémorragie diffuse ;
8. L’hémoglobinurie massive ;
9. Acidose sanguine : pH. Artérielle <7,25 ; ou Bicarbonate <15 mmol/l.
10. L’insuffisance rénale.
Cependant existent d’autres manifestations contingentes, ne suffisant pas à elles seules à définir l’accès grave :
– Obnubilation ou prostration moins marquée que le coma stade II ;
– Parasitémie élevée ;
– Ictère ;
– Hyperthermie (supérieure ou égale à 41°C) ou hypothermie (inférieure ou égale à 36°C)
Paludisme viscéral évolutif (PVE)
Forme subaiguë ou chronique d’infestation par Plasmodium vivax et Plasmodium falciparum, il s’observe lors d’infestations parasitaires répétées et/ou de plus en plus fréquemment, chez les sujets exposés se soumettant régulièrement à une chimioprophylaxie par la chloroquine à laquelle l’hématozoaire est résistant.
Le Tableau clinique se résume à :
– Une anémie parfois intense avec subictère ;
– Une splénomégalie ;
– Une fébricule à 38°C parfois absente,
– Une altération de l’état général avec asthénie, anorexie et amaigrissement.
Fièvre Bilieuse hémoglobinique
Accident immunoallergique lié à l’ingestion de quinine, la fièvre bilieuse hémoglobinique se traduit par une hémolyse massive avec état de choc et fièvre évoluant vers l’anurie chez des sujets vivant en zone d’endémie et se soumettant à une prophylaxie par la quinine.
Particularités selon le terrain
¾ la femme enceinte
Le paludisme est redoutable tant pour la mère que pour l’enfant.
Il est à l’origine d’avortements, d’accouchements prématurés, d’hypotrophie fœtale, de paludisme congénital.
¾ l’enfant
Le risque d’apparition de neuropaludisme est accru avant 5 ans.
Diagnostic Biologique du paludisme (3, 6, 7, 14,15)
Il repose sur la mise en évidence de parasites ou de matériel parasitaire dans le prélèvement et la titration des anticorps antiplasmodiums dans le sérum.
Il comprend deux volets :
– Le diagnostic direct
– Le diagnostic indirect
Diagnostic Direct
Le prélèvement
Avec un vaccinostyle on pique le doigt préalablement désinfecté et on prélève une à deux gouttes de sang sur une lame porte objet dégraissée.
Examen après coloration
La goutte épaisse : Par étalement sur une surface d’un centimètre carré, la goutte de sang est séchée puis déshémoglobinisée par l’eau neutre enfin colorée au May Grunwald-Giemsa.
C’est une technique très sensible mais ne permet pas le diagnostic d’espèce.
9 Le frottis sanguin : le frottis mince par étalement monocellulaire séché, permet l’identification d’espèce mais il est moins sensible que la goutte épaisse.
Quantitative Buffy Coat (Q.B.C)
C’est une technique de centrifugation en tube micro-hématocrite avec coloration à l’acridine orange.
Il a l’inconvénient de ne pas permettre une identification des espèces plasmodiales, encore moins une numération des hématies parasitées.
Polymérase Chain Réaction (P.C.R)
C’est un processus d’amplification de l’ADN parasitaire utilisant des stades de dénaturation, d’extension et d’amplification du matériel génétique.
Les sondes nucléiques
Des « sondes » marquées au phosphore radioactif 32P, permettent de détecter dans un prélèvement de sang des fragments du génome du parasite dont on soupçonne la présence chez le patient.
Diagnostic Indirect
Immunofluorescence indirecte (IFI)
Elle permet de voir au microscope à immunofluorescence des complexes antigènes-anticorps localisés sur le parasite.
Hémagglutination indirecte (HAI)
Elle consiste à mettre en contact diverses dilutions de sérums étudiés et des hématies jouant le rôle de support inerte d’antigènes parasitaires solubles.
En cas de positivité (agglutination), on note une sédimentation en paquet.
|
Table des matières
NTRODUCTION
PREMIER PARTIE : RAPPELS
CHAPITRE I : CLASSIFICATION GENERALE DES PARASITES
1. Classification des protozoaires
1.1. Phylum : Sarcomastigophora
1.1.1. Sous phylum : Sarcodina
1.1.2. Sous phylum : Mastigophora
1.2. Phylum : Apicomplexa
1.3.Phylum : Ciliophora
2. Classification des métazoaires
2.1. Phylum : Plathelminthes ( vers plats )
2.2. Phylum : Nématodes ( vers ronds )
2.3. Phylum : Arthropodes
2.3.1. Sous phylum : Chelicerata
2.3.2. Sous phylum : Tracheata
2.2.3. Sous phylum : Branchiata
1.2.4. Phylum : Mollusques
CHAPITRE II : RAPPEL SUR LE PALUDISME
1. Definition (1 )
2. Epidemiologie
2.1. Les agents pathogènes
2.1.1. Classification
2.1.2. Morphologie et cycle évolutif
2.2. Les vecteurs
2.3. Réservoirs de virus
2.4. Réceptivité de l’homme au paludisme
2.5. Mode de contamination
2.6. Facteurs favorisants
Télécharger le rapport complet