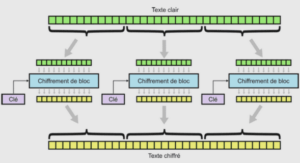Au fondement même des télécommunications se trouve l’idée de transformer un signal pour pouvoir en assurer la transmission. Ainsi le signal vocal, qui occupe une bande de fréquence de 300 Hz à 3400 KHz et qui est transmis via des variations de pression grâce à l’élasticité de l’air, a une portée réduite à quelques mètres. Le principe de la radiotéléphonie est de transformer ce signal en un signal électromagnétique porté par une onde qui peut aller loin sur un support approprié (espace), puis de reconstruire le signal vocal à l’arrivée par décodage du signal électromagnétique. Le codage du signal vocal sur des réseaux télécoms, s’est d’abord fait en utilisant un procédé qui, tout en le transformant pour pouvoir le transporter, reproduit la forme même du signal que l’on veut communiquer. On parle alors de la transmission analogique.
Cependant le développement des outils informatiques a banalisé les équipements numériques dont le coût a baissé rapidement. Il est possible de coder un signal vocal sous la forme d’une suite de bits, la technique la plus courante associant au circuit téléphonique un débit numérique de 64 Kbits/s. Avec les techniques de transmission numérique, on ne cherche plus à transmettre un signal analogue à celui que l’on veut reproduire, on traduit tout signal en une suite de bits. Choisie pour diverses raisons, cette évolution technique a provoqué de profondes modifications dans les télécommunications. Malgré les avantages apportés par cette technique ( qualité de transmission , confidentialité,…), la transmission numérique présente toutefois quelques inconvénients surtout en radiocommunication. Ce projet de mémoire qui s’intitule « CVSD et RELP – Appliquées à la radiocommunication mobile » propose quelques solutions permettant d’éliminer ce désagrément.
RADIOCOMMUNICATIONS MOBILES NUMERIQUES
Les communications radioélectriques sont le seul support permettant de communiquer avec les mobiles (véhicules ou individus équipés d’appareils portatifs), même si leur position est inconnue. Elles se sont mises en place très tôt avec les navires et les avions, et connaissent actuellement un fort développement avec les automobiles et les piétons, grâce aux réseaux cellulaires et les techniques numériques.
Domaines d’applications
Les applications de la radiocommunication mobile, qui intéressent le domaine militaire, jouent aussi un rôle important dans la vie civile et s’imposent de jour en jour dans les secteurs les plus variés. En effet, les forces armées l’utilisent soit pour des raisons économiques soit pour assurer certains services particuliers : liaison de service entre les navires et la côte, communications au sol sur les aérodromes, distribution de carburant, maintenance, …
Pour assurer la coordination de leurs travaux, maintenir l’ordre, et surtout pour les urgences, les institutions suivantes se servent de la radio : la gendarmerie, la police, les pompiers, les secouristes, les services médicaux et de sécurité, les entreprises de transport, la douane, … La communication radio concerne aussi le grand public du fait que la technologie sans fil peut s’interfacer avec le réseau filaire. On parle ici de la téléphonie mobile, très répandue depuis la naissance de la norme GSM.
Particularités de la propagation
Les liaisons avec les mobiles utilisent des bandes de fréquence présentes dans tout le spectre, depuis quelques dizaines de kHz jusqu’au hyperfréquences, en cas d’utilisation de satellites. On retrouve donc les caractéristiques de propagation de ces fréquences, avec des particularités dues au fait que l’élément communiquant est le mobile :
– portée limitée par la taille et la puissance réduite des émetteurs surtout pour les équipements portables ou embarqués à bord de voitures.
– qualité de canal de transmission variant très fortement dans le temps avec le déplacement du mobile, et sujette à de nombreuses perturbations : présence d’obstacles créant des zones d’ombre, mais aussi difractant ou réfléchissant les ondes, créant ainsi des trajets multiples et des évanouissements ; difficulté d’éviter les brouilleurs ou les parasites industriels.
– effet Doppler : c’est la variation de la fréquence f d’une onde lorsque la source et le récepteur sont mobiles l’un par rapport à l’autre.
PREDICTION LINEAIRE A EXCITATION RESIDUELLE ou RESIDUAL EXCITED LINEAR PREDICTOR
Les modulations étudiées jusqu’ici se préoccupent essentiellement de transmettre un signal, sans se préoccuper outre mesure de la nature de la parole. Les modulations différentielles permettent une exploitation des propriétés statistiques de la parole (prépondérance des basses fréquences), mais ne permettent qu’un gain médiocre relativement à la modulation par impulsion et codage.
Les procédés basés sur la synthèse de la parole partent d’une autre hypothèse : l’appareil phonatoire humain peut être représenté par un système linéaire arbitrairement complexe, excité par un signal déterminé. Il suffit de déterminer les coefficients du système linéaire, et le signal d’excitation le plus approprié pour parvenir à une approximation valable du signal original, qui est un signal de parole.
La voix humaine
La production de la parole
L’appareil respiratoire fournit l’énergie nécessaire lorsque l’air est expiré par la trachéeartère. Au sommet de celle-ci se trouve le larynx où la pression de l’air est modulée avant d’être expulsé par le conduit vocal qui s’étend du pharynx jusqu’aux lèvres. Le larynx est un ensemble de muscles et de cartilages mobiles qui entourent une cavité située à la partie supérieure de la trachée. Les cordes vocales sont en fait deux lèvres symétriques placées en travers du larynx ; ces lèvres peuvent fermer complètement le larynx et, en s’écartant, déterminer une ouverture triangulaire appelée glotte. L’air y passe librement pendant la respiration, pendant la voix chuchotée, et aussi pendant la phonation des sons sourds ou non voisés.
Les sons voisés résultent au contraire d’une vibration périodique des cordes vocales; des impulsions périodiques de pression sont ainsi appliquées au conduit vocal qui est un ensemble de cavités situées entre la glotte et les lèvres. Il peut être considéré comme une succession de tubes ou cavités acoustiques de sections diverses. Les sons voisés résultent donc de l’excitation du conduit vocal par des impulsions périodiques de pression liées aux oscillations des cordes vocales.
|
Table des matières
INTRODUCTION
CHAPITRE I – RADIOCOMMUNICATIONS MOBILES NUMERIQUES
I.1 – Domaines d’applications
I.2 – Structure générale de la radio mobile numérique
I.2.1 – Source de message numérique
I.2.2 – Codage de source
I.2.3 – Codage de canal
I.2.4 – L’émetteur
I.2.5 – Canal de transmission
I.2.6 – Le récepteur
I.3 – Systèmes de communication avec les mobiles
I.3.1- Système monocentre
I.3.2- Système multicentre
I.3.3- Réseaux cellulaires
I.4 –Techniques d’accès
I.4.1 – Accès multiple à répartition de fréquence
I.4.2 – Accès multiple à répartition du temps
I.4.3 – Accès multiple à répartition en codes
I.5 – Particularités de la propagation
I.6 – Le problème de la bande passante
I.6.1 – La modulation par impulsions et codage
I.6.1.1 – Echantillonnage
I.6.1.2 – Quantification
I.6.1.3 – Codage
I.6.2 – Problème avec le codage MIC
CHAPITRE II – MODULATION DELTA A PREDICTEUR ADAPTATIF
II.1 – Quantification différentielle
II.1.1– Le codeur
II.1.2– Le décodeur
II.2 – La modulation delta
II.2.1 – Schéma bloc
II.2.2 – Problèmes rencontrés en DM
II.2.2.1 – Saturation de pente
II.2.2.2 – Bruit granulaire
II.3 – Modulation delta à prédicteur adaptatif
II.3.1 – Principe
II.3.2 – Bloc diagramme de CVSD
II.3.2.1 – Quantification
II.3.2.2 – Registre à décalage
II.3.2.3 – Algorithme de surcharge
II.3.2.4 – Filtre syllabique
II.3.2.5 – Modulation d’amplitude par impulsions
II.3.3 – Allure des signaux en CVSD
II.3.4– Mean Opinion Score
II.4 – Exemple CVSD
II.5 – Applications de CVSD
II.5.1– Bluetooth
II.5.1.1 – Généralités
II.5.1.2 – Utilisations
II.5.1.3 – Transmission du son dans le système Bluetooth
II.5.2 – Land Mobile Radio
II.5.3 – Autres utilisations
II.6 – Résumé
CHAPITRE III – PREDICTION LINEAIRE A EXCITATION RESIDUELLE
III.1 – Introduction
III.2 – La voix humaine
III.2.1 – La production de la parole
III.2.2 – Caractéristiques de la voix
III.3 – Synthèse de la parole
III.3.1 – Principe
III.3.2 – Filtre en treillis
III.4 – Codage à prédiction linéaire
III.4.1 – Principe
III.4.2 – Analyse et synthèse de la voix
III.4.3 – Calcul des coefficients du filtre
III.4.4 – Estimation de la valeur de l’excitation résiduelle
III.4.5 – Transmission des paramètres LPC
III.5 – La prédiction linéaire à excitation résiduelle
III.5.1 – La prédiction résiduelle
III.5.2 – Structure de RELP
III.5.3 – Exemple
III.6 – Application
III.6.1 – Caractéristiques
III.6.2 – Structure de réseau GSM
III.6.2.1 – Station mobile
III.6.2.2 – Sous-système radio
III.6.2.3 – Sous-système réseau
III.6.2.4-RTCP-RNIS
CONCLUSION