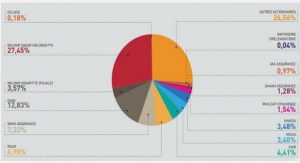De la gestion individualisée des foules
La première partie de cette recherche répond à un double objectif. Premièrement, elle permet de jalonner les termes de ce travail en présentant les principes essentiels de la doctrine française du maintien de l’ordre. On évoquera le long processus d’institutionnalisation d’une force chargée d’encadrer les foules, qui nous fera remonter jusqu’au XVIII ème siècle. Ensuite, dans un second moment, il s’agira de questionner les transformations récentes du maintien de l’ordre. On effectuera une analyse centrée sur la construction politique et policière du phénomène social des casseurs à partir de l’étude de certains d’évènements instituants. Celle ci nous mènera à l’hypothèse d’une individualisation du maintien de l’ordre par l’imbrication de nouvelles rationalités, initialement liées à la police judicaire, au sein de l’activité de la police d’ordre. Ce passage s’appuiera essentiellement sur l’observation d’une semaine menée au CNEFG, à Saint-Astier.
Principes et évolutions tactiques du maintien de l’ordre
Cette première sous-partie est très descriptive, parfois fastidieuse, mais elle a le mérite d’offrir un panorama sur le maintien de l’ordre sans lequel il est compliqué de saisir la suite de la démonstration. Elle est l’occasion de rappeler que le maintien de l’ordre est le résultat d’une lente institutionnalisation qui a débouché sur la création de forces spécialisées en 1921 . On exposera également l’ensemble des savoir-faire et des principes qui structurent l’activité du maintien de l’ordre à la française.
Qu’est- ce que le maintien de l’ordre et par qui est – il réalisé ?
Une lente institutionnalisation
Le 14 juillet 1789 au matin, l’hôtel des Invalides fut pillé permettant aux révolutionnaires de récupérer près de trente mille fusils et une vingtaine de canons. Dans l’après-midi la Bastille,symbole de la forteresse du pouvoir monarchique est prise sans grande peine par la foule révolutionnaire. Ces évènements fondateurs de la Révolution française le sont également dans l’histoire plus restreinte du maintien de l’ordre. Il s’agit tout simplement de l’échec du pouvoir en place à protéger ses bâtiments publics, échec qui entraîna la chute du régime politique en place. L’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, promulguée le 26 août 1789, semble d’ailleurs en tirer les conséquences : « La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. »
Les prémisses du maintien de l’ordre apparaissent. Mais il faudra tout de même attendre plus d’un siècle, deux révolutions, l’insurrection de la Commune de Paris et plusieurs massacres tels que la fusillade de Fourmies le 1 er mai 1891 pour qu’une force spécialisée dans le maintien de l’ordre public voit le jour, en 1921. C’est au terme d’une « guerre de couloirs » menée par le haut corps d’armée que seront créés subrepticement les premiers pelotons de gendarmerie mobile. Leur lente institutionnalisation prit une forme effective au travers de l’instruction du 1er août 1930. Les principes furent posés et la maîtrise de soi, la dépersonnalisation des manifestants, des techniques d’intervention et une expertise de la foule furent inculqués aux gendarmes mobiles. L’idée n’est plus d’avoir des agents qui imposent une force supérieure à celle des manifestants pour rétablir l’ordre mais plutôt des professionnels doté d’un savoir-faire spécifique pour encadrer et repousser la foule.
Le 9 décembre 1944, au sortir de la Seconde Guerre mondiale et suite à la dissolution des groupes mobiles de réserve (GMR), force de maintien de l’ordre sous Vichy, les compagnies républicaines de sécurité (CRS) furent instituées par le Général De Gaulle, intégrant les collaborationnistes des GMR, de même que d’anciens résistants gaullistes et communistes.
De nos jours, deux forces sont spécialisées dans le maintien de l’ordre : une de la gendarmerie nationale (les escadrons de gendarmerie mobile) et l’autre de la police nationale (les compagnies républicaines de sécurité). Elles fonctionnent sur des schémas tactiques similaires et disposent d’équipements analogues. Elles ont la particularité de pouvoir intervenir en tout temps et sur l’ensemble du territoire national, bien qu’en pratique, les EGM s’occupent plutôt des zones rurales (ainsi que des territoires d’Outre-Mer) et les CRS des zones urbaines.
Toutes deux ont pour activité principale le maintien de l’ordre mais lorsqu’elles n’y sont pas affectées, elles participent généralement à des missions de Sécurité publique. Du reste, « les ‘‘forces de maintien de l’ordre’’ se définissent alors comme l’ensemble des groupes spécialisés dans l’usage d’un répertoire d’action spécifique, destiné à gérer les différentes formes de contestations sociales, syndicales et politiques, de telle sorte que leur propre désordre n’enclenche pas un désordre supérieur à celui qui est nécessaire pour encadrer les contestations tolérées. Ce qui renvoie, d’une part, à la capacité d’encadrer les conflits tolérés et, d’autre part, en cas de ‘’désordres’’ trop importants, à ramener les manifestants à l’ordre en distillant des procédés faiblement dolosifs ».
Le maintien de l’ordre : une pratique encadrée
L’encadrement juridique comme garantie d’un « maintien de l’ordre républicain »
Le maintien de l’ordre illustre cette idée que le cadre juridique, en plus d’être un appareilde régulation des conduites, peut apparaître comme un gage de professionnalisme. L’emploi de la force publique est régulé par les articles 431-3 du code pénal et les articles L. 211-9 et 10 du code de la sécurité intérieure. Limiter la force publique et la contraindre à un ensemble très rigoureux de dispositions symbolise une détermination à ne pas « abuser » de la position d’autorité que confère l’exercice du pouvoir politique et par extension la position de détenteur de la force physique étatique. Il nécessite ainsi quatre conditions pour employer cette force :
– la formation d’un attroupement.
– la décision d’une autorité habilitée de sa dissipation.
– la prononciation de deux sommations (par un représentant de l’État ou le préfet à Paris, le Maire, sauf à Paris, ou encore un officier de police judiciaire désigné par l’autorité habilité).
– la non-dissipation du rassemblement.
Les autorités habilitées sont le Préfet de département, le sous-préfet d’arrondissement du lieu où se déroule l’attroupement, le Maire ou l’un de ses adjoints (« qui ne figurent qu’a titre historique » d’après le décret du 9 août 2012), le directeur départemental de la Sécurité publique (ou cas particulier des directeurs de police aux frontières dans le cas d’attroupements sur les enceintes aéroportuaires), le commandement de groupement de la gendarmerie départementale, ou un mandaté par une autorité préfectorale (qui peuvent-être le commissaire de police, le chef de circonscription, ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale). Ces personnels peuvent, après sommation, décider de l’emploi de la force. Leurs instructions portent sur l’objectif à atteindre (la mission de dégagement d’une place par exemple) et les moyens à mettre en œuvre (c’est-à-dire qu’elle décide de quel emploi de la force sera utilisé : elle peut par exemple autoriser les moyens lanceurs d’eau et interdire l’usage de gaz lacrymogènes, même si ces ordres sont extrêmement rares). L’usage des armes à feu requiert l’ordre express de l’autorité habilitée qui doit être transmis de manière à ce qu’il soit traçable (enregistrement des échanges radios, ordre écrit, enregistrement vidéo, etc.).
Néanmoins l’exécution reste à l’appréciation du commandant de la force publique. Il y a une division technico-politique du travail entre le préfet, donneur d’ordre et le commandant de la force publique, chargé de la mettre en œuvre. Ainsi sont fixés les rôles : le préfet ordonne une mission générale (un dégagement de place par exemple) mais laisse au technicien le souci d’apprécier la manœuvre à suivre. Le directeur général de la gendarmerie nationale explique d’ailleurs aux parlementaires son attachement à cette séparation des tâches : « La question de la répartition des rôles entre préfet et commandant opérationnel est centrale. Les opérations se déroulent mal quand ces rôles ne sont pas précisément définis, quand le préfet se mêle de la conduite opérationnelle et quand le commandant, faute de directives claires de la part de l’autorité préfectorale pense qu’il peut aller plus loin qu’il ne devrait » . Le seul cas où les forces de l’ordre peuvent agir indépendamment de l’autorité civile (sur ordre du commandant de la force publique), et sans sommation, est « si des violences ou voies de fait sont exercées contre les forces de l’ordre ou que celles-ci ne peuvent défendre autrement le terrain qu’elles occupent » comme le mentionne les articles R. 211-17 et 211-19 du code de la sécurité intérieure.
Par ailleurs, il convient de souligner que le maintien de l’ordre revendique son affiliation républicaine notamment en raison de la recherche (en principe) de l a non escalade de la violence. C’est-à-dire que les forces de l’ordre ont l’obligation de retarder le plus possible l’usage de la force. La présence policière doit avant tout être dissuasive et surtout ne jamais ajouter de désordre supérieur à celui constaté. Le précepte est de montrer ses muscles sans s’en servir, afin de ne pas envenimer la situation : « M. Patrice Bergougnoux, préfet honoraire, a parfaitement résumé ce principe en assurant que ‘‘La règle d’or en matière de maintien de l’ordre est que la force doit se manifester sans s’exercer’’ » . La position de chercheur invite toutefois à questionner les différentes situations dans lesquels la force est employée. Une approche par l’évènement permettrait de vérifier si la désescalade est nécessairement recherchée dans n’importe quel contexte et face à n’importe quel groupe social. Bien que cette recherche ne traite pas spécifiquement de ce sujet, il est incontestable que certains groupes sociaux et politiques sont plus violemment réprimés que d’autre, notamment en raison de la défiance qu’ils peuvent susciter auprès des gouvernements et/ou des forces de l’ordre (c’est tout particulièrement le cas des mouvements politiques d’extrême gauche, ou des jeunes des quartiers populaires).
Par ailleurs, l’activité des forces de l’ordre est fortement dépendante de celles des protestataires. De sorte que le cadre juridique ne se suffit pas à lui-même pour assurer le « bon » déroulement d’une opération de maintien de l’ordre. Dès lors, l’institutionnalisation des désordres sociaux garantit une certaine prévisibilité dans le déroulement des opérations, et permet d’ajuster le mieux possible le niveau de violence ainsi que l’ensemble des pratiques policières à appliquer.
La manifestation : un cadre institutionnalisé
La manifestation est apparue depuis les années 1960 comme un moyen de revendication ordinaire pour bon nombre de groupes sociaux et d’organisations syndicales, politiques ou associatives. Olivier Filleule constate à ce propos qu’« en France, la manifestation est arrivée au terme d’un processus de naturalisation et de pacification qui la placerait au rang des pratiques conventionnelles de la participation politique. De manière générale, les manifestants coopèrent avec la police, s’assemblent sur le lieu prévu à l’avance, défilent le long d’un itinéraire négocié et se dispersent pacifiquement quel que soit le résultat de leur action ».
Cette institutionnalisation s’accompagne d’un dispositif législatif qui soumet les organisateurs à une déclaration préalable de leurs intentions. L’article L. 211-1 de la loi du 23 octobre 1935 oblige ainsi les manifestants à déclarer à la Mairie ou la Préfecture le but, le lieu, l’itinéraire, la date et les horaires du rassemblement et les groupes autorisés à y prendre part. Ce moment est aussi l’occasion pour l’autorité politique de mener un certain nombre de discussions et de négociations, permettant (entre-autre) d’aménager les conditions d’un maintien de l’ordre réussi. C’est-à-dire que certains endroits peuvent être interdits d’accès en raison par exemple de l’absence d’échappatoire ou d’artères capables de drainer suffisamment les foules si jamais l’opération policière se transforme en une situation de rétablissement de l’ordre . Cette disposition offre au pouvoir politique la possibilité de négocier avec des représentants d’un mouvement social. Les autorités publiques engagent préalablement un rapport de force largement en leur faveur, dans la mesure où ils reçoivent, sur leur terrain, dans les bureaux de la préfecture avec toute la violence symbolique qui s’ensuit, certains représentants de la contestation sociale. Ces derniers se trouvent confrontés à un aéropage de techniciens du maintien de l’ordre, de dépositaires du pouvoir politique et de la force publique. De fait, les conditions de l’interaction sont défavorables aux organisateurs qui souhaiteraient s’opposer à quelques-unes des injonctions préfectorales, dans la mesure où les ressources et le capital symbolique global sont plus importants du côté des représentants de l’État. Irrémédiablement, le maintien de l’ordre en tant que rapport de pouvoir s’exerçant entre des protestataires et les représentant de l’État se joue aussi lors de cette procédure de négociation, qui intervient en amont de la rue. Mais, la commission d’enquête parlementaire sur le maintien de l’ordre observe que « de plus en plus de manifestations n’ont pas d’organisateur déclaré en préfecture, et, parmi celles-ci, de plus en plus n’ont tout simplement pas d’organisateur » . La nondéclaration d’un rassemblement rend souvent ses organisateurs imperceptibles, ce qui annihile la possibilité de sanctionner les débordements et gêne également la possibilité de négocier en amont ou durant la manifestation.
Eléments pour une sociologie professionnelle des forces mobiles
Ce point est l’occasion de préciser certains éléments recueillis concernant la sociologie professionnelle des forces de l’ordre. Ici, l’on s’appuie essentiellement sur deux textes de Dominique Monjardet . L’objet n’étant pas de présenter ses travaux mais plutôt d’amener quelques éléments de réflexion, l’évocation de certains traits institutionnels ou sociologiques sera cursive, pouvant parfois laisser un sentiment d’inachèvement.
Avant toute chose, il est utile de préciser que le maintien de l’ordre dépend de la récurrence des mouvements protestataires et n’est généralement pas l’activité principale, en termes quantitatifs, exercée par les forces de l’ordre. Du reste, toutes les activités annexes sont subordonnées aux exigences de « disponibilité » et de « mobilité », ou autrement dit organisées de manière à ce que le maintien de l’ordre reste l’activité prioritaire. En cela, tous les autres travaux doivent pouvoir être stoppées immédiatement et sans dommages. Dominique Monjardet explique que l’immédiateté « exclut une continuité et une répétitivité de la tâche qui est une condition de l’apprentissage des tâches complexes », alors que l’autre condition « exclut que ces tâches soient pourvues d’un enjeu sérieux » (ce sont donc des tâches subalternes et assimilables souvent à de la simple présence tel que garde statique ou quadrillage d’une zone).
La formation des forces mobiles met plutôt l’accent sur l’apprentissage de gestes et techniques individuels et l’inculcation de la discipline. De surcroît, les activités annexes au maintien de l’ordre sont généralement peu gratifiantes et ne requérant que peu de savoir-faire spécifiques.
La publicisation d’une catégorie policière : les « violences urbaines »
Un discours sécuritaire sur la banlieue et ses habitants
En octobre 1997, lors d’un colloque à Villepinte organisé par le gouvernement de Lionel Jospin, une rupture s’instaura dans le débat classiquement jalonné entre une droite « sécuritaire » et une gauche à laquelle on pouvait grossièrement ajouter l’adjectif de « sociale ». Pour schématiser la situation discursive, les sympathisants de droite prônaient une logique répressive quant à la délinquance, alors que la gauche se voulait plus attentive aux causes sociales. Mais le Parti Socialiste s’appropriait dorénavant le thème de la sécurité auparavant laissé à la droite, en la qualifiant de « droit fondamental de la personne humaine ».
Depuis lors, un partage commun des plaidoyers sécuritaires s’est effectué entre la gauche incarnée par le PS, la droite par l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP) (maintenant les Républicains) et le Front National (FN). Laurent Mucchielli signale que dans ce contexte, « sur le plan médiatique, on assista dès 1998 à une ‘‘campagne de disqualification’’ visant les journaux qui soulignaient encore les causes sociales de ‘‘l’insécurité’’ et des ‘‘violences urbaines’’ ». Il ajoute le fait que s’est imposé « une pensée unique catastrophiste, expliquant que les choses vont toujours plus mal, que la délinquance ‘‘explose’’, que les délinquants sont ‘‘de plus en plus jeunes et de plus en plus violents’’, qu’ils n’ont plus aucune morale, que le chômage et les institutions n’y sont pour rien, que c’est la faute de parents ‘‘démissionnaires’’ et de juges ‘‘laxistes’’, qu’il faut donc ‘‘passer à autre chose’’ pour rétablir ‘‘enfin’’ l’ordre et la sécurité […]. Depuis 2002, c’est une véritable frénésie sécuritaire qui s’est emparée de nos gouvernants, et qui se déploie dans un empilement de lois venant réformer le droit et la procédure pénale tous les six mois en moyenne » . Le tournant de 1997 s’est ainsi amplifié avec la nomination de Nicolas Sarkozy au poste de ministre de l’Intérieur en 2002.
De la même manière, un lien politique et médiatique est construit entre immigration et délinquance. Éric Fassin rappelle que le 30 juillet 2010, le Président de la République « établit un lien direct entre immigration et délinquance » en déclarant : « Nous subissons les conséquences de cinquante années d’immigration insuffisamment régulée qui ont abouti à un échec de l’intégration ». On le comprend, la cible privilégiée des discours sur l’insécurité serait les jeunes issus de l’immigration, habitants des quartiers populaires et organisés en bandes. Marwan Mohammed propose de définir les bandes en tant que « des regroupements juvéniles, informels et durables, qui se distinguent par une dynamique transgressive et un rapport conflictuel avec leur environnement immédiat » . Les rapports que ces membres entretiennent avec le monde social se caractériseraient par la déviance et l’hostilité comme facteurs de cohésion sociale. Elles se forment au carrefour d’une exclusion sociale et spatiale, entre discriminations et désavantages sociaux (chômage, précarité, instabilité familiale, lieu de résidence excentré des principales zones d’activité, etc.). En constante tension avec les agents de socialisation que sont l’école et la famille, elles sont structurées par un ensemble de normes et de pratiques où de nombreux actes de déviance se trouvent valorisés. Elles offrent un cadre d’intégration et de valorisation sociale pour certains individus que ni l’État ni la famille ne sont en mesure de leur apporter. La question directrice de cette recherche n’étant pas d’analyser ni la formation, ni la composition et ni les logiques qui structurent le fonctionnement des bandes, l’on renvoie à la lecture de l’ouvrage de Marwan Mohammed intitulé La formation des bandes, (mobilisé comme pilier de réflexion à ce sujet). Il s’agit plutôt de montrer comment les bandes sont apparues comme la figure de la petite et moyenne délinquance face à laquelle l’action répressive doit se faire toujours plus pressante.
Genèse et évolution des violences urbaines
Le récit commun en matière de violences urbaines en situe les prémices à Vaux-enVelin en 1979. Puis en 1981, à Vénissieux, dans le quartier des Minguettes où des heurts entre policiers et jeunes de la cité furent fortement publicisés. Les médias découvraient les rodéos, les vols et les incendies de voitures. Ensuite, en 1983 et en 1987, de nouveaux affrontements avec la police éclatèrent dans cette même banlieue Lyonnaise. Puis de nouveau à Vaux-en Velin en 1990, 1992, 1994 et 1995, à Rouen et à La Courneuve en 1994, à La Duchère, quartier lyonnais, et à Dammarie-lès-Lys près de Melun en 1997, à Toulouse en 1998, à Montauban en 1999. La décennie suivante est également marquée par des incidents similaires avec Montbéliard en 2000, Nîmes en 2003, les émeutes de 2005 dans de nombreux endroits en France, Villiers-le-Bel en 2007, Saint-Étienne en 2009, Grenoble en 2010 ou encore Trappes en 2013. Cette Liste n’est absolument pas complète. Elle relate certains évènements qui ont pu faire l’objet d’un traitement médiatique national.
Il ne faut toutefois pas succomber à la tentation d’un récit linéaire qui identifierait une augmentation tendancielle des dérives urbaines. Laurent Bonelli le rappelle : « L’intérêt des pouvoirs publics pour les désordres urbains ne date pas, comme tend à l’accréditer une légende dorée, des rodéos automobiles de Vénissieux et des Minguettes, qui connurent une certaine publicité durant l’été 1981. L’hebdomadaire L’Express enquête par exemple en septembre 1973 sur les ‘‘petits durs qui terrorisent les ménagères, qui dévalisent les supermarchés et pillent les caves [parce qu’] ils s’ennuient. À en mourir’’ » . De même que chaque débordement mérite d’être considéré pour ce qu’il a de particulier, selon des situations géographique, sociale, politique et économique qui lui sont propres. Les phénomènes de « violences urbaines » trouvent leur genèse dans des contextes de pauvreté et de précarité sociale et économique. Ils sont l’émanation éruptive des rapports conflictuels entre policiers et jeunes des quartiers populaires. Ils surgissent souvent à la suite d’un contrôle d’identité , d’une arrestation, ou d’un fait plus marquant qui affecte l’univers collectif d’un quartier (blessure grave ou mort d’un habitant suite à une intervention policière par exemple). L’objet de cette démonstration ne nous permet pas d’avancer d’avantage sur ce terrain, c’est pourquoi l’on revoie à la lecture d’un article de Stéphane Beaud et Michel Pialoux : leur « démarche qui cherche, pour le dire vite, à relier étroitement ‘‘émeute urbaine’’ et processus de paupérisation-fragilisation-précarisation des classes populaires, invite à aller au-delà de cette perspective en menant des analyses en termes de contextualisation ».
Les policiers observés au SOP avaient tous cet acronyme collé à la bouche : les « VU »
Leur évocation faisait sens pour l’ensemble du groupe. Cependant l’expression est plus difficile à définir qu’elle n’y parait. Une insulte envers un policier est-ce une « violence urbaine » au même titre qu’un jet de cocktail Molotov sur une voiture de police ? Les violences commises hors des quartiers dits « sensibles » sont-elles labélisées « VU » ? Qu’en est-il de celles commises en ville par d’autres individus que les jeunes des quartiers populaires ? La liste des questionnements pourrait facilement s’allonger. Cette expression regorge de catégories floues : quelles violences ? Quels modes d’action ? Quels auteurs ? Quelles cibles ? Quels discours revendicatif ? Où ? Quand ? Et cætera. Pour les besoins de la démonstration, elles seront succinctement définies comme étant toutes sortes de violences physiques et de dégradations matérielles commises à l’encontre ou en présence d’agents de police par des jeunes issus des quartiers populaires. Cette définition englobe l’aspect relationnel de la violence (entre policiers et jeunes des quartiers populaires). Elle est cependant incomplète, mais il convient surtout de se concentrer sur la genèse de cette catégorie, son instrumentalisation et sa popularisation. La notion est initialement policière mais elle s’est rapidement imposée dans la sphère publique, notamment par l’intermédiaire des Renseignements généraux (RG) qui ont mis en place un indicateur dont la structure « prêt-à-penser » répondait à l’attente journalistique et politique.
Vers un style plus musclé de police d’ordre ?
Les lanceurs de balles de défense sont des moyens de neutralisation dans la mesure où ils engendrent l’incapacitation temporaire d’un individu. Ils permettent de frapper à distance les corps. Ils représentent en quelque sorte l’équivalent policier du projectile chez le manifestant, en plus puissant et avec plus de précision. Cependant, le principe de la non escalade de la violence est remis en cause avec cette arme qui s’axe directement sur la violence des manifestants. Il ne semble plus être question de faire redescendre la tension par le contrôle du niveau de violence global (violence policière et violence protestataire). Comme on l’a expliqué antérieurement, la stratégie des forces mobiles est de rester maître de la situation en contenant l’activité des protestataires de manière à ce que la violence ne puisse pas s’intensifier. Les policiers et gendarmes ne doivent pas, en théorie, agir en fonction du degré de force employé par les protestataires, mais s’efforcer de limiter les possibilités de son escalade par le contrôle de l’initiative. Plus simplement, le commandant de la force publique ne doit pas être dans la réaction, mais dans l’action préventive, s’il a pour but de d’empêcher l’élévation du niveau global de violence. Or, si l’usage des LBD ne contribue pas dans tous les cas à l’escalade de la violence, il ne concoure pas non plus à la recherche de l’apaisement, mais ambitionne plutôt à apporter une sanction adéquate. Cédric Moreau de Bellaing fait part de ce constat à la commission d’enquête parlementaire lorsqu’il aborde le discours officiel sur la mort de Rémi Fraisse : « J’ai été surpris car j’y ai décelé un changement de discours, symptôme d’un changement de doctrine. Ainsi, l’intensité de l’engagement des forces de maintien de l’ordre serait justifiée par l’intensité de la violence des protestataires, ce qui signifie que les services de maintien de l’ordre devraient caler le degré de force qu’ils engagent sur le niveau de violence des manifestants ».
|
Table des matières
Introduction
Objectivation de ma position de recherche
I. De la gestion individualisée des foules
Principes et évolutions tactiques du maintien de l’ordre
1. Qu’est-ce que le maintien de l’ordre et par qui est-il réalisé ?
2. Le maintien de l’ordre : une pratique encadrée
3. Prévision, mise à distance et continuité hiérarchique
4. Eléments pour une sociologie professionnelle des forces mobiles
5. Du maintien de l’ordre flouté, un savoir-faire floué ?
L’interpellation comme nouvelle rationalité du maintien de l’ordre
1. Le maintien de l’ordre dans son rapport à l’activité protestataire
2. Une nouvelle ère ? La judiciarisation du maintien de l’ordre ou comment passe-ton d’un travail de police d’ordre à un travail de police judiciaire ?
II. Une gestion particulière des « violences urbaines »
La problématique des « violences urbaines »
1. La publicisation d’une catégorie policière : les « violences urbaines »
2.Controverse interne et enjeux politiques de la gestion des « violences urbaines »
Des unités d’intervention contre les violences urbaines: les « mini-CRS » départementaux
1. Des policiers départementaux projetés dans les cités
2. Initiative policière et politisation de la fonction
Un style de police plus brutal dans les quartiers populaires
1. La logique de l’affrontement
2. Ce que les « violences urbaines » font au maintien de l’ordre
III. En quoi les lanceurs de balles de défense posent-il problème ?
Les violences urbaines comme variable de désajustement du MO : l’exemple des Lanceurs de balles de défense
1. Une approche sociologique par l’instrument : Ce que nous disent les lanceurs de balles de défense sur la police dans les quartiers populaires
2. Les lanceurs de balles de défense : symbole d’une convergence dans la gestion des foules ?
La critique externe des lanceurs de balles de défense : une analyse de la controverse publique
1. La construction sociale du statut de victime
2. Le statut des médias : entre arène publique et journalistes acteurs
3. Le « temps » des expertises
4. Une difficile mise à l’agenda politique
5. L’imperméabilité de l’institution policière
Conclusion
Bibliographie
Annexes
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet