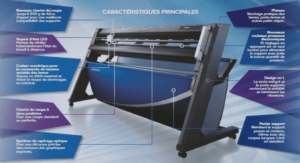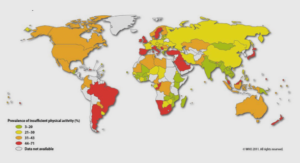Qu’est‐ ce que la « science communication » ?
Une tentative de définition
Définir la « science communication » ‐ la communication des sciences – en tant qu’activité académique est une question qui mériterait à elle‐seule un mémoire bibliographique, tant elle semble complexe.
Selon Terry BURNS, John O’CONNOR et Suzan STOCKLMAYER (2003), la « SciCom » est victime d’un malheureux manque de clarté car elle est « typiquement pensée comme l’activité de communicants professionnels (journalistes, attachés de relation publique, scientifiques…) ou, plus simplement, comme la promotion d’une science populaire », ce que laisse effectivement entrevoir le long extrait emprunté à Lars LINDBERG‐CHRISTENSEN (2006) que j’ai mis en prologue de ce chapitre. Dans cette optique, la communication des sciences serait l’ensemble des « procédés par lesquels la culture et les connaissances des scientifiques sont absorbés dans la culture d’une communauté plus large » (Chris BRYANT, 2003, cité par BURNS, O’CONNOR, & STOCKLMAYER, 2003).
Selon Suzanna HORNIG PRIEST (2010), la communication des sciences a d’abord émergé comme champ professionnel spécifique, appuyé sur un bagage académique conséquent puisqu’il s’agit de la science elle‐même. Cependant elle ne consiste pas uniquement à aider les scientifiques à diffuser leur travail, pas plus qu’elle n’est qu’une ramification spécialisée des Sciences de l’Information et de la Communication (BURNS et al., 2003 ; BUBELA et al., 2009 ; BUCCHI & TRENCH, 2010 ; HORNIG PRIEST, 2010).
Afin de tenter une réponse « académique », BURNS, O’CONNOR et STOCKLMAYER (2003) proposent déjà de considérer la terminologie elle‐même. On y traite en effet :
de communication : les chercheurs empruntent la définition de Tony SCHIRATO et Susan YELL, à savoir « une pratique de production et de négociation de sens, prenant place dans des contextes sociaux, culturels et politiques spécifiques ».
de science : les chercheurs proposent d’accepter que le terme comprenne les sciences de la nature, les sciences de l’homme et de la société, les mathématiques, l’ingénierie, la technologie, la médecine et les domaines associés.
La communication des sciences en tant qu’activité de recherche serait donc l’étude des pratiques de production et de négociation de sens, prenant place dans des contextes sociaux, culturels et politiques spécifiques, réalisés à propos des sciences et de leurs applications techniques, qu’il s’agisse des sciences de la nature, des sciences de l’homme et de la société, des sciences médicales, des mathématiques, des sciences du génie et de l’ingénierie.
Une profusion d’intitulés
Une des raisons qui rend difficile une définition bien sédentarisée tient au foisonnement de vocables qui circulent à son propos, attestant de la difficulté de percevoir les relations Baliser le terrain : Qu’est‐ ce que la « science communication » ? communicationnelles entre science et société (WOLTON, 1997) : en France, on parle de communication scientifique et technique, communication publique des sciences, publicisation scientifique, diffusion scientifique, vulgarisation scientifique, médiation scientifique, mise en culture des sciences, sciences en communication , etc. Le monde anglo‐saxon n’est apparemment pas épargné par cette profusion de termes (BURNS et al., 2003 ; BUCCHI & TRENCH, 2010) : science popularization, scientific communication, science communication, Public Awareness of Science , Public Understanding of Science, Public Communication of Science and Technology, Public Engagement in Science and Technology… BURNS, O’CONNOR et STOCKLMAYER (2003) insistent sur l’idée que ces terminologies ne sont pas interchangeables ; chacune propose de regarder la communication des sciences sous un angle spécifique. Ainsi, dans le monde anglo‐ saxon :
‐ Public Awareness of Science (reconnaissance publique des sciences) désigne l’ensemble des attitudes, opinions et intentions à l’égard des sciences. C’est à la fois une prise de conscience préliminaire et une forme d’adhésion aux préoccupations scientifiques.
‐ Public Understanding of Science (compréhension publique des sciences) désigne la compréhension des contenus, des méthodes, et des jeux sociaux mis en jeu dans les sciences.
‐ Scientific Literacy (lettrisme scientifique ou alphabétisme scientifique) est une expression dont les définitions multiples et floues correspondent globalement à un niveau idéal moyen de connaissances espérées du citoyen, permettant de construire des opinions sur des questions scientifiques, de prendre des décisions informées sur la base de raisonnements à partir de faits (on y reviendra plus loin dans le mémoire).
‐ Scientific Culture est également une expression fourre‐tout correspondant globalement à un ensemble de valeurs et de pratiques, constituant un terreau diffus, imprégnant la société, où la science est valorisée et appréciée per se (on y reviendra également).
‐ Science and Society : label utilisé pour désigner les interactions des deux sphères, pensées comme étroitement imbriquées mais ayant des intérêts différents.
Est‐ce une discipline ?
Selon BUCCHI et TRENCH (2010), il serait impropre de parler d’une discipline à part entière. Bien sûr la communication des sciences a développé depuis 20 à 30 ans un ensemble de travaux et d’enseignements spécialisés, théoriques et pratiques, basés sur un corpus de plus en plus conséquent. Néanmoins, ce corpus est significativement sous‐théorisé, le seul élément véritablement pérenne et appartenant en propre au domaine étant le modèle déficitaire – que cela soit d’ailleurs pour le supporter, le mettre en pratique ou le critiquer –. De nombreuses théories fleurissent, mais ont du mal à perdurer ; beaucoup de flou demeurent sur certains modèles et concepts ; trop de point commun avec d’autres domaines de recherche. Or pour BUCCHI et TRENCH (2010), les bonnes limites font les bons voisinages !
C’est sans doute parce que « la communication des sciences continue de porter les marques de ses origines comme entreprise de relation publique au service de corps scientifiques autoritaires » (Steve FULLER 2010, cité par BUCCHI & TRENCH, 2010), que ce champ d’activité et de recherche est considéré de manière aussi spécifique – alors que les questions traitées peuvent l’être par d’autres disciplines ou domaines, et plus particulièrement par les Sciences de l’Homme et de la Société (BUCCHI & TRENCH, 2010 ; HORNIG PRIEST, 2010) – mais aussi et surtout de manière aussi cruciale – le domaine étant annoncé en très forte croissance (BURNS et al., 2003 ; BUCCHI & TRENCH, 2010 ; CLAESSENS, 2011), très sollicité par une variété de plus en plus grande de commanditaires – scientifiques, institutions, industriels, interlocuteurs sociaux (BUBELA et al., 2009) – et réclamant constamment son autonomie, notamment pour y orienter des fonds de recherche (DUNWOODY, 2009 ; BUCCHI & TRENCH, 2010) –. Une autonomie réclamée au titre que l’augmentation significative des communications scientifiques et techniques dans la société et des problèmes qu’elle génère, nécessiterait des réponses spécifiques aux conséquences importantes (BUBELA et al., 2009 ; DUNWOODY, 2009).
Une demande d’autonomie qui reflèterait également l’origine de nombreux chercheurs – issus « historiquement » pour beaucoup des Sciences de la Nature –, chercheurs marqués par l’impératif de mieux communiquer leur activité et qui ont découvert grâce à celui‐ci des perspectives qu’ils ne connaissaient pas mais qui sont déjà fouillées par les sciences sociales (BUCCHI & TRENCH, 2010). Sharon DUNWOODY (2009) explique également cette autonomisation par le fait qu’aux Etats‐Unis, les Sciences de l’Information et de la Communication ne sont pas bien reconnues : les chercheurs travaillant sur la science en communication et sur le journalisme scientifique profitent alors de la légitimité offerte par les Sciences (sous‐entendues de la Nature) pour fonder leur propre légitimité. D’autre part, les informations scientifiques et techniques sont d’une telle complexité qu’elles font figure de « rats de laboratoire » privilégiés pour explorer les mécanismes de transformation et d’assimilation d’une information. Enfin, la science étant une des rares activités humaines qui a standardisé sa manière de dire ce qu’elle ne sait pas, elle mérite une attention particulière en ce qui concerne justement sa diffusion.
Le(s) domaine(s) de recherche
Comme l’indiquent BUCCHI et TRENCH (2010), la délimitation ne semble pas si difficile à opérer, de premier abord : les études s’intéresseraient aux communications entre communautés scientifiques, groupes d’intérêts, décisionnaires et publics variés. Sauf que très vite, il devient nécessaire de préciser les termes de ces communications : doit‐on inclure les communications entre scientifiques ? Ne s’intéresse‐t‐on qu’aux échanges entre scientifiques et non‐ scientifiques ? Considère‐t‐on les communications entre non‐scientifiques à propos des sciences et techniques ? L’enseignement doit‐il être intégré en tant que communication ou relève –t‐il d’autres disciplines comme la didactique ou la pédagogie ? A toutes ces questions, les réponses proposées sont affirmatives, à l’exclusion de la dernière, où HORNIG PRIEST (2010) propose d’exclure les communications faites au sein d’institutions scolaires ou universitaires.
Une autre difficulté majeure soulevée par BUCCHI et TRENCH (2010) est de savoir de quelles sciences on parle : savoirs uniquement ? leur mode de production ? leurs applications ? leurs conséquences ? les Sciences de l’Homme et de la Société sont‐elles également à inclure ? Là encore, la réponse est un très large oui, expliquant l’« immensité de thèmes abordés » (CLAESSENS, 2011) qui, comme on l’a vu, empiète largement sur des champs disciplinaires existants : sociologie, muséologie, écriture scientifique, journalisme, politique de la santé ou du risque… (BUBELA et al., 2009 ; BUCCHI & TRENCH, 2010 ; HORNIG PRIEST, 2010) « Une chose est au moins certaine : les discours portant sur les activités scientifiques sont de plus en plus nombreux, complexes et contradictoires ». L’étude des sciences en communication aurait ainsi pour fonction d’ « analyser les conditions de passage du discours scientifique vers le citoyen, dans un contexte marqué par l’omniprésence des discours scientifiques et le rôle croissant de la communication dans un espace public lui‐même ouvert et concurrentiel » (WOLTON, 1997).
Les « paradigmes historiques »
Dans le corpus, la communication publique des sciences, en tant que champ disciplinaire, est annoncée comme devant beaucoup à trois mouvements, trois traditions communicationnelles qui sont apparues successivement et dont les préoccupations respectives auraient laissé des traces profondes au sein mêmes des modèles (BAUER, ALLUM, & MILLER, 2007 ; SCHIELE, 2008 ; TRENCH, 2008 ; BROSSARD & LEWENSTEIN, 2010), ce qui m’oblige à les évoquer brièvement.
Le temps de l’alphabétisation scientifique (scientific literacy)
Durant cette période, qui n’a pas vraiment d’origine et se termine au milieu des années 1980, la communication des sciences est « hantée » par le souci de l’illettrisme scientifique, marqué par une double analogie (BAUER et al., 2007 ; SCHIELE, 2008) :
‐ La culture scientifique est comparable aux savoirs de base que sont lire, écrire compter (c’est pourquoi on préférera les termes d’alphabétisme ou de lettrisme scientifique, pour évoquer cette position).
‐ La culture scientifique est un pendant de la culture politique, c’est‐à‐dire la capacité à exercer en conscience sa citoyenneté.
Les efforts sont portés vers une meilleure intégration de la science en milieu scolaire, et l’encouragement des dispositifs de vulgarisation, afin de développer la culture scientifique de tout un chacun.
En matière de recherche, il s’agit principalement de savoir quel est le niveau de connaissance de la population, comment améliorer l’acquisition par le public de nouvelles connaissances scientifiques et techniques, quelles distorsions les dispositifs médiatiques introduisent‐ils en relayant l’information savante.
Autres fonctions
Ici, je répertorie d’autres fonctions trouvées dans le corpus. Je suis bien conscient qu’on pourra me reprocher de ne pas faire de certaines des fonctions de connaissance, ce qu’elles sont pour partie.
Communication
Parce qu’il fournit« d’une manière simple, un savoir qui demeurerait autrement compliqué ou ambigu » (WILLET, 1992) le modèle se révèle très utile pour la pédagogie ou la vulgarisation. Ici, modèle figuratif est utilisé pour « ne pas s’en tenir à la sécheresse d’une structure abstraite, pour en quelque sorte l’habiller, lui donner de la chair » (ASTOLFI & DROUIN, 1992). Ce qui importe alors, c’est sa fonction de communication.
Cette fonction de communication se manifeste également par la circulation des modèles au sein des communautés savantes (GODFREY‐SMITH, 2006).
Hybridation
Gérard FOUREZ (1996) rappelle que les modèles ou métaphores empruntant à d’autres disciplines peuvent enrichir – autant qu’ils peuvent immobiliser (on y reviendra) – un domaine de recherche : il donne à titre d’exemple le modèle du « programme » transplanté de l’informatique à la génétique. Franck VARENNE (2008) parle d’hybridation entre disciplines, où le modèle joue le rôle de médiateur de connaissances.
Mémorisation
Comme précisé plus tôt, parce qu’il condense les idées essentielles dans un artéfact, le modèle facilite la mémorisation (MUCCHIELLI, 2000). Mais il agit également comme une « mémoire‐ tampon, facilitant la coopération des chercheurs travaillant sur un même système‐cible, ce en leur fournissant un socle commun » (GODFREY‐SMITH, 2006).
Médiation
A ce propos, GIERE (1999) et VARENNE (2008) font référence à l’ouvrage édité par Marie MORGAN et Margaret MORRISON « Models as mediator » (1999) : les modèles y sont pensés comme des médiateurs, à savoir des agents autonomes opérant entre les données empiriques et la théorie.
Nous y reviendrons plus loin. Par ailleurs, signalé‐je déjà que nous entreverrons une autre vision de la médiation, en ce qui concerne la communication publique des sciences.
Mesure
DROUIN (1988) et WILLET (1992) indiquent que dans certains cas, les modèles permettent de réaliser des mesures (modélisations et simulations numériques). Mais de manière générale, ils contribuent à définir les paramètres à évaluer.
Normalisation
GANDOLFO (2009) parle à ce propos d’un établissement de règles unificatrices.
Organisation
La modélisation est un moyen d’organiser les faits observés autant qu’elle permet de structurer Baliser le terrain : La notion de « modèle » les relations entre concepts et données (WILLET, 1992).
Simulation
Pour BULLE (2005), la simulation consiste en l’association d’hypothèses descriptives et d’hypothèses explicatives, à des fins prédictives. La simulation est présentée selon VARENNE (2008) comme « le comble de la modélisation phénoménologique puisqu’elle ne rendrait compte que des performances visibles d’un système ». Toutefois GANDOLFO (2009) insiste : la simulation cherche à faire apparaître comme réel quelque chose qui ne l’est pas. On procède à une substitution qui présente quelques problèmes caractéristiques, sur lesquels je reviendrai plus loin.
Visualisation
Pascal NOUVEL (2002a) rapporte que, pour Jean PERRIN, « la science consiste à expliquer du visible compliqué par de l’invisible simple ». Le modèle scientifique servirait, dans cette optique, à « rendre des abstractions visibles » (GILBERT, 2004), c’est‐à‐dire créer une visibilité du théorique à travers une figuration, quelle qu’elle soit (UTAKER, 2002).
Facilitation
Pour Franck VARENNE (2008), la fonction principale du modèle en sciences est celle de facilitation, qui seule peut permettre aux autres de se réaliser. C’est‐à‐dire :
Faciliter l’accès : rendre sensible, rendre mémorisable.
Faciliter l’intellection : condenser l’information, clarifier la sélection / la classification, réaliser une illustration.
Faciliter la reproduction.
Faciliter la théorisation : élaborer des théories, interpréter, valider, hybrider.
Faciliter la communication : élaborer des traductions, faciliter la discussion et la concertation.
Faciliter l’action : contribuer à la prise de décision.
Loi, théorie, modèle
Les positions divergent de manière significative sur leur statut épistémologique respectif.
Le modèle, comme exploration de la théorie
Pour le logicien Patrick SUPPES, cité par GIERE (1999), une théorie est une entité linguistique consistant en un ensemble d’axiomes – ASTOLFI et DROUIN (1992) parlent d’un « cortège de lois » ‐. Un modèle est une entité non linguistique qui satisfait plus ou moins la théorie, à savoir un ensemble d’objets liés par des propriétés, relations, fonctions qui dépasse l’ensemble des objets. De ce fait, puisque dans la théorie, les axiomes sont considérés comme vrais, le modèle constitue une interprétation d’axiomes non élucidés.
La théorie généralise le modèle / le modèle concrétise la théorie
Dans le corpus étudié, la question du rapport entre le réel et le construit intellectuel se manifeste souvent par la dualité modèle / théorie. Ainsi, selon Andrée TIBERGHIEN, cité par MARCHIVE Baliser le terrain : La notion de « modèle » (2008) « si la théorie est une fiction, le modèle est une figuration ».
La théorie est alors envisagée comme un enchaînement de propositions interdépendantes, possédant un haut degré d’abstraction et permettant de formuler des hypothèses.
Le modèle apparaîtrait, lui, comme une « théorie particularisée » (MATHIOT, 2002), à savoir une concrétisation de la théorie, appliquée à un contexte donné (WILLET, 1992) ou l’expression des conditions spécifiques d’une théorie dans un réel donné (MARCHIVE, 2008).
On peut concevoir également cette mise en opposition en termes « quantitatif » : une théorie serait un modèle solide, ayant acquis un haut degré de généralité, donc applicables à un nombre plus important de circonstances. Les modèles sont alors vus soit comme des compléments de la théorie, des cas localisés, contextualisés, soit comme des simplifications de théorie, permettant de développer une vue d’ensemble plus accessible (FRIGG & HARTMANN, 2012).
« En définitive, un modèle sélectionne beaucoup mais généralise peu, tandis qu’une théorie sélectionne peu mais généralise beaucoup » (CAVERNI, BASTIEN, MENDELSOHN, & TIBERGHIEN, 1988, cités par MARCHIVE, 2003).
Le souci d’efficacité
Pour FOUREZ (1996), la vérification d’un modèle ne se pose pas en termes de « vrai » ou « faux » mais en termes de satisfaction : est‐il jugé utile, pertinent dans le contexte où il est employé ? « Dans cette optique, on ne se pose plus la question de savoir si les modèles sont vrais, mais on s’intéresse simplement à leur efficacité dans un cadre de pensée. Pour reprendre un mot de Ernst MACH, on s’intéresse à l’économie de pensée qu’ils vont nous permettre ». Le philosophe rappelle à cet effet que, dans la recherche scientifique, le plus intéressant n’est pas tant de valider ou de rejeter un modèle que de déterminer ses limites, c’est‐à‐dire – en employant une terminologie poppérienne – de voir comment le modèle sonne « faux ».
D’autre part, les modèles sont des « technologies intellectuelles » qui, comme toute technologie, sont liées à des institutions sociales et à des projets. Tout comme certaines technique anciennes peuvent garder un intérêt dans certains contextes – même si d’autres, plus efficaces, sont apparues – les modèles ne se remplacent pas nécessairement (FOUREZ, 1996). L’histoire des sciences fait même apparaître que plusieurs modèles peuvent cohabiter et se compléter, à l’exemple des modèles ondulatoires et corpusculaires de la lumière : « ce qui compte, ce n’est plus la fidélité à un hypothétique réel en soi, mais l’efficacité descriptive, explicative ou prédictive d’un modèle » (DROUIN, 1988).
Toutefois, FOUREZ (1996) reconnaît que, dans la pratique, on cautionne ou on abandonne un modèle pour des raisons complexes qui ne sont jamais totalement rationnelles : « il y a toujours une décision plus ou moins « volontariste » et non nécessaire ».
Baliser le terrain : La notion de « modèle »
La nécessité de contextualiser le modèle
Selon SENSEVY et SANTINI (2006), une « relation de dépendance » interdit de penser tout modèle donné hors de son domaine d’application : « si les lois scientifiques produisent des capacités, c’est‐à‐dire qui des comportements hautement variés, les modèles proposent des dispositions, c’est‐à‐dire des comportements liés à des manifestions uniques. »
De manière générale, les modèles ne fonctionnent pas hors de tout contexte. Ce sont même ces contextes qui leur donnent sens (FOUREZ, 1996). Or « en sciences humaines et en communication, les penseurs, les chercheurs et les praticiens sont partie intégrantes du contexte global dans lequel ils vivent » (WILLET, 1992). On ne peut donc détacher les modèles des conditions dans lesquels ils sont construits, comme on ne peut les détacher des choix théoriques qui sont fait en amont (MARCHIVE, 2003).
La question épistémologique et paradigmatique
« Les problèmes posés par les modèles renvoie toujours à ce que veut dire expliquer pour la science de telle époque » (Suzanne BACHELARD, citée par ORANGE (1994). En effet, tout modèle s’inscrit indubitablement dans un contexte sociétal, marquée par une actualité ou une histoire, qui oriente inévitablement la manière dont le modèle est construit ou est interprété (WILLET, 1992 ; MUCCHIELLI, 2000). Relier la production des modèles théoriques à une histoire, à des courants de pensée permet là encore d’en apprécier le sens : « insister sur le lien des modèles scientifiques avec des projets humains, ce n’est pas les réduire à un instrumentalisme utilitaire, mais les lier à l’histoire humaineet à une culture essayant de se représenter ses possibilités » (FOUREZ, 1996).
Risques et précautions à prendre
Parce que « le modèle est à la fois plus et moins que ce que le modélisateur a voulu y mettre » , il est intrinsèquement chargé d’ambiguïtés. Le bon usage d’un modèle nécessite donc la « reconnaissance préalable de son ambigüité » (LE MOIGNE, 1987).
Le risque de subjectivité
Pour WILLET (1992), l’un des tout premiers risques consiste à « développer une admiration immodérée pour un modèle dans lequel on a investi beaucoup d’effort, de spéculation et de formalisation ». Il insiste : aucun modèle n’est sacré ; ce sont des outils provisoires. Pour MARCHIVE (2003), il est nécessaire de s’interroger constamment sur le degré d’objectivité du modèle – il existe en effet un mythe du modèle « neutre » – et le degré de subjectivité du modélisateur – c’est‐à‐dire dépasser le mythe de l’impartialité du scientifique – : « souvent, les modèles comportent des suppositions, des hypothèses, des croyances et des valeurs cachées. Il est donc important de toujours chercher à saisir les intentions, les motifs et les objectifs de l’auteur d’un modèle afin de pouvoir en évaluer correctement le contenu » (WILLET, 1992).
Le risque de l’usage
Pour MARCHIVE (2003), la question essentielle concerne celle de l’usage du modèle, c’est‐à‐dire la relation entre connaissance et action : connaissance de l’action et/ou pour l’action.
En effet, les modèles peuvent être aussi dangereux que l’atome ou la voiture, si l’on manque de précaution et de circonspection (WILLET, 1992) : ils courent le risque de devenir des « mythes que nous utilisons dans nos transactions et nos relations avec d’autres personnes et avec nous‐ mêmes pour justifier ce que le bon sens considère comme inacceptable ». Tout comme il est nécessaire de ne pas promouvoir un modèle comme détenteur de tout le sens d’une théorie, il est nécessaire d’être conscient du risque d’« exemplifier » le modèle pour transformer le réel : « voir dans le modèle un moment de toute théorisation est ce qui interdit précisément d’en faire une méthode » (MATHIOT, 2002).
VARENNE (2008) appelle à la prudence lorsque les modèles contribuent à une prise de décision.
En effet, parce que les modèles se présentent comme « représentationnels », ils entretiennent l’illusion d’une prise de distance objective, alors qu’ils peuvent s’auto‐réaliser : dans ce cas, la prise de décision court le risque de provoquer justement ce que le modèle décrit.
Le risque d’ontologisation
Selon DROUIN (1988), « le modèle marque une plus grande volonté d’établir une distance entre discours scientifique et réalité. […] Le modèle s’avouerait plus volontiers et plus ouvertement comme un artéfact, comme une interprétation plausible de la réalité sans en être une traduction fidèle ». Il éviterait ainsi de confondre le discours scientifique avec la réalité. Pourtant – comme le rappelle Suzanne BACHELARD, citée par ORANGE (1994) – « si l’on ne considère pas le modèle pour soi, on lui demande de fonctionner par soi, comme dans un automatisme auquel provisoirement nous ne serions pas mêlés ». Un modèle n’est donc pas qu’un analogon : c’est un objet à part entière qui possède une forte indépendance ontologique pour l’utilisateur (VARENNE, 2008). En effet, comme le rappelait UTAKER (2002), tout modèle produit des effets réels sur la recherche. Il n’est donc pas qu’une possibilité. Il est une réalité. Il possède « une existence propre » (GILBERT, 2004) qui amène à des « glissements » (GODFREY‐SMITH, 2006).
Ainsi, Jean MATHIOT (2002) rapporte que, souvent, en sciences, l’on fait fonctionner le modèle comme une théorie particularisée, à laquelle on assigne des valeurs hypothétiques, puis que l’on calque sur le réel : le modèle se présente alors comme une « fiction organisée » où au lieu de constater la nécessité d’inventer de nouvelles solutions en cas de désaccord avec le monde empirique, on modifie les seules variables du modèle artificiellement, ce qui risque de conforter le formalisme du modèle. Dans ce cas, « le modèle ne relativise pas les interprétations mais au contraire ontologise les objets de la théorie ». Le réel devient alors une « manifestation particulière du modèle », situation pour le moins paradoxale. Pour GODFREY‐SMITH (2006), les modèles sont trop souvent pensés comme des « imagined concrete things », c’est‐à‐dire des objets qui auraient toute légitimité à exister si les êtres hypothétiques qu’ils décrivent étaient réels. L’auteur rappelle avec malice que, malgré tout le talent du philologue John Ronald Reuel TOLKIEN à donner une langue et une culture à ses elfes – Baliser le terrain : La notion de « modèle » donnant à son ouvrage « Le Seigneur des Anneaux » un aspect réaliste – la Terre du Milieu, véritable modèle de monde développé par son auteur pendant ses travaux philologiques, n’existe pas ! GODFREY‐SMITH insiste sur le risque qu’il y a à explorer des « systèmes fictionnels » suffisamment intéressants pour être étudiés per se. Les chercheurs doivent donc veiller à ne pas oublier l’approche naturaliste de la science, et le côté pittoresque (picturesque en anglais) – c’est‐à‐dire frappant, séduisant – que recèle tout modèle.
Pour VARENNE (2008), la perte du réel est un risque incontestable mais, plutôt que d’opposer les modèles – en particulier les simulations ‐ au réel, il serait plus pertinent d’opposer le « mauvais » virtuel au « bon » virtuel : les frontières sont relatives aux objectifs fixés.
|
Table des matières
Le projet de mémoire bibliographique
Avant‐propos
La démarche de recherche bibliographique
Baliser le terrain
Qu’est‐ ce que la « science communication » ?
Bibliographie
La notion de « modèle »
Bibliographie
Points d’attention à explorer, à propos des modèles en communication des sciences
Explorer les modèles de communication publique des sciences
Les questions posées au corpus
Modèles et paradigmes
Modèles « institutionnels »
Modèles de médiation
Modèles médiatiques
Modèles épistémologiques
Modèles culturels
Modèles « publicitaires »
Modèles pédagogiques
Questions complémentaires soulevées par le corpus
Bibliographie
Commentaires conclusifs
Postface
Table des matières
Table des illustrations
Annexe