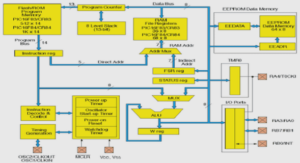L’ETUDE DE CAS PERME T D’ASSURER LA PROBL EMATISATION DE L’OBJ ET DE LA SEQUENCE
LE QUESTIONNEMENT, B ASE DU TRAVAIL DE L’ HISTORIEN
La problématisation est au cœur de notre discipline ; elle est au cœur de l’enseignement de l’histoire : ne demande-t-on pas, dès le bac, que la dissertation réponde à une « problématique » ? Pourtant « problématiser » une question est loin d’être évident : il ne s’agit justement pas de simplement « questionner » mais de mettre en avant la complexité d’un raisonnement. Chez les historiens, la question est centrale, elle « déclenche » l’étude.
L’histoire n’est pas le passé : les études historiques ne sont que des réponses aux questions que les historiens ont bien voulu se poser sur le passé. Un fait du passé ne devient un fait historique qu’une fois que le chercheur s’y intéresse, pour les explications que l’étude de ce fait nous donne sur la société de l’époque. On pourrait presque dire que finalement aujourd’hui, toute étude historique peut être considérée comme une « étude de cas » : l’historien va montrer les particularités de son sujet, permettant de répondre à sa question de départ. Cette question est un problème, en ce sens qu’elle est complexe et demande pour qu’on y réponde la compréhension de processus, de concepts.
Antoine Prost nous renseigne davantage sur cette question de l’historien : il précise qu’elle n’est jamais une « simple question » car elle suppose dès le moment où elle est posée d’avoir des connaissances sur le sujet : l’historien sait, en posant sa question, qu’elle est intéressante, par ses connaissances en la matière. Il parait alors difficile de demander à un élève de poser une question historique : « Il faut déjà être historien pour pouvoir poser une question historique » nous prévient-il. Une fois la question posée, c’est tout un panel de possibles qui se lève. La question est donc indissociable du document en histoire. Il ne peut alors y avoir de problématique valable pour un cours magistral, qui se voudrait un récit du passé, sans jamais être étayés de documents autrement que pour « illustrer ». Qui dit problématique dit étude critique.
LA PROBLEMATISATION ESSENTIELLE POUR EVI TER L’ETUDE POUR L’E TUDE
Ces explications m’amènent à deux observations concernant la problématique : la première est qu’un cours ne peut être problématisé que s’il propose une étude de document. La seconde est que l’étude de document n’est fructueuse pour l’élève que si elle est précédée d’une problématisation. Cela, je l’ai constaté en classe cette année à l’occasion d’une étude de document dont la mise en perspective n’a pas été satisfaisante.
DE L’IMPORTANCE DES REPRESENTATIONS DANS L’ELABORATION DE LA PROBLEMATIQUE… ET DE L’ETUDE DE CAS
Professeur contractuelle sur deux classes cette année, j’ai en quelque sorte eu le loisir pour les besoins de mes recherches de voir en celles-ci un « laboratoire » pour questionner l’étude de cas. Pour la préparation de mes séquences, j’ai eu à faire face à un obstacle : je n’arrivais pas à « trouver » le cas, autrement dit une étude que je puisse utiliser dans ma pratique professionnelle pour « tester » en classe l’apprentissage par l’étude de cas. Ma logique était simple : identifier les séquences à travailler avec les élèves, définir laquelle serait le plus propice à une étude de cas et dès lors trouver des documents, une problématique, ou plus largement une « entrée » permettant d’aborder cette question sous l’angle de l’étude de cas. Je me posais alors la question suivante : « quelle type d’objet historique est le plus à même d’être traité par le biais de l’étude de cas ? » et je me trouvais dans une impasse.
Pour l’historien, le cas est l’exception à la norme. Cela suppose donc, pour être étudié le plus utilement possible, que la norme soit bien connue. Or cela n’est pas possible avec les élèves : ils ne sont pas historiens, ils ne disposeraient donc pas des connaissances de « base » susceptibles de leur permettre de prendre conscience du caractère exceptionnel du cas proposé. Cependant, la formation à l’ESPE, notamment en didactique, m’a permis de prendre conscience d’un élément central, pour mes recherches comme pour mon métier : les élèves ne sont pas « vides » de savoir. Ils ont des « idées », des « opinions » sur à peu près tout, à partir du moment où on leur pose une question. C’est ce qui les didacticiens nomment « représentations ». Je décide alors de faire le point sur cette question des représentations, avant d’envisager dans quelle mesure cela peut être utile à l’élaboration de la problématique.
QUELLE PRISE E N COMPTE DES REPRESE NTATIONS DANS LES DI DACTIQUES ?
Aborder la question des représentations est devenu un « classique » des didactiques. Il est acquis maintenant pour tous – du moins sur le papier – que l’élève n’est pas une « tête vide » et que pour qu’un enseignement soit « utile » il faut dans un premier temps faire le tour des idées que l’élève a de la thématique envisagée.
Une première vision des représentations, et de ce qu’il faut en faire, est apportée par Gaston Bachelard, épistémologue qui s’est intéressé aux rapports entre imagination et savoir. Les représentations relèvent alors de « l’imaginaire ». En apportant le savoir, le scientifique « détruit » ces représentations. Des explications scientifiques vont alors « remplacer » des opinions (Vincent, 2013). Mais cette vision un peu manichéenne n’est finalement pas celle retenue par les didacticiens qui préfèrent à la notion de « remplacement » celle de « transformation ». Un des objectifs de l’enseignement est alors de faire prendre conscience à l’élève que ce que l’on appelle les représentations, qu’il aura exprimé comme un savoir, ne sont en fait qu’une « opinion » née d’une « impression » exprimée, qu’il ne faut pas confondre avec un « savoir » né d’un raisonnement. On peut entendre par l’expression « faire bouger les représentations » une translation de lieu dans l’intellect de l’élève (Goubet, 2013). Il s’agirait de réussir à ce que l’élève face la distinction dans son esprit entre ce qui est opinion (relié à l’affect) et ce qui est savoir (relié à la raison).
Concrètement, comment sont analysées ces représentations, quel usage peut-on en faire dans l’enseignement ? La didactique des sciences me permet d’en savoir plus sur le sujet, notamment un article de Christian ORANGE et Danièle ORANGE RAVACHOL qui fait le tour de la question (Orange, 2013). La notion de représentation apparait dès les années 1970, d’abord sous le terme de « concept obstacle » qui renvoi alors aux opinions de l’élève qui font barrage à l’appropriation du savoir. Les représentations sont définies comme les constructions intellectuelles de l’enfant ayant une fonction de modèle. Ces constructions sont nommées des « préconcepts ». Ces représentations sont considérées comme des obstacles épistémologiques, elles sont le fruit d’un construit social qui prend en compte des croyances plus que des raisonnements. Ne se situant pas sur le même niveau que le savoir scientifique, les deux vont entrer en conflit : un raisonnement peut remplacer un autre raisonnement, mais un raisonnement peut difficilement entamer une croyance : celui qui veut croire ne va pas s’approprier la méthode de raisonnement et le savoir scientifique va « glisser » sur lui sans jamais être intégré. On comprend alors pourquoi c’est en didactique des sciences que la question des représentations a été traité prioritairement : il ne peut y avoir de sciences sans raisonnement.
Dans les années 80 les didacticiens anglo-saxons s’interrogent sur la façon dont on peut faire bouger les « conceptions ». Ils en arrivent à la conclusion que pour être modifiées, les conceptions de départ doivent devenir insatisfaisantes pour l’élève et qu’une autre conception plausible soit disponible. Ce qu’il est important de comprendre ici, c’est que l’apprentissage ne se fait pas à partir de rien, puisque l’élève a déjà des façons de penser les questions scientifiques, même lorsqu’il ne s’agit pas de raisonnement mais simplement d’opinions. L’enseignement a donc pour objectif n’ont pas seulement d’apporter des connaissances, mais aussi de changer les conceptions des élèves pour faire prévaloir le raisonnement scientifique à l’opinion. Cependant ce changement de conception rencontre des résistances, car les représentations sont dans une certaine mesure efficaces et cohérentes.
Analyse de pratique : Une représentation erronée
Cela me fait penser à une expérience vécue en classe : en cinquième, une thématique concerne « la modernité », c’est-à-dire – entre autre – la question d’un nouveau rapport au monde aux XVᵉ et XVIᵉ siècles. Je demande aux élèves ce qu’ils connaissent de cette époque: « Que s’est-il passé entre la fin du Moyen-Âge et la Révolution française ? ». Les réponses sont donc fort variées ; plusieurs retiennent mon attention. Une élève a écrit « les gens pensent que la terre est plate, que la terre est le centre de l’univers ». A l’occasion de la séance suivante, qui porte sur les « Grandes découvertes », nous étudions une carte faisant figurer le voyage de Magellan. Cette carte est aussi l’occasion de revenir sur la découverte de l’Amérique (puisqu’elle apparait partiellement sur cette carte qui date du milieu du XVIᵉ siècle). Donc les élèves expliquent que si l’Amérique est sur cette carte, c’est parce qu’avant le voyage de Magellan, Christophe Colomb a découvert l’Amérique, « et prouvé que la terre était ronde ». Cette idée, reprise ici, n’est pas un savoir scientifique, mais une opinion, c’est bien une représentation que les élèves formule pour expliquer en quoi le voyage de Colomb est novateur et important : on le retient pour l’Amérique et parce qu’il prouve que la terre est ronde. Je demande alors aux élèves pourquoi ils disent cela : « qu’est-ce qui vous fait dire qu’on pensait à l’époque que la terre est ronde » ? La première réponse qui vient est « qu’on leur a dit ça », une élève ajoute que c’est son instituteur qui lui a dit. Cela me donne une information importante sur les représentations : elles sont parfois considérées comme des savoirs, à partir du moment où elles ont déjà été exprimées et validées par une communauté (famille, classe antérieure, etc.). Il parait assez simple de mettre à mal cette représentation. Je présente aux élèves une projection d’un globe datant de 1491 en leur demandant de m’expliquer pourquoi un globe existe si on ignore que la terre est ronde. Cela suffit à mettre à mal la représentation puisqu’un élément vient attester qu’elle est fausse. Nous passons un certain temps à analyser ce globe (plus petit, absence de l’Amérique) pour montrer qu’il est en accord avec les croyances de son temps. A la fin, il est clair pour tout le monde que la terre était considérée comme ronde à l’époque : le globe a permis de prouver qu’il y avait erreur. Encore faut-il s’assurer que l’information est intégrée : à la question « pourquoi les rois s’opposent au départ à financer le voyage » puisqu’on ne peut plus répondre : « parce qu’ils pensent que le voyage est impossible car la terre est plate », il faut pouvoir apporter une autre réponse que les élèves ont trouvé grâce à l’étude du globe qui montre une vaste étendue d’eau entre l’Europe et l’Asie : « parce que si on ignore que l’Amérique est au milieu, le voyage est trop long pour que des hommes puissent survivre aussi longtemps en mer ».Une élève intervient pour exprimer son inquiétude au sujet des contradictions entre ce qu’elle savait et ce qu’elle apprend alors : « pourquoi mon instituteur m’a dit quelque chose de faux ? ». Sans savoir si oui ou non un instituteur a pu faire l’erreur, cela me conduit en tout cas à prendre conscience que les représentations des élèves sont complexes en ce qu’il n’y a en réalité pas seulement une confrontation entre l’opinion de l’élève et le savoir du professeur, mais que l’opinion de l’élève a déjà pu être confirmé par d’autres opinions extérieures qui ont valeur de savoir pour l’élève, ce qui rend certaines conceptions d’autant plus difficiles à modifier. Dès lors l’étude d’un « cas » permet peut être de mieux délimiter les représentations à « faire bouger » afin de ne pas se retrouver « noyé » par l’importance des opinions que l’élève a déjà sur nombreuses thématiques.
Si je comprends les théories des didacticiens concernant les représentations, je prends également la mesure de certains risques qu’il peut y avoir à « faire ressortir les représentations » des élèves : il faut vraiment savoir de quoi l’on parle. Christian et Danièle Orange mettent en avant un risque de « réification » des représentations, c’est-à-dire d’en faire « une chose » un élément tangible précisément identifiable. Que faut-il entendre par là ? D’abord, une des erreurs des enseignants est de confondre « représentation » et « expression de la représentation ». Tout comme l’écrit de l’historien n’est pas « le passé » mais une « représentation du passé », l’explication orale, écrite, gestuelle de l’élève n’est pas une représentation mais une expression des représentations. Ce n’est pas une « donnée brute », une « traduction transparente » de la pensée de l’élève. Il convient donc de les mettre à distance. Cette confusion est peut être liée au terme même de représentation qui associe représentation mentale (donc la conception) et représentation physique de cette représentation (donc l’expression physique de la conception). La seconde erreur faite par les enseignants est de penser que les représentations existent telles quelles avant la situation qui conduit l’élève à les construire en réalisant la production. Parfois, la question qui va donner lieu à l’expression de la représentation est pour l’élève la première occasion de s’exprimer sur le sujet, surtout dans les classes de 6 e ou de 5 e . Dès lors, la représentation « se construit » en même temps qu’elle s’exprime. « On se figure qu’elles préexistent dans l’esprit de l’élève avant même tout questionnement, alors qu’il est psychologiquement plus exact de penser qu’elles résultent d’une construction en situation comme réponse à un questionnement provoqué par la situation didactique. » (Orange, 2013).
Un autre problème est de ne pas poser les « bonnes questions » : faire ressortir les représentations implique d’avoir posé une question, ou donné une consigne. Or, pour être épistémologiquement valable, la représentation doit être une explication d’un phénomène et non la simple représentation du phénomène (« dessine un volcan »; « tu manges du pain et de l’eau, dis ce qu’ils deviennent dans ton corps »). Sinon, la réponse ne permet pas d’appréhender le mode de raisonnement de l’élève, simplement s’il a ou non une connaissance. Or c’est à ce mode de raisonnement que se rattache la représentation, c’est lui qu’il convient de « faire bouger ». Pour Christian Orange, faire travailler les élèves sur les représentations ne doit pas avoir uniquement pour but de les rapprocher des solutions des scientifiques mais aussi de leur faire clarifier « les différents registres qu’ils mobilisent » c’est à dire rechercher les explications de leur représentation. Il ne convient pas seulement de connaitre le phénomène, mais d’avoir exploré le « champ des possibles », d’avoir soumis les hypothèses à la critique (voir à ce sujet plus haut le tableau de Chalak). Il reste à définir didactiquement quelle pourrait être « la communauté scientifique scolaire » qui serait le cadre de cette critique. Elle est composée des élèves, du groupe-classe mais aussi des documents venant de l’extérieur à la classe (manuel, récit du professeur). Ainsi, si l’on prend pour référence les réflexions de Christian et Danièle Orange, le travail des représentations change de fonction: on ne travaille pas les représentations pour les changer, mais on travaille les représentations pour identifier les raisons qui les sous-tendent. On délimite ainsi le champ des possibles par l’explicitation puis l’étude critique des représentations. Ainsi, si les raisons expliquant les représentations sont rejetées par le groupe classe avec arguments à l’appui (on revient encore une fois à l’idée du tableau de Chalak), cela finit par modifier les représentations. Je reproduis ici le tableau de Christian Orange permettant de mieux appréhender la différence entre les deux situations didactiques envisagées pour « faire bouger » les représentations.
CE QUI FAIT CAS POUR L’ELEVE, C’EST CE QU I VA A L’ENCONTRE DE SES REPRESENTATIONS
Le cas de l’élève est différent du cas de l’historien. Le cas de l’historien est la trace historique qui apparait extraordinaire, anormale au regard de ce qu’il sait. Le cas pour l’élève est un fait qui apparait anormal au vu de ses représentations, avec pour objectif de l’amener à expliciter ses représentations et à les modifier.
J’ai remarqué qu’une question purement historique bloque parfois les élèves car ils sont souvent convaincus qu’ils ne savent rien (c’est d’ailleurs déjà une représentation qu’il conviendrait de bousculer). Ils refusent parfois tout simplement d’exprimer leur opinion considérant qu’ils n’en ont pas sur un sujet qu’ils jugent « trop pointu » voir peut être « inintéressant ». Il faut garder en tête que l’historien a choisi son cas, il n’en va pas de même pour l’élève auquel les thématiques historiques sont imposées. J’ai envisagé une autre piste : en imaginant de lier passé et présent, il est possible d’utiliser une représentation générale qui touche aussi au présent, pour la confronter ensuite avec uneaffirmation contraire prise dans l’étude d’un objet historique, qui constituerait le cas.
Analyse de pratique : le « cas » Lucie Baud.
On pourrait partit de l’idée suivante : « grâce aux progrès techniques et technologiques, les conditions de vie et de travail sont de plus en plus faciles ». Il est probable que les élèves aient ce type de représentation en tête. Il ne s’agit pas d’une représentation erronée, mais incomplète, ou en tout cas qui demande à être explicitée. J’ai travaillé sur cette thématique avec des élèves de quatrième dont la séquence portait sur l’industrialisation.
LE CAS COMME BIAIS D ’UNE CONCEPTUALISATION
Si l’on prend note de tout ce qui a été dit sur l’importance des représentations, sur ce que sont les concepts et sur la distinction à opérer entre le cas de l’historien et le cas de l’élève, il me semble que partir d’un concept est une piste intéressante. Il s’agit alors de partir d’un concept pour lequel l’élève pourrait spontanément donner une certaine définition. J ’ai choisi d’envisager le terme de « guerre ». Je constate qu’en dehors des guerres mondiales (concept de « guerre totale ») et plus généralement avant la troisième, il n’est jamais question de définir ce concept de guerre, dont le mot apparait dans les programmes comme un élément de vocabulaire sur lequel il ne serait pas nécessaire de s’arrêter : tout le monde sait ce qu’est la guerre. Le terme a déjà été évoqué à plusieurs occasions : les guerres à l’époque révolutionnaire puis les guerres napoléoniennes, une étude autour du peuple français et la guerre pendant la Révolution et l’Empire a même été menée. On a aussi abordé la guerre entre la France et l’Allemagne en 1870. Les élèves ont sans doute une vision interétatique de la guerre = la guerre se produit entre deux armées, dans le but de conquérir du territoire. Il peut y avoir d’autres objectifs (répandre les libertés…). Avec l’étude d’une conquête coloniale, se pose la question de savoir si ces guerres coloniales constituent un nouveau type de guerre : les « Small Wars » et la question de savoir si elles constituent une violence spécifique ou pas (c’est par ailleurs une question qui divise les historiens). Parce que la guerre coloniale n’oppose pas deux armées, mais une armée et un peuple, elle constitue bien un « cas » au regard de la définition que les élèves pourraient donner de la guerre. A la fin de la séquence, l’objectif de complexifier pour l’élève le concept de guerre en analysant les modalités d’une conquête coloniale peut être réalisé.
Plusieurs guerres ont donc été évoquées au cours de l’année sans que je ne pense à définir le terme. A l’occasion de l’étude des conquêtes coloniales, je décide donc d’axer le cours sur le concept de guerre et de voir en quoi la conquête coloniale est différente des guerres classiques. La séquence se déroule en trois temps. D’abord, j’interroge les élèves sur ce qu’est une guerre, en écrivant les éléments de réponse au tableau. L’idée d’un conflit armé émerge assez rapidement, ainsi que l’aspect interétatique (« la guerre, c’est deux armées qui se font la guerre »). Rapidement, les élèves ne donnent plus de définition mais citent les guerres qu’ils connaissent : guerre d’Algérie, Guerre mondiale, guerre en Irak, Guerre de cent ans, l’Ukraine, le Mali. Ce premier état des lieux pose deux observations : d’abord, les élèves ont en tête les conflits actuels et il est quand même problématique de ne pratiquement pas les invoquer (sauf en géographie). Je me souviens moi-même avoir été choquée en classe préparatoire quand, en étudiant la Seconde Guerre du Golfe, mon enseignant d’histoire a complétement occulté la question de la guerre en Irak qui venait alors d’être déclenchée. L’idée de partir du concept me parait alors essentielle pour « faire du lien ». Ma seconde observation est qu’aucun élève n’a cité spontanément un conflit évoqué dans l’année, ce qui m’a laissé quelque peu dubitative. Je le comprends toutefois comme une conséquence de ce que le terme a été survolé plus qu’il n’a été traité directement. Nous sommes finalement arrivé à une définition assez consensuelle, puisque proche de celle du dictionnaire Larousse : « guerre : conflit armé entre deux Etats ».
La deuxième partie de la séquence consistait à étudier la conquête de l’Algérie à partir d’une carte et d’un texte. Cette première étape de l’étude visait à renforcer les représentations des élèves concernant les guerres classiques : montrer que la conquête de l’Algérie est une guerre (deux Etats qui s’opposent, des batailles, une lettre d’un Maréchal français qui illustre des combats). La seconde étape est la lecture de deux lettres de Bugeaud avec la question suivante : « qu’est-ce qui distingue les guerres de conquêtes coloniales des guerres classiques ? ». Les élèves observent alors que dans le cas de l’Algérie, l’ennemi de l’armée française n’est pas une armée algérienne, mais le peuple algérien. Les batailles ne sont qu’un moyen de vaincre, mais le moyen principal résulte dans la destruction des récoltes et des villages. Il s’agit d’un conflit entre une armée et un peuple. Certains élèves font directement le lien avec les conflits actuels, la question d’utilisation d’armes chimiques contre les populations. Par contre, il apparait très clairement que persiste une conception assez « fictive » de la guerre avec le maintien d’une idée selon laquelle la guerre oppose des « gentils » et des « méchants ». C’est donc une autre « représentation » concernant la guerre qu’il faudrait faire bouger.
Pour conclure sur cette expérimentation, je pense que cela confirme l’idée que partir d’un concept est constructif en matière de problématisation. Il faudrait creuser davantage ce qu’on peut entendre alors par « cas ». Ici, les élèves complètent le concept qu’ils connaissent : à côté des guerres coloniales, les guerres classiques, opposant deux Etats, existent bel et bien. Mais le cas a eu une autre conséquence : enrichir la conception de la guerre classique. Au départ, les élèves avaient une opinion (« la guerre, c’est mal ») qui devient progressivement un savoir par la multiplication des caractéristiques de la guerre que le cas leur a permis de rassembler. Partir du concept permet à l’élève d’être acteur de son savoir, puisqu’il a quelque chose à dire. Cela permet aux élèves, par leurs connaissances du vocabulaire et les liens qu’ils font avec l’actualité, d’être plus actifs lors de la séquence.
Si la problématisation et la prise en compte des représentations sont centrales aujourd’hui dans l’enseignement de l’histoire, j’ai montré que le passage par l’étude de cas était possible pour une démarche socio-constructive, permettant à l’élève de s’approprier le savoir. En mettant à jour ce qu’il sait et en le questionnant via une situation didactique qui lui pose problème au regard de ses représentations (le cas, donc), l’élève s’approprie un savoir complexe. Si j’ai abordé comment et pourquoi envisager l’étude de cas, je n’ai pour l’instant pas beaucoup insisté sur le support de l’étude de cas. J’y viens à présent brièvement.
|
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE- PRATIQUE DE L’ETUDE DE CAS EN HISTOIRE ET L’HISTOIRE SCOLAIRE
L’ETUDE DE CAS DANS LA RECHERCHE HISTORIQUE
Une pratique relativement récente qui s’inscrit dans un renouvellement du paradigme historique
Intérêt de l’étude de cas en histoire : quels sujets d’études ? Quels apports ?
DE L’ETUDE DE DOCUMENT A L’ETUDE CIBLEE, UNE APPROCHE RADICALEMENT DIFFERENTE DANS L’ENSEIGNEMENT
L’usage du document, une pratique bien ancrée
L’étude ciblée préconisée dans les programmes
La notion d’étude de cas exclue de l’enseignement de l’histoire ?
DEUXIEME PARTIE – QUEL « CAS » EN DIDACTIQUE DE L’HISTOIRE ?
L’ETUDE DE CAS PERMET D’ASSURER LA PROBLEMATISATION DE L’OBJET DE LA SEQUENCE
Le questionnement, base du travail de l’historien
La problématisation essentielle pour eviter l’étude pour l’étude
l’étude de cas assure la problématisation
DE L’IMPORTANCE DES REPRESENTATIONS DANS L’ELABORATION DE LA PROBLEMATIQUE… ET DE L’ETUDE DE CAS
Quelle prise en compte des représentations dans les didactiques ?
Ce qui fait cas pour l’élève, c’est ce qui va à l’encontre de ses représentations
LE CAS, MOYEN DE TRANSFORMER UN « TERME » EN « CONCEPT » POUR L’ELEVE.
Qu’est-ce qu’un concept en histoire ?
Quelle utilisation des concepts en didactique de l’histoire ?
Le cas comme biais d’une conceptualisation
CONCLUSION : « TOUT COMMENCE ET TOUT FINI PAR DES QUESTIONS »
BIBLIOGRAPHIE