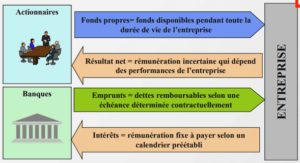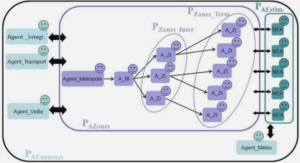Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Tradition des natifs
Comme nous avons cité auparavant, les us et le coutumes fondamentaux pour les natifs de cette zone sont principalement : l’exhumation, l’inhumation, le mariage traditionnel ou coutumier, et le Hasina. Pour une raison d’une meilleure acceptation sur la description de ces traditions, nous allons procéder comme suit :
Exhumations
La dépouille mortelle d’un individu est à la charge familiale. Après quelques années d’enterrement, les membres de la famille ont le plein droit d’organiser les eaux sature à leur frais. Le choix du jour et le montant alloué dépendent des avoirs pécuniaires de la cellule de base de l’être humain. Il y a des différentes démarches à suivre au niveau traditionnel tels que le parcours trois fois , sept fois et neuf fois du lieu d’enterrement. Ces chiffres sont sacro-saints pour les malgaches. Et puis, on s’achemine au dépouillement du reste mortel. Au cours de cette festivité, l’abattage de porc plus ajout d’arachide sont évidents afin que le participants soient rassasiés. Cette cérémonie dure environ une demi-journée.
A noter que la cérémonie se déroule en présence du SOZABE ( patriarche, notable ). Celui-ci est assisté par son adjoint et du second adjoint.
Ces personnalités jouent le rôle d’intermédiaire entre les vivants et les morts.
Ce sont les individus plus âgés du groupe ethn ique.
Inhumation
L’inhumation fait parti intégrante de la tradition de la population qui vit dans cette zone. Au vu et su de tout le monde, l’être humain est mortel en fonction des cas. Il y a une veillée durant quelques jours avant l’enterrement.
En général, le jour interdit pour l’inhumation est le jeudi car ce jour se trouve au milieu des jours de la semaine. Cette position signifie que le travail l’emporte sur la tradition. Durant l’enterrement, tous les membres de la famille et les invités sont présents pour l’honneur du disparu. Toujours est-il, les notables susmentionnés dirigent la cérémonie de condoléance. Les jeunes transportent sur leurs épaules le cercueil. Leur nombre est généralement limité à quatre individus. Ceci est variable en fonction du poids du défunt.
Circoncision
L a circoncision est réservée aux garçonnets de moins de six ans c’est-à-dire avant l’âge de scolarisation. Le jour f aste pour cette cérémonie familiale est le vendredi. Ceci peut traduire que la tradition Arabe ou Musulmane persiste encore. En fonction de l’organisation sociale y affairant, on peut procéder à une circoncision individuelle ou à une circoncision collective.
Mariage traditionnel ou coutumier
Pour la tradition malgache, c’est au tour des notables de choisir la futur épouse d’un jeune homme. A cause du développement du mariage chrétien, cette tradition commence à être dénigrée. La complication de ce mariage tire sa source par l’existence de deux types de mariages : traditionnelle et moderne. La festivité dépend du choix du sous-groupe ethnique. On peut célébrer un mariage à n’importe quel jour de la semaine. En particulier pour la zone sujette à la présente étude, le mariage a lieu notamment le vendredi et le samedi. Il y a des acteurs directs. La jeune femme et son frère plus le notaire. Il existe également les acteurs indirects qui sont composés par les escortes ( sœurs du jeune homme jouant le rô le de décoratrice pendant le jour faste ), les membres de la famille ( donnant l’honneur au futur couple ), le second type d’escorte ( pour la stabilisation spirituelle ), les cuisiniers spontanés ( préparant la nourriture ). La synergie entre les participants directs et indirects donne naissance à la réussite du mariage traditionnelle. L’effectif des invités est limité car la communication cérémonielle se fait de la bouche à l’oreille.
Navette quotidienne
La navette quotidienne au tourisme pendulaire peut être définie par un déplacement à l’échelle d’heure, d’une demi-journée d’une personne vers un lieu public : marché, centre de soir, établissement scolaire, lieu de travail, et administration publique. Le fait de quitter le foyer vers d’autres localités donne naissance au tourisme.
Les acteurs de ce type de tourisme, c’est seulement la famille qui fait un déplacement à petite échelle : le père qui effectue sont travail, la mère qui s’occupe du ménage, les enfants scolarisés qui joignent les écoles etc. . .
Ce tourisme constitue une recette et une dépense au niveau de la micro-économie d’un ménage. Ce qui veut dire sa considération. Un ménage, un foyer conjugal doit avoir son tableau de bord dans le domaine du financement pour équilibrer l’entrée et la sortie financière, enfin d’atteindre la solvabilité et l’autofinancement pour que l’épargne soit constitué, si non on doit recouvrir aux dettes, aux éventuels chômages qui sont la plus pire des cas de l’existence sur terre. A l’heure actuelle, chacun des foyers font l’objet de la navette quotidienne pour un dynamisme domicilié à par entière. A noter que chaque famille habitant dans ce District mange à leur faim dont une certaine proportion (85%) selon notre enquête, est apte à ac cueillir les visiteurs pour une raison familiale à durée d e séjour limitée un semestre au maximum.
Tourisme temporaire
Le tourisme temporaire se fait plutôt, dans une échelle temporaire plus ou moins durable, entre un mois et deux mois. Le repos, le congé cumulé ou autre constitue la base de ce tourisme. Alors, il s’agit d’affaires de la population active pour une visite familiale. Les visiteurs peuvent aller seul et sont aptes à organiser un groupe en fonction de la capacité d’accueil de la famille hôte et d’autres infrastructures d’accueils, pensions, gites d’étape, restauration, hôtellerie pour une raison d’hébergement temporaire.
Dans les zones rurales, la capacité d’accueil et les voies d’accès forment des problèmes fondamentaux face à la pureté de l’air, à la verdoyante de l’environnement de l’environnement naturel et l’attente des ruraux. L’accueil aux visiteurs d’où ils viennent est fortement assuré par le visage et les gestes amicaux des hôtes.
La plupart de ces touristes logent dans des établissements publics, privés (écoles, C.S.B, . . .) en cas de la surcharge familiale. L’essentiel c’est qu’ils atteignent vraiment leur objectif, la visite d’une localité loin d’une vision panoramique à partir des films, photos. La pratique donne une satisfaction complète car on s’approche directement dans le milieu ce dont on a besoin de goûter sans cesse et l’envie de se trouver à cette stade.
De ces analyses, ce sont des malgaches qui sont adeptes de ces types de tourismes.
Tourisme saisonnier
Ce tourisme est effectué par des vacanciers, par des chercheurs, Biologistes, écologistes, géographes…, qui sont des naturalistes ou environnementalistes. Ils s’intéressent à la composition physique, humaine, économique d’un milieu. Les zones rurales les attirent pour la découverte et l’initiation au développement. Le District de MORAMANGA n’échappe pas à ce tourisme vu son attraction et son attirance tenu comme une zone riche à un mode de vie originale, et un milieu naturel partiellement dégradé ou ayant subi l’action anthropique pour la mise en place.
Ainsi, les adeptes du tourisme saisonnier sont des nationaux et des étrangers. En cas de l’insuffisance d’infrastructures pour l’hébergement, et de communication, ils peuvent louer des matériels coulants et de s’héberger dans une hôte limitrophe pour mieux faire la mission, tout en estimant les distances à parcourir. Les hôtes ont la capacité d’accueil de trois étoiles, deux étoiles, une étoile, même des pensions et gîtes d’étapes qui se trouvent dans des zones plus urbanisées et reculées.
Tourisme d’affaires
Le tourisme d’affaire est moins pratiqué à tel point que la position rustique l’emporte encore sur les affaires. Les pratiquants de ce tourisme sont des hommes d’affaires privés, publics, même les clergés. La fréquence de leurs visites n’est pas quantifiable aussi bien que leur composition, que ces touristes viennent dans ce District selon leur marotte et leur calendrier.
S’abritent dans une zone d’autrui, ils doivent dépenser avant de gagner.
Enfin, c’est la satisfaction qui compte pour une préparation d’autres retours.
Tourisme définitif
Le tourisme définitif est un déplacement à but d’installation pérenne ou à jamais. Ces touristes, au départ cherchant des meilleures voies et moyens pour se stabiliser dans cette zone.
Leurs visites se font par étape :
– Enquête ouverte avec les responsables administ ratifs locaux .
– Enquête fermée avec la population cible.
La durée respective de cette démarche change avec la motivation de ce sujet.
Les fonctionnaires, les clergés, certains étrangers et opérateurs privés s’adonnent à la mise en place définitive pour un eldorado et un et épanouissement. Souvent, les troisièmes âges (retraités) et les membres de leur famille qui participent à cette pratique. Ils achètent du terrain constructible et s’implante progressivement et définitivement. Toutes les catégories du terrain attirent ces touristes : terrains domaniaux, terrains communaux, terrains privés, etc.
Le tourisme source de devise
Le secteur tourisme est une industrie dont la matière première est l’utilisation de l’environnement et sur lequel se superpose les structures d’accueil et l’animation qui jouent un rôle essentiel pour l’accroissement flux touristique. Les dépenses des touristes sont donc calculées à partir des hôtels, des données sur les échanges de devises de la zone et des enquêtes auprès de touris tes1 .Cependant, ce caractère non exportable constitue un atout comparatif pour les pays à vocation touristique qui ont exporté de l’aire protégée, de l’espace naturelet de sites touristiques …
En effet, le tourisme est une source non négligeable de devises étrangères pour la nation .Selon la Banque centrale de Madagascar, le secteur tourisme est un des trois premiers secteurs fructueux pour les recettes en devises, fluctuant en rang avec les entreprises franches et la pêche.
Le tourisme source de revenu.
L’écotourisme génère des activités économiques conséquentes dans d’autres secteurs de productions et de services. Le secteur de la construction est évidement concerné pendant la construction des hôtels et des installations rattachées au tourisme, y compris les infrastructures. Les hôtels et les autres types d’hébergement génèrent une activité économique à travers des liens en amont et en aval avec l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’industrie. L’accroissement de la demande du tourisme, endentée agricole et de pêche à moyen terme et à long terme, va incit er le développement de ces secteurs et augmente par la suite le revenu des ménages.
Les prestations de services touristiques et les touristes eux-même, à travers leur dépense personnelles dans et en dehors de l’hébergement touristiques ; créent une demande remarquable en matière de transport, de services bancaires, d’assurances ; de sécurités, de télécommunications, de services médicaux, de commerces de détails et plus particulièrement d’articles d’artisans et autres souvenirs.
Le ménage qui fait ces différentes activités bénéficie des revenus touristiques car le tourisme est une source de déboucher complémentaire pour leur produit.
Les prestations personnelles rattachées aux traitements et aux services traditionnels de beauté connaissent une exploitation du fait de la présence des touristes.
|
Table des matières
INTRODUCTION GÉNÉRALE
PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION GENERALE
CHAPITRE I : DESCRIPTION DE LA ZONE D’ÉTUDE
SECTION I. CADRE PHYSIQUE
§.1. Géologie et géomorphologie sommaire
§.2. Caractéristiques climatiques
A- Température annuelle
B- Pluviométrie annuelle
C- Balancement saisonnier du climat et de centre d’action
§.3. Écologie générale
A- Espèces Animales
B- Essences végétales
1. Ressource arborée
2. Arbustes
3. Herbacés
§.4. Réseau hydrographique
SECTION II : ASPECTS DÉMOGRAPHIQUES
§.1. Évolution spatio-temporelle de la population (2001-2006)
A- Autochtones
B- Allochtones
§.2. Effectif total de la population
A- Répartition par âge
B- Répartition par sexe
C- Répartition par activité
§.3. Moeurs et coutumes
A- Tradition des natifs
1. Exhumations
2. Inhumation
3. Circoncision
4. Mariage traditionnelle ou coutumier
5. Hasina
B- Coutumes des visiteurs
SECTION III : CADRE ÉCONOMIQUE
§.1. Secteur primaire
A- Agriculture
1. Culture de rente
2. Culture vivrière
B- Élevage
C- Pêche
D- Mines
§.2. Secteur secondaire
A- Artisanat
B- Industrie
§.3. Administration et services : Secteur Tertiaire
A- Administration
B- Services
1. Transport
2. Éducation
3. Santé
4. Commerce
5. Sécurité
CHAPITRE II : CONTEXTE DU SECTEUR TOURISME
SECTION I : TYPOLOGIE DU TOURISME ET SES ACTEURS
§.1. Navette quotidienne
§.2. Tourisme temporaire
§.3. Tourisme saisonnier
§. 4. Tourisme d’affaires
§. 5. Tourisme définitif
SECTION II : LES ATOUTS
§.1. Le tourisme source de devise
§. 2. Le tourisme source de revenu.
A- Le tourisme et le PIB
B- L’écotourisme et l’éducation
§. 3. Le tourisme pourvoyeur d’emplois.
A- Les emplois directs
B- Les emplois induits
C- Les emplois indirects
SECTION III : LES PROBLÈMES DU SECTEUR TOURISTIQUE
§.1. Problèmes sanitaire et hygiène dans les sites écotouristiques
§.2. Les exploitations irrationnelles des potentialités écotouristiques
§.3. L’insuffisance d’infrastructures hôtelières de qualité
§.4. L’insuffisance des infrastructures de base
§.5. Le manque de professionnalisme
§.6. Attitude non-responsable
§.7. L’insuffisance d’informations
A- Au niveau des ressources humaines
B- Au niveau socioculturel
C- Les faiblesses économiques
D- La concurrence du secteur informel
E- Les facteurs qui désespèrent les voyageurs
F- L’insécurité des voyages et le non professionnalisme de certains transporteurs
G- Risque de cyclone dans le district
H- Médiocrité des infrastructures d’accès aux sites
I- La barrière linguistique
J- Insuffisance de notoriété de la destination du district
K- Problème d’accès au foncier
L- Taxes non incitatives
DEUXIÈME PARTIE : ANALYSE DES EXISTANTS EN VUE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME RURAL
CHAPITRE I : STRATÉGIE D’APPROCHE
SECTION I : RELATION ENTRE POPULATION, MILIEU NATUREL ET
L’ÉTAT DES INFRASTRUCTURES
§.1. Préservation, conservation de l’environnement naturel : Pôle d’attraction
A- Parc national
B- Site écotouristiques (MAROMIZAHA
§.2. Entretien de l’environnement immédiat des maisons d’habitation
A- Entretien saisonnier
B- Entretien périodique
C- Entretien curatif
§.3. État des infrastructures
A- Existence des voies d’accès
1. Route National N°2
a. RIP (Route d’Intérêt Provincial)
b. CIP (Chemin d’Intérêt Provincial)
c. VIC (Voie d’Intérêt Communal)
d. RIQ (Routes d’Inter-Quartiers)
2. RNCFM (Réseau National de Chemin de Fer Malgache)
a. Train de Voyageur
b. Wagons marchandises
c. Madarail : Locomotive à grande vitesse
B- Capacité d’accueil des hôtels, restaurants
1. Distance entre hôtels, restaurants et milieu rural
2. Effectifs de ces infrastructures et localisation
3. Capacité d’accueil familiale
SECTION II. NIVEAU D’INSTRUCTION DE LA POPULATION
§.1. Niveau scolaire
§.2. Capacité linguistique
§.3. Rareté des guides
§.4. Difficulté au niveau de l’art culinaire
SECTION III. CONFISIONS DE LA DÉFINITION DU MOTIF DE DÉPLACEMENT CHEZ LES TOURISTES
§.1. Touristes nationaux
A. Objectifs
B. Durée de séjour
C. Brassage ethnique
§.2. Touristes internationaux
A. Buts
B. Motivation sur les réalités rurales
C. Élaboration de projets de développement du tourisme rural
§.3. Différence de civilisation et du niveau de vie
A- Civilisation étrangère
B- Niveau de vie entre visiteurs et hôtes
CHAPITRE II: PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION, SUGGESTIONS ET IMPACTS
SECTION I. LES PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION
§.1.Promouvoir les zones d’intérêt touristique
§.2.Promouvoir les investissements et multiplier les infrastructures d’accueil
§.3.Créer des emplois, valoriser les ressources nationales et améliorer les prestations.
§.4.Développement de l’écotourisme et à la préservation de l’environnement
SECTION II. SUGGESTIONS
§.1. Au niveau de l’ORT (Office Régional du Tourisme)
§.2. Dans le domaine des autorités locales
A. Chef de District
B. Mairie
C. Chef du quartier
§.3. Au niveau de la population locale
A. Fonctionnaires
B. Paysans
§.4. Installation des associations paysannes
A. Par quartier
B. Par commune
§.5. Mise en place d’union des associations paysannes
A. Au niveau de la commune
B. Au niveau du District
SECTION III : CONCEPTION D’IMPACTS
§.1. A ultra court terme (moins de 6 mois)
A. Dans le domaine social
B. Dans le cadre environnement rural
§.2. A court terme (entre 6 mois et 1 an)
A. Capacité d’accueil
B. Niveau intellectuel des Hôtes
§.3. A moyen terme (1 à 5 ans)
A. Amélioration des infrastructures
B. Augmentation du niveau de vie local
§.4. A long terme (supérieur à cinq ans)
A. Sortie des conditions de ruralités
B. Un développement socio-économique pérenne
CONCLUSION GÉNÉRALE
BIBLIOGRAPHIE
Télécharger le rapport complet