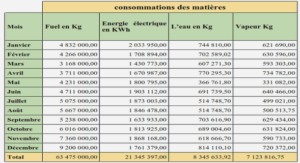Les β-lactamines (pénicillines, céphalosporines, carbapénèmes et monobactames), constituent la famille d’antibiotiques la plus prescrite dans le monde [66]. Dès le début de leur utilisation extensive, dans les années 1940, ces antibiotiques ont été confrontés au contre-point de la résistance, avec l’apparition dès 1942 de la première souche de Staphylococcus aureus résistante à la pénicilline par production de pénicillinase [29]. Dès lors, s’est engagée une course permanente entre résistance bactérienne d’une part, et développement de nouvelles molécules d’autre part. L’émergence puis la dissémination de nouvelles β-lactamases, premier mécanisme en cause dans la résistance des bactéries à Gram négatif (BGN) aux β-lactamines, sont strictement parallèles à la séquence d’introduction dans l’arsenal thérapeutique et à la consommation des différentes β-lactamines. Ainsi, l’introduction des céphalosporines de troisième génération (C3G) en pratique clinique au début des années 1980, permettant de lutter contre les infections à germes producteurs de pénicillinases, a été suivie, dès 1983, de la description de la première β-lactamase à spectre élargi (BLSE) chez Klebsiella pneumoniae en Allemagne [55]. Le début des années 2000 a été marqué par l’émergence mondiale de souches de Escherichia coli produisant un nouveau type de BLSE (CTX-M), à la fois dans les hôpitaux et dans la communauté [24, 65, 87]. La lutte contre l’émergence des entérobactéries sécrétrices de β-lactamases à spectre élargi (EBLSE), en particulier des E. coli producteurs de BLSE, constitue un réel défi parce que E. coli est le commensal aérobie majeur du tube digestif de l’homme (10⁸ /g de fèces) et la première espèce bactérienne responsable d’infections chez l’homme. La concentration fécale de E. coli BLSE, chez les personnes qui en sont porteuses, est accrue en cas de consommation d’antibiotiques. Il a été montré que la quantité relative moyenne de E. coli BLSE était 13 fois plus élevée dans une population de femmes exposées aux antibiotiques [104]. L’augmentation de l’incidence des infections à E. coli BLSE conduit à une consommation accrue des carbapénèmes, qui sont généralement les seules molécules encore actives contre ces bactéries multi-résistantes (BMR). Ces molécules d’antibiotiques de dernier recours sont à leur tour menacées parce que, parallèlement aux EBLSE, les entérobactéries productrices de carbapénèmases (EPC), β-lactamases capables d’hydrolyser les carbapénèmes, ont émergé dans de nombreuses régions du globe. Dans certains pays, les EPC sont devenues endémiques : c’est le cas des souches productrices de métallo-β-lactamases VIM-1 en Grèce et NDM-1 en Inde ou de l’enzyme OXA-48 en Afrique du Nord [19, 39, 115]. En cas d’infection liée à une EPC, le risque d’impasse thérapeutique est tel que certains pays, comme la France, ont fait de ces bactéries hautement résistantes émergentes (BHRe) une priorité sanitaire et ont mis en place une véritable politique de maîtrise de leur diffusion. En France, cette maîtrise est encadrée par la circulaire n°DGS/RI/DGOS/PF/2010/413 du 6 décembre 2010 relative à la mise en œuvre de mesures de contrôles des cas importés d’EPC qui cible les établissements de santé du territoire et qui repose sur la prévention de la transmission croisée et une politique de bon usage des carbapénèmes. Même si les cas de patients colonisés ou infectés par une EPC sont peu fréquents en France, une très nette augmentation des signalements a été observée ces deux dernières années .
GENERALITES SUR LES ENTEROBACTERIES
Définition
Les entérobactéries sont une famille très hétérogène qui regroupe de nombreux genres et espèces bactériens retrouvés principalement dans l’intestin de l’homme ou de certains animaux. Les entérobactéries sont à la fois des bactéries saprophytes, commensales et pathogènes (opportunistes ou strictes) [6]. Elles sont définies par les caractères suivants :
➤ bacilles à Gram négatif,
➤ mobiles avec ciliature péritriche ou immobiles,
➤ poussant sur milieux de culture ordinaires,
➤ aérobies – anaérobies facultatifs,
➤ fermentant le glucose avec ou sans production de gaz,
➤ réduisant les nitrates en nitrites,
➤ oxydase négative.
Classification
La distinction entre les genres et les espèces se fait par l’étude des caractères biochimiques et/ou antigéniques. La famille comprend 130 espèces actuellement répertoriées. Les espèces les plus communément isolées en bactériologie clinique appartiennent aux genres Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Hafnia, Klebsiella, Morganella, Proteus, Providencia, Salmonella, Serratia, Shigella, Yersinia .
Caractères bactériologiques
Caractères morphologiques
Toutes les entérobactéries ont une morphologie habituellement typique de type bacilles à Gram négatif de 2-3 µm de long sur 0,6 µm de large, généralement polymorphes .
Les espèces mobiles, qui sont les plus nombreuses, le sont grâce à une ciliature péritriche. Certaines sont immobiles (Klebsiella, Shigella, Yersinia pestis). La présence d’une capsule visible au microscope est habituelle chez les Klebsiella. La plupart des espèces pathogènes pour l’homme possèdent des fimbriae ou pili qui sont des facteurs d’adhésion.
Caractères culturaux
Les entérobactéries se développent rapidement in vitro sur milieux nutritifs simples (ordinaires) en aérobiose et en anaérobiose. La température optimale de croissance est de 37 °C mais la culture est possible entre 20 et 40 °C. Leurs exigences nutritionnelles sont en général réduites et la plupart se multiplient en milieu synthétique avec une source de carbone simple comme le glucose. Sur milieux gélosés, les colonies d’entérobactéries sont habituellement lisses, brillantes, de structure homogène (type “ smooth ” ou S). Cet aspect peut évoluer après cultures successives vers des colonies à surface sèche et rugueuse (type “ rough ” ou R). Les Klebsiella forment des colonies muqueuses, larges, grasses et luisantes. Les Proteus ont tendance à envahir la gélose et à y former un tapis uniforme. En milieu liquide, les entérobactéries occasionnent un trouble uniforme du bouillon .
Caractères biochimiques
C’est sur l’étude des caractères biochimiques que repose en pratique le diagnostic de genre et d’espèce qui ne doit être abordé qu’après que le diagnostic de famille ait été établi avec certitude .
Production d’hydrogène sulfuré (SH2)
La production de SH2 par les micro-organismes est mise en évidence par incorporation du fer ou de plomb dans le milieu destiné à cette étude (milieu Kligler-Hajna). Il se forme un précipité noir de sulfure de fer ou de plomb. Ce souffre réduit va se combiner avec le fer ferreux Fe2+ qui vient du sulfate de fer.
Recherche de l’uréase
Les bactéries possédant une uréase active scindent l’urée en dioxyde de carbone et en ammoniaque. Ceux-ci en se combinant donnent du carbonate d’ammonium. Le carbonate d’ammonium formé alcalinise le milieu, ce qui se traduit par le virage de l’indicateur coloré de l’orange au rose framboise ou dans de rares cas au rouge violacé.
LES ANTIBIOTIQUES CLASSIFICATION ET MODES D’ACTION
Généralités
Définition
On appelle « antibiotique » toute substance naturelle d’origine biologique élaborée par un organisme vivant, substance chimique produite par synthèse ou substance semi synthétique obtenue par modification chimique d’une molécule de base naturelle ayant les propriétés suivantes :
– Activité antibactérienne
– Activité en milieu organique
– Une bonne absorption et bonne diffusion dans l’organisme.
Les antibiotiques ont la propriété d’interférer directement avec la prolifération des micro-organismes à des concentrations tolérées par l’hôte.
Mode d’action des antibiotiques
Les antibiotiques agissent à l’échelon moléculaire au niveau d’une ou de plusieurs étapes métaboliques indispensables à la vie de la bactérie. Ils agissent par :
➤ Toxicité sélective au niveau de la :
o synthèse de la paroi bactérienne,
o membrane cytoplasmique,
o synthèse des protéines,
o synthèse des acides nucléiques
➤ Inhibition compétitive : dans ce cas l’antibiotique est un analogue structural, il interfère avec une fonction essentielle à la bactérie.
Critères de classification
La classification des antibiotiques peut se faire selon :
➤ Origine : élaboré par un organisme (naturel) ou produit par synthèse (synthétique ou semi synthétique)
➤ Mode d’action : paroi, membrane cytoplasmique, synthèse des protéines, synthèse des acides nucléiques
➤ Spectre d’activité : liste des espèces sur lesquelles les antibiotiques sont actifs (spectre étroit ou large)
➤ Nature chimique : très variable, elle est basée souvent sur une structure de base (ex : cycle β-lactame) sur laquelle il y a hémisynthèse.
La classification selon la nature chimique nous permet de classer les antibiotiques en familles (β-lactamines, aminosides, tétracyclines…etc.) Nous adopterons la classification selon le mode d’action.
|
Table des matières
INTRODUCTION
I. GENERALITES SUR LES ENTEROBACTERIES
I.1. Définition
I.2. Classification
I.3. Caractères bactériologiques
I.3.1. Caractères morphologiques
I.3.2. Caractères culturaux
I.3.3. Caractères biochimiques
I.3.3.1. Production d’hydrogène sulfuré (SH2)
I.3.3.2.Recherche de l’uréase
I.3.3.3. Production d’indole
I.3.3.4.Recherche des décarboxylases
I.3.3.5.Recherche des désaminases oxydatives
I.3.3.6. Utilisation du citrate de Simmons
I.3.3.7. Utilisation du malonate
I.3.3.8. Action de la phényl alanine désaminase (PDA)
I.3.3.9. Milieu au citrate de Christensen
I.3.3.10.Recherche de l’acétoïne ou réaction de Voges-Proskauer (VP)
I.3.3.11.Test à l’ONPG (Orthonitrophényl β-D-Galacto-pyranoside)
I.3.4. Caractères antigéniques
II. LES ANTIBIOTIQUES CLASSIFICATION ET MODES D’ACTION
II.1. Généralités
II.1.1. Définition
II.1.2. Mode d’action des antibiotiques
II.1.3. Critères de classification
II.2. Les antibiotiques
II.2.1. Inhibiteurs de la synthèse du peptidoglycane
II.2.1.1. Les β-lactamines
II.2.1.1.1. Pénames
II.2.1.1.2. Céphèmes
II.2.1.1.3. Carbapénèmes, oxapénames et monobactames
II.2.1.2. Glycopeptides et fosfomycine
II.2.2. Inhibiteurs de la synthèse des protéines
II.2.3. Antibiotiques actifs sur les enveloppes membranaires : Polymixines
II.2.4. Inhibiteurs des acides nucléiques
II.2.5. Inhibiteurs de la synthèse des folates
III. LA RESISTANCE BACTERIENNE
III.1. Définition de la résistance bactérienne
III.2. Les différents types de résistance
III.2.1. Résistance naturelle ou intrinsèque
III.2.2. Résistance acquise
III.2.3. Résistance clinique
III.3. Phénotype de résistance
III.4. Phénotypes de résistance des entérobactéries aux β-lactamines
III.5. Mécanisme de résistance
III.5.1. Déterminisme génétique de la résistance bactérienne
III.5.1.1. Les mutations chromosomiques
III.5.1.2. Les plasmides
III.5.1.3. Les transposons
III.5.2. Mécanismes biochimiques de la résistance bactérienne
III.5.2.1. Inactivation enzymatique de l’antibiotique
III.5.2.1.1. Les β-lactamases
III.5.2.1.1.1. Les pénicillinases
III.5.2.1.1.2. Céphalosporinases
III.5.2.1.1.3. Bêta-lactamases à spectre élargi (BLSE)
III.5.2.1.1.3.1. Définition
III.5.2.1.1.3.2. Epidémiologie
III.5.2.1.1.3.3. Différents types de BLSE
III.5.2.1.1.3.3.1. Anciennes BLSE
III.5.2.1.1.3.3.1.1.BLSE de type TEM (Temoneira – nom du patient)
III.5.2.1.1.3.3.1.2.BLSE de type SHV (Sulfhydryl variable)
III.5.2.1.1.3.3.2. Nouvelles BLSE
III.5.2.1.1.3.3.2.1. BLSE de type CTX-M (Céfotaximase – Munich)
III.5.2.1.1.3.3.2.2. BLSE de type PER (Pseudomonas extended resistance)
III.5.2.1.1.3.3.2.3. BLSE de type VEB (Vietnam Extended-spectrum Beta-lactamase)
III.5.2.1.1.3.3.2.4. BLSE de type GES (Guyana ExtendedSpectrum Beta-lactamase)
III.5.2.1.1.3.3.2.5. Autres BLSE de classe A
III.5.2.1.1.3.3.2.6. BLSE de type OXA (Oxacillinase)
III.5.2.1.1.4. Les carbapénèmases
III.5.2.1.1.4.1. Carbapénèmases de classe A
III.5.2.1.1.4.2. Carbapénèmases de classe B
III.5.2.1.1.4.3. Carbapénèmases de classe D
III.5.2.1.1.4.4. Support moléculaire des gènes de carbapénèmases
III.5.2.1.2. Les estérases
III.5.2.1.3. Les amidases
III.5.2.2. Modification de la cible
III.5.2.3. Diminution de la perméabilité
III.5.2.4. Excrétion de l’antibiotique par un mécanisme d’efflux
III.5.3. Evolution de la résistance aux antibiotiques
III.5.3.1. Sélection de la résistance
III.5.3.2. Diffusion de la résistance
CONCLUSION