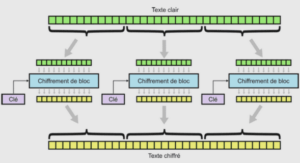Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, les maladies cardiovasculaires (CV) étaient en 2012 la première cause de décès dans le monde, représentant près de 31% de la mortalité totale [1]. En Caraïbes, il existe une forte mortalité précoce d’origine CV [2]. Les Antilles françaises n’échappent pas à cette règle. En Guadeloupe par exemple, le taux de mortalité lié à l’appareil circulatoire chez les moins de 65 ans s’élevait à 39,3 pour 100 000 entre 2009 et 2011 contre 24,3 pour 100 000 en France métropolitaine [3]. Pourtant, les départements français d’Amérique disposent d’un système de santé identique à celui développé au niveau national.
On sait que les Antilles françaises sont exposées à un niveau de risque CV relativement élevé. En 2007, la prévalence de l’hypertension artérielle (HTA) était environ deux fois supérieure en Guadeloupe à celle observée en France métropolitaine chez les femmes, et 25% plus élevée chez les hommes [4,5]. En 2009, la proportion de la population adulte recevant un traitement antidiabétique était de 6,5% aux Antilles françaises contre 3,9% en métropole [6]. Cette singularité épidémiologique semble en partie relever des conditions socio-économiques défavorables qui prévalent sur ces territoires [7,8].
On sait aussi qu’à cette particulière exposition au risque CV s’ajoute un insuffisant contrôle de ce risque. En 2007 en Guadeloupe, 22% des hommes et 44% des femmes adultes hypertendus avaient une pression artérielle contrôlée [4]. Ce phénomène n’était pas spécifique des Antilles françaises. La même année en France métropolitaine, seul un hypertendu sur quatre présentait des valeurs de pression artérielle conformes aux recommandations [5]. Aux Antilles tout du moins, le problème semble perdurer. En 2014, l’étude Prevalence of Hypertension in Disadvantaged Guadeloupeans (PHDG-2014) montrait, dans une population guadeloupéenne en situation de pauvreté mais bénéficiant d’un bon accès théorique aux soins, que moins de la moitié des hypertendus traités étaient équilibrés [9]. Dans la même population, moins d’une personne recevant un traitement antidiabétique sur trois présentait un diabète contrôlé [10]. Cet insuffisant contrôle de l’HTA et du diabète était observé quel que soit le nombre de consultations médicales dans l’année. Pourtant, nombreuses sont les solutions disponibles pour une meilleure maitrise du risque hypertensif et diabétique [11]. Chez les hypertendus traités non contrôlés ayant participé à l’étude PHDG-2014, près de 70% recevaient encore une monothérapie [7].
Parmi les hypothèses pouvant expliquer ce faible contrôle du risque figure une insuffisante qualité des soins [9,10,12]. À cet égard, les médecins généralistes ont une responsabilité particulière. En France en 2006 a été mis en place un dispositif de gatekeeping (« parcours de soins coordonné ») encourageant tous les assurés sociaux à désigner un médecin traitant, responsable de l’évaluation des besoins des personnes et de leur orientation vers les offres de soins que leur état de santé impose. Plus de 90% des adultes français ont effectivement désigné un médecin traitant, le plus souvent généraliste [13]. Ces médecins généralistes sont ainsi en première ligne dans la gestion du risque CV. Cette gestion du risque CV nécessite une approche globale mettant notamment en jeu une correcte évaluation du risque, une éducation du patient, des stratégies thérapeutiques adaptées, et une bonne surveillance des éventuelles complications [11]. En France, peu d’études ont exploré la qualité des pratiques des médecins généralistes en la matière.
METHODES
Nous avons mis en œuvre une étude observationnelle transversale, en Guadeloupe et Martinique d’octobre 2015 à septembre 2016, en faisant appel à une méthode mixte de type exploratoire [14], avec une première phase qualitative puis une seconde quantitative.
Populations
La 1e phase, qualitative, a porté sur une population diversifiée en âge, sexe, et zone d’exercice de dix médecins généralistes ambulatoires exerçant en Guadeloupe et Martinique. La 2de phase, quantitative, a porté sur un échantillon aléatoire de médecins généralistes ambulatoires exerçant en Guadeloupe et Martinique. La population source a été identifiée sur annuaire téléphonique (310 médecins en Guadeloupe, et 299 en Martinique en 2016). Ont été d’emblée exclus les praticiens ayant participé à la première phase. Un premier tirage au sort sans remise a permis de sélectionner un échantillon de 198 médecins en Guadeloupe et 192 en Martinique. L’objectif de l’échantillonnage était de parvenir à un effectif minimum de 350 praticiens, pour une précision des estimations d’environ 3%. Les critères d’inclusion étaient : a) une activité de médecine générale en cabinet, b) une pratique au moins partiellement allopathique. Compte tenu du nombre de médecins injoignables ou ne répondant pas aux critères d’inclusion parmi ceux initialement sélectionnés, un deuxième tirage au sort a été effectué sur les restants pour parvenir à l’objectif de recrutement.
Recueil des données et définitions
Pour la 1e phase, nous avons mené le recueil des données grâce à des entretiens semi‐ directifs, en face‐à‐face, articulés autour de quatre questions principales abordant l’évaluation du risque CV, l’éducation du patient, la stratégie clinique face à une HTA résistante, et l’exploration des atteintes vasculaires périphériques et coronaires (encart 1). Nous avons enregistré et transcrit les entretiens. Chacun de nous a contrôlé la transcription de l’ensemble des verbatim.
Trame d’entretien utilisée en phase qualitative, version finale
1) Comment définiriez-vous le risque CV ?
→ Quelle est votre définition du haut risque CV ?
2) Que pensez-vous de l’éducation thérapeutique dans la prise en charge du risque CV ?
→ Selon vous, quel est l’intérêt de l’éducation thérapeutique pour les patients à risque CV ?
→ Selon vous, parmi les sujets à risque CV, à quels patients faudrait-il proposer une éducation thérapeutique ?
→ Et à quels moments de leur prise en charge ?
→ En pratique, proposez-vous de l’éducation thérapeutique à vos patients à risque CV ?
→ Si réponse ‘’non’’ : Pourquoi ?
→ Si réponse ‘’oui’’ : Selon quelles modalités ?
→ À votre avis, quels sont les obstacles à l’éducation thérapeutique des patients ?
3) Face à un patient qui présente une HTA durablement déséquilibrée malgré la prise de trois médicaments antihypertenseurs, quelle stratégie adoptez-vous ?
4) Dans quelles circonstances prescrivez-vous des échographies Doppler artérielles des troncs supra aortiques ou des membres inférieurs ?
5) Dans quelles circonstances prescrivez-vous des épreuves d’effort ?
Pour la 2de phase, nous avons réalisé le recueil des données grâce à un questionnaire téléphonique essentiellement constitué de questions ouvertes, respectant le plan d’entretien utilisé au cours de la première phase (encart 2). Le nombre de questions a été minimisé pour garantir le meilleur taux de réponse possible.
Questionnaire utilisé en phase quantitative
1) Sexe (Donnée déduite de l’identité du répondeur)
2) Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? (Question fermée)
a. Moins de 35 ans
b. 35-44
c. 45-54
d. 55-64
e. 65 ans ou plus
3) Comment définiriez-vous le haut risque CV ? (Question ouverte)
4) Proposez-vous de l’éducation thérapeutique à vos patients à risque CV ? (Question fermée)
a. Oui, dans certains cas
b. Oui, systématiquement
c. Non
4.1) Si réponse a : Pouvez-vous préciser dans quels cas ? (Question ouverte)
4.2) Si réponse a ou b : Selon quelles modalités ? (Question fermée)
i. Par moi-même, au cabinet médical, dans le cadre de mes consultations
ii. Grâce à une structure ou équipe dédiée à l’éducation thérapeutique
iii. Les deux
iv. Autres modalités
4.3) Si réponse c : Pourquoi ? (Question ouverte)
5) Vous découvrez un patient qui présente une HTA durablement déséquilibrée malgré la prise de trois médicaments antihypertenseurs, quelle stratégie globale adoptez-vous ? (Question ouverte)
6) Prescrivez-vous des échographies Doppler des troncs supra aortiques ? (Question fermée)
a. Oui
b. Non
6.1) Si réponse a : Dans quelles circonstances ? (Question ouverte)
6.2) Si réponse b : Pourquoi ? (Question ouverte)
7) Prescrivez-vous des échographies Doppler artérielles des membres inférieurs ? (Question fermée)
a. Oui
b. Non
7.1) Si réponse a : Dans quelles circonstances ? (Question ouverte)
7.2) Si réponse b : Pourquoi ? (Question ouverte)
8) Prescrivez-vous des épreuves d’effort ? (Question fermée)
a. Oui
b. Non
8.1) Si réponse a : Dans quelles circonstances ? (Question ouverte)
8.2) Si réponse b : Pourquoi ? (Question ouverte)
Les variables explorées étaient : a) le sexe, b) l’âge, c) la définition du haut risque CV, d) les attitudes et pratiques en matière d’éducation thérapeutique du patient, e) les attitudes et pratiques face à une HTA résistante, f) les pratiques de prescription d’échographie Doppler artérielle et d’épreuve d’effort. Nous avons immédiatement saisi les données collectées à la phase quantitative sur formulaire informatique à l’aide de la web-application Wepi.org, maintenue par la société Epiconcept. La phase qualitative ayant permis l’inventaire des réponses possibles, nous avons codé ces réponses en temps réel. Les réponses non inventoriées ont été saisies en texte libre et codées a posteriori, après discussion avec le coordinateur de la recherche.
|
Table des matières
Introduction
Méthodes
Populations
Recueil des données et définitions
Aspects éthiques et réglementaires
Plan d’analyse
Résultats
Caractéristiques de la population
Identification des personnes à risque
Education thérapeutique des patients
Stratégie clinique face à un risque non contrôlé
Évaluation du retentissement sur les organes cibles (macro-angiopathies)
Discussion
Identification des personnes à risque
Éducation thérapeutique des patients
Stratégie clinique face à un risque non contrôlé
Évaluation du retentissement sur les organes cibles
Conclusion
Références
Index des tableaux
Annexe : verbatim phase qualitative