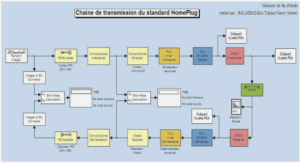Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Regard sociétal français
L’alcool souffre d’un regard à deux facettes qui s’opposent. D’un côté, la consommation d’alcool est incitée. Véronique Grappe-Nahoum, anthropologue, dans son livre Vertige de l’ivresse : Alcool et lien social publié en 2010, explicite cette fonction du boire : « Avec un paradoxe insistant : la consommation d’alcool, toujours plus « surveillée » sinon contestée, se glisse dans de larges instants du quotidien. La fête sans doute, mais aussi l’effervescence la plus simple, la plus immédiate : le « boire social », le « boire individuel, les logiques de circonstances […] ». En effet, lorsque que l’on pense aux temps de consommation de boissons alcoolisées, on pense spontanément aux moments qui permettent de célébrer, alors que Véronique Grappe-Nahoum nous rappelle que le boire peut investir des moments autrement plus nombreux, et autrement plus élargis à la fonction réductrice de la célébration. L’alcool peut alors venir évidemment récompenser les victoires, fêter les bonnes nouvelles, mais il peut être là pour consoler les mauvaises. Il peut également marquer un changement de temps comme « l’apéro » marque la fin de la journée de travail, le verre du vendredi soir lui signe la fin de la semaine (Nahoum-Grappe, 2010). Boire est incité par la société via les pairs, mais également par ou via les médias. En effet, le domaine du marketing a largement fait la promotion de l’alcool, via entre autres des publicités représentées par les figures 4, 5 et 6 ci-après, aux allures de propagande, comparant les alcools dits « bons » et les alcools « mauvais », donnant des vertus thérapeutiques à certaines boissons alcoolisées. Marie Costa, dans sa thèse de doctorante en pathologie humaine, rappelle également que « si boire semble avoir ses codes et ses fonctions, l’ivresse aurait également les siennes. ». Il est donc aisé de citer l’ivresse de l’entrée dans l’âge adulte, l’ivresse de la nouvelle année, celle de l’enterrement de vie de garçon ou jeune fille, ou encore celle du nouveau père. Celles-ci signent des rites de passage.
D’un autre côté, une vision très négative du mésusage d’alcool se dégage. Celui qui boit est tout d’abord qualifié d’ivrogne même si ce regard sur « ceux qui abusent » change au cours du temps. Au XIXe siècle, l’alcool est perçu comme un vice ou encore un fléau social, alors qu’au XXe siècle il serait petit à petit qualifié de maladie alcoolique. Le terme d’ivrognerie est donc remplacé par alcoolisme, offrant un suffixe faisant penser davantage à une conception médicale. Toutefois, le terme d’alcoolisme se trouve à son tour chargé des valeurs morales et stigmatisantes de l’ivrognerie (Sournia, 1986). La caractérisation de l’alcoolique s’appuie sur des processus d’animalisation, de déshumanisation qui le rejettent lui aussi de la société (Poussou & Nourrisson, 1992). L’alcoolique est donc un clochard qui a choisi son état, les représentations sociales qui désignent l’alcoolique sont finalement plus moralisées que médicalisées (Gaussot, 1998).
En fait, il y aurait un « savoir boire » qui schématiquement exclurait l’abstinence et l’excès. Cette devise par exemple « connaître le vin, l’apprécier, savoir en parler » sous-entend les notions de modération, de contrôle de la consommation. Cela donne aisément à la société l’idée que sortir de l’alcoolisme émane d’une question de volonté et qu’il suffirait de se maintenir dans une consommation « raisonnable ». Encore à l’heure actuelle, il est régulièrement rappelé, conseillé à la télévision ou dans des publicités diverses de « boire avec modération », ce qui entretient la représentation sociétale que boire ou ne pas boire dépend du bon vouloir de la personne. Roland Barthes, écrivain, a écrit en 1957 dans Mythologies : « […] savoir boire est une technique nationale qui sert à qualifier le Français, à prouver à la fois son pouvoir de performance, son contrôle et sa sociabilité. » Cela signifierait qu’il y aurait un savoir boire qui se devrait d’être étroitement lié au « savoir faire partie de la société ».
En France, consommer de l’alcool expose donc bien à une double contrainte sociétale. Il ne faut pas ni trop boire, ni trop peu. La consommation est valorisée, mais la personne consommatrice peut être stigmatisée. Ainsi, le bon buveur est un bon vivant et le mauvais buveur un simple déviant (Costa, 2019). Toutes ces manières de penser le consommateur d’alcool au sein de la société entretient donc des stéréotypes qui pourront avoir de lourdes conséquences en termes de stigmatisation sociale de la population alcoolodépendante.
Stigmatisation
Définition et histoire
La stigmatisation est définie par l’action de stigmatiser, d’attribuer des stigmates à autrui. Elle provient de l’étymologie latine, « stigma, stigmatis » : elle est empruntée à l’étymologie grecque « stigma » : marqué au fer rouge. Le verbe stigmatiser signifie donc au sens propre : marquer d’une trace, imprimer une marque sur le corps. En Grèce antique, les esclaves fugitifs entre autres, étaient stigmatisés au sens où ils étaient marqués au couteau ou au fer rouge afin d’exposer leur caractère indésirable aux yeux de la cité, la société. Au Moyen-âge, en Occident, le mot est utilisé davantage avec une connotation religieuse désignant ainsi les marques corporelles laissées par la grâce divine (les supplices du Christ) mais il est aussi utilisé au sens médical pour désigner les signes et séquelles d’une maladie. Ce terme a été étudié plus tard par deux hommes en particulier dont le premier est le sociologue et linguiste américain Erving Goffman. Selon lui, « la stigmatisation d’un individu intervient lorsque celui-ci présente une variante relative par rapport aux modèles offerts par son proche environnement, un attribut singulier qui modifie ses relations avec autrui, constitue un écart par rapport aux attentes normatives des autres à propos de son identité et en vient du fait à le disqualifier en situation d’interaction. » (Goffman, 1963). Chaque individu est stigmatisé en fonction des circonstances, avec des stigmates divers et variés, mais E. Goffman les classe en deux catégories différentes : les stigmates « visibles » et les stigmates « invisibles ». Les stigmates dits visibles correspondent aux attributs physiques et aux traits de personnalité directement apparents lors du contact social, par exemple une personne atteinte d’un nanisme. Au contraire, les stigmates dits invisibles comprennent toutes les facettes de l’individu difficilement décelables lors d’un contact visuel avec celui-ci, par exemple la séropositivité d’un individu. Dans son livre écrit en 1975, Stigmate – Les usages sociaux du handicap, E. Goffman décrit donc plus explicitement le stigmate comme l’attribut qui rend l’individu différent de la catégorie dans laquelle on voudrait le classer. Howard Becker, sociologue également, a davantage étudié le terme de déviance et, dans ce contexte, a rapporté que les personnes stigmatisées peuvent choisir de cacher l’identité socialement vue comme étant déviante, ou encore de se l’approprier par quatre étapes que sont : l’exposition, l’apprentissage, la dissimulation du stigmate et l’adhésion à la culture déviante. Il a, dans son livre Outsiders, également développé la théorie de l’étiquetage social, qui a pour conséquence la stigmatisation sociale.
Mécanisme de la stigmatisation
Si l’on reprend une définition plus récente des processus menant à la stigmatisation, issue de travaux en psychologie sociale, plusieurs autres notions importantes vont émerger, notamment celles de rejet et de déshumanisation. Le concept est décrit en 2001 par Link et Phelan qui définissent le mécanisme comme un cercle vicieux avec plusieurs étapes regroupées dans le figure 7 ci-après.
La première étape est l’étiquetage, étape la plus connue, qui est, associée à la catégorisation des individus, caractérisée par une sélection des différences entre individus qui dépend de leur importance dans le champ social. Ainsi, ces différences deviennent représentatives du tout. On peut aisément citer comme exemples la couleur de peau, l’orientation sexuelle, etc.
Ensuite, dans la seconde étape, ces étiquettes sont associées à des stéréotypes qui englobent un ensemble de caractéristiques indésirables, de défauts ; cela revient à dire que stéréotyper c’est attribuer des défauts à une personne étiquetée.
La troisième étape est celle de la séparation, plus précisément, la séparation en deux groupes : « eux » et « nous ». L’association entre l’étiquette attribuée à des individus et les caractéristiques indésirables reliées entraine une différence actée entre ces individus et le reste de la société. Ces croyances peuvent avoir des conséquences importantes, puisqu’il conviendrait, de fait, de traiter différemment les individus stigmatisés puisqu’ils n’auraient pas la même considération de leurs besoins : dans leur réalisation personnelle, les relations sociales ou bien même dans leurs échanges émotionnels.
Enfin, la dernière étape du processus de stigmatisation est la discrimination et la privation du pouvoir social. Elle constitue la conséquence même des trois étapes précédentes. De facto, la personne stigmatisée, à partir d’éléments de différences superficielles, se voit dévalorisée, mise à l’écart, exclue de son rôle social. De même, cette chute dans la hiérarchie sociale devient dans ce processus, à elle-même une source de stigmatisation pour l’individu, illustrant le caractère vicieux de ce cercle (Link & Phelan, 2001).
Ainsi décrite, la stigmatisation n’est pas qu’un simple étiquetage mais aussi l’exclusion d’une personne et la perte d’un statut social. Cette exclusion peut également aller jusqu’à la déshumanisation, et donc la perte du caractère humain au-delà de la perte du statut social.
Déshumanisation
La déshumanisation peut être définie, par exemple dans le Larousse, comme le fait de « faire perdre son caractère humain à un individu ou à un groupe, lui enlever toute générosité, toute sensibilité ». En psychologie sociale, on parle de déshumanisation pour définir un processus psychologique qui voit une personne traiter une autre personne comme inférieure à lui et au genre humain. Depuis l’Antiquité, ce processus de déshumanisation d’un groupe d’individu est observable, l’esclavage des peuples dits « barbares » dans le monde antique en est une illustration très ancienne. Au Moyen-Âge, la déshumanisation prend une dimension religieuse chrétienne comme le montre la controverse de Valladolid où, après la découverte du Nouveau Monde, les espagnols s’interrogent sur le fait que les peuples amérindiens possèdent ou non une âme et de ce fait s’ils sont pourvus d’humanité et dignes de Dieu. Pourtant, c’est le XXème siècle, notamment avec les deux guerres mondiales et les génocides, qui amène les psychologues sociaux à s’interroger plus précisément sur ce processus (Kelman, 1973). Dans les années 1970- 1980, ces nombreuses réflexions s’étendent progressivement vers la déshumanisation avec un travail sur le désengagement moral, autrement dit comment l’être humain peut-il s’affranchir de « barrières morales » pour mettre en place ce processus de déshumanisation envers les autres ou envers lui-même (Bastian & Haslam, 2010). Assez récemment, les travaux se précisent davantage sur le domaine médical, où l’on montre que l’expérience de déshumanisation a un impact psychique sur l’estime de soi, l’épuisement émotionnel ou encore les troubles psychosomatiques (Caesens et al., 2017). Aussi, il est montré que plus une personne est perçue comme difficile à aider, plus elle a tendance à être déshumanisée (Cameron et al., 2016). Il n’est finalement dans ce contexte plus étonnant de pouvoir associer aujourd’hui les notions de stigmatisation et de déshumanisation aux champs de la santé mentale, et en particulier concernant les troubles d’usage de substances, et notamment aux patients présentant un TUAL (Berwart, 2018; Fontesse et al., 2019, 2020).
Impact en santé mentale et dans l’addictologie
Stigmatisation et troubles psychiatriques
Historiquement, les individus souffrant de troubles psychiatriques ont très tôt été pointés comme des ennemis et rejetés. Désignés comme « possédés » par les démons au Moyen Age, l’Eglise condamne au bûcher toutes les personnes accusées de sorcellerie. Au début du XXe siècle, pendant la période asilaire, les personnes souffrant de troubles psychiques perdaient fréquemment leur statut social et étaient enfermées dans des asiles, ou à défaut dans des prisons (Bonsack et al., 2013). Entre 1939 et 1941, sous le régime nazi, l’opération « Aktion T4 » consistait en l’extermination des personnes présentant un handicap physique et/ou psychique. Pendant cette période de guerre, en France, les asiles étaient laissés à l’abandon sans soignant, contraint à s’auto organiser, laissant un taux de mortalité important. A la suite des travaux d’Erwing Goffman, la stigmatisation en santé mentale a largement été étudiée mais également ces dernières années, montrant ainsi que les pathologies psychiatriques tendaient toujours à être mises à l’écart, discriminées, non seulement par le tout public, mais également par le corps soignant (Trifiletti et al., 2014). Les troubles schizophréniques ont été la pathologie de prédilection dans ces recherches. En 2010, l’étude INDIGO (International study of Discrimination and stiGma Outcomes) est coordonnée par le King’s College de Londres sur un vaste échantillon de 732 individus dans 28 pays différents. Elle montre l’impact de la discrimination des personnes souffrant de schizophrénie dans plusieurs domaines de leur vie à savoir dans leur travail, dans leurs relations sociales au sens large et en particulier au sein de leur famille. Cette étude met aussi en lumière la stigmatisation et discrimination anticipée, définie ci-dessus, menant à une perte certaine d’opportunité au niveau de l’emploi, de l’accès au soin et des interactions sociales pour ces personnes atteintes de schizophrénie (Daumerie et al., 2012; Park et al., 2013). Finalement, les personnes présentant des troubles psychiatriques sont perçues depuis très longtemps comme dangereuses, agressives, voire nuisibles, et c’est cela qui entraine cette stigmatisation et ce rejet social (Schomerus et al., 2013). La déshumanisation de ces personnes va de pair avec cette stigmatisation, elle a d’ailleurs été qualifiée de « réponse de défaut » des personnes qui jugent les patients souffrant de troubles psychiatriques, les considérant comme menaçants (Fontesse et al., 2019).
Stigmatisation et addictions
Le champ des addictions n’est pas non plus épargné par la persistance d’un jugement sociétal à l’égard de ses pathologies, et la littérature scientifique l’étaye volontiers. Tous les troubles d’usage de substances sont stigmatisés (Luo et al., 2014; Room, 2005). Les pathologies psychiatriques sont fréquemment associées à des troubles d’usage de substances, augmentant d’autant plus le risque de stigmatisation en cas de pathologie duelle, notamment en ce qui concerne les troubles de l’humeur et les troubles anxieux (Glass et al., 2014). Les personnes souffrant d’un trouble d’usage de substances souffrent également de sérieuses répercussions : au-delà des effets délétères résultant de leur pathologie, elles sont également impactées dans leur vie sociale et professionnelle (Luoma et al., 2007). Ces conséquences sur l’accès à l’emploi, l’accès au logement ou encore sur les relations sociales sont plus sévères chez des personnes souffrant d’un trouble d’usage de substances comparé à des personnes souffrant de schizophrénie (Corrigan & Watson, 2006; Perlick, 2001). Ces attitudes stigmatisantes peuvent mener les consommateurs de substances vers un degré élevé de marginalisation sociale, les « toxicomanes » étant considérés comme ne méritant pas de soutien social ou d’empathie (Corrigan et al., 2009). Room, dans son article publié en 2005 décrit les résultats d’une étude dirigée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) menée sur 14 pays montrant que les troubles d’usage de substances se classaient en tête sur une liste de 18 en termes de degré de désapprobation sociale et de stigmatisation. Aussi, dans 11 pays sur 18, le trouble d’usage d’alcool était plus désapprouvé socialement qu’avoir un casier judiciaire pour cambriolage. Il cite également des études des pays anglophones où il est montré que les personnes dépendantes à des substances sont qualifiées comme devant être moins prioritaires dans les soins car jugées comme responsables de leur comportement addictif (Room, 2005).
Le trouble d’usage d’alcool, pathologie centrale de ce travail, est en effet largement concerné par les stigmates. En effet, Fontesse et al. ont récemment réalisé à ce sujet une étude multicentrique sur 120 patients atteints d’un trouble d’usage d’alcool. Non seulement les patients se sentaient déshumanisés, mais ils voyaient leurs besoins fondamentaux menacés. L’étude montrait une association de cette déshumanisation avec un maintien dans la pathologie addictive par le biais du recours à la consommation d’alcool comme stratégie dysfonctionnelle de coping, précipitant la rechute. Un des patients avait formulé « j’ai essayé de tout oublier », illustrant bien le recours à l’alcool comme pour soulager un malaise interne (Fontesse et al., 2019). Schomerus, plus tôt, avait déjà affirmé dans une revue de la littérature que le trouble d’usage d’alcool était l’un des troubles mentaux les plus sévèrement stigmatisés, au sens où les personnes alcoolodépendantes étaient moins reconnues comme souffrant d’une maladie mais plutôt comme responsables de leur trouble, mais aussi considérées comme plus dangereuses et plus imprévisibles que des personnes dépressives ou schizophrènes, provoquant ainsi plus de rejet et de discrimination au plan institutionnel comparativement aux troubles psychiatriques sans trouble d’usage d’alcool (Schomerus et al., 2011). Plusieurs types de stigmatisation concernent la population alcoolodépendante, et notamment la stigmatisation perçue, qui freine considérablement l’accès au soin et peuvent en partie expliquer la faible demande de soins, mais aussi la possibilité pour les patients d’expliciter leurs difficultés liées à l’addiction (Keyes et al., 2010).
Impact clinique
Outre le nombre important de personnes concernées par la problématique addictologique, souligné dans la première partie de l’introduction, un chiffre a été le point de départ de la rédaction des mes travaux, de mémoire pour commencer puis de thèse : moins de 10 % des personnes souffrant d’un trouble de l’usage d’alcool sont dans les soins en Europe (Abramovici et al, 2014). L’absence de recours aux soins a des origines multiples, et parmi elles les mécanismes de stigmatisation et de rejet social, mais aussi d’auto-stigmatisation. En effet, l’auto-stigmatisation est une résultante de la stigmatisation elle-même. Autrement dit, c’est parce que les individus sont stigmatisés qu’ils internalisent des stéréotypes qu’on leur a auparavant attribué. Goffman a écrit à ce sujet : « l’individu stigmatisé vivant dans une société y acquiert inévitablement certains critères d’identité qu’il s’applique à lui-même même s’il échoue à s’y conformer, il ne peut qu’éprouver de l’ambivalence à l’égard de sa propre personne. ». L’impact de cette auto stigmatisation dans les troubles addictologiques, comprend donc par extension l’augmentation des émotions négatives, la diminution de l’estime de soi, la réduction des émotions positives et la précarité dans les stratégies de coping fonctionnelles des patients alcoolodépendants (Fontesse et al., 2019). Il en résulte que l’on peut voit apparaitre chez les patients la mise en place de stratégies d’évitements pour dissimuler leur perte de contrôle dans les consommations à leur entourage, mais aussi aux professionnels de santé. De plus, il faut rappeler que le phénomène d’auto-stigmatisation ne se limite pas à « cette résonnance » des attitudes sociales négatives. Elle induit également une auto-inhibition des personnes stigmatisées dans plusieurs domaines comme les relations sociales et le domaine professionnel, ce qui aggrave la perte de l’estime de soi. Enfin, l’auto-inhibition est également un frein au rétablissement. Par exemple, une personne souffrant d’un trouble lié à l’usage d’alcool peut ne pas s’autoriser à consulter un médecin, ne pas postuler un emploi ou éviter des relations intimes en raison de la conviction qu’il n’est pas digne de confiance parce qu’il est alcoolodépendant. Enfin, sur le plan clinique, une crainte serait que l’auto-attribution de stigmates mène à l’augmentation de décompensation psychique, en plus de l’effondrement de l’estime de soi. Le risque que les personnes alcoolodépendantes présentent un mal-être psychique, des troubles anxieux et/ou des troubles dépressifs serait donc majoré, pouvant aggraver le risque de rechutes dans la pathologie addictologique et entretenant le patient dans sa dépendance notamment via le craving – envie irrépressible de consommer- dit de soulagement.
Et les femmes : non concernées, oubliées, stigmatisées ?
Les femmes et l’alcool
Les femmes sont, bien entendu, et sans véritable surprise, concernées par les consommations d’alcool. Selon le rapport de l’OFDT, en 2014 en France, 5% des 18-75ans étaient des femmes consommant quotidiennement de l’alcool, et 36% décrivaient un usage d’alcool au moins une fois par semaine. En 2016, on peut voir sur la figure 9 ci-après que dans de nombreux pays, notamment dans les pays développés, les femmes rejoignent les hommes en termes de prévalence d’usage d’alcool. L’usage d’alcool est défini comme la consommation d’alcool au moins 1 fois dans les 12 derniers mois. On peut donc ici faire le constat qu’en France, comme en Allemagne, au Royaume-Uni, en Norvège, en Suède, en Australie, en Nouvelle-Zélande ou encore en Argentine, la prévalence d’usage d’alcool est d’ailleurs la même que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, à savoir entre 80 à 100% (Griswold et al., 2018).
Présentation des lieux de soins addictologiques de CAEN
Le CHR Addictologie
Le service d’Addictologie du CHU (Centre Hospitalier Universitaire) de Caen Normandie est localisé au CHR (Centre Hospitalier Régional), site distinct du site principal. Il est composé d’une équipe pluridisciplinaire comprenant des médecins de formation psychiatrique ou généraliste, d’internes de différentes spécialités, d’une psychologue et d’une neuropsychologue, d’une assistante sociale, d’une diététicienne, d’une équipe paramédicale formée à l’addictologie et de deux secrétaires médicales. Il dispose de 19 lits d’hospitalisation complète, accueillant majoritairement des patients alcoolodépendants, souvent des sevrages complexes, c’est à dire de substances multiples ou pour des addictions très sévères. On compte aussi la présence d’un hôpital de jour, d’une unité de liaison sur les service somatique et psychiatrique du CHU, et d’une activité de consultations externes médicales, psychologiques, neuropsychologiques et infirmières. Au-delà de l’activité de liaison au CHU, il y a également une activité spécifique de liaison à la maternité du CHU de Caen.
Classiquement, un patient peut intégrer l’hospitalisation de manière majoritairement programmée pour un cycle dont les premiers jours sont consacrés au sevrage, puis l’on propose au patient de participer à une semaine de psychoéducation en atelier de groupe, 33 semaine appelée « Informations ». Ensuite, il peut intégrer l’hôpital de jour qui, lui, centre son activité sur la prévention de la rechute, mais cet HDJ peut aussi être axé sur la remédiation cognitive en cas de besoin, besoin évalué au préalable.
Les CSAPA
Les CSAPA (Centre de Soin d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) sont des structures médico-psycho-sociales ayant pour mission d’accompagner toute personne en difficulté avec une conduite addictive, avec ou sans produit. L’anonymat est possible et les consultations ne sont pas payantes car financées par des fonds publics.
A Caen, le CSAPA associatif dépendant de l’Association Addictions France, anciennement ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoolisme et Addictologie). Il est séparé en deux endroits distincts : les CSAPA dits Rive droite et Rive gauche. Le CSAPA Rive droite se trouve au deuxième étage d’un pôle de santé, et accueille des patients avec des pratiques addictives diverses, notamment des troubles d’usage de tabac, d’alcool, de cannabis, mais également des patients atteint de troubles du comportement alimentaire ou souffrant d’addictions comportementales. Ils ont également en place une consultation jeune consommateur adjoint à la maison des adolescents. Le CSAPA Rive gauche lui est plus isolé géographiquement même s’il est au cœur de Caen et non loin du CHR, et dans un bâtiment plus ancien. Son accueil est davantage centré sur les patients souffrant de troubles d’usage d’alcool. Ce centre a un fonctionnement singulier d’accueil sans rendez-vous, ce qui en fait sa particularité. Un des addictologues de la structure a aussi une partie de son activité d’addictologue au centre pénitentiaire de Caen, notamment axée sur l’accompagnement à la sortie de détention.
Les CSAPA sont composés d’équipe également pluridisciplinaire, comprenant des médecins addictologues de formation généraliste, des infirmiers, psychologues, secrétaires médicales, assistants sociaux, de cadre socio-éducatif et pour le CSAPA Rive Droite, d’un éducateur. Ils proposent des activités de consultations, mais aussi des groupes de paroles, des thérapies de groupes, des interventions en milieu extérieur à visée d’information ou de prévention.
Recueil de données épidémiologiques locales
J’ai contacté les trois lieux de soins évoqués ci-dessus via leur secrétariat médicaux, qui m’ont orientées vers le directeur de l’association pour le CSAPA et vers le DIM (Département d’Information Médicale) pour le CHU. Je leur ai fait la demande d’accéder au ratio hommes/femmes de patients consultant leur service depuis 2016, année par année. Les autres données qui auraient pu être intéressantes, telles que des données socio-démographiques plus précises sont recueillies indépendamment du sexe du patient, et donc n’auraient pas été exploitables dans ce travail axé sur les femmes.
Après ce recueil de données récentes et locales, il a été question d’inclure deux femmes suivies au sein de ces structures dans une courte revue de cas. J’ai pu les rencontrer, et recueillir leur témoignage ainsi que de faire une passation des échelles décrites ci-après.
Cas cliniques féminins
Tout d’abord, pour la recherche et l’élaboration de deux cas cliniques, j’ai contacté les médecins des deux structures addictologiques de Caen : Dr CHIARETTI pour le CHU et les Drs GALTIER et BURRI pour le CSAPA Rive gauche. Je leur ai demandé si une femme dans leur patientèle actuelle pouvait répondre aux critères recherchés à savoir :
– Une femme souffrant d’un trouble d’usage d’alcool selon le DSM-5 (Diagnostic and Statistical of Mental disorders version 5) sans autre trouble d’usage hormis le tabac
– Agée de plus de 18 ans
– Francophone
– Accord de la patiente
Le critère principal d’exclusion était la présence d’autres troubles d’usage (hors tabac) ou de pathologie psychiatrique en décompensation qui aurait pu représenter un biais important, ainsi que la présence d’autres troubles qui aurait pu empêcher la passation des échelles et/ou la description clinique, comme par exemple les troubles cognitifs.
J’ai ensuite contacté les deux patientes qui m’ont donné leur accord, puis les ai rencontrées dans les structures dans lesquelles elles sont suivies sur le plan addictologique. L’entretien a duré environ deux heures, et a été semi dirigé, en deux parties. La première partie retrace en détail le parcours global de la patiente, familial, professionnel, de soins somatiques, psychiatrique puis addictologique. Nous avons fait ensemble un génogramme pour retracer leur environnement familial. Il est important de préciser la temporalité dans laquelle arrive cet entretien vis-à-vis du positionnement actuel de la patiente dans son suivi addictologique. La seconde partie est composée de la passation des échelles décrites ci-dessous ainsi que d’un entretien davantage qualitatif autour de la stigmatisation. L’accord de la patiente a été la priorité, les entretiens ont été avec leur accord enregistrés et les cas cliniques anonymisés. Pour pouvoir garder une certaine comparabilité de ces deux cas cliniques et maintenir cette caractéristique de l’entretien semi dirigé, les entretiens ont été réalisés à partir d’un guide d’entretien préalablement écrit et joint en annexe (cf Annexe 2) qui détaille le déroulement des rencontres avec les deux patientes.
J’ai, pour finir, rencontré à nouveau les patientes quelques semaines plus tard pour leur faire un retour des passations d’échelles ainsi qu’un debriefing sur le vécu de cette expérience. Voici le descriptif des échelles utilisées.
A noter également que dans la discussion, il m’a paru pertinent de me saisir à nouveau d’un travail précédent auprès de la population masculine ; les cas cliniques réalisés sont joints en annexe et permettrons en comparaison aux cas cliniques réalisés pour ce travail, de discuter des spécificités féminines.
Présentation des échelles utilisées
Questionnaire Audit-C
Le test abrégé Audit-C est la version courte du test Audit mis au point sous l’égide de l’OMS pour permettre un repérage précoce des consommateurs d’alcool, tout comme le questionnaire FACE (Fast Alcohol Consumption Evaluation) (Saunders et al., 1993). Il a notamment été évalué au cours des années 2000 en médecine générale. Ce test explore les comportements des douze derniers mois en prenant en compte la fréquence de la consommation d’alcool, le nombre d’épisodes d’alcoolisation ponctuelle importante ainsi que la quantité d’alcool ingérée lors d’un jour de consommation type.
|
Table des matières
I) Introduction
II) Généralités
1- Trouble d’usage d’alcool
A) Données épidémiologiques
B) Modèle bio psycho social
C) Regard sociétal français
2- Stigmatisation
A) Définition et histoire
B) Mécanisme de la stigmatisation
C) Déshumanisation
D) Différents types, dont l’auto-stigmatisation
3- Impact en santé mentale et dans l’addictologie
A) Stigmatisation et troubles psychiatriques
B) Stigmatisation et addictions
C) Impact clinique
4- Et les femmes : non concernées, oubliées, stigmatisées ?
A) Les femmes et l’alcool
B) Les femmes, l’alcool et la stigmatisation
III) Objectifs et Méthodes
1- Présentation des lieux de soins addictologiques de CAEN
A) Le CHR Addictologie
B) Les CSAPA
2- Recueil de données épidémiologiques locales
3- Cas cliniques féminins
A) Présentation des échelles utilisées
a) Questionnaire Audit-C
b) Echelle HAD (Hospital Anxiety and Depression)
c) WEMWBS
d) Echelle d’estime de soi de Rosenberg
e) ISMI
IV) Résultats
1- Recueil de données épidémiologiques locales
A) État des lieux des soins des femmes dans les structures caennaises
2- Cas cliniques féminins
A) Situation clinique de Mme X
a) Eléments biographiques et démographiques
b) Anamnèse
c) Prise en charge
d) Evaluation
B) Situation clinique de Mme Y
a) Eléments biographiques et démographiques
b) Anamnèse
c) Prise en charge
d) Evaluation
V) Discussion
1- Points forts et limites de ces démarches
A) Recueil de données épidémiologiques locales
B) Cas cliniques féminins
2- Mise en perspective des situations cliniques
A) Mise en perspective des cas cliniques féminins entre eux
B) Mise en perspective des cas cliniques féminins avec deux cas cliniques masculins
3- Enjeux clinico-thérapeutiques et axes de recherche
A) Enjeux clinique et thérapeutique
B) Axes de recherche et application à Caen
VI) Conclusion
VII) Bibliographie
VIII) Annexes
Télécharger le rapport complet