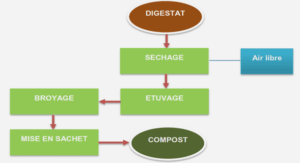Rendue possible par les découvertes scientifiques majeures du vingtième siècle, l’exploitation de la matière fissile a édifié un marché mondial de l’énergie nucléaire. Très vite, le souci de restreindre les applications de cette énergie au domaine civil et la nécessité d’en maîtriser les conséquences quant à la santé des populations ont encouragé les Etats-Unis, puis la communauté internationale, à réglementer et contrôler l’accès à ce marché. C’est ainsi qu’est créée l’agence internationale de l’énergie atomique (A.I.E.A.) en 1957, dont l’objectif est de promouvoir les usages pacifiques de l’énergie nucléaire et dont une des missions est d’établir des normes de sûreté nucléaire. Dans un document récent, l’A.I.E.A. érige dix principes fondamentaux de la sûreté nucléaire, auparavant définie de la manière suivante :
« Sûreté désigne la protection des personnes et de l’environnement contre les risques radiologiques et inclut la sûreté des équipements et des activités à l’origine de ces risques. (…) La sûreté concerne les risques radiologiques en situation normale ainsi que ceux engendrés par des incidents, ou encore ceux pouvant résulter de la perte de contrôle du cœur d’un réacteur nucléaire, d’une réaction en chaîne, d’une source radioactive ou de toute source de rayonnements. Les mesures de sûreté incluent les actions de prévention des incidents et les dispositions mises en place pour limiter leurs conséquences quand ils ont lieu. » (AIEA 2006)(5-6).
Enjeux et problématiques de la thèse
En fait, la présence d’un organisme producteur d’expertises de sûreté nucléaire n’est pas spécifique au système de contrôle français ; les T.S.O. (technical and scientific support organizations ou organisme d’appui scientifique et technique), ont même fait l’objet d’un premier colloque international en 2007 , dont le but était d’expliciter les bonnes pratiques de gestion de ce type d’organisme. Chaque participant affirmait l’existence d’un T.S.O. dans le système de contrôle externe de la sûreté nucléaire de son pays et soulignait l’importance de ses fonctions. Toutefois, il aurait été utile de se demander si l’unité véhiculée par le recours à l’acronyme T.S.O. était fondée par une activité générique. De nombreux participants – dont l’auteur, ont ainsi regretté l’absence d’exemple détaillé, qui aurait pu permettre de répondre à cette question, dont la pertinence est accentuée par l’existence d’une grande variété des statuts des différents T.S.O. ; celui-ci pouvant être par exemple un département de l’autorité de réglementation, comme aux Etats-Unis ou en Suède, ou encore un institut indépendant regroupant activités d’expertise et de recherche, comme en France, en Allemagne ou en Belgique (Le_Déaut 1998) . D’autres variables, comme le nombre d’exploitants, semblent avoir un impact non négligeable sur le fonctionnement du système de contrôle externe , et donc probablement sur l’activité d’expertise.
Les intervenants de cette conférence internationale ne sont pas les seuls à indiquer le manque d’informations concrètes relatives aux modalités de production d’expertise de sûreté nucléaire. L’absence de recherche empirique sur le fonctionnement des systèmes de contrôle externe des risques industriels est soulignée par plusieurs représentants du monde académique. C’est notamment le cas de Mathilde Bourrier, qui dans un récent état de l’art (2007), note que « les acteurs de l’administration, placés en marge des sites – autorités de contrôle ou de tutelle, ont peu fait l’objet d’investigations . (…) Tandis qu’on a focalisé souvent sur les lieux de production du risque, au plus près des acteurs de « première ligne », on a laissé de côté un certain nombre d’autres acteurs, au poids grandissant, mais dont on sait en définitive peu de choses sur les logiques et les critères d’action. » (162-163) Outre-Atlantique, les représentants du courant de recherche sur les organisations à haute fiabilité (high reliability organizations) indiquent que « les relations exploitants nucléaires-NRC ont fait l’objet de peu d’études de niveau microscopique. La plupart des recherches sur la NRC se sont concentrées sur des problématiques de niveau macroscopique comme les politiques de régulation et les réformes associées, au détriment d’études de cas portant sur les relations de travail entre les installations et les inspecteurs de la NRC » (La_Porte and Thomas 1995)(114). Et dans un article de synthèse, Pierre Benoît Joly (2005) note que les récentes recherches sur l’expertise « disent finalement peu de chose (…) sur la façon dont les experts règlent leurs rapports avec leurs collègues et avec les autres acteurs de la gestion des risques (…). » (160) .
Le dispositif de recherche
Les données empiriques sur lesquelles s’appuient les analyses ont été obtenues par le biais d’une recherche-intervention (Moisdon 1984; Hatchuel and Molet 1986; Bayart 1992; David 2000), méthodologie particulièrement utilisée par les chercheurs du centre de gestion scientifique de l’Ecole des mines de Paris. Historiquement, c’est notamment pour pallier les insuffisances de l’entretien afin de saisir le fonctionnement des organisations que cette approche fut mise en œuvre. « Quand on va interviewer des gens (…) et qu’on leur dit : quel est votre comportement, ils ne répondent pas sur le comportement en question, ils répondent sur tout autre chose, ou sur un comportement officiel, mais en tout cas pas sur le comportement qui consiste à dire « moi, vous savez, de toute façon, je dois tenir tel objectif de tonnage » (…) Ce n’est évidemment jamais ce qu’ils racontent. Donc il faut entrer dans un travail de terrain beaucoup plus minutieux pour essayer de découvrir ce qui les « tient ». » Ce travail de terrain s’effectue généralement dans le cadre d’une collaboration étroite entre les chercheurs et les représentants d’une organisation, qui, en formulant une demande, sont souvent à l’origine du projet. Le partenariat peut s’étaler sur une période assez longue (plusieurs années), et nécessiter des instances de pilotage qui permettent de s’assurer de son bon déroulement.
Pour recueillir des données pertinentes sur une activité méconnue, exercée à l’intérieur d’institutions présumées opaques, et pour s’affranchir de discours convenus sur son efficacité, une recherche-intervention semblait donc adaptée. Elle fut réalisée en collaboration avec une équipe d’experts du T.S.O. français, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (I.R.S.N.), spécialistes des facteurs humains. Ces spécialistes sont regroupés au sein du service d’études des facteurs humains (S.E.F.H.), rattaché à la direction de la sûreté des réacteurs de l’institut (D.S.R.)
Le partenariat aura duré près de quatre années, incluant une première période consacrée à une mission effectuée dans le cadre d’un D.E.A. Dans le Tableau 1, on a indiqué différents éléments caractéristiques du dispositif de recherche, en précisant notamment la demande formulée par le représentant de l’équipe d’accueil et la place occupée par le chercheur au sein de l’équipe d’accueil. On peut distinguer deux phases de la recherche-intervention, définies par les demandes successives formulées par le responsable du S.E.F.H.
Modèles d’activité d’expertise, formes de contrôle et théorie de la capture
L’expertise de sûreté nucléaire que nous nous proposons d’étudier est dédiée au contrôle des installations nucléaires civiles. Pour cette raison, parmi les recherches aboutissant à l’explicitation de modèles d’activité, nous mobilisons tout autant celles consacrées à l’expertise [3.1.] que celles consacrées au contrôle [3.2.] Alors que ce dernier terme est employé par les chercheurs en gestion, le vocable « régulation » lui est préféré par les économistes et les politologues. Certains d’entre eux ont mis au point une théorie, dite de la capture [3.3.], que nous mobiliserons, le système de contrôle français des risques radiologiques ayant souvent été qualifié d’opaque par ses détracteurs, et donc potentiellement soumis aux phénomènes résumés par ce terme.
Les modèles d’activité d’expertise
Au sein de la communauté de chercheurs qui s’est particulièrement intéressée aux processus d’expertise scientifique à partir des années 1980, il est courant de distinguer deux types d’expertise, en fonction du type d’institution qui la mobilise : l’expertise juridictionnelle et l’expertise scientifique à finalité politique. Les institutions de la justice ont rapidement fait intervenir des experts ; ainsi, « le droit romain admet le recours à des experts lorsqu’est requis un savoir-faire : l’expert est sollicité pour pratiquer des mesures, des évaluations. » (Leclerc 2005)(27) Cette longue histoire contribue à expliquer la prégnance du modèle juridictionnel dans les mentalités. Pour expliciter une représentation « spontanée » de l’activité d’expertise, un modèle canonique, nous nous inspirerons donc en partie des principes de l’expertise juridictionnelle [3.1.1.] Au sein même des sciences juridiques, cette représentation traditionnelle a toutefois été vivement critiquée ; Olivier Leclerc en a remarquablement dévoilé les mythes [3.1.2.] Un autre registre de critiques a été formulé par des chercheurs, souvent sociologues ou politologues, adeptes de démarches empiriques, et dont les recherches ont plutôt porté sur les expertises scientifiques à finalité politique. Pierre-Benoît Joly expose deux modèles, constituant une alternative au modèle canonique, auxquels nous ferons référence [3.1.3.] .
Le modèle canonique
Avant d’en critiquer la véracité, Olivier Leclerc (2005) énonce quelques-uns des principes sur lesquels repose l’expertise juridictionnelle, principes que l’on peut associer à une représentation traditionnelle de l’expertise. « L’expertise se singularise comme une mesure mettant un savoir spécifique à la disposition d’un juge chargé de trancher un litige. Ainsi, l’expertise remplit une fonction d’assistance à la décision : l’expert fournit au juge des éléments de fait qu’il intègre dans le processus de décision. Cette répartition des fonctions s’est mise en place sous l’ancien droit ; elle structure aujourd’hui le droit français de l’expertise juridictionnelle. L’expert possède une compétence propre qui échappe au juge : il doit la mettre à disposition de ce dernier et il ne peut, en aucun cas, s’ingérer dans la fonction de jugement proprement dite. Là est l’essence de sa mission, mais aussi sa limite. Le juge tranche les litiges, quand l’expert ne donne qu’un avis. Telle est la répartition des rôles qui émerge – combien progressivement – de l’histoire du droit de l’expertise juridictionnelle. » (67) Cette répartition des rôles est justifiée par les fondements logiques du raisonnement juridique : « Le jugement peut être décrit comme obéissant à la structure logique du syllogisme. La majeure est constituée par la règle de droit applicable, la mineure recouvre les faits qui doivent être tenus pour constants et qui constituent une ou plusieurs conditions nécessaires à l’application de la règle de droit. La conclusion du syllogisme en découle : les effets de la règle de droit s’appliquent – ou non – aux faits déterminés. » (80) La structure syllogistique garantit dès lors l’indépendance du juge et de l’expert, le théorique cantonnement de l’expert dans le domaine de la factualité ; « le juge maîtrise l’ensemble de l’opération syllogistique alors que l’expert n’intervient qu’au niveau de la mineure. » (81) Par ailleurs, « le droit français prohibe la délégation par le juge de son pouvoir juridictionnel : seul le juge accomplit des actes juridictionnels. En contrepoint, l’expert ne saurait effectuer de tels actes : il ne peut empiéter sur l’office propre du juge. » (125) On peut résumer ces premiers éléments déterminant les fonctions du juge et de l’expert et leur relation par les trois premières propositions inscrites dans l’Encadré 1.
Une partie de la thèse d’Olivier Leclerc est consacrée aux dispositifs institutionnels de l’expertise juridictionnelle. Le système juridique français se caractérise notamment par une présélection des experts qui seront nommés par le juge ; les listes d’experts agréés auprès des juridictions constituent « l’outil central de sélection des experts en droit français. » (200) « La compétence de l’expert est garantie par l’inscription sur les listes d’experts et par la certification de ses connaissances avant même le déroulement du procès. Lorsqu’il intervient au cours de ce dernier, la question de sa compétence est déjà traitée. » (253) « L’inscription sur une liste joue donc comme un effet de signal : sont identifiés des professionnels qui peuvent être occasionnellement désignés par les tribunaux. » (243) Deux conséquences de ces énoncés nous intéressent particulièrement :
1. Le droit français considère que le savoir détenu par l’expert est indépendant de l’expert lui-même ; toute personne identifiée sur une liste d’experts étant substituable par une autre personne inscrite sur la même liste ;
2. Le droit français considère que l’acquisition de la compétence légitimant le titre d’expert se fait en dehors du processus d’expertise.
|
Table des matières
Introduction générale
1. Enjeux et problématiques de la thèse
2. Le dispositif de recherche
3. Modèles d’activité d’expertise, formes de contrôle et théorie de la capture
4. Arguments et plan de la thèse
Première partie. Dialogue technique & Facteurs humains : une présentation historique
Chapitre 1. L’émergence des facteurs humains dans les institutions du dialogue technique
1. La naissance de la sûreté nucléaire en France au Commissariat à l’énergie atomique
2. Le développement du programme électronucléaire français
3. L’accident de Three Mile Island
Chapitre 2. L’inscription des facteurs humains dans des processus d’expertise
1. Généalogie des produits des spécialistes « facteurs humains » de l’institut
2. Les institutions de la sûreté nucléaire restructurées
3. Les modalités d’organisation de l’expertise « facteurs humains »
Conclusion de la première partie : des déterminants historiques et institutionnels de l’expertise « facteurs humains » ?
Deuxième partie. La fabrique de l’expertise
1. Sélectionner
2. Suivre
3. Restituer
Chapitre 3. La contribution au réexamen de la sûreté de Minotaure
1. La phase amont de l’expertise
2. La phase de cadrage (décembre 2004 – mars 2005)
3. La phase d’instruction (mars – juillet 2005)
4. La phase de rédaction (juillet – décembre 2005)
5. La phase de transmission (décembre 2005 – mars 2006)
6. Synthèse
Chapitre 4. L’analyse des incidents d’Artémis
1. La phase amont de l’expertise
2. La phase de cadrage (octobre – novembre 2005)
3. La phase d’instruction (novembre 2005 – janvier 2006)
4. La phase de rédaction (février – mars 2006)
5. La phase de transmission (mars – août 2006)
6. Synthèse
Chapitre 5. La gestion des compétences des personnels d’exploitation des centrales nucléaires
1. La phase de cadrage (septembre 2004 – janvier 2005)
2. La phase d’instruction (février – août 2005)
3. La phase de rédaction (septembre 2005 – février 2006)
4. La phase de transmission (février – mars 2006)
5. Synthèse
Conclusion de la deuxième partie : les singularités de la fabrique de l’expertise
Troisième partie. L’efficacité de l’expertise
Chapitre 6. Persuader ou convaincre : efficacité rhétorique et cognitive de l’expertise
1. Les savoirs lacunaires de l’expertise « facteurs humains »
2. La littérature à l’épreuve de la prescription
3. Rationalité institutionnelle et cognitive des spécialistes « facteurs humains »
Chapitre 7. L’efficacité opératoire de l’expertise : maîtriser les forces du dialogue technique
1. De la prescription à l’action : les effets potentiels de l’expertise
2. La régulation par le dialogue technique
3. Pour une maîtrise du dialogue technique
Conclusion de la troisième partie : rééquilibrer les dimensions de l’efficacité
Conclusion générale
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet