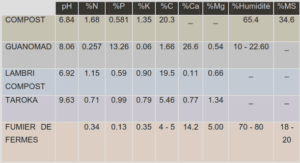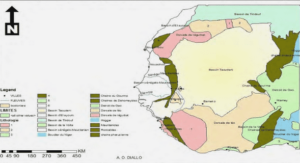Les modifications des modes de vie et des modes de production à l’échelle mondiale sont de plus en plus étudiées comme des facteurs d’accélération de la crise environnementale en cours. L’agriculture intensive apparaît comme l’un des principaux facteurs des dégradations environnementales, en particulier l’érosion de la biodiversité (Merino et al., 2019). Dans ce contexte de transformations, les relations des humains à la nature, ainsi que les façons dont elles se transforment, sont de plus en plus étudiés par les scientifiques (Ives et al., 2017). Dans ma thèse, je m’intéresse globalement à la multiplicité des relations qui existent entre les agriculteurs⸱trices et la nature dans des paysages marqués par l’agriculture intensive, et aux façons dont ces relations se complexifient, en lien avec les changements en cours. Mon travail se situe dans le champ de la géographie de l’environnement, dans la continuité de ce que Sarah Whatmore (2006) décrit comme le retour matérialiste en géographie, qui se caractérise en particulier par l’attention portée aux pratiques concrètes et aux relations entre les humains et les vivants non humains (les plantes, les animaux). Ma thèse vise à étudier quels types de relations aux vivants non-humains, ainsi qu’aux sols, coexistent dans le cadre de l’agriculture marchande (Scheromm et al. 2014), et à montrer comment des relations fondées sur les notions d’attention, de vulnérabilité, d’interactions, peuvent s’expérimenter et s’apprendre, malgré l’existence pour les agriculteurs⸱trices de préoccupations économiques et productives à l’égard de la nature avec laquelle ils⸱elles interagissent.
ETUDIER LES RELATIONS A LA NATURE EN AGRICULTURE A TRAVERS LE CARE
Contexte : crise de la biodiversité et agriculture intensive
Changements globaux et crise de la biodiversité
Dans le contexte de mutations multiples, à la fois écologiques, politiques et sociales globales, la période actuelle se caractérise par de nombreux changements dans les modes de vie des populations humaines à l’échelle mondiale, à travers notamment l’urbanisation et la mobilité croissantes, l’essor du commerce mondial, ou encore l’usage des technologies. Les modifications des activités humaines combinées à la croissance démographique (la population humaine a doublé au cours des 50 dernières années) affectent profondément les écosystèmes. Le dernier rapport de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) (Merino et al., 2019) insiste sur le fait que le rythme des changements globaux survenus dans la nature au cours des 50 dernières années est inédit dans l’histoire de l’humanité. La crise environnementale en cours prend la forme combinée de dérèglements climatiques, d’une érosion de la biodiversité, et de la multiplication de crises sanitaires. La cadence des facteurs de changements diffère toutefois selon les régions et les pays. De fortes inégalités montrent que toutes les populations, toutes les régions du monde, ne contribuent pas également aux dégradations environnementales, et montrent aussi que certaines populations ainsi que certains espaces sont plus exposés à ces dégradations. La crise environnementale est en effet, aussi, une crise sociale. Ainsi, les vulnérabilités climatiques sont aussi révélatrices d’inégalités sociales fortes, comme le montrent les travaux issus du champ des inégalités environnementales (Walker, 2012). Par ailleurs, dans ce contexte de crises et de changements multiples, des contradictions peuvent également apparaître, et montrer que les changements en cours sont plus complexes qu’une opposition entre progrès et amélioration du bien-être pour certain⸱e⸱s et dégradations environnementales et vulnérabilités fortes pour d’autres. Comme l’écrit le philosophe Pierre Charbonnier (2020), une contradiction existe dans la crise environnementale en cours, qui se présente dans une réalité sociale différenciée, qu’il résume par l’idée selon laquelle il est possible que, dans l’ensemble, nous vivions mieux, dans un monde qui se dégrade.
La biodiversité peut être définie à partir de l’article 2 de la Convention sur la diversité biologique (United Nations, 1992) comme la variabilité des organismes vivants de toute origine, cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes. La biodiversité comprend d’autres niveaux de variabilité, telles que la variabilité des traits d’histoires de vie (Cardinale et al., 2012), ainsi que les interactions et les phénomènes évolutifs qui existent au sein et entre les différents niveaux d’intégration (Mace et al., 2012). L’IPBES reconnaît ainsi le caractère dynamique de la biodiversité (variabilité dans le temps et l’espace). En France, le Ministère de la transition écologique définit la biodiversité comme le tissu vivant de la planète, ce qui recouvre l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, etc.) ainsi que toutes les relations et interactions qui existent, d’une part, entre les organismes vivants eux-mêmes, d’autre part, entre ces organismes et leurs milieux de vie . De nombreux indicateurs existent pour mesurer les effets des activités humaines sur la biodiversité, à différentes échelles. De nombreuses études révèlent que le déclin de la diversité taxonomique, phylogénétique et fonctionnelle se révèle particulièrement alarmant lorsqu’on l’étudie à l’échelle des espèces ou en termes de biomasse (Pollock et al., 2017 ; Ceballos et al., 2017 ; Hallmann et al., 2017). A l’échelle des espèces, le taux actuel d’extinction est de 100 à 1000 fois plus élevé que le taux d’extinction avant la révolution industrielle (Pimm et al., 2014). Au niveau mondial, 41% des espèces d’amphibiens, 13% des espèces oiseaux, 25% des espèces de mammifères et 20% des espèces végétales connues sont menacées d’extinction. Afin de suivre ces évolutions, le WWF a proposé la constitution des indices planète vivante (IPV), qui suivent les variations au cours du temps de la valeur moyenne des populations d’espèces. Ces populations sont tirées de la base de données Planète Vivante, qui contient des informations sur plus de 22 000 populations de mammifères, oiseaux, poissons, reptiles et amphibiens sauvages. L’IPV mondial est fondé sur un peu plus de 16 700 de ces populations.
Les valeurs de l’IPV mondial représentent l’évolution moyenne de l’abondance de la population, fondée sur le changement relatif et non sur le changement absolu, dans l’effectif de la population. En 2018, le rapport WWF concluait que l’abondance moyenne de 16 704 populations représentant 4 005 espèces suivies dans le monde avait diminué de 60 % depuis 1970 (Figure 1). En France, l’un des indicateurs qui permet de mesurer la crise de la biodiversité est le suivi de l’abondance des populations d’oiseaux communs spécialistes (c’est-à-dire les espèces communes des milieux agricoles, forestiers et bâtis), qui mesure le taux d’évolution de l’abondance des oiseaux communs spécialistes métropolitains. Les tendances observées entre 1989 et 2018 indiquent une diminution de 23% de l’abondance pour les oiseaux communs de manière générale . Elles montrent plus particulièrement une diminution de 38% pour les espèces des milieux agricoles, et une diminution de 24% pour les espèces des milieux bâtis (Figure 2).
Selon l’IPBES, les facteurs directs de changement ayant eu les incidences les plus lourdes à l’échelle mondiale sur la nature sont la modification de l’utilisation des terres et des mers, l’exploitation directe des organismes, les changements climatiques, la pollution et les espèces exotiques envahissantes. Ces facteurs directs découlent d’un ensemble de causes sous-jacentes, qui reposent à leur tour sur des valeurs sociales et des comportements incluant les modes de production et de consommation, la dynamique et les tendances démographiques, le commerce, les innovations technologiques et la gouvernance depuis le niveau local jusqu’au niveau mondial (Figure 3). D’après l’IPBES, l’expansion agricole est de loin la forme la plus répandue de modification de la couverture terrestre, dans la mesure où plus d’un tiers de la surface terrestre est actuellement utilisé pour la culture ou l’élevage au détriment des forêts, des zones humides, des prairies et de nombreux autres types de couverture terrestre naturelle (Foley et al., 2005). D’autre part, la croissance démographique (Nelson et al., 2010), l’urbanisation et l’augmentation des revenus, qui sont liées à l’augmentation de la consommation de ressources par habitant (Liu et al., 2003), sont identifiées comme étant les principaux moteurs de la déforestation (Lambin and Meyfroidt, 2011). Sur cinq décennies, les changements les plus importants en pourcentage dans l’utilisation des terres sont associés aux zones urbaines, qui ont doublé en 1992-2015.
|
Table des matières
INTRODUCTION
PARTIE I. ETUDIER LES RELATIONS A LA NATURE EN AGRICULTURE A TRAVERS LE CARE
Chapitre 1. Les relations à la nature sous l’angle du care : Le cas de l’agriculture
Chapitre 2. Des enquêtes qualitatives auprès d’agriculteurs⸱trices en France et en Belgique
PARTIE II. RESULTATS DE LA THESE : CARE ET ECOLOGISATION DES PRATIQUES AGRICOLES
Chapitre 3. Cultiver les plantes : produire en prenant soin
Chapitre 4. Écologiser les pratiques et les relations à la nature
Chapitre 5. Apprendre à observer la nature
Chapitre 6. Des réseaux qui (s’)écologisent ?
DISCUSSION GENERALE
Bibliographie
Sitographie
Annexes
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet