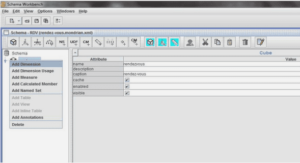Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
L’oreille interne
L’oreille interne, appelée aussi labyrinthe, est située dans le rocher et se compose de plusieurs parties principales : la cochlée, le vestibule avec l’utricule et le saccule, les trois canaux semi-circulaires, les deux aqueducs et le nerf auditif (composé du nerf cochléaire et des deux nerfs vestibulaires). L’oreille interne communique avec l’intérieur du crâne par le conduit auditif interne. Elle est constituée de deux parties structurelles : une partie osseuse “dure” de protection, appelée le labyrinthe osseux, et une partie “molle”, sensorielle, appelée le labyrinthe membraneux.
La cochlée, aussi communément appelée le limaçon, constitue le labyrinthe antérieur. Elle a la forme d’une coquille d’escargot et possède deux spires et demie.
Le noyau central de la cochlée s’appelle le modiolus. L’intérieur de la spire est un tuyau se divisant en trois tubes : le canal cochléaire qui contient l’organe de Corti et de l’endolymphe, la rampe vestibulaire en dessus et la rampe tympanique au-dessous.
L’organe de Corti repose sur la membrane basilaire et contient les structures sensorielles de l’audition : les cellules ciliées externes et internes.
Le vestibule est la partie médiane de l’organe de l’équilibre. Il est intercalé entre le conduit auditif interne et la caisse du tympan, et relie
les trois canaux semi-circulaires à la cochlée.
Le vestibule se compose de l’utricule et du saccule qui contiennent des structures sensorielles dans des zones appelées macules.
Les canaux semi-circulaires, au nombre de trois, constituent des tubes creux en forme de boucle incomplète dans les trois plans de l’espace.
Ils portent le nom de canal latéral, canal supérieur et canal postérieur. Ils sont ouverts dans le vestibule par leurs deux extrémités, dont l’une est dilatée pour contenir la structure sensorielle de l’équilibre, appelée ampoule.
Le conduit auditif interne Il est localisé en profondeur des canaux semi-circulaires et contient le nerf facial et le nerf auditif.
EPIDEMIOLOGIE
L’otite moyenne aiguë (OMA) est la pathologie la plus fréquente chez l’enfant avant l’âge de 6 ans et surtout entre 6 mois et 2 ans. Soixante-deux pour cent des enfants de moins d’un an et 83 % des enfants de moins de 3 ans ont déjà présenté au moins une OMA. Cette affection peut être également récidivante : 25 à 46 % des enfants de plus de 3 ans ont en fait plus de 3. La guérison clinique s’effectue spontanément dans 80 % des cas en moyenne.
Les garçons semblent plus souvent concernés par la maladie [11,22].
RAPPEL PHYSIOLOGIQUE:
L’oreille est un organe neurosensoriel qui assure les fonctions d’audition et d’équilibration. Nous ferons un rappel de l’audition qui est le rôle principal de l’oreille moyenne [23].
L’audition :
L’oreille externe et l’oreille moyenne jouent un rôle mécanique dans l’audition en transmettant le message sonore à l’oreille interne qui assure une fonction mixte (mécanique et neurosensorielle). Le pavillon localise, capte et concentre les sons vers le CAE.
Le CAE amplifie les sons et les conduit vers le tympan sous forme d’énergie sonore. La membrane tympanique va ainsi vibrer et transmettre le mouvement à la chaîne des osselets.
L’oreille moyenne transforme les vibrations aériennes qui atteignent le tympan en variation de pression dans les liquides de l’oreille interne.
Le mouvement de la platine de l’étrier et de la fenêtre ronde va ébranler les liquides Péri labyrinthiques, créant une énergie mécanique qui sera captée par les cellules nobles neurosensorielles de l’oreille interne.
La trompe d’Eustache adapte l’impédance des ondes transmises par voie aérienne à l’oreille interne. Ceci explique que son obstruction provoque une destruction de la caisse du tympan avec pour conséquence une rétraction de la membrane tympanique d’une part, et d’autre part la sécrétion d’un liquide séro-muqueux qui ne se draine plus.
L’intérêt de la physiologie est qu’elle permet de comprendre que toute perturbation de l’intégrité de la membrane tympanique ou du contenu de la caisse et de la trompe d’Eustache (infection, malformation, traumatisme, processus tumoral) entraîne à des degrés variables une perte auditive allant de l’hypoacousie à la surdité dite de transmission par défaut de conduction. Cette surdité s’oppose à la surdité de perception qui traduit une atteinte de l’oreille interne. Ces deux types de surdité peuvent s’associer donnant la surdité mixte.
PHYSIOPATHOLOGIE DES OTITES MOYENNES :
La pathogenèse de l’otite moyenne aigüe est multifactorielle. Deux facteurs sont principalement en cause : le dysfonctionnement tubaire et les infections rhino-pharyngées.
Les troubles des échanges gazeux au niveau de la muqueuse de l’oreille moyenne sont favorisés par le dysfonctionnement tubaire physiologique du jeune enfant. Celui-ci est lié aux particularités de la trompe d’Eustache de l’enfant (diamètre étroit, trajet court, horizontal, position plus basse de l’ostium dans le cavum, ouverture insuffisante dû à l’immaturité des muscles tubaires). Il existe d’autres facteurs de risque de dysperméabilité tubaire qui peuvent être :
Inflammatoires:
Adénoïdite et pharyngite
Rhino-sinusite
Allergie
Reflux gastro-œsophagien
11
Mécaniques:
Végétations adénoïdes
Œdème des bourrelets tubaires en cas de rhinopharyngite
Fente vélo-palatine
Congénitaux:
Trisomie 21
Maladie de Crouzon
Syndrome d’Apert
– Barotraumatique: Rare
Cette obstruction tubaire constitue le primum movens de l’OMA. Il s’en suit une dépression dans l’oreille moyenne, un collapsus des parois tubaires et une mauvaise aération de l’oreille moyenne. Ceci conduit à une métaplasie mucipare des cellules basales de l’épithélium de l’oreille moyenne. L’activité muco-ciliaire et le drainage des secrétions vers le cavum sont ainsi réduits. Cela favorise la formation d’un épanchement rétro-tympanique et la prolifération de germes. De plus, la colonisation microbienne de l’oreille moyenne à partir de la flore rhinopharyngée est acceptée par tous les auteurs.
Avant l’âge de 03 ans, 25 à 40 % des OMA sont précédées d’une infection des voies respiratoires supérieures. Ces infections sont très fréquentes surtout chez l’enfant en collectivité, elles sont d’étiologie virale dues à :
VRS
Rhinovirus
Adénovirus
Virus influenzae et parainfluenzae 1 et 3
CMV
Entérovirus
La surinfection bactérienne de la sphère ORL est favorisée par deux facteurs : l’immaturité immunologique du jeune enfant et l’inflammation secondaire à l’agression virale.
La réaction inflammatoire qui en résulte déclenche la libération de nombreux médiateurs (cytokines, TNF alpha, TNF bêta). Ces derniers renforcent l’adhérence bactérienne, stimulant la production de récepteurs sur les cellules épithéliales, modulant la réponse immunitaire et le chimiotactisme des polynucléaires et accentuant aussi la transsudation et la métaplasie de la muqueuse tubaire.
D’autres facteurs de risque d’OMA sont rapportés
Généraux:
Déficit en Ig G2 et Ig G4
Carence martiale
Dyskinésies ciliaires
Héréditaires:
Antigène HLA (sensibilité aux pneumocoques)
Environnementaux:
Vie en collectivité (crèches)
Saisons : période hivernale
pollution atmosphérique,
Autres : Influence de la prématurité, malnutrition (carence en vitamine A), le décubitus dorsal et le tabagisme passif.
Ce dernier favoriserait en plus la persistance d’un épanchement résiduel.
DIAGNOSTIC DES OTITES MOYENNES AIGUES :
DIAGNOSTIC POSITIF :
Le diagnostic de l’OMA est clinique. Il repose sur l’interrogatoire et l’otoscopie.
Le médecin qui examine l’enfant affirme le diagnostic sur l’association d’une symptomatologie d’apparition aiguë avec l’identification dans l’oreille moyenne d’un épanchement et de phénomènes inflammatoires.
Otite moyenne aigüe
L’otite moyenne aigüe (OMA) est caractérisée par un syndrome douloureux (otalgie ou pleurs le soir chez l’enfant) associé à une fièvre. L’otorrhée (écoulement de l’oreille) est liée à une perforation du tympan sous la pression de l’épanchement. Elle fait disparaitre la douleur. Avant l’âge de2 ans, peuvent exister des douleurs abdominales, diarrhée et vomissement. L’examen otoscopique confirme l’infection à des stades différents (otite congestive, collectée, perforée). . Cet examen nécessite une technique rigoureuse : l’enfant doit être correctement tenu afin qu’il ne puisse bouger la tête. Le CAE est débarrassé d’éventuels débris cérumineux. Le pavillon de l’oreille examiné est tiré doucement en bas et en arrière pour bien dégager le CAE.
L’évolution de l’OMA se fait généralement en 3 stades qui sont:
le stade d’otite congestive
le stade d’otite collectée
Le stade d’otite suppurée avec écoulement de pus (otorrhée) dans le CAE (cf Iconographies).
Stade d’otite congestive:
A ce stade, il existe des signes spécifiques et des signes non spécifiques. Les Signes spécifiques traduisent une otalgie : l’enfant pleure et tend la main vers l’oreille ou La frotte contre le drap. Les signes non spécifiques sont des signes généraux qui peuvent être:
la fièvre parfois élevée (39-40°C)
les troubles du sommeil et du comportement
les troubles digestifs à type de diarrhée et de vomissement.
L’otoscopie permet de montrer à ce stade un tympan plat, une modification de couleur avec un tympan rouge et la disparition des reliefs ; une modification de transparence dans laquelle le tympan est opaque et non translucide.
Stade d’otite collectée :
A ce stade, les signes ci-dessus cités sont plus marqués notamment l’otalgie qui devient plus importante se traduisant par une irritabilité plus importante. La fièvre persiste oscillant entre 39-40°C. A l’otoscopie on note un tympan épaissi de coloration lie de vin, une disparition des reliefs ossiculaires. La membrane tympanique est bombée traduisant la collection.
Stade d’otite suppurée:
L’otite suppurée traduit la rupture du tympan et s’accompagne d’un écoulement purulent dans le CAE. A ce stade, on a une disparition de la douleur, une défervescence thermique. Cette perforation peut se situer soit dans le cadran postéro-inférieur, ou dans le cadran postéro-supérieur.
L’otoscopie doit être complétée par:
– une rhinoscopie antérieure
– une oropharyngoscopie
– la recherche d’adénopathies cervicales
– la recherche de signes de mastoïdisme : la pression sur la face externe de la mastoïde provoque une douleur
Otite moyenne à tympan ouvert (OMO)
Les OMO se caractérisent par une inflammation et un œdème de la muqueuse de l’oreille moyenne. Il existe une métaplasie mucipare. « Oreille humide » est sans doute le terme qui caractérise le mieux cette entité. Certes, une surdité existe, d’importance variable, souvent négligée. Mais c’est le plus souvent pour une otorrhée que le malade finit par consulter. Cette otorrhée est habituellement minime, filante, inodore, mais permanente, mouillant parfois le conduit auditif externe et agaçant le patient. A l’occasion d’épisodes de réchauffement secondaires à une inflammation aiguë de la sphère rhino sinusienne ou à une baignade, elle devient purulente, abondante, et parfois fétide et blanchâtre.
A l’otoscopie, le tympan présente une perforation non marginale, soit antérosupérieure, soit centrale et réniforme. À travers cette perforation, la muqueuse apparaît œdémateuse, de couleur rose saumon et luisante. L’aspiration douce permet parfois de recueillir dans l’hypotympanum une
effusion plus ou moins épaisse, parfois de type « glue ear », qui témoigne de la transformation mucipare de la muqueuse promontoriale. Les osselets sont en règle normaux mais présentent parfois des lésions variables avec le degré et la durée de l’affection : bascule promontoriale ou lyse de l’extrémité du manche du marteau, ostéite avec ou sans interruption de l’articulation incudo-stapédienne, destruction de la superstructure de l’étrier.
DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE :
Le résultat des examens de laboratoire est le seul à pouvoir déterminer les germes incriminés dans une otorrhée permettant ainsi de mettre en œuvre un traitement spécifique. Le diagnostic bactériologique d’une otorrhée se fait selon un protocole respectant les étapes de l’examen cyto-bactériologique qui comporte le prélèvement , l’examen direct, l’isolement, l’identification du germe et la réalisation d’un antibiogramme.
Technique de prélèvement:
Les prélèvements sont habituellement réalisés par un écouvillonnage au niveau du CAE en évitant de toucher le pavillon de l’oreille.
Le transport des échantillons au laboratoire doit être immédiat, ou alors il est conseillé d’effectuer le prélèvement sur place au laboratoire.
Examen direct:
A l’aide de l’un des écouvillons utilisés pour le prélèvement, un frottis est réalisé sur une lame porte – objet et coloré au Gram. L’observation de cette lame au microscope en vue d’apprécier les éléments cellulaires et les germes en présence constitue l’examen direct.
Culture pour isolement des germes:
La culture des germes consiste à ensemencer des milieux de culture appropriés avec les sécrétions du pus d’oreille. L’oreille étant largement ouverte sur le milieu extérieur, presque tous les germes rencontrés dans les otorrhées sont des aérobies . Mais si la plupart des germes poussent facilement sur des milieux usuels, d’autres comme Haemophilus influenzae et Streptococcus pneumoniae ont des exigences particulières et nécessitent des milieux enrichis. Pour ces germes, l’incubation se fait à l’étuve à 37C en atmosphère humide et enrichie en CO2 en 18 à 48 heures.
L’emploi d’autres milieux peut être déterminé en fonction de l’examen direct.
Identification des germes:
Les bactéries isolées seront identifiées en fonction de leurs caractères morphologiques, culturaux, biochimiques et antigéniques.
De nombreuses bactéries peuvent être rencontrées dans le CAE. Mais tous les germes rencontrés ne sont pas forcément pathogènes, cependant, certaines d’entre elles sont fortement incriminées dans les otorrhées tels que:
Les Staphylocoques:
Les staphylocoques sont des cocci à Gram Positif appartenant à la famille des Micrococcaceae. Ce sont des bactéries commensales de la peau et des muqueuses [12, 37]. Leurs exigences nutritives sont variables, cependant, toutes les souches de staphylocoques sont capables de décomposer l’eau oxygénée grâce à leur catalase et de se développer sur des milieux contenantduchlorure desodium à la concentration de 7,5g%.
Lesstaphylocoques se présentent sous l’aspect de coccienpetits amas ou en très courtes chaînettes dans les produits pathologiques
Dans cegenreStaphylococcusaureus estuneespèce redoutable,car il produit de nombreuses substances favorisant l’extension de la maladie sous forme d’envahissement local (hyaluronidase) , de nécrose cellulaire (protéase, lipase), de foyers de thrombophlébite (coagulase), d’emboles septiques (fibrinolysine).
S. épidermidiset S. saprophyticuspeuventêtreégalementassociésà l’infection du CAE.
Enraison des nombreuses enzymes et toxinesqu’ellesproduisent, ces bactériessont particulièrement apteà produire dupus.
Les Streptocoques :
Les streptocoques appartiennent à la famille des Streptococcaceae. Ce sont des Cocci à Gram positif en chaînettes plus ou moins longues qui à l’inverse des staphylocoques ne possèdent pas de catalase. Ils sont asporulés et généralement acapsulés en dehors du pneumocoque. Ce sont des germes qui exigent des milieux enrichis pour leur culture
telles que la gélose au sang frais et la gélose chocolat. Ces bactéries sont également des commensales de certaines muqueuses comme la muqueuse buccopharyngée.
Dans ce genre, se rencontre Streptococcus pneumoniae qui serait incriminé dans 50% des cas d’otite moyenne chez l’enfant [41]. Les Entérobactéries :
Les entérobactéries sont des bacilles à Gram négatif généralement mobiles, aérobie-anaérobie facultatives, possédant une nitrate réductase, fermentant le glucose et caractérisées par l’absence d’oxydase. Elles se développent sur milieu de culture ordinaire. Ce sont des hôtes habituels du tubedigestifdel’homme.
Cette famille regroupe plusieurs genres rencontrés dans les otorrhées:
Escherichia : Escherichia coli
Proteus: Proteus vulgaris…
Klebsiella : Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca…
Enterobacter: Enterobacter cloacae…
Les Pseudomonas :
Cesont des bacilles à Gram négatiftrèsmobiles,aérobies stricts.
Ils appartiennent à la famille des Pseudomonadaceae et sont très répandus dans la nature; principalement dans l’eau douce et dans le sol. On les retrouverarement sur la peau etles muqueuses.
Enraisonde la richesse de leurs voies métaboliques,ils sont souvent capables de résister à de nombreux antiseptiques ouantibiotiques.
Dans ce groupe, on retrouve l’espèce Pseudomonas aeruginosa qui est un germe redoutable à cause de sa grande résistance à la plupart des antibiotiques.
Les Haemophilus :
Ce sont de fins bacilles immobiles à Gram négatif, caractérisés par leur polymorphisme. Les Haemophilus sont des germes commensaux des voies aériennes supérieures. Ce sont des parasites stricts des muqueuses de l’homme et de certains animaux.
En Europe, H. influenzae serait la deuxième cause des otites moyennes de l’enfant avec environ 20 % des souches isolées [12, 41].
Le rapport de stage ou le pfe est un document d’analyse, de synthèse et d’évaluation de votre apprentissage, c’est pour cela chatpfe.com propose le téléchargement des modèles complet de projet de fin d’étude, rapport de stage, mémoire, pfe, thèse, pour connaître la méthodologie à avoir et savoir comment construire les parties d’un projet de fin d’étude.
|
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE
I. DÉFINITION
II. ANATOMIE DE L’OREILLE
II.1. L’oreille externe:
II.2. L’oreille moyenne
II.3. L’oreille interne
III. EPIDEMIOLOGIE
IV. RAPPEL PHYSIOLOGIQUE:
V. PHYSIOPATHOLOGIE DES OTITES MOYENNES
VI. DIAGNOSTIC DES OTITES MOYENNES AIGUES
VI.1 DIAGNOSTIC POSITIF
1.Otite moyenne aigüe
2. Otite moyenne à tympan ouvert
VII – DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE
VII.1 -Technique de prélèvement
VII.2 – Examen direct
VII.3 – Culture pour isolement des germes
VII. 4 – Identification des germes
VII.5 – Antibiogramme:
VIII. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
1. Otite externe
2. Otite congestive
3. Otite séromuqueuse
IX. COMPLICATION DES OTITES MOYENNES AIGUES
1. Mastoïdite
2 Autres complications de l’OMA
X. TRAITEMENT VACCINATION CONTRE : H. INFLUENZAE ET CONTRE LES PNEUMOCOQUES.
DEUXIEME PARTIE
I.2. MATERIEL ET METHODES
I.2.1. Type et durée de l’étude
I.2.2. Critères d’inclusion et de non inclusion
I.2.3. Collecte et analyse des données
RESULTATS
I. Epidémiologie
I.1 Âge
I.2 Sexe
I.3 Origine géographique
II. Données cliniques
II.1 Antécédents médicaux
II.2 Signes fonctionnels
II.3 Examen physique
II.3.1 Examen de la cavité buccale et de l’oropharynx
II.3.2 Rhinoscopie
II.3.3 Otoscopie
II.3.4 Prélèvement du pus
III. Données paracliniques
III.1 Radiographie standard du cavum
IV. Traitement
IV.1 Aspiration:
IV.2 Type d’antibiothérapie
IV.3 Anti-inflammatoire
IV.4 Antalgique
IV.5 Traitement à base de gouttes
V. Evolution
VI. Récidive
VII. Facteurs de risque
DISCUSSION
I.1 Âge
I.2 Sexe
I.3 Origine géographique
I.4 Facteurs de risque
II. Données cliniques
II.2 Signes fonctionnels
II.3 Aspect de l’écoulement
III. Traitement
III.1 Antibiotique
III.2 Anti-inflammatoire
III.3 Antalgique
III.4 Gouttes auriculaires
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ANNEXE
Télécharger le rapport complet