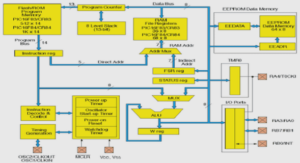Photographie et ready-made
Dans ses « Notes sur l’index » – d’abord parues en anglais en deux parties, en 1977, sous le titre « Notes on the Index : Seventies Art in America » et sous une forme légèrement différente de la version française – Rosalind Krauss établit les critères qui permettent de faire le parallèle entre photographie et ready-made et elle affirme que « Le parallèle entre la photographie et le ready-made est renforcé par le processus de production de celui-ci. Il s’agit chaque fois de transposer physiquement un objet hors du continuum de la réalité jusqu’à répondre aux conditions précises dont relève l’image artistique – et cela par isolation ou sélection. » . Le déplacement d’un objet hors du continuum spatio-temporel de la réalité que Marcel Duchamp effectue, en plaçant ses objets usuels préexistants dans le contexte muséal, procède de la même logique, selon Rosalind Krauss, que la fixation d’une image issue de la réalité par la photographie. 140 KRAUSS, Rosalind. “Notes on the Index : Seventies Art in America” (Part I), October, n° 3, printemps 1977, p. 68-81 ; id., “Notes on the Index : Seventies Art in America” (Part II), October, n° 4, automne 1977, p. 70-79. Ces deux articles ont été traduits en français par Priscille Michaud sous le titre “Notes sur l’index. L’art des années 1970 aux États-Unis”, Macula, n° 5/6, 1979, p. 165-175. “Notes on the Index : Part 1” et “Notes on the Index : Part 2” ont ensuite été republiés dans KRAUSS, R. The Originality of the Avant-garde and Other Modernist Myths, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1985, p. 196-209 et p. 210-220. Cet ouvrage a été traduit en français par Jean-Pierre Criqui : « Notes sur l’index », in Le Mythe de l’avant-garde et autres mythes modernistes, Paris, Macula, 1993, p. 65-92.
Toutefois, si le rapprochement de Rosalind Krauss entre ready-made et photographie semble valable pour le « procédé de production » – la transposition par isolation ou sélection – il nous semble toutefois que là où le sens de l’oeuvre, dans le cas du ready-made, naît du déplacement physique de l’objet, tel n’est pas le cas pour la photographie, qui ne déplace pas un objet physiquement mais matérialise la reproduction de son apparence, dans le cas où le référent est absolument reconnaissable.
De plus, ce processus d’isolation ou de sélection en photographie, dans le cadre de la première période de Walker Evans – celle qui concerne ses photographies depuis ses débuts en tant que photographe jusqu’à l’exposition « American Photographs » au Museum of Modern Art de New York en 1938 –, est essentiellement lié au sens esthétique du photographe. A l’inverse, dans une conférence donnée au MoMA en 1961, Marcel Duchamp insiste sur le caractère non-esthétique de ses choix : « Il est un point que je veux établir très clairement, c’est que le choix de ces ready-mades ne me fut jamais dicté par quelque délectation esthétique. Ce choix était fondé sur une réaction d’indifférence visuelle, assortie au même moment à une absence totale de bon ou de mauvais goût… en fait une anesthésie complète » . L’anesthésie de Marcel Duchamp se retrouve pourtant chez Walker Evans, dans la série de portraits qu’il a pris dans le métro new-yorkais entre 1938 et 1941. La figure 35 montre la mise en page d’une sélection de seize de ces portraits – ici, tous représentent des femmes – réalisée en 1959. Cette série de photographies ne sera dévoilée au public qu’en partie, sous la forme du livre titré Many Are Called, paru seulement en 1966, vingt-cinq ans après la production des photographies qui en sont le contenu. Selon Jean-François Chevrier, « le projet du métro déplace l’idéal d’impersonnalité du côté du ready-made duchampien », ce qu’il justifie en citant Walker Evans s’exprimant à propos de cette série, à une date inconnue : « Je voudrais pouvoir dire tranquillement que soixante-deux personnes sont venues inconsciemment se placer l’une après l’autre, pendant une période déterminée, devant une machine d’enregistrement fixe, impersonnelle, et que tous, quand ils sont passés dans le cadre du viseur, ont été photographiés, et photographiés sans qu’aucune décision humaine n’ait déterminé le moment de la prise de vue. ». On peut lire dans cette note de Walker Evans tous les points essentiels pour la compréhension de la série des portraits dans le métro.
Walker Evans a souhaité pour les « subway portraits » la neutralité la plus totale : ses prises de vue n’ont pas été déterminées par des choix esthétiques mais par un programme fixé avant le moment de la prise de vue, qui avait préétabli le point de vue, le cadrage et la durée du projet photographique. L’impersonnalité dont parle Walker Evans à propos de l’appareil photographique fait écho à l’absence totale de lyrisme de la part de l’opérateur et à l’anonymat des sujets photographiés. Walker Evans renforce le caractère processuel de l’opération en mentionnant le nombre exact de personnes venues se placer devant l’appareil : soixante-deux.
Comme le remarque très justement Jean-François Chevrier dans son commentaire, on peut reconnaître ici le radicalisme des procédures conceptuelles de la fin des années soixante. Peter Galassi reconnaît également cette filiation dans son introduction au catalogue de l’exposition « Walker Evans & Company » qui eut lieu au MoMA en 2000 : « Comme Evans l’avait fait avant eux, les leaders du mouvement Conceptuel des années 1960 étalèrent désintérêt philosophique et simplicité picturale comme des désinfectants sur le corps de l’art »145. Nous ajouterons qu’avant la fin des années soixante et l’Art conceptuel, la référence qui nous semble encore plus juste ici est la série de livres « proto-conceptuels » d’Ed Ruscha, pour l’idéal d’impersonnalité qui les anime, la préexistence d’un programme qui fixe les règles du jeu, son intérêt pour le déplacement et l’anonymat, mais enfin et surtout pour ce que Galassi appelle l’« esthétique conceptuelle d’anti-esthétique ». Chez Ed Ruscha, le style documentaire de Walker Evans s’entend en effet plutôt comme un non-style documentaire.
William Jenkins, dans son introduction au catalogue de l’exposition « New Topographics », commente la posture d’Ed Ruscha en tant que photographe : « Ses livres de photographies présentaient tout à la fois une rigueur pure, un humour pince-sans-rire et une telle désinvolture pour le statut des images que Ruscha pouvait utiliser des photographies qu’il n’avait pas prises. Ces images étaient dépouillées de tout artifice artistique et réduites à l’état de simples documents topographiques, riches en informations visuelles mais dépourvues de tout esthétisme, de toute expression d’émotion ou d’opinion. ». Les photographies en elles-mêmes sont peut-être de « simples documents topographiques », mais leur agencement en série dans des livres produits de manière industrielle et le programme qui a présidé à leur processus de production les distingue et leur confère un autre statut que celui de simple document.
Typologie, sérialité, programme
Entre 1938 et 1941, Evans accomplit un projet, les « subway portraits », qui comme le remarque Peter Galassi pour l’exposition « Walker Evans & Company », s’il avait été fait trois décennies plus tard, aurait été accueilli comme une contribution à l’art Conceptuel, qui explore la photographie comme une forme d’enregistrement automatique et sériel148. En effet, la série des portraits dans le métro new-yorkais représente un tournant dans l’oeuvre de Walker Evans. Désormais, il se concentre sur des sujets précis, présélectionnés, auxquels il consacre toute une série.
La sérialité est une des composantes majeures des oeuvres d’art minimal et conceptuel. Héritée d’une conception pop de la société de consommation, la série évoque également l’énumération impersonnelle d’un rapport de recensement.
Pour les « subway portraits », Walker Evans s’est installé à une place dans le métro avec son appareil sur le ventre, l’objectif pointant entre deux boutons de sa veste, une manette lui permettant d’actionner le déclencheur dans sa main, reliée à l’appareil via un câble caché dans sa manche. Ainsi, il a pu prendre discrètement des photographies des personnes assises dans le métro en face de lui. A ce propos, Walker Evans dira : « Les théoriciens attribuent à peu près tout à l’appareil photographique, excepté le fait qu’il peut être fait pour ne pas penser et pour ne pas transmettre les émotions de son opérateur. […] Je revendique que cette série d’images est la plus proche d’un enregistrement pur que les outils, les ressources et l’intelligence pratique à ma disposition pouvaient accomplir. »149. Les choix possiblement faits par le photographe sont en effet éliminés : choix d’angle, distance de vue, cadrage, etc. sont quasiment toujours les mêmes, ce qui permet à l’opérateur d’empêcher toute variable subjective d’apparaître. Le mode opératoire choisi par Walker Evans lui permet de standardiser son mode de prise de vue, et aboutir à un « enregistrement pur ».
Ce mode d’enregistrement pur du réel et la présentation en séries amènent Evans à élaborer de véritables typologies. Par exemple, les séries publiées dans Fortune, « Labor Anonymous » (1946) et « Beauties of the Common Tool » (1955), évoquent tout à la fois les traditionnelles études ou enquêtes, conçues comme des entreprises d’exploration, qui avaient fait la force de la photographie documentaire au dix-neuvième siècle en Europe comme aux Etats-Unis, et la radicalité des typologies conceptuelles à moitié scientifiques et à moitié artistiques de Bernd et Hilla Becher. La démarche photographique d’Eugène Atget pour le Vieux Paris, qu’on peut qualifier de documentaire et d’encyclopédique, mérite également d’être citée ici comme possible précédent.
A la suite des portraits dans le métro, des travailleurs anonymes et des outils communs, Evans a cherché à construire une typologie aussi rigoureuse des paysages urbains et suburbains. Comme le remarque Jean-François Chevrier, « il ne s’agissait pas pour lui de faire de la photographie un auxiliaire des sciences sociales, ni de l’apparenter à la littérature naturaliste ou « vériste ». Mais il s’était fixé des sujets d’enquête précis, à la fois pour se donner une discipline, pour éviter le style relâché des notations subjectivistes et des lamentos romantiques »150. En effet, le principe des enquêtes documentaire s’était perdu au début du vingtième siècle, puis avait resurgi avec la Crise sous une forme teintée de morale et de pathos, ce que Walker Evans rejetait absolument, comme par exemple dans les reportages de Margaret Bourke-White. Walker Evans rassemble dans ses typologies de purs enregistrements du réel ; cependant, il ne les envisage pas comme un amalgame de plusieurs documents formant une archive, mais plutôt comme des oeuvres distinctes rassemblées dans la logique d’une collection.
En 1934, cherchant quel mode opératoire adopter et quel programme se fixer, Walker Evans avait identifié le livre d’images (picture book) comme cadre et support d’une recherche sur la ville américaine. Jean-François Chevrier rapporte les propos de Walker Evans à ce sujet : « Je ne suis pas sûr qu’un livre de photos doive être identifié à un lieu. Ce qui m’intéresse, c’est la ville américaine. Je pourrais donc en utiliser plusieurs, en restant dans les choses typiques »151. Walker Evans trouve dans cette réflexion personnelle son programme, qu’il annonce à Roy Stryker – alors chargé de la coordination de la Farm Security Administration – en ces termes : « Des archives graphiques d’un centre industriel moderne, complet, complexe et picturalement riche. »1. Evans n’exclut pas, en 1934, l’intérêt pictural des sujets qu’il photographie. Il ne l’envisage toutefois pas comme seul critère de sélection du réel et se pose la question de la modernité, ce qui nous rappelle encore une fois la démarche du couple de photographes allemands Bernd et Hilla Becher dans leur enquête sur l’architecture industrielle de la Ruhr.
Typologie, sérialité et programme sont trois notions phares censées caractériser les démarches conceptuelles et notamment celles de Bernd et Hilla Becher. Pourtant, comme nous l’avons vu, certains travaux de Walker Evans comprennent déjà ces propriétés, bien avant la naissance de l’Art conceptuel et même de l’Art minimal. Jean-François Chevrier, dans un article intitulé « Documents de culture, documents d’expérience (Quelques indications) » paru en 2006 dans la revue Communications, tente d’expliquer le rapprochement des travaux des Becher avec l’Art conceptuel par l’ignorance des précédents en matière d’exploration et de photographie documentaire : « L’enquête menée par Bernd et Hilla Becher […] était au mieux rattachée aux recherches formelles de l’art minimal : on ignorait ses antécédents dans l’histoire de la photographie documentaire »153. Jean-François Chevrier expose ensuite les jalons qui ont permis la redécouverte des précédents en matière de photographie documentaire : la première grande exposition sur les missions géologiques, « The Era of Exploration », eut lieu à New York, au Metropolitan Museum of Art, en 1975. La même année, la George Eastman House de Rochester, futur International Museum of Photography, présentait une exposition intitulée « New Topographics, Photographs of a man-altered landscape ». Lewis Baltz, Bernd et Hilla Becher, Stephen Shore et Robert Adams, avec d’autres photographes, participèrent à l’exposition. Dans l’introduction au catalogue, William Jenkins place les photographes présentés dans la tradition de la photographie documentaire telle qu’elle a été plus ou moins redéfinie au début des années soixante par Ed Ruscha. Les caractéristiques communes entre les photographies présentées et celles d’Ed Ruscha se placent du côté de la description, une apparence de neutralité, une absence de style, des motifs issus du paysage contemporain. Mais une grande différence demeure : par exemple, les photographies de stations-service d’Ed Ruscha ne sont pas « à propos de » stations-service, mais elles sont autoréflexives : elles parlent du statut de la photographie pensée comme un ready-made au sein d’un livre autonome.
A l’occasion de l’exposition, Lewis Baltz dira : « Le document photographique idéal serait sans auteur ni art ». Cette phrase est citée dans l’introduction au catalogue de « New Topographics » et est emblématique d’une volonté de la part de la jeune génération de photographes américains de se replacer dans une forme de tradition du document photographique, héritée non pas, comme voudrait le démontrer William Jenkins, d’Ed Ruscha, mais, bien avant lui, de Walker Evans.
Ces deux expositions, « The Era of Exploration » et « New Topographics » marquent en effet le début de la reconstruction, sinon le renouveau d’une tradition. Nous allons voir comment cette tradition s’est effectivement transmise à travers plusieurs mécanismes, autour de problématiques liées au cinéma et à la critique du modernisme.
Walker Evans et le « destin de la photographie documentaire »
Le renouveau d’une tradition de la photographie issue du style documentaire de Walker Evans s’est organisée, après les deux expositions précitées, autour de problématiques liées au lien entre le cinéma et la photographie d’une part, et de la critique du modernisme d’autre part.
Walker Evans et le cinéma
Margit Rowell, dans son texte pour le catalogue de l’exposition « Ed Ruscha Photographe » qui eut lieu au Jeu de Paume en 2006, nous apprend à propos d’Ed Ruscha que « des photographes professionnels, comme Robert Adams, Lewis Baltz, William Eggleston ou Stephen Shore, ainsi que des réalisateurs de cinéma, comme Wim Wenders, ont également été marqués par son style prosaïque, ses thématiques terre-à-terre, et le climat de road-movie qui en émane. »155. Margit Rowell, en établissant ce lien entre Ruscha et d’autres photographes, semble faire écho au texte d’introduction au catalogue de l’exposition « New Topographics ». En effet, William Jenkins concentre une partie de cette introduction à établir la légitimé de Ruscha et défendre l’exemplarité de son cas pour le sujet traité : « Ruscha marquait un point, avec tant de clarté et de notoriété, que son importance en tant qu’antécédent aux travaux dont nous discuterons devrait être évidente. ». Nonobstant le fait que les photographes cités par Margit Rowell sont plus connus pour avoir exprimé leur admiration pour l’oeuvre de Walker Evans que pour celle d’Ed Ruscha, il est intéressant de noter la référence à ce « climat de road-movie ». Dans les livres d’Ed Ruscha, l’imaginaire de la route américaine est effectivement ancré.
De Twentysix Gasoline Stations (1963) à Thirtyfour Parking Lots (1967) en passant par Every Building on the Sunset Strip (1965), Ed Ruscha explore l’imagerie et les différentes caractéristiques d’une véritable culture de la route triomphante dans les Etats-Unis des années soixante. Mais on pourrait également situer ce climat de road-movie dans les photographies de Walker Evans. Comme nous l’avons vu, Evans a entre autres élargi la culture visuelle existante à la route et aux formes nouvelles qui en sont nées, révélant une part du réel qui n’avait jusque-là pas d’image. « Traverser le réel, l’éprouver, le sonder, c’est le révéler, mais le révéler c’est aussi laisser retentir sa charge fictionnelle latente. » remarque Jean-Christophe Bailly dans son essai intitulé Document, indice, énigme, mémoire publié dans l’ouvrage de Jean-Pierre Criqui consacré à l’image-document.
Unique moyen d’explorer les grands espaces américains, symbole d’une liberté absolue en lien avec l’essor de la société de consommation, cet imaginaire de la route révélé par Walker Evans et renforcé par Ed Ruscha laisse retentir sa charge fictionnelle dans le cinéma américain, comme le note Margit Rowell, mais aussi européen – on pense notamment à Jean-Luc Godard ou Michelangelo Antonioni.
Employé pour réaliser un reportage photographique lors d’une croisière sur un yacht privé vers Tahiti en 1932, Walker Evans s’est essayé aux techniques du cinéma, utilisant un film 35 millimètres (fig. 36). Le résultat est une succession de scènes abstraites d’une durée totale de douze minutes, intitulée Travel Notes (1932). Walker Evans n’était pas satisfait de cette première expérience avec l’image animée et ne montra le résultat qu’à peu de personnes. Pour autant, il n’en garda pas moins une attirance permanente pour le cinéma, sautant que chaque occasion qui lui aurait permis d’avoir la chance d’expérimenter de nouveau ce medium – en vain, malheureusement. Il est intéressant de noter ici que Lincoln Kirstein, ami et promoteur de Walker Evans, était ami avec Sergei Eisenstein.
Peter Galassi, dans le catalogue de l’exposition « Walker Evans & Company », file la comparaison entre les sujets d’Evans et ceux de Flaubert et postule que la culture du grand écran qui apparaît dans les photographies d’Evans vers 1930 est « héritière de la fiction sentimentale sans vergogne dans laquelle Emma Bovary s’échappa de son ennui provincial ». Cette culture du grand écran dont parle Galassi n’est pas celle « grand art du cinéma », cultivé et intellectuel, mais plutôt celle de la « séduisante et vulgaire illusion » des films comme divertissement populaire. Il poursuit : « C’était certainement en partie cette dimension sociale qui mena Evans – et plus tard Andy Warhol et Cindy Sherman – aux films. Pour un artiste curieux de l’individu solitaire face à l’édifice grouillant de la civilisation moderne, quel meilleur endroit où regarder ? »159. Le cinéma en tant que divertissement moderne est un des sujets privilégiés d’Evans à l’instar de l’automobile, des stations-service, du logement populaire, de l’architecture vernaculaire et des vitrines de magasin.
En outre, les liens entre Walker Evans et le cinéma dépassent la simple communauté de formes avec les road-movie. Au-delà de ses affinités personnelles, exprimées dans son répertoire iconographique – on peut à nouveau citer « Torn Movie Poster » (fig. 22) de 1931 ou encore « Cinema, entrance and posters, Havana » de 1933 dont le négatif est conservé au Metropolitan Museum de New York (fig. 37) – Walker Evans semble avoir entretenu avec le cinéma une relation intellectuelle, sensible à la fois dans ses sujets, sa conception de la photographie en tant que pratique et ses choix de présentation.
La collection comme montage
Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, Evans pense le lien entre ses photographies comme relevant du principe de la collection, le photographe devient donc lui-même un collectionneur. Lors d’une discussion avec des étudiants de l’université du Michigan en 1971, Walker Evans dira : « Les artistes sont, je crois, de manière figurée, des collectionneurs. J’ai déjà signalé que mon oeil collectionne. Tout bon collectionneur le fait. Celui qui s’intéresse aux premières éditions françaises du dix-neuvième siècle se fixe sur ça et y revient constamment par instinct. Mon oeil s’intéresse aux rues où il n’y a que des rangées de maisons en bois. Je les trouve et je les photographie. Je les collectionne. »160. Ce même sens de la collection se retrouve dans l’oeuvre de Dan Graham, qui malgré ses accents conceptuels, n’en attache pas moins d’importance à ses sujets.
Après la Seconde Guerre Mondiale, la télévision commence à se démocratiser véritablement, mais créer un film reste coûteux en équipement et en temps. En 1945, la marque Sony invente la première caméra portative Portapack, un outil très vite plébiscité par les artistes qui vont pouvoir créer des images animées seuls dans leur atelier. En 1958, Wolf Vostell serait le premier artiste à exposer un écran avec une image brouillée. Il se dispute la primauté de l’invention de l’installation vidéo avec Nam June Paik, dont l’ensemble de l’oeuvre est axée sur ce medium, et qui serait le premier à avoir exposé des moniteurs dans l’espace d’exposition. Walker Evans, lorsqu’il s’est essayé à l’image animée, regrettait de ne pouvoir établir une séquence cohérente. Peut-être que le format de la vidéo, qui n’implique pas les mêmes contraintes de narration qu’au cinéma, aurait pu convenir à Evans… en 1932.
Pour autant, Walker Evans poursuit ses recherches en photographie sur certains motifs en particulier, il confie d’ailleurs à Leslie Katz en 1971 : « Vous savez comment un collectionneur est. Il devient excessivement conscient d’un objet, il en tombe amoureux et ensuite le poursuit… C’est compulsif, et vous pouvez difficilement vous arrêter. ». La collection de Walker Evans possède son propre système d’organisation : les photographies, régulièrement rognées, recadrées, voire partagées en plusieurs morceaux, sont agencées sur la page de livre ou de magazine, ou bien sur les cimaises du musée, selon les principes du montage cinématographique. Par l’intermédiaire de Jay Leyda, spécialiste du cinéma soviétique et communiste dans les années 1930, Evans a pu prendre connaissance du cinéma soviétique – Eisenstein, Vertov, Dovjenko, Poudovkine – et s’en inspirer pour son propre travail. « Organisation de séquences, le montage est pour lui constitutif d’une dimension narrative de la photographie, opposée à l’autonomie picturale de l’épreuve isolée : il n’a cessé de modifier le cadrage de ses images, de les fragmenter, d’en extraire des détails qu’il combinait avec d’autres » souligne Jean-François Chevrier. Le premier exemple d’une telle organisation est évidemment American Photographs, qui n’est pas un simple album d’images à feuilleter, mais un livre construit, qui se lit à la manière d’un « recueil de poèmes en prose ou une suite de récits brefs, et qui interprète, dans l’espace (le volume) du livre, le modèle du montage cinématographique. ». Ce parallèle que Jean-François Chevrier fait entre la construction interne d’un livre de photographies et le montage cinématographique est révélateur de l’importance du montage non seulement comme procédé de communication, mais aussi comme constitutif d’une dimension narrative de la photographie : la photographie se raconte elle-même via son processus d’organisation interne. La pratique du « montage » comme mode narratif dans les livres d’images de Walker Evans, inspiré du cinéma, est plus proche, en effet de celle du film et de l’editing, que de celle du photomontage des avant-gardes européennes.
L’idée de montage documentaire comme collection est analogue à la méthode suivie par Walter Benjamin dans son projet de livre inachevé sur Paris entrepris à la fin des années vingt et repris en 1934, Paris capitale du XIXe siècle : le livre des passages. Selon Jean-François Chevrier, ce rapprochement permet, entre autres, de soustraire l’oeuvre d’Evans aux interprétations réductrices qu’en ont données les idéologues de la straight photography (ou de la street photography). « Les jeux de hasard, note Benjamin, la flânerie, la collection – ce sont des activités qui sont engagées contre le spleen. ». Derrière l’évidence psychologique, on peut reconnaître un projet commun au photographe américain et à l’essayiste allemand imprégnés de la mélancolie baudelairienne ; tous deux voient dans le présent des années trente le moment historique où se révèle une « catastrophe continuelle » (Benjamin), et cela à travers la contre-image d’un passé récent : le dix-neuvième siècle de la révolution industrielle. « Il faut, écrit Benjamin, fonder le concept de progrès sur l’idée de catastrophe. Que les choses continuent à « aller ainsi », voilà la catastrophe. ». Il s’agissait donc d’interrompre ce mouvement en extrayant du présent les traces d’un passé qui avait déjà sombré, dont subsistaient des objets témoins et des figures de survivants. Walker Evans, selon cette logique, créé une collection de fragments du passé proche qui grâce au montage en un corpus cohérent deviennent une force de résistance à la fatalité du temps qui passe.
Photographie documentaire et cinéma néoréaliste
Peter Galassi, dans le catalogue de l’exposition « Walker Evans & Company » qu’il a organisée au MoMA en 2000, analyse la posture de Walker Evans par rapport au cinéma comme divertissement moderne : « En dehors de l’usine et du bureau, le visage de la vie moderne était la culture de l’automobile et du cinéma ; après l’avènement du chemin de fer au dix-neuvième siècle, et avant les voyages aériens bon marché et la télévision, c’était par-dessus-tout à travers les voitures et les films que les citoyens ordinaires recevaient la propagation de la technologie ». Pour autant, Walker Evans adopte un regard spécifique sur cette nouveauté qui amène de profonds changements urbanistiques et sociaux : « Bien que les deux n’aient acquis que depuis peu leur crédibilité universelle, Evans ne les présenta pas comme des merveilles modernes, ni les célébra comme des symboles populaires de liberté et d’aventure. Dans ses images, ils sont considérés comme acquis, comme des parties du tissu de la vie quotidienne – typiques, inévitables, quelque peu usés et élimés. ». Dans la même logique, Lewis Baltz, photographe du nouveau courant documentaire défini par l’exposition « New Topographics », avait exprimé de manière personnelle ce rapport à la modernité : « La photographie peignait des situations exceptionnelles, des paysages théâtraux. Mais je ne vivais pas comme le philosophe naturaliste Thoreau ! Ma vie quotidienne se résumait plutôt à remplir le réservoir de ma voiture… ». Lewis Baltz, à l’instar de Walker Evans, voit dans la photographie un outil de représentation du réel en adéquation avec la réalité de la vie quotidienne contemporaine.
|
Table des matières
Remerciements
Avant-propos
Introduction
1. Walker Evans et l’Architecture
1.1. Walker Evans et l’architecture vernaculaire
1.1.1. Archéologie du temps présent
1.1.2. Une tradition visuelle élargie
1.2. Walker Evans et la dialectique “High and Low”
1.2.1. Des monuments ordinaires
1.2.2. La photographie au service de
1.2.3. « Deadpan », photographie et entropie de l’information
1.2.4. Dan Graham : dual reading
2. Walker Evans et la Littérature
2.1. Walker Evans écrivain
2.2. Walker Evans et Flaubert
2.2.1. Esthétique de la description et documentaire lyrique
2.2.2. Non-style documentaire et clarté graphique
2.2.3. Objectivité impersonnelle, « degré zéro » de la photographie et mort de l’auteur
2.3. Photographie et art conceptuel
2.3.1. Walker Evans « lettreur », le signe comme plus petit vecteur de signification
2.3.2. Photographie et ready-made
2.3.3. Typologie, sérialité, programme
3. Walker Evans et le « destin de la photographie documentaire »
3.1. Walker Evans et le cinéma
3.1.1. La collection comme montage
3.1.2. Photographie documentaire et cinéma néoréaliste
3.2. Walker Evans et le postmoderne
3.2.1. Modernité vs. Postmodernité
3.2.2. Appropriations de l’oeuvre de Walker Evans
3.2.3. Rémanences de l’oeuvre de Walker Evans
Conclusion
Bibliographie
Catalogues d’exposition
Ouvrages
Articles de périodiques
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet