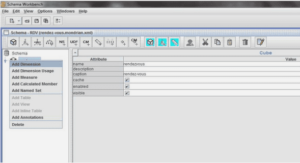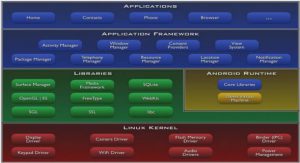Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Train complet vs le wagon isolé
Le fret ferroviaire en train complet, appelé également train entier, ou train-bloc est une forme du transport ferroviaire de marchandises qui consiste à former un train de marchandises acheminé directement de son point de chargement à son point de destination sans remaniement intermédiaire. Ce principe assure la rapidité et la fiabilité de l’acheminement et évite les aléas du passage par les gares de triage. Il permet une optimisation des conditions de traction en profitant de la pleine puissance de l’engin de traction (locomotive). Sa mise en place nécessite que la logistique des installations terminales soit adaptée aux opérations de chargement/déchargement du train dans les meilleures conditions compte tenu de la dimension de ces convois. Pour une meilleure rentabilité, ce schéma du transport exige un flux du transport suffisant pour bénéficier des avantages de la massification.
En France, par exemple, les trains entiers ont souvent une longueur limitée à 750 mètres et une charge de 1800 tonnes comme charge brute ou 1200 tonnes comme charge utile. Sur les lignes minières spécialisées, la taille et la longueur des trains-bloc peuvent atteindre des records. Dans ce cas, les contraintes liées à la résistance des attelages obligent dans certains cas à intercaler des locomotives au milieu ou en queue du train.
Le wagon isolé (ou train de lotissement) quant à lui consiste à acheminer des wagons individuels ou des groupes de wagons qui sont assemblés pour former des trains dans les gares de triage.
Les wagons sont expédiés depuis un ou plusieurs sites embranchés et passent par le relais de différentes gares de triage dans lesquelles les trains sont reformés. Un wagon isolé est donc intégré à plusieurs trains au cours de son voyage. Les trains du lotissement peuvent ensuite desservir plusieurs clients. En France, la filiale fret de la société nationale SNCF (Fret SNCF) appelle d’ailleurs son offre de wagon isolé multi lots/multi clients. Contrairement au train-bloc, il permet l’envoi et la réception de petits volumes (un seul wagon souvent) et la desserte d’un plus grand nombre de sites (de petites gares peuvent être ouvertes au trafic wagons isolés).
Les modes du transport de base
Ce type du transport autorise ainsi une desserte plus au moins souple, car moins régulière qu’avec un train-entier. Ce système, relativement coûteux (infrastructure, main-d’oeuvre) et moins fiable à cause des retards ou des pertes des wagons dans les gares de triage, et qui est, en outre, en concurrence, par la taille des envois, avec le transport routier, a vu sa part de marché fortement diminuer. Il a même été totalement supprimé dans certains pays, comme le Royaume-Uni, par exemple.
Principaux opérateurs
En Europe, le transport ferroviaire est géré par un ensemble d’acteurs institutionnels et privés, à savoir :
– Gestionnaire des infrastructures : c’est une entreprise chargée de la gestion d’un réseau ferroviaire, dont elle est généralement le propriétaire. Elle a comme missions la construction des lignes, des gares, l’entretien et la maintenance de ces installations. En France, par exemple, le propriétaire du réseau principal est Réseau Ferré de France (RFF).
– Tractionnaire ferroviaire : c’est une entreprise prestataire de services de traction de wagons sur un réseau ferroviaire. Ces services incluent la locomotive et le conducteur. La SNCF en France est, par exemple, le principal tractionnaire des trains de marchandises.
– Les loueurs de wagons : ce sont des entreprises spécialisées dans la location de wagons, de caisses mobiles ou des conteneurs pour des périodes pouvant aller de quelques jours à plusieurs années.
– Les opérateurs ferroviaires de proximité : ce sont souvent des PME ferroviaires locales ou des filiales de grands groupes (Europort filiale d’Eurotunel). Elles constituent une réponse nouvelle au transport de courte distance dans les territoires ou dans les ports.
Ils ont vocation à transporter des lots de wagons ou des trains déjà massifiés jusqu’à ou à partir d’un point d’échange avec un opérateur ferroviaire longue distance.
Mode routier
En France, le mode routier est aujourd’hui le mode du transport dominant avec plus de 80 % des parts de marché de transport terrestre [Merlin,1991]. La position dominante de la route est le résultat de sa capacité à s’adapter à l’économie contemporaine et aux évolutions de la logistique en raison de ses qualités intrinsèques (souplesse, unités du transport plus petites et plus flexibles) [Merlin,1991]. La figure I.2 ci-dessous montre la répartition modale des transports terrestres de marchandises en France en tonne-kilomètre. Une tonne-kilomètre est une unité de mesure de quantité du transport correspondant au transport d’une tonne sur un kilomètre.
Cette mesure a l’avantage de quantifier l’intensité du trafic d’un mode du transport sans double compte avec celui réalisé sur les modes suivants. Une des conclusions que nous pouvons tirer de la figure est que les parts de marchés perdues par le ferroviaire sont récupérées par le routier. Figure I.2 – Répartition modale des transports de marchandises en France
Parmi les atouts du transport routier de marchandises :
– le transport par camion est le seul mode qui peut atteindre les zones montagneuses, et d’une façon générale les lieux d’accès difficiles, tels que les milieux urbains denses où il n’y a plus d’espace disponible pour les grandes infrastructures de transport,
– la grande souplesse d’utilisation du transport routier offerte par l’utilisation de la voirie banale,
– cette souplesse permet, pour les distances courtes ou moyennes un service plus rapide que celui assuré par le chemin de fer,
– l’utilisation de la voirie locale permet d’éviter les transbordements, et permet aussi l’usage du camion comme complément du chemin de fer, de la voie navigable, du transport maritime ou aérien pour les transports finaux,
– sa capacité (en tonnes ou quelques dizaines de tonnes) réduit les groupages et le rend apte aux transports de marchandises en petites quantités, les plus fréquentes dans l’économie contemporaine,
– l’usage d’une infrastructure construite par les pouvoirs publics et entretenue par eux,
– la possibilité d’une organisation de la profession en petites entreprises qui assurent souventune bonne rentabilité et une utilisation optimale des investissements et du personnel.
Malgré ses multiples atouts, le mode routier est souvent pointé du doigt d’un point de vue environnemental. En effet, avec l’aérien, il contribue le plus aux émissions de polluants atmosphériques (particules fines et gaz à effets de serre) et nuisances sonores. C’est pour cette raison que plusieurs organismes gouvernementaux (autorités communautaires européennes et étatiques) essaient de plus en plus de réduire les parts du transport routier en proposant parfois des mesures drastiques via un ensemble de réglementations contraignantes et taxes sur les véhicules polluants.
Mode aérien
Durant les quarante dernières années, le transport aérien de marchandises a connu un fort développement grâce à l’augmentation des capacités des soutes des avions et à l’apparition des gros porteurs « Cargo » (figure I.3). Ce mode du transport bénéficie de plusieurs avantages :
– Rapidité : ce mode permet de prendre en charge les demandes urgentes.
– Sécurité : c’est le mode du transport le plus sûr avec le plus bas nombre d’accidents enregistrés.
– Régularité : la disponibilité des lignes régulières permet une bonne planification des flux de transport.
– Fiabilité : les nombreuses réglementations de la bonne traçabilité de fret aérien font de l’avion le moyen du transport le plus fiable.
Malgré ses nombreux avantages, ce mode du transport reste le mode le plus coûteux et le plus polluant également (émissions gazeuses et nuisances sonores).
Mode fluvial
Largement développé dans le Benelux et l’Allemagne où des interconnexions ont été réalisées entre les grands bassins fluviaux jusqu’aux pays de l’Europe centrale et de l’Est (liaison Rhin- Main-Danube), le réseau est de faible capacité en France et les voies fluviales principales Seine et Rhône ne sont pas encore connectées à grand gabarit au reste de l’Europe. Le problème des hautes et basses eaux est une contrainte de plus pour les chargeurs. A noter également la limitation de gabarit haut, imposée par les ponts, qui devient très contraignante en période des hautes eaux. Le transport fluvial se fait par des navires fluvio-maritimes, des péniches ou par des convois de barges porte-conteneurs poussés. La figure I.4 montre un exemple de convoi de barges.
Figure I.4 – Convoi de barges
Ce mode de transport bénéficie de plusieurs atouts :
– Compétitivité intrinsèque : le fluvial possède une forte compétitivité due à son caractère de massification des flux grâce à des économies d’échelle générée. Un convoi de barges par exemple peut remplacer plusieurs centaines de camions ou même plusieurs trains. A cela s’ajoute, sa liaison efficace entre les ports maritimes et les ports secs intérieurs (Rotterdam-Duisbourg, Dunkerque-Dourges, Le Havre-Gennevilliers) d’où partent les dessertes ferroviaires ou routières.
– Intérêt écologique : En remplaçant plusieurs camions, ce mode permet de générer des économies sur les quantités de CO2 émises dans l’atmosphère.
Pipeline
Appelé également transport par canalisation, il consiste à transporter des matières fluides au moyen de conduites constituant généralement un réseau. Les pipelines portent des noms spécifiques selon le produit transporté.
Figure I.5 – Pipeline Trans-Alaska
Les principaux systèmes du transport pipeline sont :
– gazoduc : Pour le transport du gaz naturel,
– oléoduc : Pour le transport des hydrocarbures liquides, dont surtout le pétrole,
– aqueducs : Pour le transport de l’eau douce, surtout pour l’irrigation,
– oxygénoducs : Pour le transport de l’oxygène.
Le transport par canalisation est le mode le plus compétitif pour le transport du pétrole ou du gaz naturel sur de grandes distances terrestres. Les fluides transportés par pipeline se déplacent dans des tubes en acier, soudés bout à bout, à des vitesses variant de 1 à 6 m/s. La pression et la vitesse sont créées par des pompes pour les liquides ou des compresseurs pour les gaz. Les oléodus peuvent transporter plusieurs types de liquides, en séquences appelés « trains ». Deux trains sont séparés par un mélange de produits. Le bouchon (ou zone) de mélange est éliminé à l’arrivée dans la station de réception.
Une comparaison entre les modes
En termes de capacité
L’importance de l’étude comparative des modes du transport par rapport à leurs capacités vient de l’économie d’échelle réalisée par les modes du transport de masse. En effet, l’économie d’échelle ne se limite pas à la production des biens, elle est également intéressante dans le secteur du transport ou on peut faire des économies importantes en utilisant les modes fluvio-maritimes et ferroviaires. La compétitivité intrinsèque de ces modes du transport massifiés vient de leurs grandes capacités qui amortissent leurs coûts fixes. La figure I.6 montre une comparaison des capacités de trois modes.
En termes d’émission
Le secteur du transport tous modes confondus est responsable de 14 % du total des émissions de gaz à effet de serre [UIRR,2009]. La mondialisation a permis de morceler les étapes de production et de les répartir géographiquement aux quatre coins de monde. Ainsi, certains pays se sont spécialisés dans la production des matières premières, d’autres dans leur transformation.
Cette dispersion des différentes activités de production a créé le besoin du transport par différents modes de transport. Les modes du transport consomment chaque année de grandes quantités d’énergie produites essentiellement à partir de matières fossiles. La figure I.7 représente la répartition des émissions par mode du transport [UIRR,2009].
Figure I.7 – Comparaison des modes par rapport aux émissions
Seuils de pertinence
La comparaison des coûts de transport des différents modes est une problématique très compliquée. En effet, les fonctions coûts de chaque mode de transport sont loin d’être de simples fonctions proportionnelles à une seule variable (distance). Toute étude comparative dans ce sens doit prendre en compte plusieurs paramètres qui rentrent en jeu (en partant des coûts et contraintes horaires des chauffeurs pour le mode routier, les coûts fixes de formation des trains pour le ferroviaire, les aléas climatiques pour le fluvio-maritime, etc.), et qui rendent ces fonctions non linéaires. Néanmoins, des seuils de pertinence théoriques et approximatifs peuvent être identifiés, pour chaque mode du transport en fonction de la distance. La figure I.8 montre les différents seuils de pertinence de chaque mode unitaire.
|
Table des matières
Introduction générale
I Transport multimodal : généralités et état de l’art
1 Introduction
2 Les modes du transport de base
2.1 Mode maritime
2.2 Mode ferroviaire
2.2.1 Train complet vs le wagon isolé
2.2.2 Principaux opérateurs
2.3 Mode routier
2.4 Mode aérien
2.5 Mode fluvial
2.6 Pipeline
2.7 Une comparaison entre les modes
2.7.1 En termes de capacité
2.7.2 En termes d’émission
2.7.3 Seuils de pertinence
2.7.4 Récapitulatif
3 Transport multimodal
3.1 Les unités de transport intermodal
3.2 Choix politiques et écologiques
4 Formes d’interface multimodales
4.1 Engins de manutention
4.1.1 Les grues et portiques de quai
4.1.2 Les portiques ferroviaires et fluviaux
4.1.3 Reach stacker
4.1.4 Chariot cavalier
4.1.5 AGV
4.2 Les ports maritimes
4.3 Terminaux de transport combiné rail-route
4.4 Terminaux de combiné fleuve-route
4.5 Nouvelles générations de terminaux multimodaux
4.5.1 Les ports secs
4.5.2 Terminaux de transbordement rapide rail-rail
5 Différentes formes d’intermodalité
5.1 Transport combiné rail-route
5.2 Transport combiné fleuve-route
5.3 Ferroutage et autoroute ferroviaire
5.4 Merroutage
5.4.1 Le feedering maritime
5.4.2 Le roulier
6 Organisation logistique et commerciale des chaînes de transport multimodal
6.1 Principaux acteurs de transport intermodal
6.2 Organisation du transport intermodal
7 Transport multimodal : état de l’art
7.1 Problématique de définition
7.2 Problèmes stratégiques
7.3 Problèmes tactiques
7.4 Problèmes opérationnels
7.5 Tendances et perspectives
7.5.1 La mutualisation
7.5.2 La synchromodalité
7.5.3 L’internet physique
8 Conclusion
II Localisation des terminaux intermodaux : modélisation et résolution
1 Introduction
2 Réseaux en étoile
2.1 Fonctions administratives
2.2 Fonctions d’exploitation
3 Position du problème
4 Formulation mathématique
5 Evaluation du coût intermodal
6 Résolution par algorithme génétique
6.1 Représentation des solutions
6.2 Population initiale
6.3 Opérateurs de croisement
6.3.1 Croisement de Laplace
6.3.2 Croisement arithmétique
6.4 Opérateurs de mutation
6.4.1 Mutation MPT
6.4.2 Mutation puissance
6.5 Schéma général
7 Réglages des paramètres de l’algorithme
8 Résultats numériques
9 Conclusion
III Modélisation des problèmes de transport multimodal au port du Havre
1 Introduction
2 Port du Havre
2.1 Système logistique actuel
2.2 Système logistique avec TMM
2.2.1 Composantes du TMM
2.2.2 Intêrets logistiques de TMM
3 Système DCAS
3.1 Projet DCAS
3.2 État de l’art sur le coupon
3.3 Réponse technologique et organisationnelle de DCAS
3.4 Un autre intérêt pour les entrepôts logistiques
3.5 Brouettages intraterminaux maritimes
3.6 Transfert terminal maritime centre de réparation
4 Modélisation des problèmes d’optimisations rencontrés
4.1 Problème du transfert des navettes ferroviaires
4.1.1 Description du problème
4.1.2 Circulation en noria
4.1.3 Formulation mathématique
4.2 Problème d’ordonnancement des trains et navettes sur la cour ferroviaire
4.2.1 Description du problème
4.2.2 Modélisation mathématique
4.3 Problème d’affectation des trains/navettes aux voies
4.3.1 Description du problème
4.3.2 Première formulation
4.3.3 Deuxième formulation
4.3.4 Troisième formulation
5 Conclusion
IV Résolution par méthodes de couplage optimisation simulation
1 Introduction
2 Généralités sur l’optimisation
2.1 l’optimisation mathématique
2.2 Optimisation combinatoire
2.2.1 Heuristiques et métaheuristiques
3 Généralités sur la simulation
3.1 Essai de définition
3.2 Les différents paradigmes
3.2.1 Simulation à évènements discrets
3.2.2 Simulation des systèmes dynamiques
3.2.3 Simulation multi agents
4 Comparaison optimisation simulation
5 Couplage optimisation simulation
5.1 Avantages du couplage optimisation simulation
5.1.1 Deux approches complémentaires
5.1.2 Test et optimisation de plusieurs scénarios
6 Modèle de simulation du port du Havre
6.1 Description de système simulé
6.2 Environnement de développement
6.3 Règles de gestion
6.3.1 Ordonnancement des trains de grandes lignes
6.3.2 Règles de manutention rail-rail
6.4 Optimisation via la simulation
6.5 Résultats de la simulation
6.5.1 Indicateurs organisationnels
6.5.2 Indicateurs financiers
6.5.3 Comparaison système actuel/système avec TMM
6.5.4 Comparaison système DCAS/TMM
7 Algorithme génétique basé sur la simulation pour l’affectation des voies
7.1 Problématique
7.2 Opérateurs génétiques
7.2.1 Croisements
7.2.2 Mutations
7.3 Évaluation par simulation
7.4 Comparaison avec une heuristique myope
8 Optimisation des temps de service à la cour ferroviaire
8.1 Problématique
8.2 Stratégie de collaboration agent
8.3 Algorithme de colonie de fourmis intégré dans la simulation
8.3.1 Description de l’algorithme
8.3.2 Couplage ACO-simulation
8.3.3 Réglage des paramètres
8.4 Résultats et comparaison
9 Conclusion
Conclusion générale et perspectives
Bibliographie
Télécharger le rapport complet