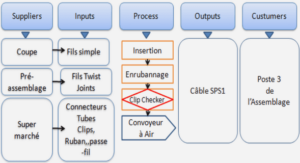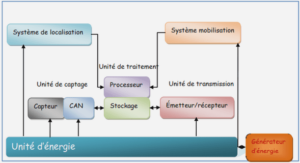Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Biologie
Nos connaissances sur le cycle de vie des Collodaires restent encore très partielles et reposent pour la plupart sur d’anciennes études. De par la nature incultivable de ces protistes marins, il est à l’heure actuelle impossible de suivre l’évolution d’une génération à la suivante. Cette difficulté est notamment liée au manque de connaissances sur la biologie de ces organismes, que ce soit vis-à-vis de leur nutrition ou de leurs préférences écologiques. Néanmoins, en les maintenant en vie sur des périodes de quelques jours (maximum = 34 jours), des études ont permis d’acquérir des informations précieuses pour la compréhension du cycle de vie des Collodaires (Swanberg et Anderson, 1985). C’est à la toute fin du XIXème siècle que Karl Brandt, zoologiste allemand de renom et pionnier de la recherche sur les Collodaires, fit les premières observations des mécanismes reproductifs chez des individus coloniaux (Brandt, 1885). Il observa au sein de plusieurs espèces coloniales (ex : Collozoum inerme, Sphaerozoum neapolitanum), des divisions cellulaires au sein des capsules centrales. Ces divisions, appelées aussi couramment « fissions binaires », sont décrites comme étant un événement de reproduction asexuée, où une cellule mère se divise, donnant naissance à deux cellules filles. De tels mécanismes reproductifs sont couramment observés chez d’autres grands protistes marins à test minéral tels que les Tintinides (Dolan, 2013) où les Foraminifères (Goldstein, 2003). En réussissant à maintenir quelques Collodaires en vie dans son laboratoire, Brant observa que de telles divisions avaient également lieu chez trois espèces de Collodaires solitaires, en particulier Thalassophysa sanguinolenta (Brandt, 1902). L’étude détaillée du noyau de cette dernière espèce lui fit suggérer que cette forme solitaire pouvait donner naissance à une nouvelle colonie (ou « proto-colonie ») par une simple succession de divisions binaires (Figure 13b). Cette proto-colonie, identifiée comme l’espèce coloniale Collozoum pelagicum, établit le premier lien entre une espèce solitaire et une espèce coloniale, suggérant que ces deux formes pourraient faire partie d’un même cycle de vie. Cette identité commune fut confirmée beaucoup plus tardivement par l’apport des méthodes moléculaires qui montreront une parfaite identité moléculaire entre les deux formes (Polet et al., 2004 ; Zettler et al., 1999). Enfin, près de 50 ans après les observations de Karl Brant, l’étude de cette même espèce solitaire a montré que, en plus de pouvoir donner naissance à une colonie, elle pouvait à un moment donné de son développement, former une multitude de petites cellules flagellées (~10 µm) appelées « spores » ou « swarmers » (Figure 13b’, e) (Hollande et Enjumet, 1953). Cette production de cellules biflagellées, certes observée auparavant (Brandt, 1885 ; Huth, 1913), n’est pas sans rappeler celle observée chez les les capsules centrales de l’hôte (Anderson, 1978a). Malgré les bénéfices sous-jacents de la translocation des produits dérivés de la photosynthèse, il semblerait que l’hôte puisse également se nourrir périodiquement de ses propres symbiontes (Anderson, 1976b). Bien que les paramètres qui influencent l’ingestion des symbiontes restent encore inconnus, le nombre constant de symbiontes observé dans un Collodaire au cours du temps suggère que le complexe hôte-symbiontes reste stable. L’ingestion pourrait ainsi permettre d’éliminer les cellules sénescentes (Figure 14c) tout en libérant de l’espace pour de nouveaux symbiontes. Néanmoins, la diminution du nombre de symbiontes lors de la phase précédant la formation des swarmers conduit à deux hypothèses : 1) l’ingestion continue des symbiontes pour fournir les ressources nécessaires au processus reproductif ; ou 2) le relargage de la totalité des symbiontes. Bien qu’il y ait peu d’arguments en faveur de l’un ou l’autre des deux mécanismes, la question de la spécificité se pose. En effet, alors que les symbiontes soient capables de se diviser au sein même de la colonie (Figure 14c), le relargage des symbiontes suggère qu’il n’y a pas de transmission verticale entre la cellule mère et la cellule fille. Dans le cas des Collodaires, le cycle de vie suggère qu’il y aurait une transmission horizontale des symbiontes, à savoir une acquisition des symbiontes en phase libre (Anderson, 2012). Cette transmission horizontale impliquerait donc des mécanismes de reconnaissance spécifiques, encore inconnus pour le moment.
La présence de microalgues photosynthétiques au sein des Collodaires permet à ces derniers de contribuer à la production primaire des écosystèmes marins. Les expériences de radiomarquage ont ainsi permis d’estimer la productivité des Collodaires via leurs partenaires symbiotiques (Caron et al., 1995 ; Swanberg, 1979 ; Swanberg et Harbison, 1979). En dépit du fait que de nombreux paramètres abiotiques (ex : température, illumination, etc.) et/ou biotiques (ex : état physiologique, stade développement, etc.) soient susceptibles de faire varier la productivité des symbiontes, celle-ci semble être constante entre les individus solitaires et coloniaux, et elle représente en moyenne une production de 360 ngC par organisme et par heure (Anderson, 1983 ; Caron et al., 1995). Grâce à ces estimations de production primaire mesurées in vivo, quelques études ont pu reporter localement la contribution des Collodaires à la productivité des écosystèmes dans lesquels ils se trouvent. Bien que leur contribution puisse être importante localement, par exemple dans le Golfe d’Aden où Khmeleva (1967) estima que les Collodaires pouvaient produire davantage de matière organique que la totalité du phytoplancton analysé dans le même environnement, celle-ci reste néanmoins le plus souvent anecdotique (~1%) à l’échelle de la production primaire d’un écosystème (Caron et al., 1995 ; Dennett et al., 2002 ; Khmeleva, 1967 ; Swanberg, 1979). Malgré cette mince contribution, la production primaire des Collodaires photosymbiotiques est unique de par la fraction de taille (meso- et macro-zooplancton) dans laquelle elle a lieu et une estimation plus globale permettrait de mieux appréhender son impact réel sur les écosystèmes marins.
Biogéographie et abondances
Il n’existe que peu de données permettant de cartographier la distribution des différentes espèces de Collodaires. Il faut attendre la fin des années 1960 pour voir publiées quelques études rapportant sporadiquement la diversité des Collodaires dans plusieurs régions océaniques (Pavshtiks et Pan’kova, 1966 ; Strelkov et Reshetnyak, 1971). Dans chacune de ces études, l’utilisation systématique de méthodes classiques d’échantillonnage (ex : filets à plancton) a grandement limité notre compréhension de la distribution biogéographique des espèces de Collodaires. En effet, les biais techniques inhérents à l’utilisation de tels outils d’échantillonnage, les perturbations mécaniques causant des dommages irréversibles aux organismes fragiles ou le faible volume d’eau échantillonné, n’ont permis d’acquérir que des données parcellaires dans l’étude des Collodaires. Néanmoins, l’étude de 42 espèces collectées des tropiques aux eaux froides des hautes latitudes a mis en évidence que seules quelques espèces semblaient être endémiques, là où la grande majorité se sont révélées être ubiquistes (Strelkov et Reshetnyak, 1971). Cette étude a notamment permis de montrer qu’une majorité d’espèces pouvait être trouvée ensemble dans les eaux chaudes des tropiques. À l’opposé, cette même étude a mis au jour que la diversité des Collodaires décline notoirement dans les eaux tempérées et froides. Ce patron de distribution a également été rapporté via l’analyse des sédiments marins (Boltovskoy et al., 2010). En effet, l’utilisation des carottes de sédiments marins pour l’étude de la diversité des Collodaires a également rendu possible une cartographie de la répartition de quelques espèces à partir des fossiles laissés au fond des océans (Figure 16). Néanmoins, le succès de cette technique repose uniquement sur la conservation d’une trace fossile ; elle n’a donc pas autorisé l’étude des Collodaires dépourvus de structures siliceuses. Ainsi, seuls les Collodaires possédant un squelette (c’est-à-dire appartenant à la famille des Collosphaeridae) ont pu être étudiés, mais ni les Collodaires nus, ni les Collodaires à spicules n’ont pu être observés grâce aux données sédimentologiques. De plus la Figure 16 illustre le manque flagrant de données acquises pour la colonne d’eau via des filets à plancton et des pièges à sédiments. Ainsi, pour les Collodaires possédant une trace fossile, la grande majorité des données de diversité à disposition provient des sédiments marins et non d’échantillons de plancton. Malgré les biais d’échantillonnage dus aux filets à plancton et mentionnés précédemment, de précieuses données ont été apportées par la suite grâce aux travaux novateurs de Neil Swanberg. En effet, la collecte in situ de Collodaires, prélevés par des plongeurs à l’aide de jarres en verre, a permis d’améliorer considérablement l’étude de ces organismes fragiles (Swanberg, 1979). Grâce à cette approche, plusieurs nouvelles espèces de Collodaires ont pu être décrites (Swanberg et Anderson, 1981 ; Swanberg et Harbison, 1979). Cependant, cette technique étant particulièrement coûteuse en temps, son application a été limitée à une dizaine d’expéditions océanographiques majoritairement réparties dans l’Atlantique Nord (Swanberg, 1979).
potentiellement ignorée dans la petite fraction de taille ; (2) la présence de cellules flagellées (swarmers) portant la signature moléculaire des Collodaires dans les petites fractions de taille ; (3) la destruction de plus grandes cellules, fractionnées, dont l’ADN se retrouve dans les petits fractions de taille ; ou (4) l’existence d’ADN extracellulaire (Not et al., 2007, 2009). De plus, ces séquences affiliées aux Collodaires ont souvent été observées en grand nombre dans les librairies de clones (Edgcomb et al., 2011 ; Massana, 2011 ; Not et al., 2009 ; Sauvadet et al., 2010). Ces résultats soulèvent néanmoins bon nombre de questions au regard de l’état actuel de nos connaissances sur la diversité et l’écologie des Collodaires. Par la suite, le développement de méthodes de séquençage à haut-débit (pyroséquençage 454 puis Illumina) a permis d’accroître la profondeur de séquençage et d’améliorer nos capacités à explorer la diversité planctonique (Edgcomb et al., 2011 ; Lindeque et al., 2013 ; Logares et al., 2014 ; Sogin et al., 2006). L’application de ces méthodes à des échantillons issus de pièges à sédiments, a notamment révélé la contribution potentielle des Collodaires dans les flux de particules (Amacher et al., 2009 ; Fontanez et al., 2015). Enfin, la publication récente de plusieurs études portant sur l’analyse des données de séquençage à haut-débit des échantillons des Expéditions Tara Océans (Pesant et al., 2015) et Malaspina (Duarte, 2015), a souligné l’importance des Collodaires dans les écosystèmes marins, qu’ils soient en surface (de Vargas et al., 2015) ou dans les profondeurs des océans (Pernice et al., 2015). Néanmoins, bien qu’elles constituent des outils sans précédents et offrent de nouvelles perspectives dans l’étude des Collodaires, ces méthodes moléculaires restent pour la plupart purement qualitatives et ne permettent qu’une description semi-quantitative de la biodiversité.
Abondances et biomasses
Tout comme l’identification taxinomique, la quantification des abondances et biomasses de Collodaires restent des tâches complexes, tant il est difficile de collecter ces organismes avec des méthodes d’échantillonnage classiques. Au cours des années 1960-70, trois études successives apporteront de premiers éléments pour comprendre la distribution des abondances de Collodaires (Khmeleva, 1967 ; Pavshtiks et Pan’kova, 1966 ; Strelkov et Reshetnyak, 1971). Les deux premières font mention d’abondances de Collodaires coloniaux particulièrement élevées, entre 3 000 – 4 000 et 16 000 – 20 000 colonies m-3, respectivement dans le détroit de Davis (à la limite de la Mer du Labrador) et le Golfe d’Aden. Par la suite, Neil Swanberg nota que de telles densités élevées n’avaient jamais été observées par ailleurs (Swanberg, 1979). Là où ses propres estimations suggéraient des abondances inférieures d’un facteur dix par rapport aux abondances des équipes russes, il observa néanmoins que de grandes quantités de Collodaires coloniaux pouvaient s’accumuler en surface des océans lors de périodes de calme prolongé (Figure 17). Ces agglomérations par temps calme en surface reflèteraient des mécanismes physiques entraînant une augmentation de la densité des Collodaires. C’est notamment le cas des cellules de Langmuir, structures induites par le vent de surface et pouvant entraîner une rétention d’organismes localement en surface, tels que les Collodaires (Caron et al., 1995). La collecte d’organismes coloniaux dans de telles accumulations, appelées aussi zoöcurrents par Ernst Haeckel (1887), pourrait donc être responsable des valeurs de densités particulièrement élevées et soulignent également une difficulté supplémentaire dans la quantification des Collodaires. Grâce à ses observations in proche de celle des Acanthaires pour la même masse d’eau. Cependant, ils insisteront sur les biais de leurs estimations liés à leur échantillonnage effectué avec une pompe à eau et des bouteilles Niskin.
Tout comme les Collodaires, la collecte d’organismes planctoniques fragiles constitue un réel défi et malgré une sophistication de plus en plus avancée, l’utilisation de filets à plancton pour la collecte de ces organismes représente un obstacle à leur étude (Remsen et al., 2004). Bien que chaque filet soit construit pour échantillonner le plancton de façon optimale, leur utilisation entraîne dans la plupart des cas des perturbations mécaniques importantes lors de la collecte. Ces perturbations peuvent provoquer des dommages mineurs aux organismes voire entraîner leur destruction. Certains filets peuvent néanmoins être déployés et traînés à de très faibles vitesses (<0,1 m s-1), mais cela au détriment du volume échantillonné et de la couverture spatiale. Il n’existe qu’une poignée d’études permettant de mesurer l’effet réel d’un échantillonnage traditionnel, utilisant des filets à plancton, sur des organismes planctoniques fragiles (Ashjian et al., 2001 ; Benfield et al., 1996 ; Dennett et al., 2002 ; Gallager et al., 1996 ; Norrbin et al., 1996). Dans l’étude la plus complète à ce jour, l’utilisation simultanée d’un filet à plancton et du système d’imagerie SIPPER (Shadowed Image Particle Profiling and Evaluation Recorder – Samson et al., 2001) a permis de comparer les abondances de divers groupes zooplanctoniques en fonction de l’outil d’échantillonnage (Remsen et al., 2004). Afin de pouvoir effectuer une comparaison directe entre les deux outils, le système SIPPER et les filets furent placés en série de manière à échantillonner exactement le même volume d’eau, celui ci passant d’abord dans le faisceau du SIPPER puis directement dans les filets. Le déploiement de cette plateforme d’échantillonnage multiple sur les 100 premiers mètres des eaux du Golfe du Mexique, révéla une sous-estimation colossale des abondances d’organismes fragiles entre les filets et le système SIPPER. Ce dernier autorisa, entre autres, une quantification des abondances de protistes et de Cnidaires 522% et 1200% supérieures aux abondances estimées par les filets. La biomasse totale du meso-zooplancton fût quant à elle estimée à 2 fois inférieure à la biomasse capturée par le système SIPPER. En plus de soulever de nombreuses questions vis-à-vis de l’efficacité des méthodes traditionnelles d’échantillonnage, cette étude révèle la grande utilité des systèmes d’imageries in situ dans l’étude du zooplancton.
Le développement récent des techniques d’imagerie in situ a donc permis d’accroître considérablement nos capacités à échantillonner une multitude d’organismes usuellement détruits lors de collectes avec des méthodes classiques de prélèvements telle l’utilisation de filets à plancton (Wiebe et Benfield, 2003). Ces approches, permettant d’observer de façon non-intrusive (sans perturbations mécaniques) les organismes directement dans leur habitat, ont notamment abouti à confirmer la présence de micro-agrégations d’organismes planctoniques en surface, mais aussi à souligner l’importance des bactéries diazotrophes du genre Trichodesmium dans cette même partie des océans (Davis et al., 1992 ; Davis et McGillicuddy, 2006 ; Guidi et al., 2012 ; Sandel et al., 2015). Au-delà de leur capacité unique à échantillonner une fraction du plancton couramment sous-estimée, les systèmes d’imagerie in situ autorisent le plus souvent une grande couverture spatiale et également une meilleure intégration de l’ensemble de la colonne d’eau en enregistrant chaque organisme à une profondeur donnée (là où seuls des filets fermants, tel le MOCNESS, permettent d’accéder à une résolution verticale fine). De plus, l’innovation technologique dans les méthodes d’imagerie in situ s’est accompagnée d’un développement de l’automatisation des méthodes d’identification taxinomique (Benfield et al., 2007 ; Culverhouse et al., 2006). Ces méthodes de tri semi-automatique ont permis de traiter la grande quantité d’images fournies par les systèmes d’imagerie, mais ont aussi plus globalement abouti à réduire le temps nécessaire à l’identification taxinomique d’organismes au sein d’un échantillon, sans pour autant réduire la qualité de l’identification (Culverhouse et al., 2003). Néanmoins, comme tout outil d’échantillonnage, quel qu’il soit, la gamme d’étude des systèmes d’imagerie in situ est également limitée par une série de contraintes technologiques inhérentes à la conception même de l’instrument. Ainsi, d’un système d’imagerie à l’autre, le volume imagé (c’est-à-dire le volume échantillonné) sera différent et la résolution du pixel sera plus ou moins fine, contraignant ainsi la gamme de taille observable. L’exemple peut-être le plus marquant est celui de l’ichtyoplancton (fraction du plancton contenant notamment les larves et juvéniles de poissons), présent dans la grande fraction de taille (meso- et macro-plancton) et qui ne dépasse rarement des densités supérieures à 0,01 individus par litre. Là où les premiers systèmes d’imagerie in situ n’avaient qu’un faible volume échantillonné (~1 – 10 L s-1), l’élaboration de l’ ISIIS (In Situ Ichtyoplankton Imaging System) augmente considérablement le volume imagé (>70 L s-1) et ouvre ainsi de nouvelles perspectives dans l’étude in situ de ce compartiment planctonique (Cowen et Guigand, 2008). En plus de d’autoriser l’étude de l’ichtyoplancton, l’ISIIS a également rendu possible l’observation du plancton gélatineux (ex : Cnidaires, Siphonophores, etc.), un compartiment du macro-zooplancton jusqu’alors extrêmement complexe à étudier avec des filets à plancton tant ceux-ci endommageaient considérablement ces organismes fragiles (Luo et al., 2014).
Apports et limitations de la taxinomie intégrative
La classification des Collodaires a été entièrement réévaluée en choisissant une approche intégrant à la fois des critères morphologiques et des données moléculaires (Chapitre I). Cette nouvelle classification a permis de mettre en évidence de nombreux conflits entre les deux approches, suggérant que l’utilisation d’une seule méthode à la fois est parfois insuffisante pour correctement identifier les espèces, genres ou familles de Collodaires. Au-delà des questions purement taxinomiques, cette méthode nous a également permis de répondre à des questions d’ordre écologique.
Vers un nouveau schéma de classification
Lors des premières tentatives de classification des Collodaires, Karl Brandt, Ernst Haeckel, Roger Anderson ou Neil Swanberg soulignèrent tous leurs difficultés à trouver des critères taxinomiques fiables pour distinguer les Collodaires, en particulier ceux dépourvus de structure siliceuse. L’apport des outils moléculaires fut particulièrement bénéfique lors de notre réévaluation de classification des espèces de Collodaires « nus ». Pour ces espèces, l’identification taxinomique sur la base des observations faites en microscopie optique, n’a fourni que très peu de critères permettant de distinguer les différentes espèces. De plus, l’identification de spécimens préservés dans de l’éthanol, et non pas examinés vivants dès leur collecte, a eu tendance à altérer de façon non négligeable les quelques rares critères morphologiques (ex : forme des capsules centrales, positions des photosymbiontes). Néanmoins, grâce à l’analyse phylogénétique simultanée des gènes ribosomaux 18S et 28S, sept clades distincts ont pu être différenciés au sein de ces Collodaires « nus ». En particulier, cette approche a confirmé l’existence des Collophidiidae Biard et Suzuki (2015), une famille de Collodaires dont la création avait été suggérée à plusieurs occasions (Anderson et al., 1999 ; Zettler et al., 1999 ; Ishitani et al., 2012). Cependant, malgré la distinction génétique de ces différents clades, aucun caractère morphologique distinctif n’a pu être observé, notamment au sein des clades C7, C8, C10 et C11, où seules deux espèces du genre Collozoum ont pu être associées aux différentes entités génétiques (Chapitre I – Figure 1). Couplée aux analyses phylogénétiques, l’utilisation de méthodes alternatives de microscopie, notamment la microscopie électronique à transmission, devrait permettre de définir de nouveaux critères morphologiques, comme ce fut le cas lors de la reconnaissance du genre Collophidium (ex : organisations des parties intracapsulaires différentes entre Collozoum et Collophidium Anderson et al., 1999).
La classification morphologique des Collodaires possédant des structures cristallines, globalement plus aisée, doit néanmoins son succès à la mise au point d’un protocole simple visant à récupérer, au cours de l’extraction de l’ADN, les structures silicifiées présentes dans la matrice gélatineuse de ces Collodaires (Figure 19). Là où l’observation de la morphologie des squelettes et des spicules de Collodaires est souvent rendue délicate par la matrice gélatineuse, l’analyse en microscopie électronique à balayage offre un accès à des détails morphologiques invisibles en microscopie optique. Les résultats de ces analyses fines, une fois comparés à ceux obtenus par la phylogénie, se sont révélés être beaucoup résolutifs que (Campbell, 1954 ; Maletz, 2011). La présence de spicules au sein des Collodaires soulève donc de nombreuses questions vis-à-vis des processus évolutifs qui ont eu lieu au sein des Radiolaires pour mener jusqu’aux Collodaires.
À cause du manque de structures silicifiées chez certaines familles de Collodaires, les données fossiles de Collodaires sont assez rares. On daterait l’apparition des Collodaires au milieu du Paléogène, soit il y a environ 43 millions d’années (Haslett, 2004). Cette datation, effectuée à partir de microfossiles de Collosphaeridae, ne permet en aucun cas d’avoir une datation pour l’apparition des Sphaerozoidae et de leurs spicules. Cependant, grâce à la phylogénie établie dans le Chapitre I, il semblerait que Collosphaeridae et Sphaerozoidae aient co-évolué au cours du temps. Deux lignées s’opposent donc, d’un côté des Collodaires possédant un squelette, de l’autre des formes possédant des spicules ou même dénuées de toute structure minérale (Chapitre I – Figure 1). À cause de leur grande fragilité et de leur ressemblance avec les spicules d’éponges, il est peu probable que de futures données fossiles soient disponibles pour les Collodaires à spicules. L’interprétation de l’histoire évolutive des Collodaires repose donc uniquement sur les données fossiles de Collosphaeridae. Grâce aux calibrations chronostratigraphiques et à l’utilisation de la méthode des horloges moléculaires, il est possible d’estimer les temps de divergence à partir d’une phylogénie moléculaire (Ho, 2008). Une telle approche a déjà été tentée pour comprendre l’évolution des Collodaires (Ishitani et al., 2012). Cependant, cette tentative fut contrainte par une phylogénie trop peu résolutive et l’utilisation de données fossiles non validées. Dans le cadre d’une future collaboration avec le Dr. Noritoshi Suzuki, l’utilisation d’horloges moléculaires, grâce à la nouvelle phylogénie des Collodaires et le choix de données fossiles validées, permettra de fournir de nouveaux arguments pour étayer notre hypothèse (développée ci-dessous) concernant l’histoire évolutive des Collodaires.
Le schéma d’évolution proposé ici n’a pas vocation à être utilisé comme tel, mais doit plutôt former une base de réflexion sur l’évolution des Collodaires. Après avoir constitué un caractère ancestral, puis évolué au cours du temps, des spicules, très similaires à ceux des Archaeospicularia, réapparaissent au sein des Collodaires plusieurs centaines de millions d’années après avoir disparu de toute famille de Radiolaires. Il est peu probable que les spicules aient été conservés au cours de l’évolution tant il est impossible de trouver une telle structure dans les autres familles de Radiolaires. Si l’on considère le taux d’évolution des gènes 18S et 28S, la phylogénie (Chapitre I – Figure 1) semble indiquer que les spicules seraient apparus en même temps que les squelettes de Collodaires, soit au milieu de l’Eocène (~43 m.a.). Or, une étude récente a démontré que la taille et la silicification des squelettes de Radiolaires avaient considérablement diminué au cours du Cénozoïque (66 m.a. à maintenant) notamment aux basses latitudes où la concentration en silice chuta brutalement (Lazarus et al., 2009). Cette étude a suggéré que l’augmentation de la stratification des océans à cette époque pouvait avoir entraîné une diminution globale des concentrations de silice. De plus, l’essor des diatomées, plus compétitives que les Radiolaires dans l’assimilation de la silice, pourrait avoir participé à la baisse de silicification des squelettes de Radiolaires. C’est également à cette période que les données fossiles semblent indiquer l’apparition des Collodaires, parmi les seuls Radiolaires à ne plus posséder un squelette de silice. Ainsi, on peut émettre l’hypothèse que face à une diminution de la disponibilité en silice, les Collodaires constituent une forme évoluée de Radiolaires, particulièrement adaptée aux basses latitudes, ayant réduit leur capacité d’assimilation de la silice au point de voir leur squelette régresser vers une forme primitive que constituent les spicules. Cette régression aurait également pu se poursuivre par la perte totale de structure silicifiée et contribuer à l’apparition des formes « nues » de Collodaires (ex : le genre Collozoum). Même si cette hypothèse semble pouvoir expliquer le changement de structure silicifiée chez les Collodaires, elle repose uniquement sur la comparaison entre deux des trois familles de Collodaires et ne prend pas en compte l’existence des Collophidiidae, exclusivement composés d’espèces « nues » et formant le clade sœur des Collosphaeridae.
Les Collophidiidae : vers une adaptation des Collodaires aux zones bathypélagiques ?
Longtemps passés inaperçus, voire ignorés des schémas de classification taxinomique, les Collophidiidae, décrits formellement au cours de cette thèse (Chapitre I), forment une famille de Collodaires pour le moins énigmatique. Pendant près d’un siècle, ces Collodaires ont été considérés comme faisant partie du genre Collozoum, certes à juste titre puisque leur morphologie « nue » est très similaire à celle des espèces du genre Collozoum. Rarement collectés, leur étude n’a permis de décrire que trois espèces coloniales à ce jour, Collophidium serpentinum, Collophidium ellipsoides et Collophidium ovatum (Haeckel, 1887), toutes trois abritant quelques photosymbiontes, identiques à ceux trouvés dans les autres familles de Collodaires (Probert et al., 2014). Bien que des Collophidiidae aient été observés à quelques rares occasions en surface (Chapitre II-1), une série d’études récentes (Edgcomb et al., 2011 ; Pernice et al., 2015) a permis de collecter des données dans les zones bathypélagiques des océans, où les Collophidiidae se sont révélés être particulièrement représentés (Chapitres I et II-1).
La surface des océans, ou zone épipélagique, ne représente certes qu’une part infime de l’océan mondial (moins de 2% de son volume) mais la diversité et l’abondance d’organismes qu’elle abrite ont fait l’objet de près de plus de la moitié des études recensées sur la base de données OBIS (Webb et al., 2010). L’océan profond, quant à lui, constitue le plus grand écosystème sur Terre et abrite une vaste biodiversité restant néanmoins trop peu étudiée, à cause notamment des difficultés à échantillonner cette zone (Robison, 2004 ; Robison, 2009 ; Webb et al., 2010). Dans ses surprenants comptes rendus de plongées en bathyscaphe, Grégoire Trégouboff apportera de précieuses observations des eaux profondes de la Baie de Villefranche-sur-Mer, parmi lesquelles il mentionnera la première observation de Collodaires coloniaux à de telles profondeurs (Trégouboff, 1956, 1958, 1959). Plusieurs décennies plus tard, des Collodaires vont de nouveau réapparaître dans les profondeurs des océans, mais cette fois-ci sous la forme de séquences d’ADN (López-García et al., 2001 ; Countway et al., 2007 ; Not et al., 2007 ; Edgcomb et al., 2011 ; Pernice et al., 2015). Un tel constat nous oblige à revoir complément notre compréhension de l’écologie des Collodaires, jusqu’alors uniquement observés dans les zones photiques et en association obligatoire avec des photosymbiontes pour l’ensemble des espèces décrites à ce jour. Ces séquences issues du milieu profond ne nous renseignent nullement sur la morphologie des organismes et on ne peut que spéculer sur la forme des Collodaires présents à de telles profondeurs. Au-delà de la forme typiquement coloniale qu’a pu observer Grégoire Trégouboff, l’existence des swarmers portant la signature moléculaire des Collodaires dans les zones bathypélagiques pourrait biaiser notre interprétation. La quasi-totalité des séquences extraites de ces données profondes suggère que seuls les Collophidiidae sont extraits à de telles profondeur (Chapitre I – Figure 4). Or, si la signature moléculaire des Collodaires profonds doit son origine à de tels swarmers, l’ensemble des trois familles devrait être représenté puisque, en effet, la production de swarmers est un phénomène observé dans toutes les familles.
Afin de compléter nos connaissances sur ce qui pourrait être désormais considéré comme une communauté profonde de Collodaires, il convient de mettre en place une stratégie d’échantillonnage visant à collecter spécifiquement ces organismes. Un tel prélèvement devra se faire de façon très délicate afin de collecter des échantillons de plancton intacts. L’utilisation de filets fermants (ex : MOCNESS) devrait permettre la collecte de ces Collodaires profonds. Néanmoins, la collecte d’échantillons d’eau de mer prélevés à la bouteille Niskin, semble être nécessaire dans l’éventualité où la signature moléculaire des Collodaire doive son origine aux swarmers. Au-delà d’apporter une contribution significative aux connaissances sur les Collodaires, la présence de Collodaires à de telles profondeurs pourrait également soulever l’existence de Collodaires asymbiotiques. En outre, si seuls les Collophidiidae constituent une communauté profonde, n’auraient-ils pas pu évoluer spécifiquement pour s’adapter à une niche écologique radicalement différente de celle des Collodaires de surface ?
Collodaires et colonialité
Dans son article au titre évoquant une « course à l’armement », Victor Smetacek (2001) évoque l’évolution des différentes mesures défensives au sein du phytoplancton lui permettant de s’adapter à la pression trophique exercée par ses prédateurs. Que ce soit les diatomées et leurs frustules, les tintinides et leurs lorica (terme emprunté aux armures portées par les soldats romains), ou même les Radiolaires et leur squelette, toutes ces morphologies seraient autant de formes permettant une meilleure protection contre les prédateurs (Hamm et Smetacek, 2007 ; Porter, 2011). Dans ce contexte, il est donc particulièrement intéressant de voir que l’évolution (ou régression) du squelette chez les Collodaires vers des formes moins complexes, en comparaison des autres ordres de Radiolaires, correspond également à l’apparition de la colonialité. Bien que l’apparition des colonies chez les Collodaires ait également concerné les espèces possédant un squelette (Collosphaeridae), cette organisation des cellules sous forme coloniale est propre aux Collodaires (Suzuki et Not, 2015). Même si l’ensemble des Radiolaires est constitué d’organismes solitaires, le stade solitaire observé chez les Collodaires est particulier du fait de sa taille démesurée et de sa morphologie où la cellule est entourée d’une matrice gélatineuse faisant près de 2 à 4 fois sa taille (Anderson, 1983). Il se pourrait alors que les Collodaires aient compensé la perte de structure siliceuse au profit d’une adaptation vers la colonialité, un gigantisme leur conférant la protection nécessaire contre leurs prédateurs. Enfin, en plus d’offrir une protection certaine face à des prédateurs, le colonialisme permet à une multitude de cellules de partager un seul et même microenvironnement, où les échanges peuvent être favorisés, et où la colonie elle-même peut créer des conditions optimales propices au maintien et au développement de ses partenaires photosymbiontes.
La photosymbiose, facteur de distribution des Collodaires ?
L’ensemble des Collodaires décrits à ce jour, y compris les Collophidiidae, sont caractérisés par l’existence d’une photosymbiose obligatoire (Hollande et Enjumet, 1953). Si la présence de micro-algues a été révélée dès les premières observations de Collodaires (Brandt, 1882a, 1882b ; Haeckel, 1862, 1887), l’identité de ces photosymbiontes n’a jamais pourtant été démontrée. Grâce à la collecte de nombreux spécimens de Collodaires au cours de cette thèse, des analyses détaillées ont permis de caractériser l’identité génétique et morphologique des photosymbiontes de Collodaires, identifiés comme l’unique espèce Brandtodinium nutricula (Probert et al., 2014 ; Annexe 3). La présence systématique d’une seule et unique espèce de photosymbiontes au sein de l’ensemble des espèces étudiées renforce donc l’aspect spécifique de la relation entre les Collodaires et leurs partenaires symbiotiques. La nature exclusive de cette photosymbiose contraste avec la plus grande diversité taxonomique des partenaires symbiotiques chez les autres Radiolaires (ex : Acanthaires ; Decelle et al., 2012a, 2012b) ou chez les Foraminifères (Decelle et al., 2015). Néanmoins, il y a encore un manque flagrant de données permettant de comprendre la nature de ces relations. S’agit-il d’un pur mutualisme, où l’hôte Collodaire fournit un microenvironnement favorable à ses photosymbiontes qui lui offrent un apport nutritif en retour (Anderson, 1976, 1983), ou bien s’agit-il d’un parasitisme « inversé » où seul l’hôte bénéficie de cette association (Decelle, 2013) ?
De plus, il a été démontré qu’au cours du cycle de vie des Collodaires, les juvéniles (ex : les proto-colonies) n’héritent pas des symbiontes de la cellule-mère (transmission verticale) mais doivent acquérir leurs photosymbiontes directement dans l’environnement (transmission horizontale ; Anderson, 2012). Comprendre la nature de ces interactions permettrait de mieux appréhender la manière dont les photosymbiontes sont recrutés dans l’environnement. La persistance de cette transmission horizontale des symbiontes suggère que les populations de Collodaires sont d’une certaine façon contraintes par les populations des photosymbiontes vivant en phase libre. Grâce aux données de metabarcoding et d’hybridation in situ (FISH) acquises lors de la série saisonnière dans la Baie de Villefranche-sur-Mer (Chapitre II-2), il serait possible d’examiner la cooccurrence entre les symbiontes en phase libre et leurs hôtes. En outre, grâce à l’aspect saisonnier de ces prélèvements, il serait possible de voir en détail comment évoluent les deux populations au cours du temps. La communauté de Collodaires est-elle plus influencée par une série de variables environnementales ou est-elle sous l’influence de la population de photosymbiontes en phase libre et de leurs disponibilités pour les populations de juvéniles ?
Le succès écologique des Collodaires semble désormais être étroitement lié à une série d’évolutions parmi lesquelles la photosymbiose pourrait contraindre significativement la persistance d’une population donnée. L’histoire évolutive des Collodaires suggère qu’ils ont évolué au cours des derniers millénaires dans des zones de plus en plus oligotrophiques, et ceci grâce à l’apport nutritif de leurs symbiontes, qui, à l’échelle d’une colonie, pourrait ressembler à de véritables « microfermes marines ». Les Collodaires auraient donc pu s’adapter à ces zones où la nourriture est rare et particulièrement disputée. De manière générale, il a été suggéré que la photosymbiose permettrait aux grands organismes, tels que les Rhizaria, de survivre dans ces milieux hostiles (Norris, 1996 ; Stoecker et al., 2009). Il apparaît donc que la photosymbiose pourrait être un moteur expliquant les patrons de distribution de biomasse et de diversité observés au cours de cette thèse.
Nouvelles approches pour l’étude de la biodiversité et l’écologie des Collodaires
Pendant près d’un siècle de recherches océanographiques, les Collodaires ne sont apparus qu’à de très rares occasions dans les études portant sur la diversité et l’abondance du plancton dans l’océan mondial. Le choix des outils utilisés tout au long de cette thèse est le fruit d’une réflexion sur la meilleure façon d’échantillonner ces organismes fragiles que sont les Collodaires. Après des décennies passées à utiliser des techniques d’échantillonnage traditionnelles (ex : filets à plancton, bouteilles Niskin), le développement récent de nouvelles technologies commence à changer peu à peu notre vision des océans en démontrant l’importance de compartiments planctoniques longtemps ignorés. Ainsi, au cours de cette thèse, l’utilisation de méthodes d’étude alternatives, telles que le metabarcoding (Chapitre II) ou l’imagerie in situ (Chapitre III), a permis de s’affranchir de ces techniques, souvent proposées pour expliquer la sous-représentativité des Collodaires du fait des difficultés à les identifier ou de leur fragilité limitant nos capacités à les collecter.
L’apport de l’imagerie in situ
Une partie des études réalisées au cours de cette thèse se sont appuyées sur la base de données immense que constitue la collection d’images in situ acquises par l’Underwater Vision Profiler (UVP), un système d’imagerie in situ développé au Laboratoire d’Océanographie de Villefranche-sur-Mer depuis 1992. Grâce à l’utilisation d’une partie des données (1 450 profils verticaux sur les 5 000 disponibles à l’heure actuelle), ces travaux ont mis en évidence que les Collodaires étaient des acteurs importants des communautés zooplanctoniques, en particulier dans les zones oligotrophiques (Chapitre III). Même si l’utilisation de l’UVP a fourni quantité d’informations déterminantes sur l’abondance et la biomasse des Collodaires dans de nombreuses régions des océans, ces observations sont néanmoins restreintes à la gamme de taille de l’instrument (600 µm ~ 10 mm). De plus, il semblerait que l’UVP, dans sa configuration actuelle, ne puisse pas correctement échantillonner les premiers mètres de la colonne d’eau, à la surface des océans. Or, c’est dans cette couche de surface que plusieurs études ont décrit de très fortes densités de Collodaires (Swanberg, 1979 ; Caron et Swanberg, 1990 ; Caron et al., 1995 ; Michaels et al., 1995). Ces agglomérations de sub-surface semblent certes être purement liées à des mécanismes physiques (ex : stabilité de la colonne d’eau, météo clémente, cellules de Langmuir, etc.) et ne concernent que certaines zones océaniques (typiquement les grands gyres), mais le sous-échantillonnage d’une telle masse de Collodaires Nouvelles approches pour l’étude de la biodiversité et l’écologie des Collodaires l’UVP est géo-localisée dans le temps et dans l’espace, mais aussi dans la niche écologique qu’elle occupe, car associée à de nombreux paramètres physico-chimique relevés par les différents capteurs associés à l’UVP (ex : sonde CTD, capteur de nitrate ISUS, etc.). De ce fait, comme pour les analyses de diversité des barcodes environnementaux, et pour faire suite aux travaux présentés dans le Chapitre III, j’envisage des analyses de corrélations appliquées à ces données, ce qui rajouterait une dimension quantitative à l’étude de l’écologie des Collodaires. De plus, grâce à la couverture géographique globale et à l’hétérogénéité des écosystèmes rencontrés, la détermination des niches écologiques n’en sera que plus résolutive. Ces travaux d’études de l’écologie des Rhizaria, et notamment ceux des Collodaires, pourront également aborder les possibles interactions biotiques entre les différents composants des communautés planctoniques observés par ailleurs avec l’UVP. Enfin, des études récentes suggèrent que les écosystèmes oligotrophiques seront fortement influencés par les changements climatiques (Behrenfeld et al., 2006 ; Polovina et al., 2008). Au vu de la distribution préférentielle des Collodaires dans ces écosystèmes (Chapitre III), il serait intéressant de tester expérimentalement, ou de modéliser, si ces changements à grande échelle peuvent influencer la distribution des Collodaires, comme cela semble être le cas pour d’autres groupes planctoniques tels que les copépodes (Helaout et Beaugrand, 2007 ; Reygondeau et Beaugrand, 2011).
Du barcode à l’environnement
Biodiversité des Collodaires
L’utilisation des outils moléculaires a permis de révolutionner les études de biodiversité tout en s’affranchissant des identifications morphologiques, particulièrement laBORIEUSES (Dı́EZ ET al., 2001 ; López-García et al., 2001 ; Moon-van der Staay et al., 2001). Grâce à la sélection d’un grand nombre d’échantillons acquis lors de l’expédition Tara Océans, la couverture géographique de notre étude a permis d’examiner les patrons de biodiversité des Collodaires à travers une large gamme d’écosystèmes (ex : upwelling, gyres et fronts océaniques, etc.). Cette biogéographie (Chapitre II-1) a notamment confirmé une des hypothèses émises auparavant, stipulant que les Collodaires sont des organismes en grande majorité ubiquitaires (Strelkov et Reshetnyak, 1971 ; Swanberg, 1979). Même si certaines familles semblent occuper des niches écologiques préférentielles (ex : Collophidiidae en profondeur), les Collodaires, dans leur ensemble, semblent s’être adaptés à de nombreuses conditions environnementales. Néanmoins, ces conclusions sont principalement dictées par les résultats obtenus lors de l’étude phylogéographique mettant en jeu la région V9 du gène ribosomal 18S. Or, comme cela a été évoqué précédemment (sous-partie 1.1), ce court fragment d’ADN n’offre qu’une faible résolution taxinomique (Figure 20). Ainsi, l’interprétation de la distribution de la biodiversité des Collodaires est donc principalement basée sur la distribution des clades et non des différentes espèces. Afin de répondre à ces contraintes, l’utilisation d’autre barcodes pourrait améliorer la résolution taxinomique et permettre l’étude détaillée de la distribution des différentes espèces de Collodaires. Une telle problématique n’est pas restreinte à la seule étude de la biogéographie des Collodaires. Chez la cyanobactérie marine du genre Synechococcus, le gène petB (gène codant pour la sous-unité b6 du cytochrome) s’est 18S dans les approches de metabarcoding pour les Collodaires, et devrait nous permettre de définir des entités génétiques robustes.
Vers un metabarcoding quantitatif ?
L’approche de metabarcoding utilisée pour l’analyse de la diversité environnementale des Collodaires (Chapitre II) nous a permis d’étudier la distribution géographique des différents clades identifiés lors notre révision de leur classification (Chapitre I). Cependant, cette approche ne nous a pas permis de quantifier l’abondance absolue des Collodaires à partir de leur nombre de copies du gène ribosomal 18S. Même si l’effort a été fait de mesurer le nombre total de copies au sein d’un seul Collodaire, les résultats trop variables entre les deux formes de Collodaires ne nous permettent pas de convertir ce nombre de copies, extraites de l’environnement, en nombre de capsules centrales.
Cependant, étant donné la corrélation positive entre le nombre de copies du gène 18S et la taille ou le biovolume des organismes (Zhu et al., 2005 ; Godhe et al., 2008), certaines études ont tenté une comparaison entre les abondances de barcodes et les abondances d’organismes estimées en microscopie optique (ex : de Vargas et al., 2015). Malgré cette corrélation, les barcodes n’apparaissent pas systématiquement comme étant de très bons proxy pour déterminer le biovolume des organismes, et encore moins leurs abondances cellulaires. Dans le cas de groupes spécifiques tels que les diatomées, la comparaison des abondances des différents genres estimées par microscopie avec les abondances relatives de barcodes fournit quelques résultats cohérents (de Vargas et al., 2015). Néanmoins, pour les Collodaires, une telle comparaison entre comptages microscopiques et abondances relatives de barcodes semble impossible au vu des dommages infligés aux Collodaires par les filets à plancton, qui nuiraient à cette comparaison.
Cependant, étant donné la collecte réalisée en parallèle avec les filets à plancton et l’UVP au cours de certaines stations d’échantillonnages de l’expédition Tara Océans, nous avons tenté d’établir une comparaison entre les abondances relatives de barcodes avec les estimations quantitatives enregistrées par l’UVP. Pour cela, nous avons estimé le nombre de barcodes que représenteraient les organismes observés par l’UVP en utilisant les valeurs moyennes enregistrées en PCR quantitative (Chapitre II-1 – Figure 1). Même si ces deux types de prélèvements n’ont pas été réalisés de façon simultanée et consistent en des prélèvements obliques (filets) et verticaux (UVP), nous avons essayé de maximiser la comparaison en sélectionnant uniquement les images enregistrées par l’UVP entre la surface et la DCM. De plus, ces instruments ne couvrant pas la même gamme de taille, nous n’avons sélectionné que les échantillons de metabarcoding pour la fraction 180 – 2 000 µm, et mis un seuil de taille entre 600 – 2 000 µm pour l’UVP, afin de se rapprocher d’une gamme analogue. Pour 49 stations de prélèvements les barcodes n’ont pu être comparés aux images à cause de l’absence de ces dernières. Sur les 46 stations où les abondances de copies ont pu être comparées, il apparaît que l’UVP sous-estime le nombre de copies d’ADN en comparaison du nombre estimé via le metabarcoding (Figure 24). Malgré les efforts mis en jeu pour sélectionner une gamme de taille et des profondeurs d’échantillonnage comparables, d’autres paramètres semblent biaiser la comparaison. Ainsi, les résultats présentés ici ne performances de classification taxonomique semi-automatique (ex : utilisation de réseaux de neurones – http://benanne.github.io/2015/03/17/plankton.html) associée à des initiatives de sciences participatives (ex : Plankton Portal – http://www.planktonportal.org), le développement de ces méthodes alternatives d’échantillonnage semble prometteur. Enfin, au-delà du cas spécifique des Collodaires, l’utilisation de telles plateformes d’échantillonnage ou de systèmes hybrides pourrait offrir de nouvelles perspectives dans l’étude de la diversité et l’écologie du plancton fragile.
|
Table des matières
1. Plancton et écosystèmes océaniques
1.1 Le Plancton au coeur des écosystèmes marins
1.2 Les Rhizaria, un super-groupe de protistes méconnus
2. Les Collodaires, état des connaissance
2.1 Morphologie, classification et évolution
2.2 Biologie
2.3 Biogéographie et abondance
Chapitre I – Classification of the marine protist Collodaria Towards an integrative morpho-molecular classification of the Collodaria (Polycystinea, Radiolaria)
Chapitre II – Biodiversity of the Collodaria
II-1 Worldwide biogeography of Collodaria (Radiolaria) assessed through metabarcoding
II-2 Seasonal dynamics of rhizarian communities in the north-western Meditteranean Sea revealed by high-throughput sequencing
Chapitre III – Rhizaria, the elusive stars of the oceans
Global in situ observations reveal the biomass of Rhizaria in the oceans
Discussion et perspectives
1. Apports et limitations de la taxinomie intégrative
1.1. Vers un nouveau schéma de classification
1.2. Quand la taxinomie intégrative offre un aperçu du cycle de vie
2. Vers une nouvelle histoire évolutive des Collodaires ?
2.1. Les spicules au cours de l’évolution
2.2. Les Collophidiidae : vers une adaptation des Collodaires aux zones bathypélagiques ?
2.3. Collodaires et colonialité
2.4. La photosymbiose, facteur de distribution des Collodaires ?
3. Nouvelles approches pour l’étude de la biodiversité et l’écologie des Collodaires
3.1. L’apport de l’imagerie in situ
3.2. Du barcode à l’environnement
a. Biodiversité des Collodaires
b. Quelles limites pour le metabarcoding ?
c. Vers un metabarcoding quantitatif ?
Références bibliographiques
Télécharger le rapport complet