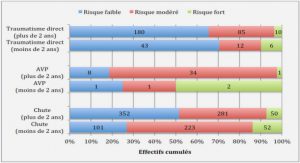Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Contexte socio-économique
Population
La population est essentiellement de race Marofotsy. Ce sont les descendants d’anciens guerriers de la Reine Ranavalona, ils seraient originaires de la région du Fody (près d’Anjiro). Les Merina (Tanjafy) qui sont venus de la région d’Anjozorobe se sont installés principalement dans les parties centrales de la région. Dans la région de Tsaratanana et de Betrandraka, de nombreux villages sont constitués par des Betsileo. Enfin, citons les infiltrations Sihanaka, Tsimihety et d’autres ethnies venant du Sud-Est de l’Ile. Actuellement, la mentalité a quelque peu changé et les parents essayent de scolariser leurs enfants, étant donné que des écoles primaires (EPP) existent maintenant dans presque chaque Fokontany. Mais, très souvent, les enfants abandonnent leurs études après le CEPE pour plusieurs raisons et retournent travailler la terre, ou se consacrent à l’élevage ou encore à l’orpaillage.
Il semble que les jeunes sont plus attirés par les villes et essayent d’y trouver du travail. Pour le moment, ils constituent une armée d’ouvriers largement plus instruits que leurs parents, (Rasolomanana E., 1999).
Agriculture et élevage
L’agriculture est la principale richesse et activité de la région. On y cultive essentiellement le riz, le manioc et surtout quelques cultures vivrières. Par contre, c’est une région riche en zébus mais le système d’élevage reste encore très archaïque. Notons que les zébus constituent une source de revenu appréciable. Dans la plupart des villages, on élève aussi des porcs et de la volaille, mais uniquement à l’échelle familiale (Rasolomanana E., 1999).
Potentiel énergétique et minier
Potentiel énergétique
La région d’Andriamena dispose d’un réseau hydrographique important, constitué essentiellement des trois grands fleuves, la Mahajamba, le Kamoro et la Betsiboka qui se déversent tous dans le Canal de Mozambique. Ces fleuves ainsi que leurs affluents drainent l’ensemble de la région. L’énergie hydroélectrique que cela représente n’a pas été exploitée pour plusieurs raisons :
– d’une part, au voisinage de l’usine, on n’a pas trouvé de chutes d’eau importantes ou de rivières pouvant justifier l’installation d’une petite centrale électrique;
– d’autre part, lors de l’installation de l’usine de traitement, le prix du gas-oil était encore trop bas et ne justifiait aucunement le recours à toute autre source d’énergie;
– et enfin, le débit des rivières et des fleuves pendant la saison sèche est relativement faible et rend critique l’utilisation d’une centrale hydroélectrique.
Potentiel minier
D’après Giraud P. (1960), cette région dispose également d’un potentiel minier important autre
que la chromite :
· l’or : D’une part, dans de nombreuses rivières, les orpailleurs travaillent par lavage à la batée des sables noirs et graviers. D’autre part, nous avons pu observer que quelques gîtes en place ont fait l’objet de grattage ou de travaux miniers. L’or se rencontre soit dans les alluvions récentes dans lesquelles il est concentré de façon très irrégulière, soit dans des horizons éluvionnaires au milieu de la latérite, soit en place dans des filons de quartz hydrothermaux fréquemment associés à une minéralisation plombifère ou surtout cuprifère;
· le plomb et le cuivre : sur la feuille Andriamena, on a affaire à plusieurs filons de quartz hydrothermaux renfermant les minéraux essentiels suivants : or, chalcopyrite, malachite, galène, blende;
· les pegmatites : ce sont essentiellement des pegmatites potassiques à quartz, microcline, muscovite ou biotite. Leur mode de gisement est très varié. La zonéographie de ce champ n’a pas été faite, mais on peut distinguer les types suivants : pegmatites pauvres en biotite et magnétite, pegmatites à biotite et niobiotantalates uranifères, pegmatites à biotite et muscovite, béryl et columbite;
· la magnétite-ilménite: interstratifiés dans les formations à graphite ou à pyroxène et amphibole, on rencontre en abondance des bancs de quartzites à magnétite. Il semble, dans certains cas, mais aucune analyse n’a été faite, que cette magnétite soit titanifère. L’ilménite, elle, a été rencontrée dans tous les concentrés de bâtée recueillis. Elle provient de la désagrégation des roches basiques (pyroxènites, amphibolites, vieux gabbros);
· l’amiante : il s’agit d’une amiante d’amphibole du groupe trémolite-actinote, en petits amas ou veines, au milieu de lentilles amphiboliques à trémolite-actinote et à chlorite. Les fibres sont, en général, cassantes, parfois pierreuses. Il semble que l’on se trouve toujours dans une zone où la transformation des amphiboles en amiante n’est pas complètement achevée.
Contexte environnemental
La région est essentiellement constituée de prairies avec quelques forêts résiduelles le long des rivières. Les feux de brousse constituent le principal fléau qui frappe la région. Pendant la saison des pluies, les précipitations ne sont retenues par aucune végétation et ruissellent à la surface de la latérite qu’elles dégradent à un rythme accéléré.
Des mesures doivent être prises rapidement pour remédier à cette catastrophe. On doit penser au reboisement en commençant par les zones à proximité des villages, puis étendre ces mesures de plus en plus loin jusque sur les flancs des nombreuses collines qui bordent cette région.
Contexte géologique
Guérangué (1975) a mis en évidence une importante déformation qui est responsable du plissement synfolial des basites-ultrabasites ainsi que le socle cristallin de la zone Nord Andriamena.
Les basites-ultrabasites de la zone Ouest Andriamena n’ont pas été affectées par cette déformation (Martel-Jautin et al, 1988 – Rakotomanana D., 1996). Les intrusions basiques-ultrabasiques d’Andriamena sont regroupées suivant trois essaims NW-SE (Rakotomanana D., 1996) :
le premier essaim le plus à l’Est dit d’Ambatomandondona-Bemavo recèle de petits corps chromifères submersifs ;
l’essaim central d’Andriamena-Bemanevika recèle dans sa partie Sud-Est les plus gros gisements de chromite massifs dont la taille semble augmenter en allant vers le Sud (gîtes de Belavenona, d’Andriamena, de Telomita, d’Ankazotaolana, de Bemanevika, des petits gisements FA8, L5B, …) ;
l’essaim le plus à l’Ouest dit d’Andriampotsy-Londokomana où la chromite est soit disséminée, se présente parfois en schilieren
Le caractère intrusif des complexes basiques-ultrabasiques d’Andriamena a été mis en évidence pour la première fois par Bésairie en 1959 mettant ainsi fin à une théorie plus ancienne (Giraud, Guigues) voulant que ces complexes soient des phases relictuelles d’un magmatisme basique stratiforme repris par le métamorphisme associé à l’Orogenèse Shamwaïenne (2600 MA).
Hottin (1976) a montré que les formations des séries graphiteuses et calco-ferromagnésiennes des sillons synclinoriaux, dont les séries d’Andriamena, se sont déposées durant l’Archéen. Elles ont été plissées et métamorphisées dans le faciès granulite durant l’Orogenèse majeure Shamwaïenne.
Grossièrement, la partie sommitale de la série d’Andriamena est constituée des formations paragneissiques calco-ferromagnésiennes (métagabbros et orthoamphibolites) et siliceuses. Vers le coeur du synclinorium, les faciès deviennent pélitiques alumineux à hyperalumineux. Cet ensemble métamorphisé gneissique et migmatisé dans sa très large majorité (ponctuellement granitisé) sert de socle cristallin à un complexe intrusif basique-ultrabasique que Bésairie a daté du Protérozoïque supérieur (982 MA) et qui supporte les indices de chromite de la région d’Andriamena, notamment ceux de la rive droite du fleuve Betsiboka.
D’après Giraud (1955), le socle archéen aurait un style tectonique isoclinal serré dû à l’orogenèse shamwaïenne et les formations cristallophylliennes sont en position synclinale assimilable à un graben sur les masses migmatito-granitiques. Le socle aurait été affecté par des événements successifs et juxtaposés qui auraient transformé les anciennes structures. La direction générale des couches est subméridienne légèrement Ouest ou Est. Les pendages sont forts entre 70 et 90° généralement Ouest avec des variations locales faciles.
Roches basiques et ultrabasiques
Les roches ultrabasiques sont constituées par des pyroxénolites composées de pyroxène orthorhombique et de péridotites du type harzburzite. En général, elles se présentent en petits corps filoniens ou en vastes chambres magmatiques circonscrits
Les roches basiques sont formées pour l’essentiel de leuconorites à gros grains et de gabbros ou norites à grains fins. On les trouve souvent au toit et au mur des ultrabasites. Ces roches basiques sont composées de plagioclases et de pyroxène orthorhombique.
Notons la concordance des plans de schistosité des roches ultrabasiques et basiques encaissantes avec les pendages des bancs de chromite, sauf pour les norites à grains fins qui occupe une position quelconque au sein de la leuconorite.
Contrôles gîtologiques essentiels de la minéralisation chromifère
La minéralisation chromifère d’Andriamena se présente sous trois types essentiels :
la chromite se présente sous la forme d’une minéralisation disséminée, en inclusion dans les silicates mafiques et/ou en position interstitielle par rapport aux minéraux du cumulus ou en trame interstitielle discontinue. La chromite peut alors se présenter en schlieren,
les ultrabasites et les basites peuvent avoir des textures litées et rubanées probablement magmatiques. La chromite peut alors être le constituant minéral essentiel de ces lits ou de ces rubannements sans en être le composant unique ou prédominant,
la chromite forme des structures sécantes de chromitite encaissées par les ultrabasites et plus rarement par les basites.
Les amas de chromite sont généralement contenus dans des lentilles de pyroxénolites, qui constituent la gangue du minerai. Ces pyroxénolites, roches ignées très anciennes, subissent parfois des
altérations qui les transforment en talcshistes ou soapstones.
Le caractère sécant des structures de minéralisation massive de la chromite, sa constante association aux phases hydratées laissent supposer un lessivage des silicates et de la chromite par de l’eau qui les aurait dissout et redéposé dans les fractures des basites et des ultrabasites. Malgré son mode de gisement sécant par rapport à l’encaissant, une même chromitite n’est jamais sécante par rapport à deux faciès pétrographiques superposés, sauf si les dits faciès ont un contact graduel marqué par des variations de proportions des minéraux composants.
Les développements des structures de minéralisations chromifères sont marqués par les conditions du développement de la leuconorite et de l’individualisation ou du développement des ultrabasites (Rasolomanana E., 1999).
Cadre tectonique et structural
Le plongement fort de la schistosité du socle a toujours été noté par les anciens auteurs (Giraud, Jourde, …) qui ont donné la fourchette de 70 à 90°. Des approches plus fines des variations aux abords des intrusions et sur de courtes distances (décamétriques pour les intrusions de petite taille et hectométriques pour les intrusions de grande taille relative) ont permis de relever que : la schistosité et le rubannement deviennent systématiquement et brutalement verticaux aux abords des intrusions, et les directions et le plongement de la schistosité et du rubannement épousent ceux du contact socleintrusion, notamment dans ses environs immédiats. Le suivi des variations des contacts socle-intrusion, et plus particulièrement au niveau des “modèles réduits”, nous autorise à penser que le modèle tectonique de la mise en place des intrusions est celui lié à un shearing vertical senestre.
L’observation de l’intrusion au niveau des contacts avec le socle cristallin permet de relever que
des niveaux relativement minces et conformes aux allures de l’éponte présentent de vagues structures de boudinage avec des boules et blocs à arêtes convexes et angles arrondis,
le contact est toujours une surface de coulissage de force avec des surfaces discontinues, rabotées et striées.
Ceci indique une mise en place par force de l’intrusion, on propose les modèles suivants :
· la mise en place des intrusions se serait faite à la faveur de l’ouverture de fentes de cisaillement vertical. La conformité des plans de schistosité ou de rubannement du socle à l’allure de la fente indique une déformation ductile dans des conditions de réchauffement,
· le magma basaltique serait injecté dans les fentes ainsi ouvertes où il se serait introduit par force,
· la mise en place du magma basaltique serait au moins post- et au plus syn-cinématique.
Trois grandes familles tectoniques ont été observées et qui affectent plus particulièrement les structures de la minéralisation massive de la chromite, ce sont des failles telles que :
une première famille subméridienne légèrement ouest est verticale. Le sens du rejet n’a pas pu être déterminé. Les failles de cette famille sont très rares et sont à remplissage de biotite,
une deuxième famille est de nature cisaillante probable (sur l’indice FA8 seulement). Elle a provoqué un boudinage des niveaux à chromite de la pyroxénite,
une troisième famille, la plus fréquente et rencontrée partout, est essentiellement de direction NW-SE, de plongement sud-ouest de 20 à 70°, exceptionnellement subhorizontal (10°) ou très redressé (80 à 85°). Son rejet est oblique et quelques mesures sont faites pour définir le déplacement du compartiment nord-est suivant une direction N40 à 70 sud-est. Ce rejet a une projection plane d’importance variable, allant du mètre à 3-5 mètres. Ce type de faille est systématiquement à remplissage de pegmatite, généralement de texture hébraïque.
|
Table des matières
INTRODUCTION
PARTIE I- CONTEXTE DE LA ZONE D’ETUDE
I.1- Contexte géographique
I.2- Morphologie, orographie et hydrographie
I.3- Situation climatique et pluviométrique
I.4- Contexte socio-économique
I.4.2- Agriculture et élevage
I.4.3- Potentiel énergétique et minier
I.4.3.1- Potentiel énergétique
I.4.3.2- Potentiel minier
I.4.4 Contexte environnemental
I.5- Contexte géologique
I.5.1- Roches basiques et ultrabasiques
I.5.2- Contrôles gîtologiques essentiels de la minéralisation chromifère
I.5.3- Cadre tectonique et structural
I.5.4- Les cortèges filoniens terminaux, les phénomènes tardi- et post-magmatiques
I.6- Travaux antérieurs sur le district chromifère d’Andriamena
I.6.1- Historique
I.6.2- Généralités sur les indices de chromite
I.6.3- Les gisements de chromite Bemanevika et d’Ankazotaolana
PARTIE II- RAPPELS METHODOLOGIQUES
II.1- Magnétisme aéroporté
II.2- Magnétisme au sol
II.3- Utilisation de la méthode magnétique
II.4- Avantages et inconvénients de la méthode magnétique
II.5- Traitements numériques des données
II.6- Logiciel de traitement
II.7- Documents d’interprétation
PARTIE III- RESULTATS ET INTERPRETATION
III.1- Secteur Telomita
III.2- Secteur FA8
III.3- Secteur L5B
III.4- Secteur L7G
Synthèse et discussion
CONCLUSION GENERALE
Télécharger le rapport complet