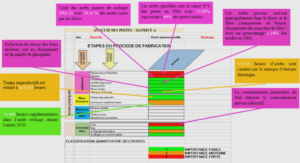A l’heure actuelle, les études environnementales montrent une croissance perpétuelle des activités humaines ainsi que les besoins qui s’y affèrent, avec en parallèle une pollution assez flagrante. Les industries et l’agriculture représentent les sources de pollution de grande envergure. De ce fait, l’environnement présente une concentration anormale de composé ayant des risques de toxicités élevés pour le milieu tel que l’utilisation abusive des engrais et des pesticides ou encore l’utilisation des énergies primaires. La conséquence de tel scénario est la pollution de l’air, du sol et plus important de l’eau.
Ce même problème existe à Madagascar à cause de l’essor industriel existant ces dernières années. Le captage des eaux souterraines représentant un pourcentage élevé pour l’approvisionnement en eaux est sujet actuellement à une pollution sévère surtout sur les côtes littorales où la nappe est de faible profondeur [1] [2]. Particulièrement, la Société Galana Raffinerie Terminale (GRT) siégeant sur la côte Est de Madagascar où des antécédents d’activité polluante successive ont été remarqués, est suspectée de polluer les eaux souterraines selon les habitants à proximité de cette dernière. Dans le cas de pollution accidentelle ou provoqué, les polluants migrent à travers la surface du sol, atteint le toit de la nappe et polluent l’eau souterraine suivant son écoulement .
TRAVAUX RECENTS CONCERNANTS LA MODELISATION DU TRANSPORT DE POLLUANT DANS LES EAUX SOUTERRAINES
La modélisation a connu un essor considérable notamment pour la simulation du transport de polluant. Divers auteurs ont proposé des modèles mathématiques de types mécanistes à l’aide d’équation différentielle établie suivant les phénomènes considérés soit en déterminant la solution exacte, soit en effectuant un analyse numérique à l’aide d’un logiciel de calcul adéquat.
GENERALITES SUR LE SOL
DEFINITIONS
❖ Appelé aussi couverture pédologique, elle représente la couche de terre meuble, peu épaisse et recouvrant une grande partie des continents.
❖ Le sol est un milieu vivant et dynamique qui permet l’existence de la vie végétale et animale. Son rôle est d’assurer la vie en tant que source de nourriture, matière première et contribue, avec la végétation et le climat, à régler le cycle hydrologique et à influencer sur la qualité des eaux [6]
❖ Le sol est une pellicule d’altération recouvrant une roche formé d’une fraction minérale et de matière organique ou humus. Sa genèse commence à partir de la roche puis évolue sous l’action du climat et de la végétation au fil du temps.
Suivant les spécialistes, la définition du sol varie mais dans notre étude, celui de Moscowicz P. et al nous incite le plus du fait de l’approche physico-chimique concernant l’eau et ses interactions avec le sol dans la tranche superficielle .
LES FONCTIONS DU SOL
Le sol assure trois fonctions .
Une fonction biologique
Le sol sert d’abri aux espèces animales et végétales. En plus, plusieurs cycles biologiques incluent le sol comme le cycle de l’eau qui est essentielle à sa propre construction.
Une fonction alimentaire
Le sol produit et contient tous les éléments nécessaires à la vie telle que Na, K, Fe, N, CO2, eau, air. En les accumulant, il peut les mettre à la disposition des plantes et des animaux.
Une fonction d’échange et de filtre
C’est un milieu poreux traversé en permanence par des flux hydriques et gazeux: l’eau des puits et des sources a préalablement traversé le sol pour être stocké en profondeur.
LA RELATION ENTRE L’EAU ET LE SOL
Elle se compose de deux zones :
● La zone non-saturée subdivisée en trois zone lui-même. Une partie la plus proche de l’air libre est la zone d’évaporation et d’évapotranspiration, une partie où le transfert d’eau par infiltration dite zone de transition et une partie où l’eau est retenue par capillarité dite frange capillaire. En général, cette appellation est due au fait que les interstices sont partiellement occupées par l’eau et le reste par l’air
● La zone saturée où l’eau occupe totalement les milieux vides présents dans le sol. Dans ce cas, nous sommes en présence d’une aquifère.
CARACTERISTIQUES DU SOL
Pour l’étude du sol, les caractéristiques liées à l’infiltration d’eau en surface ainsi qu’aux polluants lessivés sont la granulométrie, la porosité, la perméabilité ainsi que la fraction en matière organique.
● La granulométrie caractérise deux propriétés du sol : la répartition des particules par leurs dimensions et l’appréciation de la texture.
● La porosité exprime le pourcentage de vide existant dans le sol. Plus celle-ci est grande, plus le sol est poreux.
● La perméabilité défini la capacité du sol à laisser passer l’eau en écoulement. Elle est étroitement liée à la porosité et à la granulométrie.
● La fraction en matière organique donne la matière organique présent dans le sol. Son rôle assure l’adsorption des composés organiques qui se lient à eux par des interactions hydrophobes.
GENERALITES SUR L’HYDROGEOLOGIE
Les ressources en eaux représentent l’ensemble des eaux accessibles comme ressource c’està-dire utile pour l’homme et pour l’écosystème. Selon l’estimation par Cirad-Gret en 2012, 97,4 % représente les océans, 0,009% représente l’atmosphère, 1,96% les glaciers, 0,6% représente les nappes souterraines, 0,015% représente les lacs et les rivières et les eaux du sol représentent 0,005%. Durant son cycle, l’eau s’évapore sous l’effet du soleil puis elle se condense et forme les nuages. Par suite elle retombe sous forme de pluie ou de neige selon le climat et rejoignent les cours d’eau, les océans et les mers ou bien s’infiltre dans les nappes et les rivières souterraines. Notre étude se concentre uniquement sur les milieux souterrains c’est-à-dire les nappes.
|
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
PARTIE I : SYNTHESES BIBLIOGRAPHIQUES
A. TRAVAUX RECENTS CONCERNANTS LA MODELISATION DU TRANSPORT DE POLLUANT DANS LES EAUX SOUTERRAINES
B. GENERALITES SUR LE SOL
B.1. DEFINITIONS
B.2. LES FONCTIONS DU SOL
B.1.1. Une fonction biologique
B.1.2. Une fonction alimentaire
B.1.3. Une fonction d’échange et de filtre
B.3. LA RELATION ENTRE L’EAU ET LE SOL
B.4. CARACTERISTIQUES DU SOL
C. GENERALITES SUR L’HYDROGEOLOGIE
C.1. AQUIFERES
C.1.1. Aquifère à nappe libre
C.1.2. Aquifère à nappe captive
C.1.3. Autres types de nappes
C.2. PROPRIETES HYDRODYNAMIQUES DES ECOULEMENTS SOUTERRAINES
C.2.1. Gradient hydraulique
C.2.2. Conductivité hydraulique
D. LA POLLUTION
D.1. DEFINITION
D.2. ORIGINE DE LA POLLUTION
E. GENERALITES SUR LES HYDROCARBURES
E.1. DEFINITION
E.1.1. Les hydrocarbures aliphatiques
E.1.2. Les hydrocarbures aromatiques
E.2. ORIGINE DES HYDROCARBURES
E.3. LES HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
E.3.1. Caractéristiques physico-chimiques des HAP
E.3.2. Origines des hydrocarbures aromatiques polycycliques
E.3.3. Toxicité des hydrocarbures aromatiques polycycliques
F. TRANSPORT DE POLLUANT
F.1. LA CONVECTION
F.2. LA DIFFUSION MOLECULAIRE
F.3. LA DISPERSION MECANIQUE OU DISPERSION CINEMATIQUE
F.4. LA SORPTION
F.5. LA BIODEGRADATION
F.6. EQUATION DE TRANSPORT DE POLLUANT
PARTIE II : MATERIELS ET METHODES
A. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE
A.1. HISTORIQUE DE GRT
A.2. CLIMATOLOGIE
A.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
B. SOURCE DE LA POLLUTION
B.1. PRELEVEMENTS D’ECHANTILLONS
B.2. ÉCHANTILLONNAGE DES EAUX SOUTERRAINES
C. DIAGNOSTIC DU SITE POLLUE
C.1. DIAGNOSTIC DE L’EAU SOUTERRAINE
C.1.1. Le pH
C.1.2. Le DBO5
C.1.3. Le DCO
C.1.4. La teneur en huile et graisse
C.2. CARACTERISATION DU SOL
C.2.1. La granulométrie
a) Texture du sol
b) Le diamètre des particules
C.2.2. La porosité
a) La densité apparente sèche
b) La densité réelle
C.2.3. La fraction en carbone organique
D. PARAMETRES HYDRODYNAMIQUES DE L’AQUIFERE
D.1. LA CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE A SATURATION
D.2. GRADIENT HYDRAULIQUE
D.3. LA POROSITE EFFICACE
E. PARAMETRES LIES AUX POLLUANTS
E.1. LE FACTEUR DE RETARD
E.1.1. La vitesse de mobilisation des polluants
E.1.2. La vitesse d’écoulement de la nappe
E.2. LA CONCENTRATION EN POLLUANT
E.3. LE COEFFICIENT DE DIFFUSION MOLECULAIRE
F. MODELISATION DU TRANSPORT DE POLLUANT
F.1. POSITION DU PROBLEME
F.2. SOLUTION ANALYTIQUE
F.3. SOLUTION NUMERIQUE
F.3.1. Notion de maillage et discrétisation
F.3.2. Discrétisation des dérivées partielles
F.3.3. Schéma d’Euler implicite
F.3.4. Stabilité du schéma numérique
PARTIE III : RESULTATS ET DISCUSSIONS
A. DIAGNOSTIC DU SOL ET DE L’EAU SOUTERRAINE
A.1. ANALYSE DE L’EAU SOUTERRAINE
A.2. ANALYSE DE LA TEXTURE
A.3. ANALYSE GRANULOMETRIQUE
A.4. LA POROSITE
A.3.1. Densité apparente du sol
A.3.2. Densité réelle du sol
A.5. LA FRACTION EN CARBONE ORGANIQUE
A.6. CONCLUSION PARTIELLE
B. PARAMETRES HYDRODYNAMIQUES DE L’AQUIFERE
B.1. CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE
B.2. GRADIENT HYDRAULIQUE
B.3. LA POROSITE EFFICACE
B.4. CONCLUSION PARTIELLE
C. PARAMETRES LIES AUX POLLUANTS
C.1. LE FACTEUR DE RETARD
C.2. LA CONCENTRATION EN POLLUANT
C.3. LE COEFFICIENT DE DIFFUSION MOLECULAIRE
D. MODELISATION DU TRANSPORT DE POLLUANT
D.1. PREDOMINANCE DES PHENOMENES MIS EN JEU
D.2. SOLUTION DU MODELE POUR LES DEUX METHODES
D.3. INTERCOMPARAISONS ET VALIDATION DES MODELES
E. ETUDE COMPARATIVE
CONCLUSION