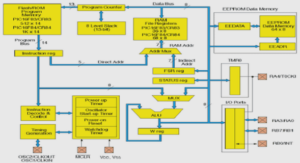Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Les ingénieurs et l’éthique au Québec et en Allemagne
L’Ordre des ingénieurs du Québec44
La réflexion éthique ne s’est pas développée qu’outre-Atlantique. D’ailleurs, comme je l’ai dit précédemment, le premier code d’éthique s’adressant à des ingénieurs, qui était en fait un code de « conduite professionnelle », est européen : il a été adopté en 1910 par l’Institution of Civil Engineers britannique. Aujourd’hui, des codes d’éthique existent à peu près partout dans le monde, mais les modalités d’institutionnalisation diffèrent d’un pays à l’autre. Dans certains pays, les ingénieurs sont organisés au sein d’un Ordre, comme il y en a un en France pour les architectes depuis 1940, et pour les médecins depuis 1945. Le non respect du code de déontologie professionnelle peut alors conduire à la radiation du « tableau de l’Ordre » et donc l’impossibilité de pratiquer le métier.
Pour les ingénieurs, c’est le cas au Québec où le principe d’autogestion est un fondement du système professionnel. L’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) tel qu’il existe aujourd’hui date de 1974. Il remonte en fait à 1898 : à l’époque, la pratique de la profession était restreinte dans la province de Québec, aux seuls membres de la Société canadienne des ingénieurs civils, fondée en 1887. Cette société devient l’Institut canadien des ingénieurs en 1918 et ouvre une section québécoise en 1920. La Corporation des ingénieurs professionnels de la Province du Québec, est l’ancêtre de l’actuel OIQ. Elle comptait lors de sa création 500 membres, l’OIQ compte aujourd’hui 41 000 membres. Le premier code d’éthique des ingénieurs fut établi en 1924 par la Corporation. La même année, elle forma un comité chargé d’étudier la pratique illégale. En 1932, l’assemblée générale adopta un sceau officiel pour les ingénieurs leur permettant d’authentifier leurs plans, rapports et documents officiels. Celui-ci devint obligatoire en 1959, avec l’entrée en vigueur d’un nouveau code d’éthique.
Le 6 juillet 1973, le Code des professions et la création de l’Office des professions du Québec modifient en profondeur la réglementation québécoise des corporations professionnelles45. Si les professions ont toujours « pour principale fonction d’assurer la protection du public »46, la nouveauté est que désormais les corporations n’assument plus seules cette responsabilité. En effet, l’Office des professions a été investi de la responsabilité juridique et des pouvoirs nécessaires pour obliger, le cas échéant, chaque profession à respecter cette priorité47. Sur le plan administratif, la loi donna alors des pouvoirs étendus aux comités de discipline des corporations, faisant de leurs codes des réglementations ayant quasiment force de loi. Ainsi, suite à l’adoption de la loi 260 par le Gouvernement du Québec, la Corporation des ingénieurs changea de nom pour devenir l’Ordre des ingénieurs du Québec. En 1976, son code d’éthique fut remplacé par un code de déontologie auquel doivent se conformer tous les membres de la profession. L’OIQ s’est vu déléguer, comme tous les autres ordres professionnels existants, le contrôle de l’accès à l’exercice de la profession, aussi bien que la surveillance de la pratique et le respect de l’intégrité professionnelle avec un pouvoir qu’aucune association n’a jamais eu aux Etats-Unis.
La loi sur les ingénieurs précise dans la section 1 concernant les « dispositions interprétatives » que le mot « ingénieur » désigne pour elle « un membre de l’Ordre », c’est à dire « une personne inscrite au tableau de l’Ordre », le tableau étant « la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi ». Le champ de la pratique protégée des ingénieurs est décrit ensuite de façon très détaillée : par exemple, il est précisé que « les chemins de fer, les voies publiques, les aéroports, les ponts, les viaducs, les tunnels et les installations reliées à un système de transport » ne relèvent de ce champ que si leur coût excède trois mille dollars. Quant à la nature de l’activité des ingénieurs, elle consiste à faire pour le compte d’autrui les actes suivants : « donner des consultations et des avis ; faire des mesurages, des tracés, préparer des rapports, calculs, études, dessins, plans, devis, cahiers des charges; inspecter ou surveiller les travaux ».
La formation des ingénieurs se déroule au Québec en cinq années : elle conduit à l’obtention d’un baccalauréat en ingénierie qui donne accès à la profession d’ingénieur. Les étudiants qui veulent s’orienter vers la recherche choisiront plutôt de préparer, en cinq ans également et dans les mêmes universités, le diplôme de maîtrise, qui donne accès au Ph.D. La plus ancienne d’entre elles, l’Ecole polytechnique, qui fut créée en 1878, connut un démarrage particulièrement difficile et fut pendant plusieurs décennies la seule institution permettant aux jeunes francophones d’acquérir une formation d’ingénieur. Ses diplômés ont d’ailleurs été fortement associés à la création en 1920 de la Corporation des ingénieurs du Québec. Dans tous les programmes de cette institution, 15% des cours sont consacrés aux sciences humaines, sociales et administratives. La moitié est donnée sous forme de cours obligatoires : la gestion de projets d’ingénierie ; l’éthique et les responsabilités de l’ingénieur, ainsi que les questions de santé et de sécurité au travail; la technologie et l’organisation (ou la technologie et l’environnement ou encore la technologie, l’information et la société); l’économie de l’ingénieur et enfin, l’introduction au génie. Les autres cours sont choisis par les étudiants, à l’intérieur d’une banque de cours. « Dans ces cours, le futur ingénieur est amené à considérer le génie dans une perspective humaniste et sociale. Il y prend conscience de son rôle et de ses responsabilités, et développe un esprit ouvert et critique. En effet, l’ingénieur ne peut exercer sa profession sans être sensibilisé au contexte humain dans lequel elle s’inscrit et sans être ouvert aux grandes questions de l’heure »48.
Face à l’évolution rapide de la pratique du génie, à la modification des formations, à la multiplication des disciplines, au constat que le développement technologique et les préoccupations environnementales devenaient des enjeux prioritaires pour la société, « l’Ordre a décidé, en 1987, de faire [de ces questions] ses choix de société et d’y apporter un éclairage particulier en présentant le point de vue de la profession sur ces questions d’intérêt public »49. Concrètement, quelques années plus tard, le premier manuel québécois destiné à l’enseignement de l’éthique dans les écoles d’ingénieurs a été publié avec le soutien et la participation de l’OIQ. L’ouvrage québécois Ethique et Ingénierie50 s’inspire des travaux existants en Amérique du Nord en les adaptant au contexte du pays. Il a été élaboré à partir du cours « Ethique et pratique professionnelle » donné depuis 1985 à la Faculté des sciences appliquées de l’Université de Sherbrooke. Les auteurs y développent une méthode centrée sur une grille d’analyse de la décision très influencée par les théories du développement moral de Lawrence Kohlberg51. Deux problématiques sont également abordées : celle des professions et du professionnalisme dans la modernité et celle de la responsabilité sociale des ingénieurs et des autres décideurs en ingénierie.
Une histoire de la profession intimement mêlée à l’histoire des formations68
La formation des ingénieurs en France : une histoire de plus de deux siècles
La profession d’ingénieur est particulièrement enviée en France : c’est, selon Paul Bouffartigue et Charles Gadéa, le pays où le prestige social associé à la figure de l’ingénieur est le plus marqué69. Le titre exerce dans l’imaginaire national une fascination certaine : il évoque l’excellence scolaire, la réussite d’un concours extrêmement sélectif, le passage par une préparation éprouvante de deux ou trois ans au cours de laquelle est dispensée une formation mathématique poussée. Il évoque également un statut élevé, l’appartenance à une élite, attributs des rares diplômés des meilleures écoles qui demeurent des références incontournables, malgré la diversité d’accès à la profession et de prestige des institutions.
Les premières écoles d’ingénieurs fondées dans la deuxième partie du dix-huitième siècle ont eu une influence déterminante sur la profession et sur les formations. L’Ecole des Ponts et chaussées est la plus ancienne : créée en 1747, elle fut suivie de près par l’Ecole du génie de Mézières en 1748 et l’Ecole des mines en 1783. Mais celle dont l’influence a été la plus marquante depuis sa création jusqu’à aujourd’hui est l’Ecole polytechnique fondée en 1794, dans la foulée de la Révolution, un an après la dissolution des universités. Ces institutions qui se sont vite dotées d’un enseignement théorique formalisé, ont contribué à instaurer un système de formation scientifique de haut niveau, en dehors des facultés des sciences. Leur statut était renforcé par les pouvoirs techniques et administratifs considérables conférés à leurs diplômés, destinés à servir dans les corps techniques de l’Etat. Cependant, si la position dominante dans la société des ingénieurs qui étaient issus de ces institutions prestigieuses a permis de doter le pays d’une élite scientifique sûre et capable de répondre aux besoins d’une France pré-industrielle, elle a également freiné l’émergence des « ingénieurs civils » au XIXè siècle. Une précision lexicale s’impose ici : le terme « ingénieur civil » qui n’est plus utilisé aujourd’hui en France et qui dans sa traduction anglaise désigne les ingénieurs du génie civil désignait à l’époque en français l’ingénieur de l’économie privée par opposition au fonctionnaire. Selon Bruno Jacomy, c’est parce que c’est dans le domaine des travaux publics, c’est-à-dire du « génie civil » (civil engineering) que la rivalité entre les fonctionnaires et les autres ingénieurs était la plus dure (et la plus injuste selon ces derniers) que les « non-fonctionnaires » ont choisi de s’appeler ainsi, s’appuyant aussi sur le modèle de la prestigieuse Institution of civil Engineers anglaise70.
La reconnaissance du titre : un dur combat et un lourd héritage
Le diplôme d’ingénieur « civil » est né avec la création de l’Ecole centrale des arts et manufactures en 1829, qui a été suivie de celle d’autres institutions, qui gardèrent chacune une individualité forte. Après la Première Guerre Mondiale, la prolifération de la délivrance de diplômes d’ingénieurs incita le gouvernement sur proposition de la Fédération des associations, sociétés et syndicats d’ingénieurs (FASSFI), créée à l’aube de la crise de 1929,
à promulguer la loi du 10 juillet 193471. Par ce texte, c’est le titre d’« ingénieur diplômé » – et non d’« ingénieur » – qui fut réglementé avec obligation de préciser le nom de l’école ayant délivré le diplôme. Ainsi, c’est à un diplôme d’école et non un diplôme national, tels que ceux qui sont décernés par l’université, qu’ont abouti les longs débats sur le titre d’ingénieur et sa protection. La loi de 1934 institua également la Commission des titres d’ingénieurs (CTI), organisme chargé d’attribuer les habilitations à délivrer le diplôme aux écoles d’ingénieurs privées. Cette commission, devenue centrale dans le système français des formations d’ingénieurs, est composée de trois collèges : les représentants du Ministère et du personnel enseignant ou dirigeants des grandes écoles y siègent à parité avec, à parts égales, le groupement d’employeurs le plus représentatif et les groupements d’ingénieurs les plus représentatifs72. La mention obligatoire de l’établissement d’origine des ingénieurs diplômés renforça la rivalité entre les écoles et la hiérarchie très figée des titres. Ainsi, dès l’entre-deux guerres, deux groupes d’ingénieurs s’opposent : ceux qui le sont de par leur fonction dans leur entreprise, et les « vrais », les incontestés, dont le titre est protégé par la loi.
L’aboutissement des longs débats autour du titre est probablement à l’origine d’un des traits dominants du système français qui relie l’école d’origine au déroulement de la carrière professionnelle. Par ailleurs, la réglementation a également contribué indirectement à uniformiser les formations les portant toutes à cinq années d’études après le baccalauréat : le parcours de formation « canonique » d’un ingénieur français est ainsi constitué de trois ans dans une école habilitée par la Commission des titres, à laquelle les étudiants accèdent sur concours à l’issue de deux ou trois années de « classes préparatoires aux grandes écoles » passées dans un lycée73. Cette uniformisation, réalisée au détriment de la constitution d’une formation supérieure technique de niveau intermédiaire, a fait de la France le pays où la distinction entre ingénieurs et techniciens est certainement la plus tranchée : l’ingénieur diplômé est issu d’une formation supérieure de cinq ans tandis que le technicien supérieur possède un « diplôme universitaire de technologie » (DUT) ou un « brevet de technicien supérieur » (BTS) obtenus l’un comme l’autre en deux ans. Enfin, le poids du modèle de la grande école a contribué à éloigner les écoles d’ingénieurs des besoins des entreprises en particulier en matière d’ingénieurs de production, malgré la création régulière de formations cherchant à s’adapter davantage à l’industrie.74
Le cas de l’Ecole nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) est exemplaire de ce nivellement vers le modèle « canonique » des formations d’ingénieurs75. Les Ecoles d’arts et métiers qui avaient été créées au début du XIXe siècle pour former des ouvriers qualifiés et des chefs d’atelier donnèrent beaucoup d’« ingénieurs maison » à l’industrie par promotion sur le lieu de travail. Elles bénéficièrent de l’investissement très fort de la Société des anciens élèves des Arts et Métiers, créée en 1847, qui poussa à une amélioration constante des programmes. Elles reçurent le droit de décerner un brevet des Arts et Métiers en 1885, puis un brevet d’ingénieur A&M en 190776. Le contenu scientifique de la formation fut pour cela renforcé et la formation qui durait trois ans, passa à quatre en 1950, puis à cinq ans en 1963. Enfin en 1974, l’Ecole devenue « nationale » et « supérieure » rejoignit le rang des prestigieuses « grandes écoles » en proposant aux futurs gadzarts77 une formation de trois ans accessible désormais sur concours à l’issue de deux années de classes préparatoires.
Pour reprendre les propos de Bernard Decomps, Président du Haut comité éducation-économie et auteur d’un rapport ministériel publié en 1989 sur les besoins en ingénieurs en France et l’évolution de leur formation78 : « Notre pays a une tradition qui veut qu’on appelle ingénieur quelqu’un qui a fait une grande quantité de mathématiques, de physique et a suffisamment cultivé l’abstraction avant de s’intéresser de plus près aux technologies. Résultat : tous les vingt ou trente ans, on découvre que les jeunes ingénieurs ne sont pas adaptés aux techniques et on crée une nouvelle école ! »79. Cette façon de faire avait été inaugurée par l’Ecole centrale des arts et manufactures : créée en 1829 par des savants et des industriels avec l’ambition de former de « véritables » ingénieurs industriels, l’Ecole centrale fut vite reconnue comme une filière d’excellence, à l’instar de Polytechnique. Progressivement, on vit les deux institutions se rapprocher : Polytechnique s’inspirant du programme scientifique de l’Ecole centrale et celle-ci prenant exemple sur son aînée quant aux modalités de recrutement des étudiants. Plus récemment, les institut nationaux des sciences appliquées (INSA), ouverts aux bacheliers en 1957 pour une formation de quatre ans, passèrent à un cursus de cinq années d’études dont les deux premières constituent les classes préparatoires « intégrées ». Les écoles nationales d’ingénieurs (ENI) ouvertes en 1960 pour former en quatre ans des ingénieurs venant remplacer les ingénieurs des Arts et Métiers, dont la position hiérarchique en entreprise s’était élevée avec le statut de leur école, se sont battues pour obtenir le « droit » à une cinquième année.
La formation des ingénieurs français aujourd’hui
En 2000, 232 établissements habilités par la Commission des titres d’ingénieurs délivrent en France un peu plus de 25 000 diplômes d’ingénieurs chaque année. Les trois quarts d’entre eux forment moins de cent ingénieurs par an et seules huit écoles en forment plus de trois cents (dont l’ENSAM, l’INSA de Lyon, Centrale et Polytechnique). Près d’un quart des ingénieurs diplômés sortent d’une école privée. La plupart des établissements publics – formations universitaires comprises – relèvent du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, les autres dépendent d’autres ministères (défense, agriculture, industrie, télécommunications…) en particulier celles qui forment en même temps des ingénieurs des corps (Polytechnique, Mines-Ponts, Travaux publics de l’Etat, « Agro »). Le paysage de la formation des ingénieurs français est donc particulièrement éclaté.
La période plus récente de l’histoire des ingénieurs fut surtout marquée par la tentative de réforme de l’enseignement supérieur proposée par Edgar Faure après les événements de 1968. Deux associations furent alors fondées en 1969 et 1970 pour défendre les intérêts des grandes écoles : la Conférence des grandes écoles (CGE) qui rassemble des directeurs d’écoles scientifiques et de gestion (174 en 1998) et le Comité national pour le développement des grandes écoles (CNGE) qui réunit des dirigeants d’entreprises ou de groupements professionnels, des directeurs d’écoles et des représentants des associations d’anciens élèves. Lors de l’élection du gouvernement socialiste en 1981, les grandes écoles virent leurs privilèges à nouveau menacés par le programme du Ministre de l’Education Nationale, Alain Savary, qui souhaitait assimiler les classes préparatoires aux universités. Les associations d’anciens élèves, la CNGE, et le Conseil national des ingénieurs français (CNIF, fondé en 1957) firent jouer leurs liens avec le monde industriel et la haute fonction publique, dont les dirigeants sont pour la plupart issus des grandes écoles, pour contrer avec succès les propositions les plus audacieuses du programme. La loi se contenta de limiter la représentation forte des anciens élèves dans les conseils d’administration des écoles. Certaines associations d’élèves demeurent de puissants groupes de pression : lors d’incidents récents à l’occasion de l’« usinage » – nom du bizutage des gadzarts à l’ENSAM – on a pu voir la profession s’émouvoir des attaques portées à cette tradition défendue avec vigueur par « l’association d’ingénieurs issus d’une même formation la plus importante d’Europe », avec plus de 25 000 adhérents.
L’histoire « manquée » de la professionnalisation des ingénieurs français
Jusqu’en 1829, la France n’a connu d’ingénieurs qu’au service de la Nation qui furent vite dotés d’une formation scientifique et technique spécifique de haut niveau. Ce n’est donc pas l’absence d’un corpus de savoir professionnel spécifique qui a freiné la naissance de la profession, c’est plutôt l’organisation des ingénieurs en un groupe professionnel indépendant de l’Etat qui a fait défaut. Les ingénieurs français ont donc été formés très tôt aux théories sur lesquelles s’appuyait la pratique des génies, mais parce qu’ils travaillaient dans les corps techniques, ils étaient au service de la nation (ou du roi) avant d’être au service du métier ou de leur groupe : ils étaient des fonctionnaires avant d’être des professionnels. Et cette caractéristique marquera la suite de l’histoire. La profession ne pouvait pas naître des ingénieurs des corps, et n’aurait pu émerger que sur l’initiative des premiers « ingénieurs civils » formés à l’Ecole centrale des arts et manufactures à partir de 1828. Mais la Société des ingénieurs civils, première association d’ingénieurs en France, créée en 1848, n’est pas parvenue à donner des bases solides à la profession en tant que groupe80. Chaque nouvelle école qui s’ouvre se dote d’une association d’anciens, chargée de soutenir et promouvoir ses diplômés : « à une période ‘héroïque’ pour les ingénieurs civils au milieu du siècle, solidaires pour se faire reconnaître, succède une période de concurrence entre écoles où c’est moins la qualité d’ingénieur que l’étiquette de telle école qui prévaut progressivement »81.
Au cœur du combat des ingénieurs civils: les associations d’anciens élèves
A la fin du XIXe siècle, la résistance des membres des corps de l’Etat au développement des ingénieurs « civils » suscité par la demande industrielle constitua la première étape de la professionnalisation des ingénieurs français. Alors que l’Association des ingénieurs allemands (VDI) se battait pour arracher le prestigieux grade de « docteur » de l’Université (obtenu en 1899) et que les ingénieurs des Etats-Unis cherchaient à obtenir la reconnaissance sociale réservée aux professions, les ingénieurs « civils » français vivaient un conflit larvé avec les ingénieurs de l’Etat aux tendances protectionnistes, dont le titre prestigieux était assorti du statut protégé des fonctionnaires82. Ces derniers se voyaient reprocher, en particulier, le cumul de leurs fonctions administratives et de missions d’expertise rémunérées sous forme d’honoraires par des entreprises privées. Dejà en 1848, alors que l’Ecole Centrale n’avait pas vingt ans, Emile Thomas, écrivait que « ceux-ci, grâce à un préjugé de corps, et à des vues de privilèges, abusent souvent de leur position presque magistrative, pour écarter les mémoires, préjudicier à des projets qui n’émanent pas de leur corps : souvent même, et lorsqu’ils ont à effectuer la réception des travaux d’art au compte de l’Etat, pour nuire, sans la moindre nécessité, aux intérêts matériels des entrepreneurs, et à la réputation des ingénieurs civils »83.
C’est dans cette dynamique de reconnaissance des ingénieurs « civils » que fut créée sur l’initiative de jeunes « centraux » (diplômés de l’Ecole centrale), la Société « centrale » des ingénieurs civils français (SCIC) en 184884. Les objectifs de cette association d’ingénieurs civils, la plus ancienne et longtemps la seule en France, étaient d’élever le statut de l’industrie – et donc son prestige social – mais également de définir les fonctions que devraient y assurer les ingénieurs. Selon l’article 2 des statuts de l’association créée en 1848, son objectif est d’« éclairer par la discussion et le travail en commun les questions d’arts relatives au génie civil ; de concourir au développement des sciences appliquées aux grands travaux de l’industrie »85. La SCIC s’ouvrit dès sa création aux ingénieurs autodidactes et ingénieurs issus d’autres formations que Centrale sous les mêmes conditions de parrainage que les centraux. La seule condition était de ne pas – ou plus – être fonctionnaire. La Société fut reconnue d’utilité publique en 1860 sous le nom de Société des ingénieurs civils de France (ICF).
Au cœur de la rivalité entre civils et fonctionnaires, caractéristique de la fin du XIXe siècle, le cas des ingénieurs civils formés à l’Ecole des ponts et chaussées est exemplaire, car c’est dans le domaine du Génie civil que la concurrence fut la plus forte et le climat le plus tendu entre les deux groupes. La lutte pour l’obtention du titre d’« ingénieur civil de l’Ecole des ponts et chaussées » fut au cœur des revendications de l’Association des ingénieurs civils, anciens élèves de l’Ecole des ponts et chaussées dès sa création, en 1860. Elle ne cessa qu’avec la loi de 1934, soit plus d’un demi-siècle après l’existence, dans les faits, d’ingénieurs civils formés par l’EPC. La nouvelle réglementation protégeant le titre « d’ingénieur diplômé » (suivi du nom de l’école) permit aux « civils » de porter, sans être inquiétés, le nom d’« ingénieurs diplômés de l’Ecole des ponts et chaussées. »
Dans ce contexte difficile d’émergence de l’ingénieur civil, l’éclatement des formations d’ingénieurs et les hésitations de la Société des ingénieurs civils à remplir sa mission de représentation des intérêts concrets des ingénieurs civils, expliquent, selon André Grelon, l’importance que prirent les amicales d’anciens élèves, en particulier celles des écoles les plus anciennes86. Ainsi, le combat pour la reconnaissance des ingénieurs civils renforça l’« esprit d’école » et éloigna les jeunes ingénieurs et leurs associations des discussions plus larges touchant la profession, les droits et les devoirs de ses membres, ainsi que les questions politiques et sociales. L’influence forte des corps de l’Etat, longtemps les seuls employeurs, a créé de plus un habitus de traiter les problèmes liés à l’utilisation des technologies par voie légale et administrative
|
Table des matières
Introduction
PREMIERE PARTIE Les ingénieurs et leur éthique professionnelle : perspective théorique et historique
Chapitre 1. L’éthique professionnelle des ingénieurs
1. Introduction
2. L’engineering ethics, une discipline née aux Etats-Unis
3. A la recherche des discours éthiques des ingénieurs français
4. Conclusion
Chapitre 2. Les ingénieurs et leur univers professionnel et moral
1. Introduction
2. Le concept de profession parasite le débat sur l’engineering ethics
3. L’engineering ethics : éthique « appliquée » ou « sectorielle » ?
4. L’”ingénierie” n’est pas neutre du point de vue des valeurs
5. La maîtrise de l’ingénierie : une question éthique et politique
6. … qui concerne aussi les ingénieurs
7. Le pouvoir des ingénieurs en question
8. Conclusion
DEUXIEME PARTIE Mise en place d’une enquête originale sur les ingénieurs français
Chapitre 3. Présentation de l’échantillon et du questionnaire d’enquête
1. Introduction : de l’éthique à la sociologie
2. La population de l’enquête sur les ingénieurs, la science et la société
3. L’enquête sur « les Ingénieurs, les Sciences et la Société » (ISS)
4. Représentativité de l’échantillon des répondants
Chapitre 4. La structure des données socio-démographiques de l’enquête ISS
1. Introduction
2. Que font « les hommes en gris » au travail ?
3. Des destins tracés d’avance ?
4. « Les femmes ne sont pas des hommes comme les autres »
5. Conclusion 2
TROISIEME PARTIE Les ingénieurs et leurs représentations des relations qu’entretiennent les sciences, la technique et la société
Chapitre 5. Les ingénieurs et leurs identités professionnelles
1. Introduction
2. L’ingénieur : un cadre pas tout à fait comme que les autres ?
3. Le rôle des ingénieurs, selon la profession et selon les diplômés.
4. Dynamique du groupe professionnel des ingénieurs
5. Identité professionnelle et questions d’éthique
6. Conclusion
Chapitre 6. Éthique professionnelle et attitudes politiques et syndicales
1. Introduction
2. L’orientation politique des ingénieurs
3. L’intérêt des ingénieurs pour la politique
4. Attitudes politique et questions d’éthique
5. Conclusion
Chapitre 7. Éthique professionnelle et attitudes religieuses
1. Introduction
2. Les croyances et des pratiques religieuses des ingénieurs
3. Les ingénieurs catholiques : un groupe homogène
4. Attitudes religieuses et attitudes morales
5. Attitudes religieuses et questions d’éthique
6. Conclusion
Conclusion générale
Bibliographie
Télécharger le rapport complet