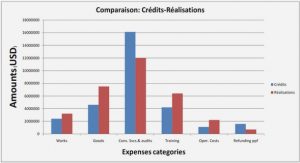Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Influences et interactions du ‘contrôle invisible’
De la reconnaissance des transactions informelles…
La théorie des transactions informelles développée par Breton et Wintrobe (1982) introduit les relations de confiance dans le cadre de la théorie de l’agence. Elle met en avant le rôle et le mode de fonctionnement des échanges informels dans la bureaucratie1. Elle donne la première explication économique de l’existence et du fonctionnement des structures informelles dans les organisations (Charreaux, 1990). Cette théorie explique de manière précise le fonctionnement des réseaux de relations informelles d’une part, et les interrelations entre ces réseaux informels et le contrôle. L’hypothèse de base est que les relations dans l’entreprise ne sont pas gouvernées par le pouvoir mais par l’échange. Cette relation d’échange est, pour les auteurs, fondée sur la confiance.
La confiance apparaît donc comme une alternative au fonctionnement des institutions dans la mesure où elle garantit l’exécution des contrats informels2. Elle joue un rôle central dans le fonctionnement des réseaux et dans la construction de la relation entre supérieurs et subordonnés dans les organisations hiérarchiques. Les transactions informelles sont la base de ces relations. La coopération d’un subordonné avec son supérieur (l’adoption d’un comportement dirigé vers l’atteinte des objectifs du supérieur) dépend du prix (matérialisé sous forme d’avantages divers) que le supérieur est prêt à payer au subordonné. Les questions que soulèvent Breton et Wintrobe (1982) sont les suivantes : les subordonnés peuvent-ils poursuivent leurs propres objectifs quand ceux-ci diffèrent de ceux de leurs supérieurs ? Si oui, sous quelles conditions et dans quelles limites ? En cherchant à répondre à ces questions, les auteurs développent une théorie de la confiance et des réseaux comme fondement d’une théorie du comportement sélectif. Bien que la structure analytique du modèle soit celle de l’économie néoclassique, ils y intègrent trois concepts fondamentaux : le comportement sélectif, la confiance et la concurrence interne.
L’idée essentielle est que les membres de la bureaucratie choisissent d’être efficaces (coopératifs) ou inefficaces (non coopératifs), et se comportent de manière sélective. Le comportement sélectif efficace ou inefficace est déterminé par l’intention du subordonné d’atteindre les objectifs fixés par le supérieur ou au contraire de les contrarier. La capacité de comportement sélectif est évaluée en termes de réduction des coûts, eux-mêmes déterminés en termes de services informels1. Le comportement sélectif nécessite l’utilisation de réseaux, considérés comme des institutions dans lesquelles les services informels des subordonnés sont échangés contre certaines caractéristiques du travail (avantages divers).
A l’intégration au sein de la relation de contrôle
Ces processus formels sont « nécessaires aussi bien qu’inévitables » (Galbraith, 1973, p. 47) et leur utilisation est améliorée quand ils sont conçus à l’intérieur de l’organisation formelle. De nombreux auteurs soulignent les interactions sociales profondes qui se déroulent dans le cadre des échanges informels et dépassent la conception plus mécanique de Breton et Wintrobe (1982). Interaction entre structure formelle et structure informelle
Barnard (1938) définit les organisations formelles comme le processus social concret par lequel l’action sociale est accomplie en grande partie. Le système coopératif est « un système complexe composé d’éléments physiques, biologiques, personnels et sociaux qui se trouvent dans une relation spécifique et systématique, en vue de la coopération de deux ou plusieurs personnes pour au moins un certain temps » (Barnard,1938, p. 65). Les organisations sont une forme de coopération entre les hommes de nature consciente. Cette coopération est délibérée et orientée vers un but. Elle est une conséquence de la modification de l’action de l’individu. Les individus qui entrent dans un processus coopératif créent des interactions à caractère social qui ne peuvent être évitées. Par ailleurs, la coopération impose des changements dans les motivations des individus. La conjonction de différents facteurs, dont ceux liés à la relation de groupe influence la psychologie de l’individu. Cependant, le système coopératif permet également d’établir entre les individus une relation consciente et délibérée (Barnard, 1938, p. 42). Ce type de relation présente deux particularités : d’une part, elle induit des actions spécifiques afin d’amener l’individu dans le système coopératif; d’autre part, elle contrôle ses actions au sein du système. La conséquence la plus importante de la coopération est le conditionnement social de tous ceux qui participent (Barnard, 1938). Les motivations des individus sont ainsi constamment modifiées par la coopération.
On retrouve également cette distinction chez Simon (1976, p. 147). Selon l’auteur, l’organisation informelle est constituée par l’ensemble des contacts et interactions, personnels et quotidiens que les individus établissent entre eux sans pour autant poursuivre de but commun (Simon, 1976, p. 115). Pour leur part, Guibert et Dupuy (1997) s’inscrivent dans la même perspective de « complémentarité » du contrôle formel et du contrôle informel et indiquent que « pas plus qu’elles ne sont substituables, ces deux formes de contrôle ne fonctionnent en opposition l’une contre l’autre ».
Encastrement de l’économique et du social
Steiner (1994) rappelle la définition donnée par Granovetter (1985) du concept
d’encastrement », aujourd’hui à la mode, en ces termes : « Par « embeddeness » je veux dire que l’action, les résultats et les institutions économiques sont affectés par les relations personnelles des agents et par la structure de l’ensemble de leur réseau de relations ». Il s’agit d’une logique unique, dans le sens où les acteurs ne poursuivent pas des intérêts égoïstes immédiats, mais se concentrent à entretenir des relations de coopérations à long terme qui apportent des bénéfices aux niveaux individuel et collectif du point de vue de l’apprentissage, du partage du risque, de l’investissement et des facilités d’accès des produits sur le marché (Uzzi, 1996).
Cette théorie, développée par Granovetter (1985 ; 1992) postule que l’encastrement réduit les comportements opportunistes et favorise l’enrichissement des relations de confiance et de réciprocité (Uzzi, 1996). La confiance réduit à son tour l’incertitude de la transaction. Ce principe apparaît fondamental pour la compréhension des échanges économiques et repose sur trois postulats fondamentaux :
la poursuite des buts économiques est accompagnée par la poursuite de buts non économiques tels que la sociabilité, la reconnaissance, le statut et le pouvoir ;
l’action économique, comme toute action, se situe dans un contexte social et ne peut être expliquée par la seule référence aux motivations individuelles ;
les institutions économiques n’émergent pas automatiquement en fonction de circonstances externes ; elles sont construites socialement. La compréhension de ce processus nécessite de porter une attention particulière aux dynamiques qui le sous-tendent. L’action économique est « encastrée » dans les réseaux de relations personnelles entre acteurs.
On peut identifier deux caractéristiques de « l’encastrement » : une caractéristique relationnelle et une autre structurelle. L’encastrement relationnel a des effets directs sur l’action économique individuelle. Il concerne la qualité de l’échange (comportement des partenaires, prise en compte des besoins et objectifs de l’autre, développement de relations de confiance, partage d’information).
L’« encastrement » structurel s’intéresse à l’architecture du réseau et au contrôle social (notamment les normes de groupe). Uzzi (1996) précise que l’action économique est déterminée par la structure et la qualité des liens sociaux entre les entreprises, qui créent des opportunités et offrent un accès unique à ces opportunités. Pour Weber (1956) « le contenu significatif d’une relation sociale peut reposer sur une entente par un engagement mutuel. Cela signifie que ceux qui participent à cette relation se font (entre eux ou d’une autre manière) des promesses valant pour leur comportement futur. Chaque participant compte alors normalement – pour autant qu’il considère les choses rationnellement – sur le fait que (avec une certitude variable) l’autre orientera son activité dans le sens que lui-même (agent) donne à l’entente ». La sociologie économique souligne la nécessité de développer des relations de confiance et un comportement loyal afin que l’action économique et les institutions puissent fonctionner normalement. Granovetter (1992) étudie également les conditions socio-structurelles susceptibles de produire de la confiance et de la loyauté (ou méfiance et malveillance). Il précise que la défiance, l’opportunisme et le désordre ne sont jamais complètement absents ou omniprésents. Le fait que le comportement loyal puisse faire partie d’une relation personnelle reflète, selon l’auteur, l’un des effets les plus directs de l’« encastrement » relationnel. Ce dernier explique la préférence des acteurs économiques à travailler avec des individus avec lesquels ils ont déjà traité. De ce fait,
une relation continue fournit des incitations à la loyauté et encourage les transactions futures. Elle permet de rendre le comportement plus prévisible.
Le rôle des réseaux sociaux
Dans le cas des réseaux informels, sur lesquels se porte l’attention générale des chercheurs dans le domaine des réseaux, la confiance est l’élément fondamental. La confiance détermine à la fois une structure de gouvernement particulière au réseau (Jones, Hesterly et Borgatti, 1997) et garantit le respect de la parole donnée ou de l’engagement informel pris.
Les relations informelles sont des relations d’échange particulières qui appellent des modes de contrôle spécifiques. Des études portant sur le fonctionnement de ces réseaux et sur ses implications pour le management sont nécessaires et légitimes, notamment parce que « le management a peu de contrôle sur la manière, sur le moment et sur les conséquences de la participation des employés à des activités de réseau » (Kreiner et Schultz, 1993). La sociologie économique, dans l’analyse qu’elle propose des réseaux, considère trois catégories d’objets essentiels qui peuvent faire l’objet d’une transposition dans le domaine du contrôle de gestion. On distingue ainsi l’action économique, les résultats structurels de ces actions et les institutions qui résultent et contraignent tout à la fois les comportements des agents (Steiner, 1993). Les résultats structurels doivent être compris comme des implications pour la structure sociale de l’organisation.
De nombreuses typologies des réseaux ont été élaborées. Grandori et Soda (1995) en distinguent trois types. En premier lieu, ils définissent les réseaux sociaux reposant sur des relations informelles elles-mêmes fondées sur la confiance, et qui n’intègrent aucune forme d’arrangement formel. En second lieu, les auteurs parlent de réseaux bureaucratiques dont les relations sont formalisées dans un contrat qui précise les nature et valeur des biens et services échangés ainsi que les modalités de la relation s’instaurant entre les partenaires. Enfin, ils distinguent les réseaux de propriété considérés comme des systèmes d’incitation permettant de maintenir une forme de coordination. Ils sont entendus comme une forme bureaucratique de réseau formalisé qui est de plus fondé sur un engagement de propriété.
Dans un cadre plus large, il est donc possible de classer les réseaux en quatre catégories, selon qu’il s’agisse de réseaux de relations interentreprises (réseaux externes) ou intraorganisationnelles (réseaux internes) d’une part, et de réseaux dont le fonctionnement est régi par des relations formelles ou informelles d’autre part. Le degré de formalisation est l’une des trois caractéristiques retenues notamment par Grandori et Soda (1995) pour établir des distinctions entre réseaux – les deux autres caractéristiques étant le degré de centralisation et les mécanismes de coordination utilisés. Le tableau ci-après synthétise la classification exposée précédemment .
Le contrôle organisationnel comme pratique sociale
La situation de contrôle
Comme nous l’avons postulé, la relation de contrôle est une relation d’échange. Cette conception implique de s’inscrire dans une optique plus souple du contrôle organisationnel3 définit comme « le processus consistant à contrôler ou influencer le comportement des individus en tant que membres d’une organisation formelle pour augmenter la probabilité qu’ils atteignent les buts organisationnels » (Flamholtz, 1996).
Le terme contrôle fait référence, pour Giddens (1984, p. 345), « à la capacité qu’ont certains acteurs, groupes ou types d’acteurs d’influencer les circonstances de l’action d’autres acteurs ou groupes d’acteurs ». Il souligne ainsi, le caractère social de ces pratiques. De même, selon Hofstede (1978) le contrôle4 dans une organisation est un processus social dans un système social ou peut-être socio-technique. De même, Ouchi et Maguire (1975), quant à eux, préconisent l’introduction du processus de socialisation dans le champ du contrôle organisationnel. Les organisations sont des unités sociales (ou groupements humains) construits et reconstruits délibérément pour atteindre des objectifs spécifiques (Etzioni, 1964, p. 3). D’une manière plus large, Chiapello (1996) précise que l’on est dans une situation de contrôle « lorsque le comportement d’une personne est influencé par quelque chose ou quelqu’un ». Cette situation de contrôle décrit bien le contexte de contrôle organisationnel précédemment mentionné.
Cette notion fait également référence à celle de situation de gestion développée par Jacques Girin (1983). Pour l’auteur, la spécificité de la recherche en gestion réside précisément dans l’étude des « situations de gestion ». Nous sommes en présence d’une situation de gestion « chaque fois qu’à un ensemble d’activités en interaction est associée l’idée d’activité collective et de résultat faisant l’objet d’un jugement, et que des agents sont engagés dans la situation de gestion lorsqu’il se reconnaissent comme participant à des degrés divers à la production du résultat ». La notion de jugement fait référence dans un premier temps, à un jugement social externe à la situation proprement dite, puis dans un second temps, à un jugement social interne des membres du groupe. L’organisation est alors « la rigidification des moyens pris pour faire face à la situation de gestion ». Girin (1983) précise que « les rapports entre les agents engagés dans une situation de gestion ne résultent ni directement, ni simplement, des rapports institués entre eux du fait d’une organisation ou d’une structure sociale, mais également des particularités de la situation elle-même, incluant des facteurs purement matériels ».
Bien qu’elle soit locale, la situation de gestion ne peut s’analyser qu’en faisant référence au contexte dans lequel elle s’insère. La complexité découlant de ces nombreux paramètres rend très difficile toute tentative de description de la situation de gestion. Car « les interactions entre [groupes d’intérêts] sont des processus multilatéraux […] » (Dermer et Lucas, 1986)1. Ainsi, la relation entre contrôleur et contrôlé n’est pas « un
Les auteurs précisent que « pour tout groupe d’intérêt, des relations de contrôle multiples existent : celles au sein du groupe d’intérêt ; celles entre les différents groupes d’intérêt, avec les subordonnés ; celles avec des entités latérales ou avec les supérieurs ; et celles avec des entités hors des frontières organisationnelles conventionnellement reconnues ».
Friedberg (1988) explique que la structure et les règles de fonctionnement renforcent et créent des solidarités entre les individus. Ces solidarités s’expriment au travers des pressions des groupes de pairs ayant pour objectif d’obtenir une certaine conformité des comportements des individus. La liberté de choix et de comportements des individus se trouve d’autant plus restreinte, du fait de ces pressions. Un phénomène d’apprentissage des normes du groupe émerge alors : « si tous ces facteurs limitent l’éventail des choix rationnels des acteurs, ils n’éliminent jamais totalement leur capacité de choisir. Entre les contraintes inhérentes à la situation des individus ou des groupes et leur comportement, il subsistera toujours une zone d’imprécision à l’intérieur de laquelle chaque acteur calcule son intérêt pour arrêter sa conduite » (Friedberg, 1988, p 32). Il s’établit ainsi une sorte de jeu entre l’organisation et ses membres. Les engagements de chaque individu dans le jeu reposent sur des anticipations et des attentes relatives au comportement de l’autre, même si ces dernières restent particulièrement difficiles à établir et à apprécier. Drucker (1964) considère que « ce dont on a besoin dans la situation sociale est une décision fondée sur des hypothèses – et essentiellement des hypothèses non liées aux évènements enregistrés mais liés au futur, c’est-à-dire aux attentes qui n’ont pas de probabilité mais peuvent seulement être jugées en fonction de leur plausibilité ». Cette question de la plausibilité est subjective et dépend des anticipations des individus, elles-mêmes influencées par la confiance. Ainsi, il apparaît clairement que les décisions prises par les individus découlent de l’interaction ci-avant mentionnée.
L’intérêt de la notion de situation de contrôle tient au fait qu’elle met en jeu deux éléments fondamentaux :
une relation de contrôle qui inclue elle-même à la fois des relations interindividuelles autour d’un dispositif formalisé de contrôle ;
un contexte organisationnel qu’il est fondamental de considérer pour comprendre les enjeux de la relation entre les individus et qui dépassent largement le cadre formel dans lequel les instruments peuvent l’inscrire.
De ce fait, les outils de gestion ne s’appréhendent pas seulement au travers de leur dimension technique mais dans un contexte social, comme le note Giddens (1984, p. 70), « nous pouvons donc concevoir les règles de la vie sociale comme des techniques ou des procédures généralisables employés dans l’actualisation et la reproduction des pratiques sociales ».
Par ailleurs, ces outils de gestion constituent une réponse à la complexité des situations de gestion. Ils « régissent aussi des rapports entre des hommes, entre des groupes sociaux. Ils cristallisent ainsi des rapports de force d’une manière qui peut même parfois disparaître aux yeux des agents. […] Moyens de gérer, les instruments de gestion sont aussi des moyens d’articulation des rapports sociaux » (Berry, 1983). Les instruments de gestion contribuent à définir la situation de contrôle et à la contextualiser, et sont influencés par les pratiques qu’ils génèrent à travers cette même situation.
La relation de contrôle : un échange pluriel
Constatant les limites d’une analyse qui ne distinguait que deux types de contrôle, contrôle par les comportements et contrôle par les résultats, Ouchi et Maguire (1975) et Ouchi (1979, 1980) introduisent un troisième mécanisme de contrôle : celui des clans. Ils fonctionnent comme un processus de socialisation qui élimine la divergence des buts entre les individus. En ce sens, les clans constituent un mécanisme de contrôle dont les propriétés se rapprochent de celles des réseaux sociaux. Alors que Ouchi et Maguire (1975) évoquent la notion de contrôle des clans, Merchant (1982) parle de contrôle du personnel. Ce mode de contrôle regroupe trois facteurs :
la mise à jour des capacités (sélection, formation, examen) ;
l’amélioration de la communication (en clarifiant les attentes et en fournissant de l’information pour la coordination) ;
et le contrôle par les pairs (avec du travail de groupe et des objectifs partagés).
Le contrôle du personnel est le plus approprié lorsque simultanément la capacité à mesurer la performance et la connaissance des actions spécifiques adéquates sont faibles. On retrouve ce type de contrôle dans les organisations dites professionnelles.
Dans ces structures les membres opérationnels ont tendance à être professionnels (bien formés et responsables) par rapport aux standards de leur profession, et tendent à se contrôler eux-mêmes (Merchant, 1982).
La relation d’échange constitue l’unité d’analyse privilégiée des réseaux. L’échange n’en est certes pas une caractéristique propre ; c’est la nature de la relation d’échange qui en fait une spécificité. Kreiner et Schultz (1993) parlent d’une économie par nature informelle, fondée sur les relations personnelles et qui fonctionne nécessairement avec un certain tact. Elle explique de nombreuses occasions de rencontres personnelles et d’interactions dans la communauté biotechnologique. Ce partage va à l’encontre du principe de rationalité des échanges économiques.
Au sein des relations d’échange, le thème de la réciprocité apparaît souvent dans les résultats des études sur les réseaux (Powell et Doerr, 1994, Grandori et Soda, 1995 ; Uzzi, 1996). Ouchi (1979) estime que cette norme de réciprocité est indispensable aux types de contrôle envisagés : marché, bureaucratie et clans. Elle constitue un pré-requis social nécessaire au fonctionnement de ces mécanismes de contrôle. L’une des caractéristiques fondamentales de la confiance est également son caractère réciproque dans la mesure où « très tôt […] un sentiment d’‘être digne de confiance’ se développe et accompagne l’extension généralisée de la confiance accordée à l’autre. Cela ne signifie évidemment pas que la confiance naît sans conflit ou tension ; au contraire, elle se développe et s’exerce en dépit de la présence d’une angoisse diffuse, dont le contrôle se présente comme l’origine la plus générale de la motivation de la conduite humaine » (Erikson, 1963)1.
Axelrod (1984), dans le cadre des stratégies de coopération « donnant-donnant », attribue au principe de réciprocité la capacité de faire émerger une coopération mutuelle. Pourtant, le principe de réciprocité des services rendus, malgré l’importance qu’il revêt dans l’économie de l’échange, n’est pas un impératif pour la relation. En effet, les échanges individuels ne sont pas guidés par l’intérêt personnel (Kreiner et Schultz, 1993). La réciprocité peut-être différée ou retardée. Cela s’apparente donc davantage à de la charité. Les participants à l’économie de l’échange font preuve de peu d’intérêt pour les termes immédiats de l’échange et prennent peu de précautions pour s’assurer de la réciprocité des échanges. Simons (1995b) inclue dans son dispositif de contrôle les systèmes de croyance qui ont pour vocation de donner davantage de pouvoir de décision et d’action aux individus et à les encourager à chercher de nouvelles opportunités. Ces systèmes de croyance « communiquent des valeurs fondatrices et favorisent l’implication des participants dans les objectifs de l’organisation ».
Les relations d’échange au sein du réseau informel sont des relations stables dans lesquelles les partenaires sont amenés à se revoir. Cela rend possible l’apparition de la coopération : « la manière la plus directe d’encourager la coopération est de conférer une certaine durabilité à l’échange » (Axelrod, 1984). Le caractère répétitif des relations au sein du réseau rend propice l’émergence de comportements coopératifs et le développement de relations de confiance.
Chaque ensemble de relations de contrôle représente un mix de rationalités parmi trois types de rationalités qu’identifient Dermer et Lucas (1986) :
la rationalité technique de réalisation de la tâche, centrée sur l’objectif d’efficacité ;
la rationalité organisationnelle de communication et de coopération, centrée sur un effort coordonné pour l’atteinte des objectifs ;
la rationalité politique, médiatrice entre des parties en conflit, qui poursuivent leur intérêt propre, et centrée sur l’objectif de stabilité et d’équité perçue.
De l’idée de responsabilité présente dans certaines conception du contrôle et souligné par Simon (1976, p. 135), on évolue vers celle de responsabilisation. Dans cette conception élargie l’objectif n’est plus le respect de l’autorité mais l’initiative individuelle « encadrée ». L’acteur est autonome, le contrôle contribue à développer l’empowerment2.
De la logique classique de production d’information…
Incertitude et information
L’information représente un point d’ancrage fondamental de la problématique du contrôle organisationnel. Anthony et Dearden (1976) précisent que l’on peut réduire l’incertitude1 de la prise de décision en acquérant de l’information additionnelle (p. 94). Mais cette information est coûteuse. Les théories économiques se sont donc penchées sur les conditions d’allocation de ressources pour l’acquisition d’information supplémentaire. Bien que la théorie de l’information décrive une technique permettant de décider le montant à allouer à cette information supplémentaire, toutes les valeurs attribuées par ces techniques sont hautement subjectives. Par ailleurs, la mise en application de cette théorie nécessite de spécifier clairement la nature du problème étudié, ainsi que la nature et le coût de l’information supplémentaire, clarté qui ne peut-être obtenue en ce qui concerne les problèmes de gestion. Une information ne peut-être associée clairement et uniquement à un problème spécifique. Malgré l’incertitude sus-mentionnée, il faut produire de plus en plus d’information dans des situations dont la complexité s’accroît parallèlement. On considère généralement qu’il existe une relation croissante entre incertitude et quantité d’information : « plus l’incertitude1 de la tâche est grande, plus grande la quantité d’information qui doit être traitée entre les preneurs de décision pendant l’exécution de la tâche afin d’atteindre un niveau de performance donné » Galbraith (1977, p. 36).
La théorie de l’information est utile parce qu’elle indique que l’objectif de l’information, pour la prise de décision, est de réduire l’incertitude. De plus, elle postule que la valeur de l’information supplémentaire doit être supérieure à son coût. En effet, comme le précisent Bouquin et Pesqueux (1999) « le modèle classique du contrôle de systèmes se veut donc l’architecture d’une chaîne de délégateurs fondée sur des processus où l’information joue le rôle central ». Les organisations se sont ainsi centrées sur la production d’informations permettant une certaine efficacité des dispositifs de décentralisation en particulier. Galbraith (1977, p. 40) souligne que « afin de coordonner des rôles interdépendants, les organisations ont inventé des mécanismes pour collecter l’information, décider et répartir l’information pour résoudre les conflits et guider les actions interdépendantes ». Dans cette optique, nombre d’auteurs dans la discipline du contrôle ont proposé des modèles permettant de récolter cette information.
Le feedback : mécanique du retour d’information
Pour Flamholtz, Das et Tsui (1985) le feedback fait référence à l’information fournie sur le comportement et le résultat du travail. Il donne à l’individu l’information nécessaire pour que ce dernier corrige son comportement s’il s’éloigne des standards requis. L’accent mis sur le retour d’information est souvent lié à des conceptions limitées du contrôle organisationnel. La définition qu’en donne Arrow (1964) comme « choix des
Galbraith (1977, p. 36) définit l’incertitude comme « la différence entre la quantité d’information nécessaire pour accomplir une tâche et la quantité d’information déjà détenue par l’organisation ». règles opérationnelles qui informent les membres de l’organisation sur la manière dont il faut agir » en est l’illustration.
Flamholtz, Das et Tsui (1985) identifient trois dimensions essentielles du mécanisme de feedback : la nature du feedback : l’utilisation appropriée du feedback des comportements ou des résultats dépend de la nature des objectifs du travail et du système de mesure ;
la restitution du feedback : l’efficacité du feedback dans l’influence des résultats du travail est liée à la manière dont il est délivré ;
la crédibilité de la source du feedback : l’effet du feedback sur les performances et les attitudes dépend de la crédibilité de la source.
Ainsi, en tant que mécanisme au cœur du contrôle, le feedback peut directement tirer les efforts individuels vers l’atteinte des objectifs du groupe ou de l’organisation (Flamholtz, Das et Tsui, 1985). Les auteurs formulent deux propositions intéressantes liées aux deux fonctions primaires de la mesure comme mécanisme de contrôle :
sur la validité et la fiabilité de l’information : la performance est affectée par la validité et la fiabilité de l’information ;
sur la validité et la fiabilité du comportement : à la fois les performances et les attitudes sont affectées par la validité et la fiabilité des comportements.
On oublie souvent en effet, que l’information provient d’individus qui ont des raisons de déformer l’information. Ce sont ces raisons qui rendent l’information non fiable (Stinchombe, 1990, p. 16)1. Comme le conçoivent Flamholtz, Das et Tsui, (1985), « une hypothèse fondamentale est à la base de ces propositions, avec des implications claires pour la sélection d’une méthodologie de recherche. Nous considérons les questions de validité et de fiabilité comme étant significatives en priorité du point de vue des individus qui reçoivent l’information. Une information valide et fiable, si elle n’est pas perçue comme telle, aura peu de chances d’avoir un quelconque effet sur le Stinchombe (1990, p. 14) précise que « un système d’information fiable, est en fait un système qui ne trompe pas de manière régulière ses utilisateurs sur l’incertitude des conclusions auxquelles on aboutit en fonction de cette information, mais qui en même temps ne les trompe pas avec des indicateurs stables de l’environnement ».
comportement du récepteur ». La non validité des données peut résulter de distorsions intentionnelles ou peut être une réaction psychologique au processus de mesure, réaction que les psychométriciens considèrent comme effet interactif ou réactif (Flamholtz, Das et Tsui, 1985). Car les décisions et les alternatives comportementales sont limitées par l’ensemble d’informations produites par le système de mesure. Ce feedback sur le comportement ou les résultats n’est pas possible lorsque le processus de transformation est ambigu, ou bien lorsque la possibilité de mesure du résultat est faible.
L’enjeu est important puisque dans ce cas, la fonction corrective du contrôle n’est pas assurée et, dans les cas les plus graves, les effets de la mesure de performance sont nuls.
Si l’information n’est pas perçue comme valide et fiable, le processus de feedback ne peut avoir lieu. Il faut alors envisager d’autres moyens de contrôle : social ou autocontrôle, ce qui reste conditionné par une conception moins mécanique et plus ‘relationnelle’ de l’échange d’information. Nous développons cette perspective dans le paragraphe suivant.
Un autre problème qui découle de l’incertitude et du manque d’information réside dans les situations favorables qu’elle peut occasionner pour certains acteurs. En effet, « le pouvoir réel réside chez ceux qui maîtrisent les sources d’incertitude » précise Hofstede (1994, p. 135) et la maîtrise de ces zones d’incertitude constitue alors un enjeu de premier ordre, comme l’a illustré Crozier (1964) dans son étude sur les jeux informels d’acteurs autour des zones d’incertitude dans une bureaucratie.
Vers une relation de contrôle comme relation d’échange d’information
De l’idée de feedback unidirectionnel, on passe à celle d’un échange bilatéral, voire social. Cette évolution tient à l’inefficacité, dans bon nombre de situations, du simple retour d’information sur les comportements des individus. Par ailleurs, l’apparition et la reconnaissance de nouvelles incertitudes et de nouveaux risques organisationnels modifient les enjeux informationnels, le manager étant « un canal d’information de capacité de décision limitée » (Arrow, 1964). Merchant (1982) indique qu’un pré-requis du retour d’information est la capacité à mesurer les résultats, ce qui implique que ce retour d’information ne puisse avoir lieu que dans les cas du contrôle par les résultats ou des actions. Il convient donc bien d’envisager de nouvelles modalités d’organisation de la problématique informationnelle pour la relation de contrôle : la notion d’échange apparaît alors des plus prometteuses.
On constate donc une modification de la logique associée à l’information : d’une logique de production on évolue vers une logique de sélection de l’information pertinente. Cette mutation, est justifiée par un changement dans la nature des risques auxquels les organisations font face, et surtout ceux auxquels elles décident d’accorder de l’importance.
Nouvelles incertitudes, nouvelle complexité : de nouveaux risques organisationnels
Le concept de risque organisationnel fonde la théorie et la pratique du contrôle dans les organisations (Besson, 1997b). Il faut, selon Besson (2000) « repositionner le contrôle de gestion comme une discipline des sciences de l’organisation dont l’objet est la maîtrise des risques organisationnels ». La perception du risque n’est nullement « une appréciation objective des dangers, mais plutôt la conséquence d’une projection de sens et de valeur sur certains événements, certaines pratiques, certains objets voués à l’expertise diffuse de la communauté ou des spécialistes » (Le Breton, 1995, p. 31). Ces risques organisationnels sont issus de la problématique de l’action organisée (Besson, 1997b), dont les déficits donnent lieu à des risques spécifiques pour lesquels des dispositifs de contrôle particuliers sont mis en œuvre.
La notion de risque dans les problématiques de contrôle
La notion de risque, dans son acception restreinte, est à distinguer de celle d’incertitude. Piriou (1999) précise que le risque renvoie à l’idée que « la réalisation future d’un événement est prévisible (peut-être associé à une distribution de probabilités) donc assurable ». Cette conception est aussi celle de Knight (1964, p. 19) pour qui « l’incertitude doit être prise dans un sens radicalement distinct de la notion familière de risque dont elle n’a jamais été correctement séparée. (…). Il apparaît qu’une incertitude mesurable, ou ‘risque’ proprement dit, d’après notre usage du mot, est si différent d’un risque non mesurable qu’il ne s’agit en fait pas d’incertitude du tout. Nous réserverons le terme incertitude pour ce qui est non quantifiable ». Cette restriction de l’utilisation de la notion de risque ne fait pas l’unanimité chez les chercheurs en sciences sociales. March et Shapira (1987), notamment, expliquent qu’un nombre de facteurs variables tels que l’humeur, les sentiments, et la manière dont les problèmes sont présentés, semblent affecter la perception et les attitudes face au risque.
Le risque est donc également une notion socialement construite qui varie selon les époques et les lieux. C’est une mesure de l’incertitude qui souligne « le déficit ou l’adversité susceptibles d’advenir à l’acteur ou à la population qui négligent une information ou s’engagent dans une action particulière » (Le Breton, 1995, p. 23). Le risque, nous dit Adams (1998, p. 29) « est constamment en mouvement et il se modifie en réponse aux tentatives de mesure ». C’est ainsi qu’un risque perçu est un risque sur lequel on a déjà agi.
En matière d’organisation1, la notion de risque provient, pour Bécour (2000) de l’existence d’éléments perturbateurs « liés à l’incomplétude du système pour couvrir l’ensemble des situations (…), aux défaillances des outils utilisés pour contrôler et aux insuffisances humaines à comprendre, mettre en œuvre, ajuster le fonctionnement aux variables d’environnement interne et externe (notion d’apprentissage organisationnel) ». Le lien entre toutes les situations de risque est « la prise de conscience que le monde est complexe et que les situations de décision sont caractérisées par l’incertitude » (Laufer, 1993). Das et Teng (1996) distinguent risque relationnel et risque de performance. Le risque relationnel tient à la possibilité et aux conséquences d’un engagement partiel des partenaires d’une alliance à joindre leurs efforts, à une coopération incomplète. Le risque de performance tient à la possibilité et aux conséquences que les objectifs de l’alliance ne sont pas atteints malgré une coopération complète des partenaires. Ce risque englobe tous les risques de hasard exceptés ceux qui touchent à la coopération. Deux séries de travaux ont contribué singulièrement à l’appréhension du risque organisationnel : d’une part, la théorie de l’agence et la notion d’asymétrie d’information ; d’autre part, les travaux plus récents de Besson (1997b, 2000) et Padioleau (1999).
L’intérêt de la théorie de l’agence est le fait qu’elle ait accepté « de relâcher l’hypothèse d’un avenir certain et d’une information également répartie pour intégrer la notion de risque et celle d’information asymétrique qui, sous l’hypothèse d’une rationalité substantielle, aboutissent à la mise en évidence de comportements opportunistes et de défiance, sources de problèmes pour la coordination des décisions individuelles » (Béjean, 1999). De ce fait, l’information est la mesure négative de l’incertitude nous dit Arrow (1984, p. 138). Les institutions économiques peuvent dès lors compenser le hasard moral par des informations non issues du marché telles que les codes d’éthique et l’internalisation de valeurs.
Pour un risque « organisationnel »
Les travaux ultérieurs complètent cette vision parcellaire du risque organisationnel. Padioleau (1999) définit le risque comme phénomène social. « Toute action, individuelle ou collective est en effet risque ». Ce phénomène social conjugue deux types de risques génériques : ceux qui proviennent « d’objets » d’activités, ceux qui sont liés aux actions éventuelles (qu’il nomme praxis). Cet ensemble forme le phénomène du double risque. Il est intéressant de noter que pour l’auteur, le risque est aussi bien positif que négatif, pour l’objet (bien-être social, efficience versus danger), comme pour la praxis (efficacité des mesures, conformité à des principes versus coûts budgétaires, tracs de mise en œuvre).
On retrouve cette dichotomie entre système d’activité (flux de travail) et système d’action (rôles, règles, relations informelles et schémas culturels) chez Besson (1997, 2000). Ce dernier présente le contrôle de gestion comme « une technologie disciplinaire visant à maîtriser les risques organisationnels de divergence entre l’intention stratégique de la direction générale et les logiques de l’action managériale ». L’auteur développe une typologie issue de la dualité objectifs de l’individu/objectifs de l’organisation et analyse les enjeux qui y sont liés.
Quatre types de risques sont ainsi identifiés (Besson, 2000) :
le risque de coordination, qui est « un risque de conception qui prend sa source dans la complexité de la modélisation » ;
le risque d’opportunisme, « risque de transgression qui prend sa source dans la défiance de la direction générale à l’égard des acteurs » ;
le risque cognitif, « risque de régression qui prend sa source dans la clôture cognitive de la direction générale » ;
le risque de légitimation, « risque de justification qui prend sa source dans la nécessité d’expliquer (…) ».
Risque de coordination et risque d’opportunisme relèvent du modèle de la routine ; risque cognitif et risque de légitimation relèvent du modèle de la transformation. Ces risques sont inhérents à l’action managériale, que le contrôle va donc tenter de maîtriser grâce à des dispositifs d’influence.
De la production à l’échange d’information
Le modèle classique apparaît étroitement liés à certaines formes d’organisation et il se dégage une forte interdépendance avec les systèmes d’information. Bouquin et Pesqueux (1999) précisent que « le modèle classique du contrôle de systèmes se veut donc l’architecture d’une chaîne de délégation fondée sur les processus où l’information joue le rôle central »1. Il convient d’envisager de manière plus systématique l’information sous l’angle de son effet sur les comportements puisque comme le signalent Flamholtz, Das et Tsui (1985) la présence de données fausses dans les systèmes d’information « a été reconnue comme un problème majeur pour la conception et l’administration des systèmes de contrôle organisationnels ». La question pertinente n’est donc pas prioritairement celle de la production
mettre en place les processus et les systèmes permettant d’atteindre les finalités recherchées ». « Le processus de contrôle peut être conçu comme étant lui-même un système d’information, tant sur le plan de son automatisation (système informatique) que sur celui de la mise en relation d’un émetteur et d’un récepteur au moyen d’un support » (Bouquin et Pesqueux, 1999). d’information, mais celle de sa qualité et de sa sélection. Bréchet et Mévellec (1999) indiquent que « les comportements sont largement influencés par les signaux émis par les systèmes d’information et tout spécialement par celui qui est animé par le contrôle de gestion »1.. L’information est ainsi le concept fondamental du contrôle. Aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement d’en assurer la production, encore faut-il que l’information produite par les systèmes d’information soit fiable pour l’utilisateur. Le problème de l’information est l’élément qui structure, dans la théorie de l’agence comme dans les autres théories des organisations sur lesquelles la discipline du contrôle s’est appuyée, la problématique de la délégation / coordination2. En effet « c’est donc l’information qui va se trouver au centre des dispositifs du contrôle, c’est elle qui sert de support aux ordres de la hiérarchie, de même que c’est elle qui permet de rendre compte de l’effet des comportements des acteurs » (Bouquin et Pesqueux, 1999). Initialement focalisés sur la production d’informations les acteurs prennent conscience des enjeux qui entourent les systèmes d’information3. Il a de ce fait une triple finalité : aide aux opérations, aide à la décision, aide à la communication (Grenier, 2000), et comme objectif de « filtrer l’information inutile et diffuser seulement l’information pertinente pour le preneur de décision » (Anthony & Dearden, 1976, p. 96).
Bien que les auteurs parlent d’information pertinente, il est difficile pour les concepteurs des systèmes d’information de savoir précisément quelle information, concernant l’organisation aura cette caractéristique. Ils tentent donc d’extraire de la réalité celle qu’ils estiment être pertinente, d’en soustraire l’information inutile, et de communiquer différents types d’informations aux utilisateurs du système en fonction de leur perception des besoins de chacun. De ce fait, le contrôleur de gestion se trouve aujourd’hui « au cœur du processus informationnel de l’entreprise ». Il s’agit « de s’assurer de la fiabilité des informations et du respect des échéances » (Bouquin et Pesqueux, 1999). Mais il convient également pour lui d’accepter « de ne plus exercer le monopole de l’information ». Lebas (1995) propose d’employer le terme de « manager de l’information » pour qualifier le contrôleur de gestion. Car le traitement de l’information est d’abord une activité humaine (Grenier, 2000).
Plus généralement, deux rôles fondamentaux sont attribués à l’information (Besson et Bouquin, 1991) :
elle permet de construire des modèles de représentations de la complexité ; « rares sont, en effet, les personnes en mesure d’appréhender immédiatement une réalité. Cette dernière est toujours pour l’homme le résultat d’une construction sociale » ;
elle permet de définir des modes d’action sur la complexité ; l’action des individus procède toujours à partir de modèles d’action dont l’individu n’est pas toujours conscient.
A notre sens, l’information, et plus spécifiquement l’échange d’information s’affirme donc comme le socle de la relation de contrôle. Nous avons indiqué que les relations en situation de contrôle étaient influencées par les dispositifs formels de contrôle en même temps qu’elles contribuaient à en conditionner les pratiques. Il en va de même pour l’information que contiennent ces relations de contrôle. Si l’on suit Besson et Bouquin (1991) cette information fonde les modèles de représentation des individus, définissant ainsi un contexte pour leur action.
L’information comme condition de la relation de contrôle
On peut légitimement considérer que le problème des dirigeants de l’organisation est d’abord un problème d’information. Il s’agit notamment de déterminer comment développer l’information nécessaire pour imposer des objectifs raisonnables (Schiff et Lewin, 1970). Pour Giddens (1984, p. 77), il est fréquent, dans la vie sociale, « que des acteurs situés stratégiquement tentent de façon réflexive, par des procédures sélectives de traiter, de communiquer des informations ; il assiste des hommes, au sein d’une organisation, dans des fonctions d’exécution, de gestion et de prise de décision » de ‘filtrage d’information’, de régir les conditions générales de la reproduction d’un système, pour le conserver tel qu’il est ou, au contraire, pour le transformer »1. On peut penser que les conditions de la relation, la dynamique que nous développons dans la section suivante, peuvent avoir une influence déterminante sur cette capacité ou volonté des individus de filtrer l’information et sélectionner, finalement, celle qui entrera dans le cadre de l’échange.
|
Table des matières
INTRODUCTION
1. Clarification des concepts de la recherche
2. Histoire de la thèse
3.Comment rendre compte : fidélité et intelligibilité
PREMIERE PARTIE : CONTROLE, INFORMATION, CONFIANCE
CHAPITRE 1 LA RELATION DE CONTROLE : UNE RELATION SOCIALE ET PLURIELLE
Section 1. Le principe d’unilatéralité des relations
Section 2. Le principe de bilatéralité des relations
Section 3. La relation de contrôle comme relation d’échange plurielle
CHAPITRE 2 CONTENU ET DYNAMIQUE DE LA RELATION DE CONTROLE
Section 1. Le contenu : l’échange d’information
Section 2. Une dynamique de la confiance
Section 3. Caractéristiques de la confiance
Conclusion de la première partie
DEUXIEME PARTIE : DEMARCHE ET METHODES DE LA RECHERCHE
CHAPITRE 3 POSITION EPISTEMOLOGIQUE ET IMPLICATIONS METHODOLOGIQUES
Section 1. Positionnement épistémologique : une perspective interprétativiste
Section 2. Implications méthodologiques
Section 3. Les conditions de validité et de fiabilité de la recherche
CHAPITRE 4 PRESENTATION DU CAS : ENVIRONNEMENT ET ORGANISATION
Section 1. Le contexte de gestion hospitalière
Section 2. Mise en évidence de zones de risques organisationnels à lhôpital
Section 3. Les spécificités de lHôpital Européen Georges Pompidou
CHAPITRE 5 METHODES DE RECUEIL ET DANALYSE DES DONNEES
Section 1. Le recueil des données qualitatives
Section 2. Analyse des données
Conclusion de la deuxième partie
TROISIEME PARTIE : ANALYSE EMPIRIQUE DE RELATIONS DE CONTROLE : L’HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU
CHAPITRE 6 ANALYSE DES REPRESENTATIONS INDIVIDUELLES DE LA RELATION DE CONTROLE
Section 1. Les contrôleurs de gestion HEGP
Section 2. La Direction des Finances
Section 3. La Direction de la Politique Médicale
Section 4. Les médecins
CHAPITRE 7 ANALYSES INTRA-GROUPE ET INTER-GROUPE
Section 1. Analyses intra-groupe
Section 2. Analyses inter-groupe
CHAPITRE 8 RESULTATS DE LA RECHERCHE ET EMERGENCE DUN CADRE THEORIQUE DINTERPRETATION
Section 1. Interprétations théoriques
Section 2. Propositions issues de la recherche
CONCLUSION ET PROLONGEMENTS DE LA RECHERCHE
1. Heurts et bonheurs de la recherche qualitative
2. Apports de la recherche
3. Limites et prolongements de la recherche
BIBLIOGRAPHIE
Télécharger le rapport complet