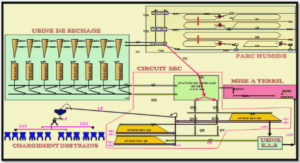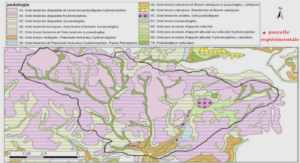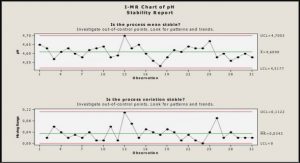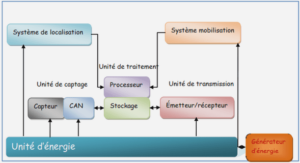Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
La consommation de drogues en Afrique
C’est vers les années 1950 que le mythe d’une consommation traditionnelle bien codifiée des drogues tombe laissant place à un usage de plus en plus généralisé avec le recours à de nouveaux types de produits. La consommation de cannabis est attestée chez les jeunes au Ghana dans les années 1950 et 1960. Le nom bhanga (dérivé de hindi), utilisé par les fumeurs de marijuana au Ghana, suggère sa provenance sud-asiatique (United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, 1999). En 1977, la consommation de médicaments psychotropes gagne les étudiants et les paysans, qui utilisent les amphétamines pour mieux supporter la fatigue. Vers les années 1980, un glissement de l’usage des produits traditionnels à la consommation de produits industriels, aussi bien d’origines locales qu’importées, s’opère (Cesoni, 1992).
Les débuts de la consommation des drogues de synthèse en Afrique de l’Ouest sont datés des années 1980, « alors que l’offre d’opium, dont est dérivée l’héroïne, dépassait la demande dans les pays occidentaux. Les trafiquants entreprirent d’écouler leurs surplus dans leur propre pays. Cela mit fin à la saturation des marchés et favorisa la création de zones de demande intenses » (Fottorino, 1991 : 12). Les trafiquants en quête de nouveaux marchés illicites où écouler la cocaïne et l’héroïne, rapporte l’OICS, ciblent la classe moyenne qui se développe dans certains pays africains, transformant ainsi des pays longtemps réputés dans le trafic en zone de consommation (OICS, 2015).
Jusqu’en 1985, rapporte Césoni, les « drogues dures » étaient pratiquement inconnues en Afrique, sauf au Nigeria, où un groupe limité de consommateurs aurait utilisé l’héroïne et la cocaïne. Entre 1987 et 1991, les « drogues dures » sont apparues dans d’autres pays, comme le Burkina Faso (héroïne), la Côte-d’Ivoire (héroïne et cocaïne) et le Tchad (héroïne). Un accroissement de l’abus de médicaments psychotropes a été aussi constaté dans les mêmes pays (Cesoni, 1992). Le Nigeria est aussi l’un des premiers, voire le premier pays d’Afrique subsaharienne à connaître des problèmes liés à la consommation d’héroïne et de cocaïne7 (Cesoni, 1992). « Sur Allen Avenue, rebaptisée cocaïne avenue, les stupéfiants commencent leur ronde de nuit, sous la scelles de bicyclettes, dans de confortables Mercedes, aux fonds de la poche des dealers, on sniffe de la coke pour 60 Naira (3000 francs CFA). Un gramme vaut entre 200 et 300 nairas. Il faut savoir profiter des prix, 10 à 20 fois moins élevé que sur le macadam new-yorkais » (Fottorino, 1991).
Des stimulants de type amphétamine sont connus et utilisés dans la plupart des pays observés, y compris la Côte d’Ivoire et le Nigeria. Selon une étude du PNUCID, les détournements d’amphétamines ont diminué dans les années 1990 mais les stimulants de type amphétamine font toujours partie des trois ou quatre substances les plus maltraités en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Sénégal. L’Ecstasy, un nouveau type de drogue est entré au Mozambique, au Nigeria, en Afrique du Sud et au Zimbabwe dans les années 1990. Le LSD est connu et utilisé au Nigeria et plus largement, en Afrique du Sud, où il est également fabriqué. Au Ghana et Nigeria, la transformation de la cocaïne base en crack se fait grâce à l’usage de techniques de «cuisine» simples (United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, 1999).
En 2006, l’OICS rapportait que dans la plupart des pays d’Afrique l’abus de drogues semble être en hausse, l’âge de l’initiation à la drogue baisse et le nombre de femmes et d’enfants qui prennent de la drogue augmente. Le mode d’administration, poursuit l’OICS, évolue également, la tendance la plus nette étant l’usage par injection d’héroïne (OICS 2006). En 2009, sur les 375 tonnes estimées d’héroïne pure consommées dans le monde, entre 40 à 45 tonnes seraient arrivés sur le continent africain. Environ 34 tonnes seraient consommées sur place, le reste repartant vers l’Europe, la Chine et l’Australie (Champin, 2012). L’UNODC estimait, dans la même année, à plus de 1,7 millions le nombre de consommateurs en Afrique (Afrique subsaharienne et Afrique du Nord), dont plus de 500 000 en Afrique de l’Est et près de 800 000 en Afrique de l’Ouest et du Centre. Parmi les pays réputés importants consommateurs, on compte le Kenya, l’île Maurice et l’Afrique du Sud (Champin, 2012).
En 2008, on estimait à 1,78 millions le nombre d’usagers de drogues par voie intraveineuse en Afrique sub-saharienne avec une prévalence entre 3,8 et 12,5% selon le pays. Dans son rapport mondial sur les drogues de 2012, l’ONUDC alertait sur l’augmentation inquiétante de l’usage de cocaïne en Afrique de l’Ouest (WACD, 2014), en comparaison à la moyenne mondiale (MDM, 2014). L’INL remarque que la consommation de toutes les drogues illicites est en augmentation au Ghana et que l’usage de cocaïne et d’héroïne a augmenté au Nigéria en 2012 (INL, 2013). En 2013, le rapport mondial sur les drogues de l’ONUDC observait que : Burkina Faso, Côte d’Ivoire and Morocco each reported increases in cocaine use based on expert perceptions, and the latest changes reported by Ghana and Togo (relative to 2008) also indicated rising cocaine use » (UNODC, 2013)
En l’absence de données objectives sur le niveau de consommation des drogues en Afrique, les chiffres approximatifs rapportés par certaines institutions posent plusieurs problèmes. Les chiffres ne traduisent pas la vraie réalité sur le taux de consommation dans les pays africains et n’identifient pas les catégories les plus concernées. Ils posent aussi les problèmes de la méthodologie de collecte des données qui servent de base aux statistiques évoquées. De fait, les chiffres peuvent enfin être source de frustration pour les institutions locales responsables de la lutte contre le trafic et la consommation comme ce fut le cas, en 2011, au Nigéria.
Politiques de lutte et de contrôle des drogues
En Afrique, depuis plusieurs années, les initiatives internationales en matière de contrôle des stupéfiants relèvent d’une approche prohibitionniste, recherchant l’élimination totale des drogues à usage récréatif. La Convention Unique sur les Stupéfiants de 1961, rapporte le WACD, a établi un mécanisme de coordination du contrôle international des stupéfiants. Elle a également établi des contrôles stricts pour la culture du pavot à opium, du cocaïer (utilisé pour produire la cocaïne) et du cannabis, et pour les produits qui en sont dérivés, décrits sous le nom de « stupéfiants ». Les parties prenantes à la Convention de 1961 se sont engagées à limiter la production, la fabrication, l’exportation, l’importation, la distribution, le commerce, l’usage et la détention de ces substances, sauf à des fins médicales et scientifiques, les quantités réservées à cet effet relevant de la responsabilité du gouvernement. La « guerre contre la drogue » déclarée par le Président Richard Nixon en 1971 est décrite comme la conséquence de cette approche prohibitionniste. L’imposition de régimes de peines applicables à tous les usagers et revendeurs de drogues et le recours à des agents des services de sécurité de l’État pour détruire les cultures de plantes servant à la fabrication de stupéfiants dans les pays producteurs n’ont pas permis d’empêcher la présence de ces drogues (WACD, 2014).
À partir de 1984, l’Organisation des Nations Unies a considéré que l’élimination du trafic illicite des drogues exige une attention toute particulière de la communauté internationale. Elle a élaboré en 1988 une troisième convention exclusivement répressive contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes. Cette convention impose aux États la répression de tout acte de trafic illicite de drogue, et de toute opération de blanchiment de l’argent de la drogue. Elle oblige les Etats à placer sous contrôle les substances nécessaires pour la fabrication des drogues et à coopérer pour lutter contre le trafic illicite (WACD, 2014). Dans certains pays africains, une gamme de groupes ethniques est impliquée dans des activités illicites de drogues. La stigmatisation liée à la participation à ces activités est telle que, si le pouvoir est associé aux mêmes groupes, il y a le risque qu’aucune action significative ne soit prise. La relation étroite entre les élites politiques et ceux qui sont directement impliqués dans des activités illicites de drogues, due à une association ethnique ou régionale, peut contribuer à une application sélective des contrôles juridiques visant à minimiser le problème des drogues illicites (United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, 1999).
Exprimant sa préoccupation face aux menaces croissantes que font planer le trafic et la consommation de drogues en Afrique de l’Ouest, Kofi Annan, ancien Secrétaire Général des Nations Unies, a fait instituer la Commission Ouest-Africaine sur les Drogues en janvier 2013. Celle-ci poursuit les objectifs de sensibilisation de l’opinion publique aux défis posés par le trafic de drogues et suscite l’engagement politique pour l’élaboration des recommandations fondées sur des données probantes. La Commission poursuit également l’objectif de promouvoir les capacités régionales et locales afin de favoriser la prise en charge de ces défis par les autorités et populations locales (WACD, 2014).
Parmi les autres mécanismes de lutte contre le trafic de drogues, il y a la stratégie anti-terroriste de la CEDEAO et le plan de mise en œuvre adoptés en février 2013, ainsi que la stratégie maritime intégrée, finalisée en novembre 2013. Le Plan d’action de l’Union Africaine pour la lutte contre la drogue (2013-2017) adopté en janvier 2013 encourage les membres de l’UA à garantir des politiques de lutte contre la drogue qui tiennent compte de l’importance des droits humains et de la santé publique (WACD, 2014).
Des types de drogues multiples en circulation
En 2005, lors de ses enquêtes de terrain, Ndione décrit les types de drogues utilisées par ses interviewés parmi lesquelles l’héroïne, la cocaïne, le chanvre indien. L’héroïne, pousuit-il, se présente sous forme de poudre qui se trouve dans une sorte de capsule. Elle est sniffée et se vend dans les quartiers tels que Grand Dakar, Pikine, Thiaroye, etc. Son coût varie entre 2 500 et 15 000 francs, la différence se trouve au niveau de la qualité et de la quantité. La dose de 2 500 francs ne donne qu’un flash de cinq minutes tandis celle de 10.000 ou de 15.000 francs peut être consommée en plusieurs prises. Elle est disponible dans des endroits chics tels les bars, les discothèques ou boîtes de nuit. L’héroïne est un produit qui vient brut, c’est une fois arrivée à destination qu’elle est traitée et mélangée avec une poudre. Le coût est fonction alors de sa pureté (la qualité) et de sa gamme (Ndione MS, 2005).
Le yamba, produit principal au Sénégal ?
Le Sénégal a la particularité d’être un pays à la fois producteur, exportateur et importateur de chanvre indien. Chronologiquement, selon Werner, on peut estimer que la consommation de chanvre est devenue un phénomène sociologique à partir de 1968 avec l’apparition de la mode dite « rasta » dans les années qui ont suivi. En effet, contrairement à la croyance répandue concernant le caractère traditionnel de l’usage du chanvre indien au Sénégal, cette plante n’y serait pas spontanée (Kerarho, 1974) même si, dans l’état actuel des connaissances, il est impossible de savoir avec certitude quand elle y a été introduite (Werner, 1992). Il semble que le chanvre ait été employé depuis longtemps en Casamance, notamment par les femmes. Un indice en faveur d’une introduction initiale en Casamance est à rechercher dans l’étymologie du terme « yamba » (communément utilisé pour désigner le chanvre indien) qui dériverait de l’appellation brésilienne « djamba » (Kerharo, 1974 ; Werner JF, 1992).
Depuis le début des années 80, le marché dakarois est approvisionné en niakoye et en lops (ou « lopito »). Le niakoye est cultivé en Gambie et en Casamance, acheminé par voie terrestre ou maritime jusqu’à Dakar où il était vendu entre 10 et 20 000 francs le kilo en 1988. Il est concurrencé par le lops en provenance du Ghana ou du Nigéria, qui parvient à Dakar après avoir transité par la Gambie. Dans les années 1990, malgré son prix élevé (entre 60 000 et 80 000 francs le kilo en 1988), la plupart des usagers préfèrent se procurer du lops s’ils en ont les moyens. Enfin, note Werner, le marché dakarois est aussi investi, depuis les années 1990, de nouvelles variétés cultivées en Gambie et en Casamance, comme le « sansemilla » qui seraient des hybrides entre des plantes de lops et de niakoye (Werner, 1991).
Le trafic de yamba est rapporté comme ayant joué un rôle fondamental dans les mouvements de rébellion en Casamance. Dans son ouvrage la drogue, l’argent et les armes (1991), Labrousse, responsable de l’Observatoire géopolitique des drogues, écrit : « Au Sénégal, en Casamance, la drogue pourrait jouer un rôle dans un conflit armé. Déjà en 1987, la police a détruit 12 tonnes de « yamba » (marijuana) dans le village de Ndombor Dir, près de la frontière de la Gambie. Au printemps de 1990, est apparue la rébellion des forces démocratiques de Casamance (MFCD) qui luttent pour l’indépendance de la région. Le gouvernement (du Sénégal) accuse ce mouvement d’être aidé par la Mauritanie et de se financer grâce à l’argent du yamba. Il est probable que si cette situation économique continue à se dégrader, la production et le trafic se développeront en Afrique » (Fottorino, 1991 : 44).
D’après un correspondant de l’Observatoire Géopolitique des Drogues en Basse-Casamance, les revenus du cannabis, qui alimentent les séparatistes en armes modernes, grenades et Kalashnikov, intriguent les forces officielles sénégalaises. « Des militaires chargés de réprimer la guérilla auraient torturé des séparatistes pour obtenir des renseignements précis sur les lieux de production et les réseaux de commercialisation de la drogue afin de les exploiter à leur profit », indiquait la dépêche internationale des drogues dans son premier numéro de juin 1991 (Fottorino, 1991).
Le développement du trafic local de cannabis est également mis en rapport avec le déclin de l’agriculture de subsistance exposé aux changements climatiques et à la baisse de leur prix de vente. Le rapport des Nations Unies sur les drogues en Afrique indique : Senegalese farmers » (United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, 1999: 23).
Les revendeurs s’approvisionnent directement chez le cultivateur ou chez le grossiste. Il existe des filières et des réseaux de production, de stockage, de distribution et de vente du cannabis avec de gros trafiquants et de petits distributeurs recrutés en général parmi la jeunesse délinquante ou prédélinquante des villes (Collomb, Diop et Ayats, 1962). L’usage toléré du cannabis à des fins thérapeutiques jusqu’à une période récente est devenu un facteur de toxicomanie chez les jeunes. En outre, l’augmentation de ce produit a entraîné une désaffection de la culture de plusieurs produits vivriers, au moment où des essais de cultures d’autres drogues sont signalés sur le continent africain (Sénégal, 1997).
Le chanvre, comparé à la cocaïne et l’héroïne, est plus accessible géographiquement et financièrement. Dans les années 2000, son coût varie entre 250 francs pour un joint et 30 000 ou 40 000 francs pour le kilogramme. Un paquet de yamba de 500 francs peut donner 5 ou 6 joints (Ndione MS, 2005). Le yamba (ou boon, ou wii, ou shit) se présente sous la forme d’un broyat, mélangé ou non à du tabac, il est fumé sous forme de joints (jum en wolof). Il est consommé de préférence de façon collective par des groupes d’amis de la même classe d’âge (United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, 1999 ; Werner, 1993).
En analysant les motifs de consommation du chanvre indien chez les fumeurs à Dakar, Werner écrit que l’usage du yamba répond à certaines attentes des usagers. Il leur permet d’abord d’améliorer leurs compétences sociales (diminution de l’agressivité, augmentation des échanges verbaux, accès au plaisir partagé, meilleure acceptation des rôles sociaux) ; ensuite de restaurer leur estime de soi (il rend l’usager soucieux de son hygiène corporelle, de son apparence vestimentaire et fier de lui-même) ; et enfin d’apprécier les modifications de l’humeur qu’il entraîne (« ça donne de l’espoir »), (« ça donne la forme »), (« ça donne de la science ») (Werner, 1993). Le cannabis peut représenter non seulement un facteur d’intégration au groupe, comme dans les pays occidentaux, mais aussi un important facteur d’acceptation et d’intégration sociale de la différence, comme dans le cas des lépreux de Casamance, qui renouent économiquement et socialement avec la collectivité par le biais de la consommation, mais aussi de la vente, pourtant illégale, de cannabis (Cesoni, 1992).
Médicaments psychotropes
La disponibilité des médicaments psychotropes est signalée dans les années 1970 par Césoni qui écrit que ces substances sont disponibles sur les marchés parallèles, où il est possible de s’approvisionner lorsqu’une réglementation stricte est appliquée dans le circuit des pharmacies. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, les produits psychotropes peuvent être achetés sans ordonnance auprès des pharmacies ou dans les dispensaires. Les clients peuvent aussi se procurer sur les marchés clandestins, à Dakar aussi bien qu’en province, un grand nombre de substances dites illégales dont la composition exacte est inconnue. Une enquête de Frères des Hommes constate l’existence de cette activité au Mali, en Côte-d’Ivoire, au Sénégal, au Zaïre (actuel RDC) et au Congo. Selon cette étude, le marché pharmaceutique illicite en Afrique est caractéristique d’une économie de pénurie ; ces médicaments déconditionnés et parfois moins chers sont quelquefois le seul recours possible des plus défavorisés (Cesoni, 1992).
Le ginz, produit et mode de consommation à la fois
Le terme de ginz employé par les usagers désigne des solvants organiques (essence, diluant, vernis, colle, etc.) dont l’inhalation (moo ou ginz en wolof) provoque un état d’ivresse intense, de courte durée, souvent associé à des hallucinations visuelles effrayantes. Également d’apparition récente, cette pratique a constitué le mode d’entrée dans l’univers de la « prexion » (terme employé pour désigner un état altéré de conscience). En général, l’usage du ginz est rapidement abandonné du fait de sa toxicité et de son caractère péjoratif de pratique considérée comme relevant d’un comportement infantile (Werner, 1993).
La consommation de drogues au Sénégal
Le passage d’une consommation « traditionnelle contrôlée » à un usage de type problématique s’opère dans la décennie 1980. Au début de cette décennie, Gueye et Omais signalait qu’« au Sénégal, nous ne rencontrons presque jamais, pour le moment, de véritables toxicomanies et encore moins de toxicomanies aux drogues dures » (Gueye et Оmaïs, 1983). Puis, plusieurs enquêtes constatent la manière dont les bouleversements profonds de la société sénégalaise, de même que les stratégies commerciales extérieures introduisent de nouvelles consommations et modifient la situation. Les préparations traditionnelles, écrit Césoni, sont de moins en moins utilisées dans les milieux jeunes au profit des substances importées. Une enquête menée en 1980-1981 dans les milieux scolaires urbains fait état d’une consommation élevée de cannabis (70 % de l’échantillon), suivi de l’alcool (15 %) et, pour le reste, des médicaments psychotropes et les solvants (Cesoni, 1992).
En 1982, une montée de la consommation de médicaments psychotropes, notamment des hypnotiques et des tranquillisants, a obligé le Ministère de la Santé Publique à en limiter les importations. Césoni rapporte que 39 % des jeunes entre 15 et 24 ans consomment au moins une des drogues dites « licites » (tabac, alcool et tranquillisants) et 14 % ont expérimenté une des « drogues illicites » (cannabis, médicaments psychotropes achetés sans ordonnances, solvants) (Cesoni, 1992).
L’héroïne et la cocaïne font leur apparition au début des années 1980 à Dakar (Cesoni, 1992), mais ne circulaient pas encore en banlieue (Werner, 1993). En 1989, Werner constate l’apparition d’héroïne à Pikine et le début de sa diffusion, malgré son prix relativement élevé puisqu’un « képa » (dose permettant de confectionner 1 à 3 cigarettes) se négociait entre 1000 et 2000 FCFA. De même, poursuit Werner, la cocaïne et son dérivé, le crack, n’ont fait leur apparition à Pikine qu’en 1990. La diffusion de ces nouvelles drogues vers la périphérie de Dakar est corollaire à l’intensification de la répression qui s’est exercée à l’encontre des « dealers » dakarois à partir de 1988 et le déménagement de certains d’entre eux vers les quartiers plus tranquilles de la banlieue (Werner, 1993).
À propos du profil des consommateurs de drogues au Sénégal, la littérature rapporte des éléments d’identification qui concernent le sexe et la catégorie socio-professionnelle des usagers. Dans les années 1990, à partir d’informations concernant la catégorie socioprofessionnelle de leurs pères, Werner constate qu’une majorité des usagers est issue du prolétariat urbain (petits commerçants, artisans, ouvriers), d’une population paysanne appauvrie (des migrants) ou d’une petite bourgeoisie urbaine (fonctionnaires, employés …) durement éprouvée par la baisse du pouvoir d’achat. En particulier, ces jeunes sont confrontés à une crise du marché du travail visible au niveau de la baisse importante des emplois salariés. Ils se trouvent même exclus du secteur dit « informel » de l’économie qui se révèle incapable d’absorber cette masse de demandeurs d’emploi. Au cours des entretiens de Werner, la gravité du problème de l’emploi a été soulignée de façon répétée et insistante par ses interlocuteurs, qui en faisaient la cause primordiale de leurs comportements déviants (Werner, 1993).
En terme de distinction de sexe, le CILD constate que la toxicomanie semble être l’apanage beaucoup plus des garçons que des filles. Leurs observations montrent cependant que de plus en plus de filles sont concernées par la consommation de drogues. Dans les années 2000, environ 20% de la population des usagers de drogues identifiés par le CILD sont des femmes avec une prédominance, chez elles, de consommation de sédatifs. Il n’existe certes pas de statistiques sur la prévalence de la toxicomanie chez les femmes mais le recoupement des données au niveau hospitalier, pénitencier et de certaines ONG permet de s’en faire une idée même si elle est parcellaire de l’ampleur du phénomène. Des études faites au niveau de la clinique psychiatrique du CHU de Fann montrent que le problème de la toxicomanie féminine existe et prend de l’essor. Si en 1982 un seul cas avait été signalé parmi les hospitalisés, ce nombre est passé à 5 en 1988 et à 11 en 1997 (CILD, 2003).
Les femmes toxicomanes retrouvées en milieu hospitalier proviennent, en grande partie, de familles aisées ou qui ont séjourné à l’étranger, notamment en Occident. Une autre population de femmes toxicomanes se retrouve dans les milieux marginaux, y compris celui de la prostitution. Les statistiques pénitentiaires font état à ce titre d’un plus grand nombre de femmes et d’une plus grande progression de la fréquence. Le nombre de femmes interpellées pour usage et trafic de stupéfiants est passé de 10 en 1982 à 33 en 1985, 108 en 1987 et 314 en 1988. Au niveau scolaire, une enquête effectuée en 1999 (FORUT), montre que 20.9% des écolières du second cycle ont eu une expérience avec le tabac contre 18.1% pour l’alcool, 15% pour le cannabis et 48.62% pour les solvants (CILD, 2003).
Une tentative d’explication du faible pourcentage de femmes consommatrices de drogues est faite par Werner qui écrit qu’« on peut supposer ici une sous-représentation des femmes liée au fait que l’usage des psychotropes illicites (« yamba », « pions ») voire licites (alcool, tabac) entraîne une stigmatisation beaucoup plus importante chez les femmes que chez les hommes. Si un homme qui fume du chanvre indien est un ceddo (guerrier), une femme par contre est une caga (une pute) et, si elle boit des pions, elle devient une saleté (une ordure) » (Werner, 1993).
En ce qui concerne le mode de consommation, Werner rapporte que l’héroïne (paodo; pendax, sanqal) est fumée, mélangée à du tabac ou du chanvre, sniffée ou encore inhalée, dans ce cas après combustion sur une feuille d’aluminium. Elle est rarement injectée et c’est alors le fait de membres de la communauté libanaise ou de Toubabs (Werner JF, 1992). Dans les années 1990, Werner mentionne l’existence d’une pratique, « moo », « ginz », en wolof, qui consiste à inhaler de la vapeur d’essence ou de diluant ou de colle ou de vernis, des produits d’accès facile et bon marché, qui provoquent un état d’ivresse intense et de courte durée, associé souvent à des hallucinations visuelles (Werner, 1993).
En 2005, une enquête du Comité Interministériel de Lutte contre la Drogue (CILD 2004-2005) montre la diffusion de l’usage de la cocaïne/crack et de l’héroïne ainsi que le recours à la voie intraveineuse dans plusieurs régions du pays. À la fin des années 2000, se confirme l’existence d’un usage de drogues injectables au Sénégal qui est classé dans la catégorie des pays à faible prévalence avec entre 1 000 et 10 000 consommateurs de drogues intraveineuses (ONUDC, 2008).
La législation sur les drogues au Sénégal
historique et contexte juridique
Depuis son accession à l’indépendance, le Sénégal a élaboré un ensemble de textes et créé des structures spécialisées sur les questions de drogues. Ces actions ont été réalisées suite à sa ratification des diverses conventions des Nations Unies sur les drogues. Le développement sans précédent de l’usage abusif des drogues, après la Seconde Guerre Mondiale a conduit les Nations Unies à élaborer deux conventions : la convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la convention de 1971 sur les substances psychotropes, ratifiées par le Sénégal (Sénégal, 1997). En 1963, le Sénégal adopte une loi qui réprime l’usage, la détention, la culture et le trafic de cannabis qui, à l’époque, était la seule drogue qui faisait l’objet d’une consommation abusive et d’un commerce illicite (CILD, 2005 ; Sylva, 2006). En 1972, une autre loi relative à la répression des infractions en matière de stupéfiants et son décret d’application n° 75 – 815 du 21 juillet 1975 sont promulguées (Sylva M.B. 2006).
La Commission Nationale des Stupéfiants (CNS), créée en 1965 puis réorganisée en 1987, prévoit la mise en place au niveau national d’une structure de coordination des activités de lutte contre les drogues (Sénégal, 1997). En 1975 sont mis en place d’autres textes qui répriment tous ceux qui sont impliqués dans le trafic et qui favorisent une approche compréhensive à l’égard du toxicomane. Cette approche se matérialise par l’introduction de l’aspect sanitaire dans le traitement juridique des usagers de drogues. Le traitement thérapeutique ou injonction thérapeutique2 qui constitue ce volet sanitaire du traitement judiciaire du toxicomane apparaît comme un soin de substitution à la peine. Au terme de cette loi, si le toxicomane consommateur non trafiquant accepte de se soumettre à une cure de désintoxication, il sera dispensé d’emprisonnement ; dans le cas contraire, la détention pourrait intervenir (CILD, 2003).
|
Table des matières
INDEX DES TABLEAUX
INDEX DES ENCADRÉS
INTRODUCTION GÉNÉRALE : VERS UN RENOUVELLEMENT DU REGARD SUR LES DROGUES
PREMIÈRE PARTIE CONTEXTUALISATION
CHAPITRE 1 : LES DROGUES EN AFRIQUE DE L’OUEST : DU TRAFIC ET DE LA CONSOMMATION
CHAPITRE 2 : POUR UNE SOCIO-HISTOIRE DES DROGUES AU SÉNÉGAL
CHAPITRE 3 : CONSTRUCTION DE L’OBJET DE LA RECHERCHE
DEUXIÈME PARTIE CONCEPTUALISATION, MÉTHODOLOGIE ET ETHNOGRAPHIE DU MILIEU DES USAGERS DE DROGUES
CHAPITRE 4 : LA MÉDICALISATION : CONCEPT ET MODÈLE D’ANALYSE
CHAPITRE 5 : LE CONCEPT DE DÉVIANCE
CHAPITRE 6 : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET PROFIL DES PERSONNES ENQUÊTÉES
CHAPITRE 7 : ÊTRE CONSOMMATEUR DE CAME À DAKAR : ETHNOGRAPHIE D’UN MILIEU À LA MARGE
TROISIÈME PARTIE MOBILISATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DES CONSOMMATEURS DES DROGUES
CHAPITRE 8 : L’AUTOMÉDICATION CHEZ LES USAGERS DE DROGUES À DAKAR
CHAPITRE 9 : LE VOYAGE HORS DU MILIEU
CHAPITRE 10 : DU RAPPORT À LA JUSTICE AU SEVRAGE PAR INCARCÉRATION VOLONTAIRE
CHAPITRE 11 : LES MOBILISATIONS COLLECTIVES AUTOUR DE L’USAGE DES DROGUES À DAKAR
QUATRIÈME PARTIE DE LA MÉDICALISATION AUX RÉACTIONS SOCIALES IMMÉDIATES
CHAPITRE 12 : LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE TRAITEMENT POUR LES USAGERS DE DROGUES
CHAPITRE 13 : RÉACTIONS SOCIALES DES ACTEURS IMMÉDIATS
CHAPITRE 14 : PERCEPTIONS ET APPRÉCIATIONS DES USAGERS DE DROGUES SUR LE CEPIAD
CONCLUSION GÉNÉRALE
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Télécharger le rapport complet