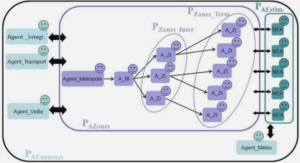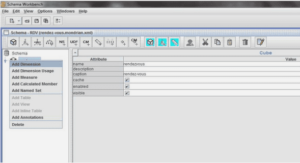Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
L’œsophage abdominal [60]
Anatomie descriptive [60]
C’est un segment très court (3 cm) qui correspond à la portion terminale de l’œsophage. Il est profond, oblique à gauche et se termine dans l’estomac au cardia.
Sa paroi est constituée de 3 tuniques qui sont de la superficie à la profondeur :
– la musculaire (en deux plans : superficiel longitudinal et profond circulaire)
– la sous-muqueuse ;
– et la muqueuse.
Rapports [60]
→ Rapports avec le diaphragme
L’orifice oesophagien du diaphragme est un véritable canal musculaire
ouvert en avant. L’œsophage est uni au muscle par une gaine celluleuse de glissement sur laquelle se fixent des fibres diaphragmatiques.
→ Rapports péritonéaux
L’œsophage est recouvert sur sa face antérieure par le péritoine pariétal.
En arrière il existe le méso-œsophage postérieur.
→ Rapports avec les organes Quatre rapports sont essentiels :
– le foie en avant ;
– L’estomac : la grosse tubérosité forme avec le bord gauche de l’œsophage l’angle de His ;
– la rate à gauche ;
– les nerfs pneumogastriques (X) : le pneumogastrique gauche antérieur, mêlé aux fibres oesophagiennes et le pneumogastrique droit qui est postérieur, volumineux séparé de l’œsophage, proche du pilier droit.
Vaisseaux et nerfs [60]
La vascularisation artérielle (coronaire stomachique et diaphragmatique inférieure) de l’œsophage abdominal est pauvre. Ce qui fait que les sutures au niveau de cette portion de l’œsophage sont précaires.
Les veines réalisent une anastomose porto-cave importante entre les systèmes azygos et porte. Les lymphatiques ont une double destinée : thoracique (ganglions médiastinaux postérieurs) et abdominale (ganglions coronaires stomachiques).
L’innervation est double : vagale et sympathique.
L’estomac [60]
Anatomie descriptive
L’estomac a la forme de la classique cornemuse (figure n°2) avec :
– une partie supérieure verticale : le fundus (poche à air radiologique) surmontant le corps de l’estomac ;
– une partie inférieure oblique en haut, en arrière et à droite : l’antre ;
– deux faces : antérieure et postérieure ;
– deux bords ou courbures : le bord droit est la petite courbure, concave et le bord gauche est la grande courbure, convexe. Il fait avec l’œsophage l’angle de His très aigu ;
– deux orifices : l’orifice oesophagien (cardia) profond situé à 2 cm de la ligne médiane à hauteur de D11 et l’orifice duodénal (pylore) situé à 3 cm à droite de la ligne médiane sur le flanc droit de L1, 6 ou 7 cm au-dessus de l’ombilic.
La capacité de l’estomac varie de 1 à 1,5 litre.
L’estomac est situé dans l’étage sus-mésocolique, au niveau de l’hypochondre gauche et de l’épigastre, et sous le grill costal (organe thoraco-abdominal). Il n’est fixé que par son adhérence au diaphragme en haut et sa continuité avec le duodénum.
La paroi de l’estomac comprend quatre tuniques : la séreuse péritonéale, la musculeuse (en 3 plans : superficiel longitudinal, moyen circulaire et profond oblique), la sous muqueuse et la muqueuse épaisse et plissée.
Du fait de sa position anatomique, l’estomac peut être atteint en cas de traumatisme thoraco-abdominal. Le tableau clinique est présent dans un délai court et la radiographie de l’abdomen sans préparation permet d’objectiver précocement un pneumopéritoine. Les lésions gastriques sont souvent rencontrées dans les traumatismes avec point d’impact au niveau épigastrique.
Rapports [60]
→ Rapports péritonéaux :
L’estomac est enveloppé par le péritoine viscéral sauf en arrière sur sa face postérieure au niveau du cardia et de la grosse tubérosité. A ce niveau le péritoine forme le ligament phrénico-gastrique et l’estomac est directement uni au diaphragme par le ligament suspenseur de l’estomac. La face antérieure de l’estomac est dans la grande cavité, la face postérieure répond à l’arrière cavité des épiploons proprement dite et les bords sont unis aux organes voisins par des mésos : le foie par le petit épiploon ; la rate par l’épiploon gastro-splénique et le côlon transverse par le ligament gastro-colique.
→ Rapports avec les organes
L’estomac répond au niveau de sa face antérieure au lobe gauche du foie, au diaphragme, aux organes thoraciques et à la paroi thoraco-abdominale. Au niveau de sa face postérieure il répond au diaphragme, à la rate, à la surrénale et au rein gauche, au pancréas, au mésocôlon transverse et, sous le mésocôlon à l’angle duodéno-jéjunal. Au niveau de la grande courbure l’estomac répond au ligament gastro-phrénique, à l’épiploon gastro-splénique et à la rate et au ligament gastro-colique. La petite courbure donne attache au petit épiploon avec le cercle artériel de la petite courbure.
La face antérieure du cardia est recouverte par le lobe gauche du foie et la face postérieure repose sur le pilier gauche du diaphragme.
Le pylore répond, en avant, au lobe carré du foie, au col de la vésicule biliaire et au côlon transverse ; en arrière à la tête du pancréas, au prolongement droit de l’arrière-cavité des épiploons et aux ganglions rétro-pyloriques de la chaîne lymphatique hépatique ; en haut, au petit épiploon et aux vaisseaux pyloriques ; en bas, au ligament gastro-colique avec les vaisseaux gastro-épiploïques droits et les ganglions lymphatiques sous pyloriques et le mésocôlon transverse.
Vaisseaux et nerfs [60]
Les artères viennent toutes des branches du tronc coeliaque. Elles constituent trois systèmes : le cercle artériel de la petite courbure formé par les artères coronaire stomachique et pylorique, le cercle artériel de la grande courbure formé par les artères gastro-épiploïques et les vaisseaux courts de l’estomac qui sont constitués par des collatérales des branches terminales de l’artère splénique et de la gastro-épiploïque gauche.
Les veines sont satellites des artères et tributaires du tronc porte. Au niveau du cardia elles constituent une anastomose porto-cave avec les branches de la veine diaphragmatique inférieure (système cave inférieur) et les veines oesophagiennes (système azygo-cave supérieur).
Les lymphatiques aboutissent au groupe coeliaque para-aortique par trois chaînes : la chaîne coronaire stomachique, la chaîne splénique et la chaîne hépatique.
Les lymphatiques communiquent entre eux et avec les lymphatiques mésentériques supérieurs, pancréatiques, oesophagiens.
L’innervation est double : vagale et sympathique.
Le duodénum [60]
C’est le premier segment de l’intestin grêle.
Anatomie descriptive
Le duodénum a schématiquement la forme d’un rectangle ouvert en haut et à gauche. Il mesure environ 30 cm de long et est composé de quatre parties appelées respectivement premier duodénum (dirigé en arrière en haut et à droite il fait suite au pylore sur le flanc droit de L1), deuxième duodénum (vertical de L1 à L4), troisième duodénum (horizontal devant L4 il peut être écrasé sur le rachis dans un traumatisme abdominal) et le quatrième duodénum (vertical de L4 à L2) et se termine à l’angle duodéno-jéjunal. Le quatrième duodénum est relié au pilier gauche du diaphragme par le muscle de Treitz (figure n°3).
Le duodénum est très profond, fixe et central devant le rachis. Il comprend quatre tuniques : la séreuse péritonéale, la musculaire avec deux plans (superficiel longitudinal et profond circulaire), la sous muqueuse et la muqueuse.
Les lésions duodénales surviennent le plus souvent lors d’un choc violent [3,4]. Elles sont souvent associées à d’autres lésions d’organe qui font toute leur gravité.
L’atteinte duodénale dans les traumatismes ouverts est directe. Dans les traumatismes fermés le choc est souvent dû à une projection du duodénum [7]. La radiographie de l’abdomen sans préparation (ASP) peut retrouver deux types d’image :
– une disparition de l’ombre du psoas avec absence de pneumopéritoine et de niveau liquide qui constituent des signes négatifs importants en cas de rupture rétro-péritonéale ;
– ou un croissant gazeux sus hépatique clair inter-hépato-diaphragmatique en cas de rupture intra péritonéale.
Rapports [60]
→ Rapports péritonéaux
La partie initiale du premier duodénum est entourée en totalité par le péritoine viscéral. Le reste du duodénum avec la tête du pancréas, est accolé à la paroi abdominale postérieure par le fascia de Treitz. Il devient rétro-péritonéal et seule sa face antérieure est péritonisée, recouverte par le péritoine pariétal postérieur.
Sur la face antérieure, s’accolent la racine du mésocôlon transverse, le grand épiploon au-dessus du mésocôlon transverse, le mésocôlon lui-même et le mésocôlon ascendant au-dessous de la racine du mésocôlon et la racine du mésentère.
→ Rapports avec les organes
Dans la loge duodéno-pancréatique, il s’agit du pancréas, des canaux bilio-pancréatiques et des vaisseaux duodéno-pancréatiques.
En dehors de la loge les rapports sont :
– en avant : le foie, la vésicule biliaire, le mésocôlon transverse, le mésentère et ses vaisseaux et l’estomac ;
– en arrière : le pancréas, l’artère gastro-duodénale qui croise la face postérieure du premier duodénum ; à droite la veine cave inférieure, le pédicule rénal droit et les vaisseaux spermatiques ou utéro-ovariens droits ; à gauche derrière les troisième et quatrième duodénum , l’aorte et le pédicule rénal ;
– en haut, au niveau de la partie mobile du premier duodénum, le bord libre du petit épiploon contient le pied du pédicule hépatique avec notamment l’origine de l’artère gastro-duodénale et en-dedans les vaisseaux pyloriques.
Vaisseaux et nerfs [60]
La vascularisation de la partie mobile est assurée par de nombreuses branches venues des artères hépatiques, gastro-duodénale, pylorique, gastro-épiploïque droite, pancréatico-duodénale supérieure. Malgré cela il existe souvent une zone de la face postérieure du bulbe pauvrement irriguée.
Le duodénum fixe est vascularisé par des branches des arcades pancréatico-duodénales.
Les veines sont tributaires du tronc porte.
Les vaisseaux lymphatiques vont aux ganglions duodéno-pancréatiques puis aux ganglions sous et rétro-pyloriques ou mésentériques supérieurs.
L’innervation est double : vagale et sympathique.
Le jéjuno-iléon et son mésentère [60]
Le jéjuno-iléon ou grêle est la deuxième partie, mobile, du tube digestif.
Le mésentère est son méso. Il contient les vaisseaux mésentériques supérieurs.
Anatomie descriptive
Le jéjuno-iléon est situé dans l’espace sous-mésocolique de l’abdomen, depuis l’angle duodéno-jéjunal en haut et à gauche jusqu’au côlon ascendant dans la fosse iliaque droite. Il est mobile, relié à la paroi par le mésentère et fixé par ses extrémités (figure n°4). C’est un tube constitué par 15 ou 16 anses intestinales en U disposées en deux groupes :
– en haut et à gauche, les anses jéjunales horizontales. La première anse jéjunale qui fait suite au duodénum tient dans la profondeur ;
– en bas et à droite les anses iléales verticales. La dernière anse iléale est ascendante, du petit bassin au côlon ascendant où elle se termine.
Le jéjuno-iléon mesure 5 à 6 mètres. Son calibre va en diminuant, de 3 à 2 cm.
Vaisseaux et nerfs [60]
Les vaisseaux et nerfs du jéjuno-iléon qui forment le pédicule mésentérique supérieur pénètrent dans le segment moyen de la racine du mésentère au bord supérieur du troisième duodénum. L’artère mésentérique supérieure naît de l’aorte au niveau du disque D12-L1 derrière le pancréas, chemine d’abord dans le segment moyen de la racine du mésentère devant l’aorte puis dans le mésentère flottant, à droite et se termine à 50 cm environ de l’angle iléo-cæcal par une ou 2 branches. Cette artère vascularise l’intestin grêle et le côlon droit.
Les branches droites sont destinées au côlon droit. La plus basse est l’artère iléo-caeco-côlo-appendiculaire.
Les branches gauches intra mésentériques sont destinées au jéjuno-iléon : 8 à 17 artères forment un système d’arcades.
Malgré l’existence d’une arcade anastomotique intra péritonéale les vaisseaux droits doivent être considérés comme terminaux, une désinsertion du mésentère entraînant la nécrose du segment initial correspondant.
La veine mésentérique supérieure est la branche principale d’origine de la veine porte formée par les veines intestinales situées en avant et à droite des artères.
Le tronc mésentérique est constitué à un niveau très variable et peut être très court.
Les lymphatiques jéjuno-iléaux sont les chylifères, très nombreux, satellites des vaisseaux droits. Les ganglions se disposent en trois groupes dans le mésentère : un groupe périphérique le long du vaisseau parallèle ; un groupe moyen le long de l’arcade primaire et un groupe central dans la racine.
Les nerfs : le plexus mésentérique supérieur, péri artériel, vient du plexus solaire.
Le côlon [60]
Anatomie descriptive
Le côlon est la partie de l’intestin qui s’étend du jéjuno-iléon au rectum. Il est formé de droite à gauche par les segments suivants : le caecum et l’appendice, le côlon ascendant, l’angle colique droit, le côlon transverse, l’angle colique gauche, le côlon descendant puis le sigmoïde (figure n°5).
Le caeco-appendice est un segment en cul-de-sac normalement situé dans la fosse iliaque droite. Mais il existe des variations anatomiques de position. Cette portion du côlon est très mobile dans l’abdomen. L’orifice iléo-caecal est muni d’un sphincter lisse très puissant et d’une valvule muqueuse formée par deux valves superposées : la valvule de Bauhin.
Le côlon ascendant est long de 8 à 15 cm. Son diamètre décroît de bas en haut. L’angle colique droit qui l’unit au transverse est très aigu et se situe entre le rein et le foie.
Le côlon transverse mesure 35 à 75 cm de long et forme une grande anse transversale qui s’étend d’un angle colique à l’autre sous le foie et l’estomac. Il est situé en position antérieure.
L’angle colique gauche qui unit le côlon transverse et le côlon descendant est situé très profondément, très en dehors et très en haut, beaucoup plus à droite au niveau du rein gauche. Cet angle est très aigu. Le côlon descendant est oblique en bas, en dedans et en avant sur 6 à 15 cm. Le sigmoïde est un segment mobile dont la forme et la situation dépendent de sa longueur. Il est compris entre le bord interne du psoas gauche, au détroit supérieur, en haut et la face antérieure de la troisième vertèbre sacrée où il se continue avec le rectum.
|
Table des matières
I. INTRODUCTION
II. PREMIERE PARTIE : RAPPELS
1. Généralités
1.1. Définitions
1.2. Intérêts
1.3.Epidémiologie
1.3.1. Fréquence
1.3.2. Age et sexe
1.3.3. Circonstances étiologiques
1.3.3.1. Les agressions et rixes
1.3.3.2. Les accidents
1.3.3.3. Les tentatives de suicide
1.3.3.4. Les contextes de guerre
1.3.4. Agent causal
1.4. Rappels anatomiques
1.4.1. Limites de la cavité abdominale
1.4.2. Anatomie de surface
1.4.3. Contenu de l’abdomen
1.4.3.1. La cavité péritonéale
1.4.3.1.1. L’œsophage
1.4.3.1.1.1. Anatomie descriptive
1.4.3.1.1.2. Rapports
1.4.3.1.1.3. Vaisseaux et nerfs
1.4.3.1.2. L’estomac
1.4.3.1.2.1. Anatomie descriptive
1.4.3.1.2.2. Rapports
1.4.3.1.2.3. Vaisseaux et nerfs
1.4.3.1.3. Le duodénum
1.4.3.1.3.1. Anatomie descriptive
1.4.3.1.3.2. Rapports
1.4.3.1.3.3. Vaisseaux et nerfs
1.4.3.1.4. Le jéjuno-iléon et son mésentère
1.4.3.1.4.1. Anatomie descriptive
1.4.3.1.4.2. Rapports
1.4.3.1.4.3. Vaisseaux et nerfs
1.4.3.1.5. Le côlon
1.4.3.1.5.1. Anatomie descriptive
1.4.3.1.5.2. Rapports
1.4.3.1.5.3. Vaisseaux et nerfs
1.4.3.1.6. Le rectum
1.4.3.1.6.1. Anatomie descriptive
1.4.3.1.6.2. Rapports
1.4.3.1.6.3. Vaisseaux et nerfs
1.4.3.2. L’espace rétro péritonéal
1.5. Etiologies
1.6. Physiologie
1.6.1. Mécanismes lésionnels
1.6.2. Conséquences
1.6.2.1. Perforation digestive et tableau d’irritation péritonéale
1.6.2.2. Syndrome hémorragique
2. Méthodes diagnostiques des traumatismes abdominaux
2.1. Circonstances de découverte
2.2. Interrogatoire
2.2.1. Le traumatisme
2.2.2. Le traumatisé
2.3. Examen physique
2.3.1. Inspection
2.3.2. Palpation
2.3.3. Percussion
2.3.4. Auscultation
2.3.5. La ponction lavage péritonéale
2.4. Examens paracliniques
2.4.1. Examens de laboratoire
2.4.1.1. Numération Formule Sanguine (NFS)
2.4.1.2. Groupage Sanguin Rhésus
2.4.1.3. Bilan d’hémostase
2.4.1.4. Biochimie
2.4.2. Imagerie
2.4.2.1. Radiographie simple de l’abdomen sans préparation (ASP)
2.4.2.2. Echographie abdominale
2.4.2.3. Tomodensitométrie abdominale
2.4.2.4. L’imagerie par résonance magnétique
2.4.2.5. Bilan des lésions associées
2.4.2.5.1. Bilan urologique
2.4.2.5.2. Radiographie du thorax
2.4.2.5.3. Radiographie du rachis
2.4.2.5.4. Radiographie de membres
2.5. Formes cliniques selon la topographie de la lésion pariétale
3. Traitement
3.1. Buts
3.2. Moyens et méthodes
3.2.1. Moyens médicamenteux
3.2.2. La réanimation
3.2.3. La chirurgie
3.2.3.1. Voies d’abord
3.2.3.1.1. La laparotomie
3.2.3.1.2. La minilaparotomie
3.2.3.1.3. La laparoscopie
3.2.3.2. Gestes thérapeutiques
3.3. Indications
3.4. Complications
4. Conclusion
III. DEUXIEME PARTIE : NOTRE ETUDE
MATERIELS ET METHODES
1. Cadre d’étude
2. Type d’étude
3. Critères d’inclusion
4. Critères d’exclusion
RESULTATS
1. Aspects anatomo-cliniques
1.1. Mécanismes
1.2. Circonstances
1.3. Agent causal
1.4. Points d’impact et siège de la lésion pariétale
1.5. Tableaux cliniques
1.6. Imagerie
1.6.1. Radiographie de l’abdomen sans préparation
1.6.2. Echographie abdominale
1.6.3. La tomodensitométrie
1.6.4. Coeliochirurgie
1.7. Siège de la plaie intestinale
1.7.1. Plaie de l’œsophage
1.7.2. Plaies gastriques
1.7.3. Plaies du duodénum
1.7.4. Plaies du jéjunum
1.7.5. Plaies de l’iléon
1.7.6. Plaies coliques
1.7.7. Plaies rectales
1.7.8. Lésions d’organes associées
2. Aspects thérapeutiques
2.1. Morbidité
2.2. Mortalité
2.3. Durée d’hospitalisation
IV : TROISIEME PARTIE : COMMENTAIRE
V. CONCLUSION
VI. REFERENCES
Télécharger le rapport complet