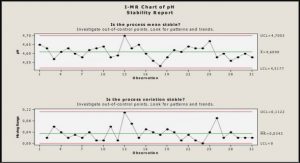Définition d’une pompe en générale
Une pompe est une machine destinée à faire circuler un fluide (liquide ou gaz) dans un endroit vers un autre, elle permet au courrant de surmonter les pertes de charges et de surélever jusqu’à une certaine hauteur (source : Les pompes et les stations de pompage, voir bibliographie) D’une manière générale, on peut classer des pompes en deux catégories:
– Les pompes volumétriques : pour ces pompes, la quantité d’eau délivrée dépend du mouvement de va et vient ou de bas en haut du piston dans un cylindre avec un système des clapets ou des soupapes.
– Les turbopompes : qui comprennent un rotor animé d’une vitesse de rotation uniforme, accouplé avec un moteur
Eléments principaux des pompes à pédales
En général, une pompe à pédale est constituée par un assemblage des différentes pièces que l’on va citer ci-dessous.
• L’activation de la pompe formée par deux tiges que l’on les nomme : « pédales »
• Deux cylindres munis chacun par un piston avec joint en cuir.
Les cylindres sont des tuyaux qui abritent l’assemblage du piston et le clapet de retenu d’aspiration. Le joint hydraulique formé par le contact mouvant entre la paroi du cylindre et le joint de cuvette de piston crée un vide partiel permettant la montée d’aspiration. Les cylindres sont habituellement en laiton et plus résistant à la corrosion en milieu acide. La rugosité des cylindres en laiton de bonne qualité est comprise entre 4 et 8 µ pouces (0,1 à 0,2 µ m) Le cylindre peut être aussi en fonte (1,3 à 5,1 µ m), en acier lisse (3,5 à 4,5 µ m) ou en PVC (Chlorure de polyvinyle) (0,1 à 0,3 µ m) (Notes : 1 µ pouce = 25.10-3 µ m) La longueur du cylindre est fonction de la course C de levier,
• Une boîte à eau.
• Un piston à chaque cylindre.
Généralement en laiton ou en bronze, parfois en fonte. L’usure de segment d’étanchéité pose encore des gros problèmes aujourd’hui. Le cuire de segment doit d’une qualité spécial.
• Une conduite de refoulement en PVC et une conduite d’aspiration en PVC.
Ces deux termes ont la même définition mais la seule différence c’est que le tuyau d’aspiration s’applique à tout tuyau de pompe situé au- dessous du cylindre, par contre le tuyau de chute (tuyau de refoulement) supporte le cylindre dans le piston c’est le tuyau de refoulement du cylindre. L’élargissement du diamètre du tuyau de chute entraînera une diminution de la perte de charge due au frottement mais une augmentation de coût.
• Les valves Elles sont de types divers : clapets, soupapes, valves à billes… Mémoire de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur, ridigé par Mr RAKOTOARISON Falimampiandry Patrick. Les valves sont en générales en laiton ou en bronze
• La presse étoupe. C’est un dispositif d’étanchéité pour le contrôle des fuites d’eau provenant du sommet du support (pour les pompes refoulantes) mais elle sert aussi comme coussinet et pièce de guidage pour la tige de la pompe.
• La tige de pompe. (Tringlerie) Elle relie le bras à l’assemblage du piston. La tige et ses raccords doivent être très solides pour supporter la force hydraulique F et celle admise sur la tige de la pompe, car pendant le mouvement ascendant du piston, elle est soumise à une traction et pendant le mouvement descendant elle est soumise à une compression. Pour les puits peu profonds, les tiges de pompes sont en aciers galvanisés et sont munies d’extrémités filetées. Une tige d’acier correctement filetée de 13 mm de diamètre devrait supporter une force de 180 Kg
• Un support d’équilibre pour l’ensemble.
Remarque : Cette pompe avec son support peut être fabriquée, soit en bois, soit en acier (en acier pour l’esthétique mais plus coûteux et en bois pour moindre de dépense)
DEFINITION DU MOT « IRRIGATION »
Selon le cours théorique : L’irrigation est un procédé pour faire parvenir l’eau dans les plantes, en sachant :
– le réseau d’irrigation : il s’agit d’un ensemble des organes, ouvrages et appareils qui assurent le transport, la répartition et la distribution à chaque exploitation agricole, même à chaque parcelle, des eaux destinées à l’arrosage, sans oublier d’ailleurs les organes qui doivent éventuellement évacuer les eaux en excès.
– la théorie d’arrosage : dans cette théorie, on fait l’étude de la quantité d’eau indispensable aux irrigations que l’on se propose de réaliser, de l’utiliser dans de bonnes conditions. Pour cela, il faut connaître les besoins en eau des plantes suivant les régions intéressées et les propriétés physiques des sols arrosés.
– les techniques d’arrosages : ce sont les façons de donner aux sols arrosés les eaux qu’ils vont absorber et retenir pour les mettre à la disposition des plantes. Il faut tenir compte le choix d’un système rationnel d’arrosage pratiquement utilisable et économique, qui mérite d’être sérieusement étudié.
– l’économie des arrosages : dans ce cas, il faut maîtriser la correspondance entre sol à irriguer et l’eau disponible à fin d’éviter tout gaspillage de cet eau. On y étudie aussi la rentabilité (bilan des dépenses et des recettes puis connaissance des bénéfice ou pertes) lors de l’exploitation du système d’arrosage.
• D’où on peut définir un petit périmètre irrigué comme : une action de trouver dans un rayon relativement restreint une eau disponible, ensuite l’amener sur les lieux de culture, puis la repartir entre toutes les plantes en quantité bien déterminées et de réalisation bien instruite. Il ne présente aucun grand ouvrage d’art.
Type d’alimentation en eau de ce système
L’alimentation en eau des billons peut être faite par : Des ouvertures aménagées sur une diguette d’un canal d’alimentation. Des siphons : ce sont des conduites qui passent au-dessus de la diguette du canal d’alimentation, ces conduites sont soumises en charges c’est à dire après leur amorçage, leurs extrémités sont immergées dans l’eau. Des tuyaux qui passent à travers la diguette du canal (enterrés), l’écoulement dans ces conduites est en charge et leurs autres extrémités débouchent à l’air libre. L’ordre des grandeurs de la longueur maximum des billons est représenté dans le tableau n°3 en annexe La méthode d’irrigation à la raie est adaptée à la plus part des cultures et en particulier à celles qui ne tolèrent pas la submersion de leur feuillage (beaucoup de cultures maraîchères). Elle est particulièrement recommandée pour les pommes de terre.
|
Table des matières
INTRODUCTION
PARTIE1: LES POMPES A PEDALES
I.GENERALITES
I.1. La FAO
I.2. Le projet GCP/MAG/075/SWI
I.3. Méthodologie et problématique
II.NOTION D’UNE POMPE
II.1. Définition d’une pompe en générale
II.2. Pour une pompe à pédale
II.3. Les termes à savoir quand on parle d’une pompe
III.ELEMENTS PRINCIPAUX DESPOMPES A PEDALES
III.1. Eléments principaux des pompes à pédales
III.2. Accessibilité de l’atelier de fabrication
IV.LE SYSTEME DE POMPAGE
IV.1. Différentes positions du piston
IV.2. Expression de la force hydraulique
IV.3. Calcul du débit refoulé
IV.4. Avantage mécanique
IV.5. Détermination de la force nécessaire demandée aux utilisateurs
IV.6. Calculs des pertes de charges
V. LES DIFFERENTS TYPES DES POMPES A PEDALES
V.1. Introduction
V.2. La pompe à béton
V.3. Pompe aspirante refoulante nommée : pompe « MAHASOA »
VI. PROFIL ET MODE OPERATOIRE DES POMPES A PEDALES
VI.1. La pompe MAHASOA
VI.2. Raisons de modification de la pompe vers la pompe MAHASOA
VI.3. Mode opératoire
VII. COUT DE FABRICATION
VII.1. Coût de la pompe à béton
VII.2. Coût de la pompe « MAHASOA »
VIII. PLAN TECHNIQUE ET ASSEMBLAGE
VIII.1. Pour la pompe à béton
VIII.2. Pour la pompe « MAHASOA »
IX. EQUIPEMENTS EN AMONT DES POMPES A PEDALES
IX.1. Bâche d’aspiration
IX.2. Grilles ou crépine
IX.3. Vannes
IX.4. Tulipe
IX.5. Coude
X. ANOMALIES ET REMEDES DES POMPES A PEDALES
XI. RESSOURCES EN EAU
XI.1. Stocks d’eau
XI.2. Evaluation des stocks d’eau.
XI.3. Forage
XI.4. Puits
XI.5. Tranchée
XI.6. Extension des surfaces à irriguer
PARTIE2: LES DIFFERENTS TYPES D’IRRIGATIONS
I. DEFINITION DU MOT « IRRIGATION »
I.1. Selon le cours théorique
I.2. Etymologiquement et historiquement
II. INTRODUCTIONS
III. L’IRRIGATION PAR RUISSELLEMENT
III.1. Description d’une irrigation par ruissellement
III.2. Les deux facteurs principaux de ruissellement
III.3. Dimensionnement de la planche de ruissellement
III.4. Sous-système dérivé de l’irrigation par ruissellement
III.5. Conditions à la réalisation
IV. L’IRRIGATION PAR BASSIN OU PAR SUBMERSION
IV.1. Définition de ce système d’irrigation
IV.2. Mode d’alimentation
IV.3. Dimensionnement du bassin de submersion
IV.4. Conditions à la réalisation
V. L’IRRIGATION PAR INFILTRATION
V.1. Définition de ce système d’irrigation
V.2. L’irrigation à la raie ou en billon
VI. L’IRRIGATION PAR ASPERSION
VI.1. Introduction
VI.2. Installation des équipements à l’aspersion
VI.3. Les données théoriques de l’aspersion
VI.4. Exemples concrets d’un asperseur à Madagascar
VII. IRRIGATION LOCALISEE OU GOUTTE A GOUTTE
VII.1. Origine
VII.2. Structure du réseau
VII.3. Facteurs de la mise en œuvre du goutte à goutte
VII.4. Limites d’utilisation du goutte à goutte
VII.5. Equipement
VII.6. Caractéristiques
VII.7. Application et conditions réacquises
PARTIE 3: APPERCU ENVIRONNEMENTAL ET ECONOMIQUE ET INVENTAIRE DES AVANTAGES-INCONVENIENTS
I. APPERCU ENVIRONNEMENTAL
I.1. Introduction
I.2. Mise en contexte du projet
I.3. Etude technique d’impact
I.4. Evaluation de chaque impact
I.5. Analyses comparatives des impacts
I.6. Mesure d’attenuation et compensation
II. APPERCU ECONOMIQUE
II.1. Introduction
II.2. But
II.3. Exemple du site d’Anjomakely
II.4. Besoins en eau des plantes
II.5. Les dépenses
II.6. Les recettes
II.7. Conclusion
III. INVENTAIRE DES AVANTAGES ET INCONVENIENTS
III.1. Avantages
III.2. Inconvenients
III.3. Etude de faisabilité technique
IV. MESURES D’ATTENUATION POUR LES INCONVENIENTS
IV.1. Pour les quatre systèmes d’irrigation
IV.2. Pour la motopompe
CONCLUSION GENERALE
Télécharger le rapport complet