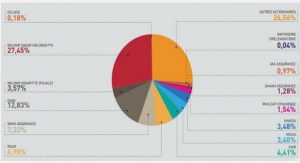PREMIERE PARTIE : AUX ORIGINES DU SYSTEME PARTISAN TURC
Les quatre clivages structurants
Nature et causes de la « critical juncture » turque
En nous inspirant de la démarche initiée par Seymour Lipset et Stein M. Rokkan , nous pouvons émettre l’hypothèse que la vie politique turque est structurée autour de quatre clivages fondamentaux. Avant d’expliciter ces derniers, il convient de revenir à la critical juncture qui en est la cause. Cette critical juncture est le déclin progressif de l’Empire ottoman face à une Europe alors en plein développement A quand remonte ce déclin ? Contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord, le désastre de Lépante (1571) n’annonça pas le début de la décadence ottomane. Par exemple, le traité de paix signé (en 1573) avec la République de Venise reconnut la domination de la Sublime Porte sur Chypre. En outre, la marine ottomane fut rétablie après la bataille de Lépante, et celle-ci conquit (en 1574) la ville de Tunis (qui, jusque-là, était une possession espagnole). D’ailleurs, le grand vizir Sokollu Mehmet Paşa aurait alors déclaré à l’ambassadeur vénitien : « En détruisant nos forces navales, vous nous avez rasé la barbe. En conquérant Chypre, nous vous avons amputé le bras.
Le bras coupé ne repousse pas, mais la barbe rasée repousse encore plus drue.»
En réalité, le reflux ottoman débute à partir de la fin du XVIIème siècle : le grand vizir Fazıl Ahmet Paşa Köprülü mena, entre 1676 et 1681, des expéditions militaires en Ukraine afin de contrer la puissance russe dans cette région. Ces campagnes se conclurent par une véritable déroute pour le sultan, qui se vit dans l’obligation d’accorder à la Russie un statut de protectrice de l’Eglise orthodoxe de Jérusalem. Par ailleurs, l’armée ottomane fut contrainte de reculer sa ligne de défense en deçà des rivières Bug et Dniepr. L’échec du second siège devant Vienne (1683) confirma cette inversion des rapports de forces entre l’armée ottomane et les armées européennes : suite à cette victoire austro-polonaise, une coalition anti-ottomane se forma (réunissant la Russie, l’Autriche, la Pologne, Venise et les Etats pontificaux). En 1686, la ville de Buda (qui, depuis cent quarante-cinq ans, symbolisait la ligne de défense des territoires hongrois sous souveraineté ottomane) fut conquise par l’armée autrichienne, dirigée par Charles de Lorraine. Venise prit possession d’Athènes un an plus tard, alors qu’au même moment, la Transylvanie échappait à la domination ottomane.
Ce crépuscule fut confirmé après la signature du traité de Karlowitz/Karlofça (1699), qui consacra le début du reflux de la Sublime Porte en Europe. Le sultan céda, par exemple, la Podolie aux Polonais, la Morée et la Dalmatie aux Vénitiens, ainsi que la Hongrie et la Transylvanie aux Autrichiens. De surcroît, l’intervention des Pays-Bas et de l’Angleterre dans les négociations permit à ces deux Etats d’obtenir (à l’instar de la France) une renégociation des accords commerciaux en leur faveur et une réactualisation des Capitulations. En dépit de quelques gains territoriaux, les accords de Passarowitz/Pasaforça (1718), qui succédaient à quatre ans de guerre contre Venise, réduisirent encore la proportion de territoires européens sous souveraineté ottomane : la Sublime porte dut céder aux Autrichiens la Valachie occidentale, le nord de la Serbie (Belgrade incluse) et Temesvar.
L’Empire ottoman fut également confronté (à partir du début du XVIIIème siècle) à une série de conflits armés avec la Russie. Cette succession de guerre (1710-1711, 1735-1738, 1768-1771, 1787-1792, 1806-1812, 1828-1829) eut pour conséquence une accentuation du reflux territorial de l’Empire en Europe et dans le Caucase. C’est à la suite d’un de ces conflits russo-ottomans que fut conclu (en juillet 1774) le traité de Küçük-Kaynarca, qui accorda au tsar un rôle de protecteur officiel des chrétiens orthodoxes vivant dans l’Empire ottoman. Ce même traité plaça la Géorgie sous la domination de Saint-Pétersbourg, accorda l’indépendance à la Crimée et autorisa les marins russes à circuler librement dans les Détroits et la Mer Noire. Ainsi, cet accord va inaugurer l’émergence d’une nouvelle problématique sur la scène internationale : la « question d’Orient », marquée par une concurrence des puissances européennes autour des anciens territoires ottomans du Vieux Continent.
Comment peut-on expliquer ce déclin ? Le mouvement parallèle de modernisation des armées européennes (initié par la restructuration, au XVIème siècle, de l’armée hollandaise par Maurice de Saxe) et le déclin quantitatif de l’armée ottomane l’explique en grande partie. Prenons l’exemple de l’artillerie (apparue vers la fin du XIVème siècle) : sous le règne de Süleyman, l’artillerie ottomane était de loin la plus redoutable. Toutefois, les experts militaires ottomans négligèrent (à partir de la fin du XVIème siècle) sa modernisation face aux perfectionnements de celle-ci par les armées européennes. Ce perfectionnement européen fut également visible sur le plan maritime : ainsi, des Etats occidentaux comme l’Espagne et le Portugal construisirent leurs puissances respectives sur le contrôle des mers, prélude à une domination sur le commerce international. Or, en contournant la « route de la soie » via le cap de Bonne-Espérance (en Afrique) pour accéder directement aux Indes, la Sublime Porte se vit être privée d’une de ses ressources économiques majeures : le commerce des épices. Cette évolution du commerce mondial accentua le processus de déclin économique de l’Empire ottoman. Cependant, la décadence impériale ne fut pas le seul fruit de la modernisation militaire et technologique en Europe. Elle fut également la conséquence d’une « indéniable démobilisation des armées ottomanes » . D’après les données relevées par Ömer Lütfü Barkan, seulement 2000 sipahi de Roumélie sur 32 000 et 1000 sipahi d’Anatolie sur 18 700 répondaient encore à l’appel au début du XVIème siècle. Ce phénomène s’aggrava au XVIIème siècle : par exemple, Koçi Bey déplora que le nombre de sipahi mobilisables ne s’élevait qu’à 7000 ou 8000 individus. Selon l’historien İlber Ortaylı, alors que l’armée des sipahi comptait 100 000 personnes sous Süleyman le Magnifique, elle n’en comprenait plus que 20 000 cent-cinquante ans plus tard . En effet, les sipahi pouvaient (même s’ils ne répondaient pas à l’ordre impérial de mobilisation) conserver leurs privilèges, leurs propriétés et leurs titres pendant sept ans. Dans les faits, on constate même que ces cavaliers transmettaient leur charge de manière héréditaire, et que leurs activités réelles ne relevaient plus vraiment du champ militaire. Ce double -mouvement parallèle (déclin de soi-même et développement des voisins européens) constitua un véritable choc, comparable à ceux que connût le Japon de 1543 à 1868 et la Chine durant les guerres de l’opium. Ce « choc de l’Occident » conduira à l’éclosion de quatre clivages (dont deux d’entre eux trouvent néanmoins leurs racines durant l’apogée ottomane), que nous allons détailler maintenant.
Le clivage « musulmans stricts »/« musulmans pluralistes »
Etudions maintenant le cas du premier clivage, opposant « musulmans stricts » et « musulmans pluralistes ». Contrairement à ce qu’on pourrait de prime abord imaginer, ce clivage ne trouve pas ses origines uniquement dans la période kémaliste, mais plonge également ses racines dans les débuts de la période ottomane. Ce fut sous le sultan Orhan que le processus d’officialisation de l’islam en tant que religion étatique débuta. Sous son règne, une première medrese fut créé à İznik (l’ancienne Nicée) en 1331. Toutefois, cette tendance ne s’accentua réellement que sous Mehmet le Conquérant. Celui-ci institua une structure officielle chargée de la gestion du culte (le Seyhülislamlık), ainsi qu’une nouvelle medrese à Istanbul. Hamit Bozarslan explique qu’à partir de ce règne, les ulema se virent confier la mission de définir « ce qui est licite et ce qui ne l’est pas dans le domaine de la foi, oublieux de l’esprit de gaza [soldats de la foi] des combattants volontaires passés.
Ils sont les gardiens d’un temple érigé à la gloire de l’orthodoxie et de l’orthopraxie. Les successeurs de [Mehmet] le Conquérant vont d’ailleurs s’attacher à perfectionner cet islam officiel qui, s’il continue à intervenir dans la dynamique de conquête, le fait désormais en tant que composante de l’Etat […]. Dorénavant, c’est l’Etat qui mène des guerres au nom de l’islam, et non pas l’’’islam’’ qui se fait guerrier pour forger un Etat ».
Ce double mouvement d’autonomisation du pouvoir politique par rapport à la religion et de définition (par ce même pouvoir) d’une orthodoxie religieuse officielle est à l’origine du clivage opposant musulmans stricts et musulmans pluralistes. Effectivement, du fait de l’autonomisation du sultan vis-à-vis de l’islam, des oppositions eurent parfois lieu entre le pouvoir politique et les dignitaires religieux. Nous pouvons illustrer notre propos à travers l’antagonisme entre les confréries islamiques et le sultan Mehmet II (qui accusaient ce dernier de prendre, « sous l’emprise des conseillers du mal », des lois « despotiques » et des dispositions contraires à la charia ). Par conséquent, à la mort de Mehmet II, une insurrection fut menée par les milieux religieux, qui conduisit au meurtre du grand vizir Mehmet Paşa et à l’intronisation du très conservateur Bayezid (celui-ci se trouva d’ailleurs dans l’obligation de rétablir les anciens privilèges des cheikhs). De même, certains religieux critiquaient le déplacement de la capitale ottomane à Istanbul, jugeant cette ville trop « infidèle » et lui préférant Bursa (la ville des « vrais musulmans »). Par ailleurs, la définition (par les instances religieuses) d’une orthodoxie sunnite officielle n’était pas sans susciter d’oppositions. A partir du XIIIème siècle, l’on assista à l’émergence d’un islam hétérodoxe qui se manifesta à travers des courants aussi divers que le yesevisme, le vefaisme, l’haydarisme et le kalenderisme. Puis, une nouvelle forme d’hétérodoxie apparut au XVIème siècle : le bektashisme, ancêtre de l’alévisme. Il convient également de souligner que le clivage « musulmans pluralistes »/« musulmans stricts » se coupla parfois avec le clivage « centre »/« périphérie » (que nous exposerons ultérieurement). En témoignent les révoltes celali (1550-1610) et kızılbaş (qui débutèrent à la fin du XVème siècle), dont les affiliations religieuses relèvent du chiisme. En témoigne également la révolte de cheikh Bedreddin de Simanya en 1416. Ce dignitaire religieux avait aussi la particularité de développer un discours de tolérance œcuménique, adressé aussi bien aux musulmans qu’aux juifs et aux chrétiens. De surcroît, le dogmatisme des ulema était parfois également battu en brèche par des dignitaires religieux sunnites, tel que Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî (qui prônait le respect des minorités non musulmanes).
Ce débat entre « musulmans stricts » et « musulmans pluralistes » refit surface durant le déclin de l’Empire ottoman, et se personnalisa à travers (par exemple) l’affrontement idéologique (au XVIIème siècle) entre Koçi Bey (qui prônait une réhabilitation des principes politiques traditionnels et une réaffirmation de l’orthodoxie sunnite) et Kâtip Çelebi (qui, au contraire, critiquait vertement les « fanatiques », dont il accusait les idées de freiner la modernisation de l’Empire). Cette opposition s’articulait autour d’une question plus large que le simple antagonisme entre dogmatisme et tolérance, et se conjuguait avec le clivage « modernistes »/« traditionnalistes » (que nous détaillerons tout à l’heure). Ainsi, durant les Tanzimat , les minorités religieuses se virent accorder de nouveaux droits, ce qui ne fut pas sans susciter l’agacement de la frange conservatrice de la population musulmane. Sous Atatürk, cet antagonisme entre musulmans stricts et musulmans pluralistes se traduisit par une opposition entre laïcs et conservateurs. Par exemple, le 10 avril 1928, les articles de la Constitution mentionnant l’islam comme religion d’Etat furent supprimés. Puis, le 15 mai 1937, la laïcité fut inscrite dans la Constitution (comme les cinq autres « principes du kémalisme »). L’antagonisme entre religieux et laïcs fut également particulièrement vif durant l’adoption (en 1924) de la loi sur l’unification de l’enseignement, qui conduisit à la fermeture des écoles coraniques et au rattachement de tous les établissements scolaires au Ministère de l’Education nationale. Cette importance de la question du contrôle de l’éducation dans l’émergence d’un clivage « musulmans pluralistes »/« musulmans stricts » en Turquie n’est d’ailleurs pas sans rappeler les analyses de Lipset et Rokkan sur l’apparition du clivage « Eglise »/« Etat » en Europe occidentale.
Le clivage « centre »/« périphérie »
Le deuxième clivage que nous pouvons relever est un antagonisme entre le « centre » et la « périphérie ». Comme dans le cas précédent, ce clivage trouve son origine bien avant le déclin de l’Empire ottoman. Comme le souligne Hamit Bozarslan : « Basé sur une distinction très nette entre le centre et le ‘’reste’’, dont il faut à tout prix empêcher l’intégration au sein d’instances de décision, un empire n’est pas une fabrique de citoyens. La pensée politique ottomane a jalousement préservé ce dogme de séparation entre la classe militaire et la reaya [population civile] jusqu’aux réformes du XIXe siècle.
»Cette séparation conduisait parfois à des velléités d’autonomie de la « périphérie » par rapport au « centre » (qui se conjuguèrent à l’occasion avec les avatars annonciateurs du futur clivage « autoritaires »/« démocrates », que nous décrirons ultérieurement). Fermement réprimées par le pouvoir politique, cet affrontement latent se traduisit à travers l’édification de forteresses et la constitution de milices locales dans les villes de province. En outre, l’on assista (de 1603 à 1609) à un vaste exode des habitants de ces régions vers des zones montagneuses difficiles d’accès, où de nouveaux bourgs furent crées.
Puis, ce clivage gagna en intensité à la fin du XIXème siècle, avec le réveil des nationalismes balkaniques et l’autonomisation progressive des périphéries de l’Empire. H. Bozarslan explique également qu’à partir de la seconde moitié du XIXème siècle, le « centre » perdit son « ingénierie du pouvoir » . C’est dans ce contexte d’érosion territoriale de l’Empire qu’émergea un débat divisant les élites ottomanes d’alors : « qui sommes-nous ? Qu’est-ce qui est le plus important ? Etre un citoyen ottoman ? Etre un musulman ? Etre de ‘’race’’ turque ? » Le « choc de l’Occident » fut donc le terreau sur lequel émergea une problématique « identitaire », qui cherchait à distinguer « nous » et « les autres ». Sous Abdülhamid II, cet autre fut le chrétien (ce qui explique les massacres d’Arméniens commis durant son règne, comme celui d’Erzurum en 1895). Cette période fut donc l’occasion d’une addition des clivages « centre »/« périphérie » et « musulmans stricts »/ « musulmans pluralistes ». Puis, sous le régime unioniste (qui souhaitait centraliser l’administration et affirmer le caractère « turc » de l’Etat), cet autre n’était plus seulement le chrétien (pogrom anti-arménien d’Adana en 1909), mais aussi le non-Turc en général, y compris lorsqu’il était musulman (répression du mouvement indépendantiste albanais en 1909, hostilité à l’égard du nationalisme arabe, etc). Sous Atatürk, la figure de l’altérité devint le Kurde, désormais désigné sous l’appellation « Turc des montagnes » afin de l’assimiler. Ainsi, l’on recense dix-huit insurrections kurdes entre 1925 et 1938, dont les trois plus connues sont la révolte du Cheikh Saït (1925) , celle du mont Aranat (1930) et celle de Dersim (1938).
Le clivage « modernistes »/« traditionnalistes »
« Faut-il imiter les Européens ou garder nos spécificités religieuses et culturelles ? » C’est la question à laquelle durent faire face les élites ottomanes devant le déclin de leur pays. Cette interrogation existentielle mena à l’apparition d’un troisième clivage, opposant « modernistes » et « traditionnalistes ». Cette tension apparut avec les velléités de modernisation formulées par Selim III : conseillé par des experts militaires français, ce sultan promulgua (en 1793) le Nizam-ı Cedid, qui créait un nouveau corps d’infanterie formé à l’occidentale, dont les membres étaient recrutés via la conscription. En outre, Selim III ressentait une fascination ambigüe pour la Révolution française : « Tout indique que la France révolutionnaire horrifie et fascine en même temps l’empire de Selim III.
[…] En un sens, le sultan réformateur devient l’initiateur d’un processus d’exportation conservatrice d’un modèle révolutionnaire européen, qui va marquer le XIXe siècle ottoman dans sa totalité. »
Son successeur Mahmut II tenta de poursuivre les réformes, mais vit ses initiatives être freinées par la révolte des janissaires (au cours de laquelle le grand vizir modernisateur, Mustafa Bayraktar, fut exécuté).
Ce débat entre « modernistes » et « traditionnalistes » fut également visible à travers l’affrontement (en 1908-1909) entre le sultan Abdülhamid II et les Jeunes-Turcs du « Comité Union et Progrès » (et se coupla pour l’occasion avec le clivage « autoritaires »/« démocrates », que nous allons exposer tout à l’heure), ces derniers réclamant l’instauration d’une monarchie constitutionnelle. Toutefois, ce fut durant la période kémaliste que le clivage entre « modernistes » et « traditionnalistes » devint le plus visible. Ainsi, Atatürk mena une entreprise de modernisation teintée d’occidentalisme (ce qui lui valut la rancoeur des milieux conservateurs). De 1922 à 1923, la Grande Assemblée Nationale de Turquie bouleversa les structures politiques en abolissant le sultanat et en proclamant la République. En 1925, fut lancée la « révolution du chapeau » : le port du fez était désormais interdit pour les hommes, et les femmes fonctionnaires ne pouvaient plus porter le voile.
En 1926, le calendrier grégorien fut adopté. Durant la même année, les traductions du Code civil suisse, du Code pénal italien et du Code commercial allemand remplacèrent la charia. En 1928, l’alphabet latin fut adopté. Les femmes obtinrent le droit de vote en 1930 pour les élections locales, et en 1934 pour les élections nationales .
Le clivage « démocrates »/« autoritaires »
Le quatrième clivage traversant la scène politique turque semble être celui opposant les « autoritaires » aux « démocrates ». Dans ce cas également, l’opposition entre Abdülhamid II et les Jeunes-Turcs est significatif. Dans certains contextes, il convient toutefois de relever que le clivage « démocrates »/« autoritaires » se coupla avec le clivage « centre »/« périphérie » : ainsi, après le virage autoritaire du gouvernement unioniste, les tendances démocrates de l’opposition se joignirent aux représentants des populations non-turques.
Sous Atatürk, l’une des manifestations de ce clivage entre autoritaires et démocrates fut l’attitude hostile qu’eurent les autorités à l’égard du premier parti d’opposition au régime : le Parti Républicain Progressiste (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, TCF). Crée le 17 octobre 1924, cette formation politique réclamait, dans son programme, qu’aucun nouvel amendement constitutionnel ne soit adopté « sans l’accord explicite de l’électorat turc ». Dans ce cas également, le clivage « démocrates »/« autoritaires » se superposa avec le clivage « centre »/« périphérie » : le régime kémaliste prit prétexte de la révolte du Cheikh Saït pour interdire le TCF. Ce clivage entre « autoritaires » et « démocrates » se retrouvait d’ailleurs au cœur même de l’élite kémaliste : tandis que Celal Bayar prônait une démocratisation du régime, Recep Peker souhaitait que la Turquie kémaliste s’inspire de l’Italie fasciste et de l’URSS stalinienne.
Le clivage « autoritaires »/« démocrates » se prolongea sous İsmet İnönü, qui (par exemple) interdit aux étudiants de la faculté de droit de l’Université d’Istanbul d’organiser des réunions en hommage au poète libéral Namık Kemal. C’est, d’ailleurs, cet antagonisme entre « démocrates » et « autoritaires » qui nous permet de comprendre pourquoi, durant les élections législatives de 1950, le Parti Démocrate arriva en tête dans les régions côtières de l’Ouest du pays : ce vote en faveur de la droite ne s’expliquait pas par un conservatisme particulier des habitants de ces régions (les mœurs, au contraire, y étaient déjà plus « occidentalisées » qu’en Anatolie intérieure) mais, au contraire, par un attachement de ces électeurs aux valeurs démocratiques (ce qui les a conduit à sanctionner le CHP d’İnönü).
La décennie Menderes (1950-1960)
Entre 1950 et 1960, la Turquie fut dirigée par un grand parti de centre-droit : le Parti Démocrate (Demokrat Parti, DP) d’Adnan Menderes et Celal Bayar. Comme nous l’avons précédemment évoqué, la force de ce parti fut (durant les élections de 1950, 1954 et 1957) de séduire tant les électeurs de gauche favorables à une démocratisation du régime turc que l’ensemble des électorats de droite : conservateurs modérés, libéraux (au sens économique du terme), nationalistes et islamistes. Effectivement, tout en veillant à rassurer les électeurs anti-autoritaires attachés à l’héritage kémaliste, le DP veillait à s’attacher la sensibilité islamiste d’une partie de l’électorat de droite. Poursuivant la politique initiée par İnönü depuis 1945, Menderes libéralisa l’attitude de l’Etat vis-à-vis des activités religieuses. L’on assista, par exemple, à l’affirmation des confréries musulmanes (comme le Nurculuk ), au développement des cours de religion et à l’ouverture des premières écoles imam-hatip . De même, la première mesure prise par le gouvernement DP fut le rétablissement de l’appel à la prière en langue arabe. Un député de Konya (Himmet Ölçmen) alla jusqu’à déclarer : « A la tête de cette nation se trouve un homme choisi par le Prophète et par Allah, et cet homme se nomme Menderes. » Sur le plan économique, le Parti Démocrate se faisait l’avocat d’une politique résolument libérale. Ainsi, Adnan Menderes activa (au cours de ses mandats) trois des quatre clivages structurant le champ politique turc : il se plaça sur le versant « démocrate » du clivage « autoritaires »/« démocrates », avant d’en rejoindre le versant opposé vers 1956-1957. Soulignons d’ailleurs qu’à partir du tournant autoritariste du DP, l’on assista à une baisse de la participation électorale : alors que celle-ci s’élevait respectivement à 89,3 et 88,6 % en 1950 et 1954, celle-ci chuta à 76,6 % en 1957. Cette baisse de la participation peut être interprétée comme étant la conséquence d’une désaffiliation des électeurs de sensibilité anti-autoritaire par rapport au DP. Il est d’ailleurs intéressant de constater la remontée de la gauche lors des élections législatives de 1957, au moment même où le DP usait de méthodes de gouvernement de plus en plus autoritaires. Par ailleurs, ces élections virent l’émergence (dans la province de Burdur) d’un parti fondé par des dissidents du DP, réclamant un assouplissement de la censure de la presse et un plus grand respect des libertés individuelles : le Hürriyet Partisi (Parti de la Liberté, HP). L’aspect autoritaire du Parti démocrate se renforça en 1958, avec la constitution du Vatan Cephesi (Front de la Patrie) : cette organisation (que l’historien et politologue Hamit Bozarslan n’hésite pas à qualifier de « véritable machine de guerre » ) avait pour fonction de discréditer les opposants à Adnan Menderes, dont les activités partisanes étaient associées à une « trahison » de la nation. Le CHP était d’ailleurs, durant cette époque, l’objet de nombreuses poursuites judiciaires (voire menacé d’interdiction). Ainsi, dès 1959, « plus personne ne peut écarter l’hypothèse de l’instauration d’un nouveau système de parti unique » . A partir de cette même année, de fréquents affrontements opposèrent étudiants et policiers, ce qui aboutit (le 28 avril 1960) au décès du jeune Turan Emeksiz (qui devint une véritable icône pour la jeunesse universitaire radicalisée).Concernant le clivage entre « musulmans stricts » et « musulmans pluralistes », il se positionna sur le versant « musulman strict ». Menderes n’avait-il pas déclaré, durant un meeting électoral : « Si vous le souhaitez, nous pourrions revenir au califat » ? Ce fut également durant la période DP qu’eurent lieu les pogroms anti-grecs, anti-arméniens et antisémites d’Istanbul (tacitement tolérés, voire encouragés par le gouvernement) des 6 et 7 septembre 1955, ce qui aboutit au départ de nombreux membres des minorités non-musulmanes.
L’ultimatum du 12 mars 1971 et le régime militaire de 1971-1973
Devant cette montée des radicalités, « La formule politique opposant dans les urnes un parti conservateur populiste et un parti ‘’occidentaliste’’ élitiste, unis cependant par un pacte nationaliste et kémaliste […] ne peut dès lors faire preuve de viabilité » . Par conséquent, une fraction de l’armée (composée de jeunes militaires kémalistes, mais également nassériens) planifia un coup d’Etat pour le 9 mai 1971 . Ces velléités furent jugulées par la hiérarchie militaire qui, après avoir écarté les conspirateurs, adressa (avec le soutien du président d’alors, l’ex-chef d’état-major Cevdet Sunay) un ultimatum à Süleyman Demirel le 12 mars. Le deuxième article de cet ultimatum enjoignait le Premier ministre à former « un nouveau gouvernement dans le cadre des règles démocratiques, gouvernement fort et fiable qui serait capable de trouver une solution pour remédier au contexte anarchique manifeste et de réaliser les réformes prévues par la Constitution en respectant la vision kémaliste et les principes de la révolution turque » . Cette déclaration entraîna la démission du gouvernement Demirel. L’événement fut salué par l’élite kémaliste et par certains mouvements de gauche au nom de l’« anti-impérialisme » .Un nouveau gouvernement (composé de technocrates) fut nommé : il était dirigé par le professeur de droit Nihat Erim (ex-député du CHP) .Le nouveau Premier ministre annonça clairement ses intentions en déclarant : « Nous leur tomberons dessus comme une massue. » L’on assista à l’établissement de tribunaux militaires, à la proclamation de l’état de siège, à la censure de la presse et à l’interdiction des manifestations. Des modifications constitutionnelles eurent également lieu, qui restreignirent les libertés individuelles. L’un des militaires putschistes alla même jusqu’à décrire la Constitution de 1961 comme étant « trop large pour le peuple turc ». Même si leur parti avait été dissous, les militants islamistes n’ont pas été inquiétés par les autorités militaires . En fait, ceux qui étaient les plus nettement visés par la
répression étaient les activistes de gauche radicale et les militants pro-kurdes. Des milliers d’intellectuels et de syndicalistes furent arrêtés, et de nombreuses figures de la gauche radicale furent assassinées (comme Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, İbrahim Kaypakkaya et Mahir Çayan) . L’un des plus redoutables outils de la répression fut une structure secrète nommée « Contre-guérilla » : « Les documents de cette organisation, publiés à l’insu de leurs auteurs dans les années 1970-1980, montraient qu’elle considérait les violations des droits de l’homme, y compris, ‘’pillages, massacres et viols’’, comme autant de moyens légitimes de la ‘’guerre psychologique’’.
En dépit de son autoritarisme, le régime militaire s’avéra vite instable : le 22 mai 1972, Ferit Melen remplaça Nihat Erim au poste de Premier ministre. Puis, ce fut Naim Talu qui (le 15 avril 1973) devint chef du gouvernement . Par ailleurs, l’armée ne parvint pas (durant l’automne 1972) à imposer au parlement la candidature du général Memduh Tağmaç à la présidence de la République .En acceptant l’organisation d’élections libres pour octobre 1973, le gouvernement mit fin à l’intervalle militaire consécutif à l’ultimatum du 12 mars.
|
Table des matières
Introduction
Première partie : Aux origines du système partisan turc
I / Les quatre clivages structurants
A ) Nature et causes de la « critical juncture » turque
B ) Le clivage « musulmans stricts »/« musulmans pluralistes »
C ) Le clivage « centre »/« périphérie »
D ) Le clivage « modernistes »/« traditionnalistes »
E ) Le clivage « démocrates »/« autoritaires »
F ) La décennie Menderes (1950-1960)
II / Le multipartisme turc après 1960
A ) L’interlude militaire de 1960-1961
B ) Le retour à la démocratie
C ) La montée des radicalités
D ) L’ultimatum du 12 mars 1971 et le régime militaire de 1971-1973
E ) Les élections législatives de 1973 et la coalition CHP-MSP
F ) Les deux gouvernements de « Front Nationaliste »
G ) La junte militaire de 1980-1983 et la « Synthèse turco-islamique »
H ) Les années ANAP (1983-1991)
I ) Le retour des gouvernements de coalitions
J ) Les élections législatives de 1999 et la coalition DSP-MHP (1999-2002)
Deuxième partie : L’AKP à l’épreuve du pouvoir
I / Bilan et orientations idéologiques
A ) Une satisfaction des électeurs sur les « enjeux consensuels »
B ) … mais également sur les « enjeux conflictuels »
II / Un parti s’appuyant sur une large base électorale
A ) L’AKP : une synthèse des droites turques
B ) Du rôle de l’idéologie dans le maintien au pouvoir de l’AKP
C ) L’AKP : un parti populiste et élitiste
D ) Aspects démographiques du succès électoral de l’AKP
E ) Du bon usage du clivage entre « autoritaires » et « démocrates »
F ) Une organisation interne efficace
Conclusion
Bibliographie
Annexes
Tableaux électoraux
Résultats des élections législatives de 1950 à 1957
Résultats des élections législatives de 1961 à 1977
Résultats des élections législatives de 1983 à 1999
Résultats des élections législatives de 2002 à 2011
Résultats provinciaux de l’élection présidentielle du 10 août 2014
Cartes
Provinces de Turquie
Implantations des trois candidats lors de l’élection présidentielle du 10 août 2014
Implantations de l’AKP, du CHP, du MHP et du BDP/HDP lors des élections locales du 30 mars 2014
Implantation de l’AKP lors des élections locales du 30 mars 2014
Implantation du CHP lors des élections locales du 30 mars 2014
Implantation du MHP lors des élections locales du 30 mars 2014
Implantation du BDP/HDP lors des élections locales du 30 mars 2014
Indices de développement humain en Turquie (taux provinciaux)
Eléments d’iconographie
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet