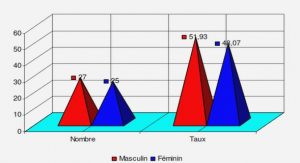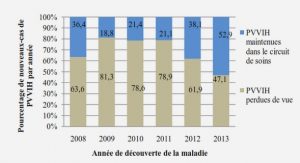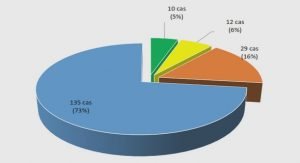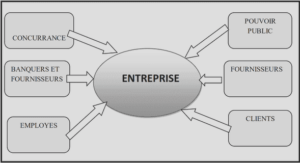Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
LA VILLE D’ANTSIRABE
La géologie
ÉTUDES SOCIO-ÉCONOMIQUES
|
Table des matières
PARTIE 1 : ETUDES DE FAISABILITE
CHAPITRE 1. APERÇU GÉNÉRAL
I. LA REGION DU VAKINANKARATRA
II. LA VILLE D’ANTSIRABE
III. LE MILIEU PHYSIQUE
III.1 Le relief
III.2 La géologie
III.3 Le climat
III.3.1 La température
III.3.2 La pluviométrie
III.4 L’hydrologie
III.5 Sols et végétation
III.5.1 La végétation
III.5.2 Les sols
CHAPITRE 2. ÉTUDES SOCIO-ÉCONOMIQUES
I. ÉTUDES SOCIOLOGIQUES
I.1 Population et démographie
I.1.1 Nombre de population
I.1.2 Évolution de la population
I.1.3 Taille des ménages
I.1.4 Mouvement migratoire
a. A l’intérieur de la région
b. A l’extérieur de la région
I.2 Santé
I.3 Enseignement et éducation
II. ÉTUDES ÉCONOMIQUES
II.1 Agriculture
II.2 Élevage
II.2.1 Élevage bovin
II.2.2 Élevage porcin
II.2.3 Élevage de volailles
II.2.4 La sériciculture
II.2.5 Élevage d’autruche
II.3 Tourisme
II.4 Industrie et artisanat
II.4.1 Exploitation du sol
II.4.2 Métallurgie légère
II.4.3 Secteur bâtiment
II.4.4 Travail du bois et annexes
II.4.5 La branche textile
II.4.6 L’agro alimentaire
II.4.7 Les huileries et savonneries
II.5 Transport et commerce
II.5.1 Transport
a. Routes
b. Coûts du transport
c. Trafic aérien
d. Trafic ferroviaire
II.5.2 Commerce
III. ÉTUDES DU CONTEXTE URBAIN
III.1 Les locaux à usage d’habitation
III.2 Les locaux à usage commercial
III.3 Les locaux à usage de bureaux
III.4 Les demandes immobilières
III.5 Statistiques de la production immobilière
CHAPITRE 3. ANALYSE DE LA SITUATION ET JUSTIFICATION DU PROJET
I. ANALYSE DE LA SITUATION
I.1 Cadres socio-économiques
I.2 Analyse de la situation immobilière
II. JUSTIFICATION DU PROJET
PARTIE 2: ETUDES ARCHITECTURALES
CHAPITRE 1. DESCRIPTIONS GENERALES DU BATIMENT
I. LE LIEU D’EMPLACEMENT DE L’OUVRAGE
II. L’ORIENTATION ET L’ASPECT EXTERIEUR DE L’IMMEUBLE
II.1 L’orientation
II.2 L’aspect extérieur
II.2.1 Du côté de la façade principale
II.2.2 Du côté de la façade postérieure
II.2.3 La toiture
II.2.4 L’aménagement extérieur
III. L’AMENAGEMENT INTERIEUR
III.1 Le rez-de-chaussée
III.2 L’étage
III.3 L’appartement
IV. LES ELEMENTS STRUCTURELS DU BATIMENT
IV.1 Choix de l’ossature
IV.2 Les murs
IV.3 Les ouvertures
IV.3.1 Les fenêtres
IV.3.2 Les portes
IV.4 Les revêtements
IV.5 La peinture
IV.6 La toiture
IV.7 L’assainissement
CHAPITRE 2. CONFORT ET SECURITE DU BATIMENT
I. LE CONFORT
I.1 L’isolation acoustique
I.1.1 Généralités
I.1.2 Choix des matériaux à utiliser
a. Les murs
b. Les cloisons
I.2 L’isolation thermique
I.3 La pureté de l’air
I.4 L’éclairage
I.4.1 L’éclairage naturel
I.4.2 L’éclairage artificiel
I.5 La circulation
I.5.1 La circulation horizontale
I.5.2 La circulation verticale
I.6 Les gaines
II. LA SECURITE
PARTIE 3 : ETUDES TECHNIQUES
CHAPITRE 1. PREDIMENSIONNEMENT
I. PLANCHER
II. POUTRE
II.1 La hauteur
II.2 La base
III. POTEAUX
III.1 Poteaux à section rectangulaire
III.2 Poteaux à section circulaire
CHAPITRE 2. LA DESCENTE DES CHARGES
I. INVENTAIRE DES CHARGES
I.1 Les charges permanentes
I.2 Les charges d’exploitation
II. CALCUL PRATIQUE DE LA DESCENTE DES CHARGES
II.1 Calcul des charges verticales
II.2 Calcul des charges dues aux effets du vent
II.3 Détermination du centre de gravité de l’ensemble
II.3.1 Détermination du moment d’inertie
II.3.2 Les moments à équilibrer dans les poteaux
II.4 Récapitulation des résultats obtenus
CHAPITRE 3. LES EFFETS DU VENT
I. LES HYPOTHESES DE CALCUL
II. LES CARACTERISTIQUES DU BATIMENT
II.1 Les dimensions
h La situation géographique
h Le coefficient de perméabilité µ
h Calcul du rapport de dimension λ
III. LES ACTIONS DU VENT
III.1 Détermination du coefficient
III.2 Les actions extérieures
III.3 Les actions intérieures Ci
III.4 La combinaison d’action Ce − Ci
IV. LA PRESSION DYNAMIQUE DE BASE qb
V. LA PRESSION DE BASE DE CALCUL
V.1 L’effet de dimension δ
V.2 L’effet de masque Cm
V.3 L’effet du site
V.4 L’effet de hauteur
VI. LES ACTIONS DYNAMIQUES EXERCEES PAR LE VENT
VI.1 Les actions parallèles à la direction du vent
VI.2 Les actions perpendiculaires à la direction du vent
CHAPITRE 4. ETUDES DE LA SUPERSTRUCTURE
I. CALCUL DES STRUCTURES
I.1 Choix de la méthode à utiliser
I.2 Application de la méthode
I.2.1 Évaluation des charges
a. Charges verticales sur les poutres
a.1 Charges permanentes
a.2 Surcharges d’exploitation
b. Charges horizontales sur les poteaux
I.2.2 Réalisation des calculs
I.2.3 Récapitulation des résultats
II. CALCUL DES POUTRES
II.1 Hypothèses de calcul
II.1.1 Hypothèses générales
II.1.2 Caractéristiques des matériaux
a. Le béton
b. L’acier
II.1.3 Définitions des données nécessaires
II.2 Dimensionnement des armatures longitudinales
II.2.1 Armatures en travée
II.2.2 Armatures aux appuis
II.3 Vérification à l’E.L.S
II.4 Vérification de la flèche
II.5 Vérification des conditions d’appuis
II.5.1 Vérification au niveau des appuis de rive
a. Vérification du béton d’âme
b. Vérification de la compression du béton
c. Vérification des armatures longitudinales
II.5.2 Vérification au niveau des appuis intermédiaires
a. Vérification du béton d’âme
b. Vérification de la compression du béton
c. Vérification des armatures longitudinales
II.6 Dimensionnement des armatures transversales
II.6.1 Choix du diamètre
II.6.2 Détermination de l’espacement
II.6.3 Répartition des armatures transversales
II.7 Adhérence acier – béton
II.7.1 Ancrage des armatures aux appuis
II.7.2 Vérification de l’entraînement des armatures
III. CALCUL DES POTEAUX
III.1 Étude des poteaux à section rectangulaire
III.1.1 La longueur de flambement et l’élancement
a. La longueur de flambement
b. L’élancement
III.1.2 L’excentricité
III.1.3 Détermination de l’état de la section
III.1.4 Dimensionnement des sections partiellement comprimées
III.1.5 Vérification à l’E.L.S. des sections partiellement comprimées
III.1.6 Vérification de la section entièrement comprimée
III.1.7 Détermination des armatures transversales
a. Le diamètre
b. L’espacement
III.2 Étude des poteaux à section circulaire
III.2.1 Caractéristiques des matériaux
a. Le béton
b. L’acier
III.2.2 Dimensionnement des sections d’armatures longitudinales
III.2.3 Vérification à l’E.L.S.
a. Détermination de l’état de la section
b. Vérification des sections entièrement comprimées
c. Vérification de la section partiellement comprimée
III.2.4 Détermination des aciers transversaux
a. Le diamètre
b. L’espacement
IV. LE PLANCHER
IV.1 Hypothèses et méthode de calcul
IV.2 Principes de calcul
IV.3 Expression des efforts
IV.3.1 Moment fléchissant
IV.3.2 Efforts tranchants
IV.4 Calcul pratique des armatures des poutrelles
IV.4.1 Évaluation des charges
a. Calcul du poids propre g
b. Combinaisons des charges :
IV.4.2 Les résultats
IV.4.3 Calcul d’armatures
a. Caractéristiques des matériaux
a.1 Le béton
a.2 L’acier
b. Hypothèses
c. L’organigramme de calcul
d. Les sections des armatures longitudinales
e. Les sections des armatures au niveau des appuis
IV.4.4 Vérifications au niveau des appuis
a. Appui simple d’about
a.1 Vérification concernant la compression du béton
a.2 Vérification concernant les armatures inférieures
b. Appuis intermédiaires
b.1 Vérification concernant la compression du béton
b.2 Vérification concernant les armatures longitudinales
IV.4.5 Calcul des armatures transversales
a. Vérification de la contrainte de cisaillement du béton
b. Dimensionnement de sections des aciers
c. Calcul de l’espacement entre les armatures transversales
d. Répartition des armatures transversales
V. L’ ESCALIER
V.1 Généralités
V.2 Modélisation de la structure
V.3 Détermination des charges
V.3.1 Calcul de q2
V.3.2 Calcul de q1
V.4 Détermination des sollicitations
V.4.1 Expressions des sollicitations
V.4.2 Les résultats des calculs
V.5 Calcul des sections d’armatures
V.5.1 Caractéristiques des matériaux
a. Le béton
b. L’acier
V.5.2 Calcul des armatures longitudinales
a. Calcul pratique des sections d’armatures
b. Vérification de la condition de non fragilité
c. Vérification à l’E.L.S
d. Calcul des armatures de répartition
VI. CALCUL DES ÉLEMENTS DE LA TOITURE
VI.1 Généralités
VI.2 Vérification des pannes
VI.2.1 Vérification suivant le cas de charge n°1
a. Modélisation de la structure
b. Évaluation des charges
c. Calcul pratique de la contrainte
VI.2.2 Vérification suivant le cas de charge n°2 et n°3
a. Modélisation de la structure
b. Calcul des contraintes
VI.3 Vérification de la tôle
VI.4 Dimensionnement de l’acrotère
VI.4.1 Évaluation des charges
VI.4.2 Détermination des sollicitations
VI.4.3 Détermination des sections d’armatures
a. Calcul des sections d’aciers
b. Vérification à l’E.L.S.
c. Détermination des sections d’armatures du voile vertical
CHAPITRE 5. ETUDES DE L’INFRASTRUCTURE
I. GENERALITES
II. DONNEES RELATIVES AU TERRAIN
III. CHOIX DU TYPE DE FONDATION
IV. ÉTUDE DE LA FONDATION
IV.1 Détermination des sollicitations
IV.2 Prédimensionnement de la semelle filante
IV.2.1 Détermination de la section
IV.2.2 Vérification de la contrainte
IV.3 Détermination des armatures longitudinales
IV.3.1 Calcul des sollicitations maximales
a. Modélisation de la semelle
b. Calcul des sollicitations
IV.3.2 Calcul des sections d’armatures longitudinales
IV.3.3 Vérification de la contrainte tangente
IV.4 Détermination des armatures transversales
IV.4.1 Choix du diamètre φt
IV.4.2 Calcul de l’espacement
IV.5 Détermination des armatures de peau de la longrine
IV.6 Dimensionnement de la semelle proprement dite
IV.7 Vérification du tassement
IV.8 Dimensionnement des longrines de liaison
IV.8.1 Calcul des moments à équilibrer
IV.8.2 Détermination des sections d’armatures
a. Calcul des sollicitations
b. Calcul des sections d’armatures
IV.8.3 Vérification à l’E.L.S.
IV.8.4 Vérification de la flèche
a. Évaluation de la flèche
b. Évaluation de la flèche admissible
IV.8.5 Dimensionnement des armatures transversales
a. Choix du diamètre
b. Détermination de l’espacement
CHAPITRE 6. ETUDES DU SECOND ŒUVRE
I. PROJET D’ECLAIRAGE
I.1 Les paramètres
I.1.1 Le facteur de dépréciation d
I.1.2 Le facteur d’utilance U
a. L’indice du local k
b. Le facteur de réflexion des parois
c. L’indice de suspension J
d. La classe des luminaires
d.1 Le système de répartition lumineuse
d.2 La répartition
I.1.3 Le rendement η
I.1.4 L’éclairement E
I.1.5 Le flux lumineux total F
I.2 Dimensionnement pratique des luminaires
I.2.1 Calcul du flux total
I.2.2 Implantation des luminaires
I.2.3 Le flux lumineux par source
II. L’ALIMENTATION EN EAU
II.1 Les canalisations primaires
II.1.1 Les débits de base Qb
II.1.2 Détermination des sections des conduites φ
II.1.3 Calcul des débits probables Qp
II.2 Les canalisations secondaires
III. L’ASSAINISSEMENT
III.1 Évacuation des eaux pluviales
III.1.1 Dimensionnement des sections des descentes des eaux pluviales
III.1.2 Les regards
III.2 Évacuation des eaux usées
III.2.1 Les siphons
III.2.2 Les collecteurs d’appareils
III.2.3 Détermination des conduites de chute
III.3 Évacuation des eaux vannes
III.3.1 Diamètre des conduites des eaux vannes
III.3.2 Dimensionnement de la fosse septique
a. Dimensionnement de chaque compartiment
b. Dimensionnement de l’élément épurateur
PARTIE 4 : ETUDES FINANCIERES
CHAPITRE 1. DEVIS DESCRIPTIF
CHAPITRE 2. DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
I. CALCUL DU COEFFICIENT DE DÉBOURSÉ k
II. LES SOUS DÉTAILS DES PRIX
III. LE BORDEREAU DES DÉTAILS ESTIMATIFS (B.D.E.)
PARTIE 5 : INFORMATISATION
I. GENERALITES
II. REALISATION
II.1 Outil de programmation
II.2 Présentation de la calculette
CONCLUSION
Télécharger le rapport complet