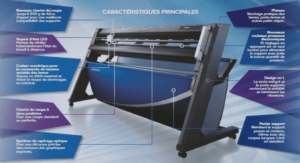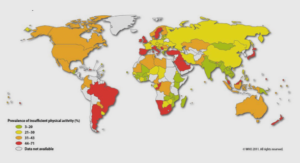Méthode de recherche
Ces objets uniques sont traités de la manière suivante
Dans un premier temps, nous avons recherché ces longforms et leurs conditions d’élaboration. Ainsi, nous nous sommes livrés à une phase de veille et de recherche, afin de trouver les objets les plus uniques, les plus poussés, et les plus propices à faire ressortir des points importants de leur comparaison.
Les longformsqui conjuguaient les plus de médias ont été privilégiés. La plupart du temps, son, animation, vidéos, photographies, dessins sont conjugués. Cette phase a permis de se familiariser avec l’objet et le champ d’étude grâce à un recensement et un benchmark. Il nous a permis de constater la rareté de ces objets, ainsi que leur caractèreprécieux, unique, et la diversité de choix et de techniques qui peut-être fait, dans la narration principalement.
Ensuite, nous sommes passés à une phase d’étude: chaque longforma été étudié selon une grille, et reporté dans un tableau, afin d’en comprendre les différences et les similitudes par l’exercice de la confrontation, qui nous permet de faire ressortir les grandes lignes, les grandes tendances et les grands courants. Ont été analysés la disposition sur la page, l’utilisation de chaque média séparément, la place accordée à chacun, leur articulation, la proéminence d’un média sur l’autre, les atouts et les limites. Grâce à cette confrontation, nous avons pu établir un plan des similarités et des différences entre les différents objets, et également déterminer ce qui fonctionnait à nos yeux ou non. Et la diversité des techniques de narration combinées possibles.
Nous nous sommes ensuite livrés à une phase d’entretien. Nous avons mené la plupart du temps des demandes fructueuses, et des entretiens intéressants, mais malheureusement parfois courts, car certaines de ces longformsdatent de plusieurs années, et ceux qui les ont imaginés très demandés. Malheureusement, certaines de mes demandes d’entretien sont restées sans réponse, ce qui ne m’a pas permis de mener une enquête orale confrontant les pensées de tous les créateurs de ces longforms. Afin de mieux les comprendre, il semblait très important de parler aux concepteurs de ces longforms, afin de mieux comprendre les enjeux, leurs volontés et leurs ambitions.
Ensuite, nous nous sommes livrés à l’analyse des discours sur ces longforms. Nous avons recherchés ce qu’en dit la presse et les médias spécialisés, maisaussi les internautes qui laissent des commentaires. Ainsi, nous avons pu confronter les avis des professionnels comme desanonymes, et ainsi se poser la question de la réception, après s’être demandé comment ils avaient été conçus. La réception étant au coeur des enjeux, il semblait normal que nous nous intéressions à ce sujet, car ces objets ont été pensés à destination de quelqu’un, un lecteur, un récepteur. Evaluer la qualité et la valeur d’un longform, c’est donc réfléchir et s’intéresser à son efficacité auprès d’un public.
Enfin, après de nombreuses lectures sur les rapports entre texte, image, écran, mais aussi sur le contexte, la narration, et les médias en lignes, nous avons engagé une réflexion théorique sur les objets étudiés. Cela nous a permis de conceptualiser des intuitions, et d’ancrer notre réflexion très spécifique dans un contexte, en le reliant à plusieurs domaines d’études universitaires, et à des discours de spécialistes.
Ces longformsapparaissent comme particulièrement riches, et chaque grande partie de notre travail cherchera à montrer un discours que délivrent ces articles sur les récits multimédia d’aujourd’hui.
Nous étudierons dans la première partie comment le récit de l’histoire qui a motivé le longform a été créé, organisé. Par ailleurs, nous nous interrogerons sur les media utilisés, et la valeur qui leur a été accordée. Bien que ces articles s’ancrent dans une tradition très forte, nous tâcherons de montrer que ces longforms permettent de créer de nouvelles formes de récits multimédia, et ainsi de faire émerger une nouvelle conception de l’illustration.
Nous verrons ensuite comment le fond de ces articles et la forme qu’ils prennent sont à la recherche d’une adéquation l’un avec l’autre, afin de créer de nouvelles formes. Nous étudierons comment le média et la technique affleurent et déterminent ces longforms, et construisent un récit commun.
Enfin, nous étudierons dans la troisième partie comment la technique prend le pas sur l’histoire racontée en faisant apparaître, en filigrane, des gestes politiques qui transforment le récit, et vont jusqu’à lui faire prendre une forme de storytelling.
Le longformmultimédia : l’illustration réinventée?
Depuis l’antiquité, l’oeuvre est régie par des règles qui régissent les rapports entre les différents arts, aussi appelés media: le dessin qui accompagne le texte ne doit pas être tout puissant, mais soumis au dessein du livre entier. L’usage des figures, que la rhétorique nomme «! enargeia! » ou «! evidentia! », est nécessairement subordonnée à l’objectif global de l’orateur ou du poète, au choix cohérent des matériaux du livre. Le livre ne peux ni se prêter à l’hétéroclite ni céder au manque d’unité, au risque d’apparaître comme monstrueux . Toutefois, dans l’art du livre, c’est à la fin du XIXème siècle, grâce à des conditions technologiques et culturelles, que tout change. Il devient impossible de penser la profusion des images en termes d’union ou de fusion avec le texte.
C’est l’entrelacement, l’interpénétration, ou l’immixtion qui seraient plutôt les termes adéquats. Les conséquences poétiques sont nombreuses, et les règles sont bouleversées. S’opère unerébellion de l’image, qui entend soudain passer au premier plan et soumettre le texte à sa loi . Ainsi, le montage d’images sur une même page, qu’elle soit papier ou web, résulte d’une longue tradition, et la toute puissance qu’elle peut acquérir face au texte est un sujet de questionnement depuis plus d’un siècle.
Le questionnement et les réflexions d’Evanghélia Stead, chercheuse spécialisée dans le livre fin-de-siècle à l’Université de Versailles- Saint Quentin en Yvelines, s’ancrent dans un contexte culturel bien précis. Si la question de l’intermédialité pose problème aux historiens et aux artistes depuis l’invention de la perspective, et l’édiction de ses règles par Albertià la Renaissance, sa place au sein du débat n’a fait que grandir au fil des époques. Le paroxysme de cette fusion, ou con fusion entre les arts, comme le souligne l’ouvrage de Stead, a lieu à la fin du XIXème siècle, sous l’influence d’artistes qui ont changé le visage de l’art, tel que Richard Wagner , dont le travail sur l’usage de tous les arts à la fois a permis de faire tomber les limites du champ d’action de chacun.
Cette expérience multimédia existe en théorie dès le grand essor de la presse et du journalisme, au milieu du XIXème siècle. L’utopie d’utiliser les arts, et donc les médias tous sensibles dans le but d’un récit a été dès le départ très lié au désir de récit journalistique. Historiquement, il est intéressant de noter que l’enregistrement d’une interview d’Eugène Chevreul par Nadar marque un tournant a bien des égards: il s’agit du premier reportage photographique dans la presse, du premier enregistrement d’une interview de voix, et de la première impression tramée sur du papier dans la presse. Ainsi, dès l’essor historique du journalisme, le son, l’image, et l’écrit ont été enregistrés conjointement, dans une sorte de récit total, sans que les conditions techniques ne permettent d’exploiter complètement cette possibilité, cette utopie.
Michel Melot a observé l’évolution de l’illustration photographique des grands reportages à travers les âges, et a déterminé qu’après la deuxième guerre mondiale, la photographie n’est «! plus seulement témoignage concret d’un événement sensationnel, elle peut aussi résumer une situation dans une synthèse ténue et profonde, arrachée à l’éphémère, qui fait de l’image banalisée le contraire d’un spectacle ordinaire. Il y a de l’ordre à mettre, du sens à saisir dans le foisonnement des faits photographiantes: le reporter se charge de cette mission.!» . Mais il note également que les images en mouvement ont également été liées, dès la naissance du cinéma, aux récits journalistiques, avec les actualités au cinéma. C’est l’image ponctuelle, et brute, qui trouve sur les écrans son domaine de prédilection. Le dessin n’est pas en reste puisque délestée de la nécessité d’être sensationnel, il se fait image symbolique, à travers laquelle c’est au lecteur de trouver un sens, une vision du monde .
Inventer un nouveau storytelling multimédia : un équilibre précaire entre le texte et son illustration
S’il s’agit pour lui uniquement d’histoires vraies, de non fiction, le journalisme se pose aussi cette même question: comment raconter de la meilleure manière possible une histoire, en accord avec le médium utilisé, tout en utilisant toutes les ressources techniques qu’il a à disposition? Il faut raconter d’une manière adaptée au support, et au public. À travers les différentes étapes de l’histoire du journalisme, tous les media ont su trouver leur place, et inventer une manière de créer leur propre récit journalistique, parfois même jusqu’à devenir média. En général, chaque média correspond à un medium, c’est à dire un canal par lequel exprimer son art de la meilleure manière possible: le dessin, la sculpture, le son, l’écrit, etc. C’est ainsi que chacun trouve le mode d’expression qui lui correspond le mieux.
De nos jours, la donne a changé. Grâce au web et à la technologie, le récitjournalistique peut devenir multimédia c’est à dire utiliser les ressources de chaque média sur un même support.
Les expérimentations de cette multiplicité de médias, et donc de media, dans un seul et même récit fleurissent. Avec l’arrivée du web, il s’agit de réinventer la grammaire de l’article illustré. Et même de poser la question suivante: quel media peut revêtir le statut d’illustration?
Des oeuvres hybrides
Chaque longformque nous avons sélectionné semble faire appel à différents media, autres que l’écrit. Sur l’écran de l’ordinateur, l’oeuvre journalistique nous apparaît hybride, comme une chimère à la fois linguistique et plastique: les limites de chaque medium sont brouillées, et l’oeuvre finale emprunte des petits morceaux de la grammaire de chaque moyen d’expression.
Pour commencer, sur l’écran, la lettre tout comme l’image sont composées de pixels. Le pixel, c’est «! l’unité de base permettant de mesurer la définition d’une image numérique matricielle. Son nom provient de la locution anglaise picture element, qui signifie « élément d’image » . Pour la première fois, le texte, composé de lettres, et l’image sont soumis au même régime d’apparition, luminescent et dynamique: tous deux sont numérisés et recomposés au seul profitde l’oeil . Les traditionnelles deux soeurs ennemies sont donc remises sur un pied d’égalité grâce à la technologie.
Plus encore, c’est grâce à internet que tous les médiums semblent enfin être réconciliés. Son, image, texte, cinémagraphe, tous apparaissent grâce à une seule et même innovation technique: le signal électrique, qui fait tout apparaître ensemble sur l’écran et dans l’ordinateur, sans hiérarchiser les moyens d’expressions, comme pouvaient le faire les théories traditionnelles et les règles édictées au préalable. Il s’agit donc de construire une nouvelle donne pour l’illustration.
La première chose que l’on peut constater en observant l’intermédialité de ces longforms, c’est qu’il n’y a pas de règle: chaque longformutilise les media qu’il souhaite sans contrainte de choix ou de préséance d’un médium sur l’autre. Le choix de chaque media et l’importance qui lui est accordée dépend donc de l’histoire racontée, des désirs des journalistes et des directeurs artistiques, ainsi que de la ligne éditoriale du média qui édite l’article.
Une utilisation des médias chaque fois différente: un espace d’expérimentation
Bien que chaque longform utilise des langages issus de médias différents, on peut même aller jusqu’à dire que l’utilisation et la valeur de chaque media varie selon l’article. «! Machines for life! » observe une construction plutôt classique, mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit du plus anciens de nos longforms, puisqu’il a été publié en 2013. Le texte est plus important, c’est lui qui raconte l’histoire et retranscrit le portrait et les interviews. L’image, bien que très travaillée, y est un support esthétique du texte, tout en éclairant un angle bien précis de l’article: la peinture d’une esthétique et d’un genre musicale robotique, analogique pour être vraiment précis, par le groupe. C’est cet aspect, ainsi que l’esthétisme travaillé du duo dansleur musique comme dans leurs apparitions qui est mis en avant. Les photographies ainsi que les cinémographes sont issus d’un même photoshoot, par le photographe Nabil, ce qui témoigne d’une construction esthétique de l’article dès le départ, en accord avec le ton et la direction donnée aux entretiens et au portrait, et plus encore au titre, qui annonce déjà la couleur. L’image fait preuve, en montrant visuellement ce que le texte avance, et on peut observer que les exergues apparaissant en code binaire avant de se révéler au lecteur ont la même fonction.
Le longformde Highline, bien que très audacieux dans son introduction, montre aussi une claire dichotomie entre le texte, qui raconte l’histoire, et l’illustration, rôle assumé par tous les autres médias présent en son sein. Le texte est le plus fort, et racontel’histoire. Les images ont une autre fonction: montrer des réalités et des ambiances, de manière plus concrète, afin que le lecteur se rende compte de ce qu’il se passe en visualisant le récit au plus juste. Elles permettent de s’ancrer dans une réalité, de s’immerger, plus encore quand les images s’animent. On pourrait avancer que les vidéos, qui se différencient des images en mouvement du fait qu’elles sont beaucoup plus longues, ont encore un autre rôle, qui serait le même que celui de la data. Elles ne montrent pas seulement, elles donnent à comprendre car elles sont construites en mouvement. Il s’agit pour le lecteur d’aller au delà de voir, de mettre sa pensée en mouvement de la même manière que les images se sont animées. Mais il semblerait même que dans la narration, les images animées, contrairement aux images statiques qui peuvent apparaître comme assez froides, prennent un rôle dans cette narration conjointe qui traditionnellement aurait pu être considérée comme l’apanage du texte, qui est de procurer de l’émotion, de manière saisissante, comme les animations de sable du début, et donc d’aller au delà de la simple délivrance de l’information.
Dans le longformdu New York Timesconsacré au rock féministe aux Etats-Unis, ce n’est pas le texte qui raconte l’histoire, mais le son, illustré d’images, qui ont différents aspects. Elles peuvent tout d’abord servir à créer une ambiance, à ouvrir une porte vers un univers qui est celui de l’univers de la chanteuse où du groupe qui parle. Sous ce régime, les vidéos qui succèdent à la musique et aux images prennent des allures de citations non écrites, en son et images mêlées: il s’agit d’extraits de dialogues filmés particulièrement parlant ou révélateurs lors de l’interview.
Ainsi, les frontières entre le texte, le son, l’image, la vidéo sont complètement brouillés. C’est quand les mots prononcés lors de cette table ronde résonnent ou bien se répondent les uns aux autres, termes qui pourraient présupposer l’utilisation du son pour les transmettre, les citations apparaissent pourtant écrites. S’agit-il d’un souci de clarté? Ou bien il pourrait peut être aussi s’agir de donner un statut au texte qui est autre que celui de légende, auquel il est relégué le long de l’article: c’est d’écrire ce qui est important de la manière la plus claire et efficace possible. Il s’agit donc dans ce longformdu médium de la fidélité à la vérité, aux paroles dites, ainsi que du médium de la clarté et de l’efficacité sans fioritures ni agréments, comme en témoigne l’écran noir sur lequel il apparaît. Enfin, les images peuvent revêtir un aspect assez subversif en délivrant un véritable discours sans paroles, l’air de rien, alors qu’il ne s’agit que d’images d’arrière plan. Les images d’ambiance deviennent alors manifestes subversifs, l’air de rien, et sont alors le medium de la revendication et du souterrain, propre aux mouvements féministes sont il est question dans le papier.
La tradition mutlimédia des récits journalistiques
Au delà de l’utilisation d’un médium en particulier, il est important de noter que tous empruntent des éléments au récit journalistique traditionnellement lié aux différents médias. Ils se placent ainsi dans la lignée de récits journalistiques issus de différents supports, radiophoniques, écrits, télévisuels, photoreportages, etc.
Il ne faut pas oublier que dans les structures étudiées, c’est la figure du journaliste qui a la primauté. Son médium sera ainsi mis en valeur par rapport aux autres, reléguant parfois les autres médias à un rôle moins important. Ainsi, selon les capacités du journaliste et la place accordée au concepteur et au webdesigner, la place d’un médium face à un autre peu changer, et reflète une entreprise et ses valeurs, ainsi qu’une ligne éditoriale, une hiérarchie et des personnalités.
Mais n’oublions pas à nouveau de souligner que chacun de ces objets est une expérimentation unique. Chaque longformreprend les codes d’un médium, qui lui sont spécifiques, et aucun de nos récits ne se ressemblent, dans leur forme comme dans leur fond. Chaque longform utilise chaque médium à sa manière, afin de mettre en valeur une histoire qui leur est propre. Il s’agit ici de trouver une nouvelle manière de raconter les histoires en ligne. Lors de notre entretien avec l’équipe de L’Equipe Explore, Aurélien Delfosse déclarait: «! Il faut maintenant créer une culture du web! » . Ce qui passe d’abord pas le fait re raconter des histoires en ligne, mais également de trouver un mode de narration qui corresponde aux usages des lecteurs. Il s’agit donc d’une co-construction d’une nouvelle forme de narration, entre les concepteurs, c’est à dire les journalistes et les directeurs artistiques, et le lecteur, récepteur de l’histoire, qu’ils prennent en compte et qui les influencent.
Ainsi, chaque cas diffère. Les longforms utilisent les média dont ils ont besoin pour raconter leur histoire, et l’utilisation varie en fonction de l’histoire racontée. Ces longforms utilisent donc des techniques préalablement inventées, pour créer un récit qui leur est propre. Il n’y a donc pas de règle, et chaque longform adopte la forme qui lui convient le mieux en fonction de son histoire, mais aussi de son Histoire avec un grand H, qui est aussi l’histoire de son média, en intégrant les média qui sont nécessaires, et classe l’importance de chaque «! art! » selon l’histoire qu’il a à raconter.
Ces longformssont des oeuvres hybrides. Chacun d’entre eux utilise un grand nombre de media, créant parfois des associations insolites, qui sortent de l’ordinaire et de la tradition de l’illustration. C’est le fait du média web, qui délivre l’illustration de ses carcans théoriques habituels. Grâce à elle, le web crée ici de nouvelles formes de récit, sans que l’illustration et les différents media renient leur héritage. Le fait que chaque longform adopte son propre monde de narration et sa propre utilisation des différents media fait que les frontières traditionnelles sont brouillées, ce qui est aussi le fait du support. Si les rapports traditionnelsentre les différents médias sont modifiés, on observe la naissance de nouvelles valeurs, et de nouvelles manières de raconter.
Le storytellingmultimédia : un lecteur immergé dans le récit?
Mais pourquoi cette volonté d’allier tous les arts? Afin d’en mettre plein la vue au lecteur?
Et certainement de toucher tous ses sens afin qu’il soit pris dans l’histoire jusqu’au bout, et intensément. Comme en témoignent nos entretiens et nos observations, le lecteur est important dans la construction de ces longforms, et la réflexion sur comment l’engager et mobiliser son attention est très présente.
Le lecteur participe activement à la création du longform
Tout d’abord, les longforms sont pensés de telle manière qu’ils ne peuvent exister sans l’intervention du lecteur. Contrairement au livre, la page change en fonction des actions du lecteur. Ici, il doit scroller, ou swiper, selon les modes d’affichage choisis par les concepteurs du longform. C’est le lecteur qui fait apparaître l’article, et sa fonction est donc capitale: sans lecteur, pas d’article.
Les articles auxquels nous sommes confrontés utilisent deux modes d’affichage et de défilement différents: le scroll (la page défile verticalement) et le swipe (la page défile horizontalement). Ces deux modes de défilement sont les premières manifestations du geste narratif présent sur la page, car ils permettent d’engager le récit. Le scrollytelling et le swipytelling sont deux modes de narrations adaptés à l’écran, tous les deux très inclusifs et immersifs à l’égard du lecteur, grâce à différents outils, et apparaissent comme deux formes de narration interactive.
Comme l’explique Benjamin Hoguet
La narration interactive est l’art de raconter des histoires qui incorporent des formes d’interactions technologiques, sociales ou collaboratives pour proposer des contenus adaptés aux nouveaux modes de consommation du public!
Le scrollytelling et le swipytelling en sont deux manifestations. Tout d’abord, le scrollytellingutilise une nouvelle manière de raconter les histoires en ligne, déjà citée plus haut: le parallax scrolling. C’est l’action de la souris qui fait apparaître les différentes parties du texte, les chapitres et différents enrichissements. C’est un nouveau dispositif de navigation qui apparaît, avec de nouveaux éléments de lecture qui émerge sur la page à mesure qu’on scroll, tout en apportant une dimension esthétique. Dans ce procédé, l’immersion est efficace, bien que les mouvements du lecteur soient très limités par les concepteurs du longform. La plupart du temps, quand le longform est techniquement réussi, scrollerest le seul geste requis par l’internaute, qui n’a donc pas à lancer les vidéos etc. Grâce aux scrollytelling, les enrichissements multimédia s’ancrent de manière harmonieuse dans le récit. Bien qu’il apporte une dimension esthétique, ce sont les contenus qui priment: la parallaxe ne permet que de rendre un récit plus complexe et fouillée, tout en l’agrémentant d’une expérience ludique, donnant ainsi à la lecture sérieuse une valeur de divertissement. C’est un dispositif léger qui remet le temps de la lecture au goût du jour, et qui permet de générer une audience supplémentaire en agrémentant un article d’une nouvelle raison de le lire. C’est l’utilisateur qui compose son récit, en fonction de ses clics.
Un récit augmenté pour capter l’attention du lecteur
Plongé dans ce temps du récit, le lecteur se retrouve aussi plongé dans la réalité. L’image et les augmentations sont tant de moyens de plonger le lecteur dans la réalité, tout comme les formes de narration utilisées.
Comme le signale Benjamin Hoguet, l’interactivité est aujourd’hui une nouvelleproposition de valeur, liée à la transformation brutale des usages. Cela reste une bonne alternative de nos jours pour représenter le réel et engager un dialogue avec un public toujours plus sollicité et submergé de contenus. Il est nécessaire de changer la narration pour comprendre notre réalité: les nouveaux modes de narration interactive permettent de représenter la complexité du réel.
Car «! la froideur de l’écriture peut bien, parfois, paraître insupportable. La parole est présente, vivante. L’écriture apporte au grain de la parole une paille non négligeable: c’est la parole objectivée, immuable, reproductible et transportable. La conséquence de cette commodité que constitue la double réduction de la chose au son et du son à l’alphabet, c’est de nous priver de la réalité. Et la greffe si répandue des figures sur l’écriture pourrait bien y trouver sa première raison.!»
|
Table des matières
Remerciements
Note liminaire
Introduction
I. Le longform multimédia : l’illustration réinventée?
1) Inventer un nouveau récit multimédia : un équilibre précaire
Des oeuvres hybrides
Une utilisation des médias chaque fois différente: un espace d’expérimentation
La tradition multimédia des récits journalistiques
2) Un lecteur immergé dans le récit grâce aux augmentations du texte
Le lecteur participe activement à la création du longform
Un récit augmenté pour capter l’attention du lecteur
Une interactivité qui laisse place à l’histoire
3) La modernité, espace et temps de la réconciliation du texte et de ses augmentations
Le web: espace du multimédia
Décadence ou réconciliation?
Image et modernité sur l’écran
II. Récit en media, récit d’un média?
1) Une adéquation technique
Références et signes
Du fond ou de la forme, qui a la primauté?
Des oeuvres médiagéniques?
2) Une adéquation historique
Forme éditoriale et héritage
Écran et papier
Une réflexion sur le journalisme et son histoire
3) Création d’une nouvelle poétique
Des frictions désamorcées par la réflexivité du média
Écrits d’écrans et médiagénie
Pour une poétique de l’écran
III. Longforms multimédia et storytelling politique
1) Des dispositifs communicationnels
Tentative de définition
Des dispositifs particuliers
Une réception biaisée?
2) « Stories that matter »
Des histoires à fort pouvoir de séduction
Une dramatisation du récit
Du Pathos à l’Ethos
3) Un dispositif de contrôle?
Le webdesign, institueur de cadres
Une lutte pour le pouvoir?
Le dispositif wagnérien
Conclusion
Recommandations
Bibliographie thématique
Annexes
Objets d’étude analysés selon une grille commune
Entretien 1
Entretien 2
Entretien 3
Entretien 4
Etude de cas
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet