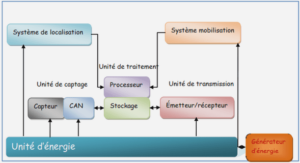Le territoire de Grenoble-Alpes Métropole avant et après la fusion
Un territoire administratif englobant une plus grande partie du système urbain grenoblois
La fusion entre les trois EPCI donna naissance à un nouveau territoire hétérogène. L’ancienne communauté d’agglomération grenobloise (celle des vingt-huit communes) était composée de vingt-quatre communes du « grand pôle » urbain (CGET, 2014). L’ancienne communauté de communes du Sud Grenoblois (vingt-et—une communes) en comptait seulement trois alors que la communauté de communes des Balcons Sud Chartreuse n’en comptait aucune. Les communes de ces deux anciens EPCI font majoritairement partie de la couronne périurbaine. Cet indicateur énonce un grand nombre d’autres éléments hétérogènes (dans ce cas métropolitain) : différence de densité, différence d’activités économiques, différence de paysages ect.
Un territoire s’ouvrant sur ses massifs
L’ancienne communauté d’agglomération à vingt-huit bordait le massif du Vercors, l’ancienne communauté de communes des Balcons Sud Chartreuse intégrait le Sud du massif de la Chartreuse et la communauté de commune du Sud Grenoblois longe le sud du massif de Belledonne. La fusion des trois offre un lien « institutionnel » entre vallée et montagne. Toutefois, chaque massif ne nous offre pas une configuration de relief et d’accès homogène. Le Vercors est longé des communes de Veurey-Voroize à Miribel-Lanchâtre. Ces communes sont pour la plupart classées montagne de manière partielle car se partagent du nord au sud un bout de la crête (alt. supérieure à 2000m) qui domine une pente forte, puis un bout du piémont et de la vallée. La population habite majoritairement le piémont et la vallée. Encore une fois, la situation n’est pas homogène du nord au sud, on a notamment la commune de Miribel-Lanchâtre dont les habitants sont un peu plus haut en altitude (500m). Dans l’ensemble on a tout de même une situation géomorphologique que l’on pourrait associer à une barrière naturelle forte. Seules deux routes nous permettent de rejoindre « l’autre côté », les plateaux du Vercors. Il y a celle qui part de Sassenage, qui est très pratiquée matin et soir par les travailleurs et dans certaines saisons par les touristes. On a aussi la route qui part de Seyssins et Seyssinet-Pariset qui est aussi très pratiquée mais moins accessible car plus escarpée.
Concernant le Chartreuse, seul le sud est intégré dans le territoire métropolitain ce qui représente une très petite parcelle du massif. On a une situation très différente du Vercors. Les habitants de l’ancienne communauté de communes des Balcons Sud Chartreuse vivent au coeur du massif et non sur ses piémonts. En prenant la route de Corenc, on arrive très rapidement au Sappey enChartreuse qui est à 1000m d’altitude. D’ailleurs le Sappey a la seule infrastructure de tourisme de ski de la métropole. On arrive dans un univers « village » au sein d’une moyenne montagne.
Une autre route nous permet d’atteindre les communes de Chartreuse de la métropole, celle qui part de Voiron pour arriver à Sarcenas. La massif de la Chartreuse est aussi habité sur ses piémonts par les communes de l’agglomération (Fontanil-Cornillon, St-Egrève, St-Martin-leVinoux, La Tronche, Corenc, Grenoble, Meylan).
Enfin, la situation du massif de Belledonne est encore très différente et hétérogène. Un grand nombre de communes de l’ancienne communauté de communes du Sud Grenoblois font partie du sud des balcons de Belledonne. C’est le cas par exemple de Vaulnaveys-le-Haut et Bas, Herbeys, Brié-et-Angonne, un bout de Jarrie etc. Cette partie de massif est quadrillée de diverses routes. Les communes les plus au sud de la métropole sont, dans leur cas, ouvertes vers les Ecrins d’un côté (Séchilienne, St-Barthélémy-de-Séchilienne) et la Matheysine de l’autre (NotreDame-de-Mésage). Ces communes sont situées sur des axes de circulation actuellement et anciennement très empruntés.
Contexte du mémoire : ancrage fort dans le terrain
Imbrication entre missions et recherche
•Du terrain et de l’expérience naissent les questionnements de la recherche.
Le sujet de recherche de ce mémoire repose sur l’explicitation du ou des sens possibles donnés à la politique montagne de Grenoble-Alpes Métropole. Ce sens repose sur la rationalité que veutlentdonner les acteurs à cette politique, sur ses causes, sur leurs représentations ainsi que sur les valeurs et les possibles orientations. La recherche de ce sens constitue le lien entre mes missions au sein de l’institution et ma recherche. Les différentes étapes de travail ont contribué à l’élaboration des questionnements et des hypothèses.
La politique montagne, on le verra, n’est pas dénuée de motifs mais son intention et ses causes apparaissent très implicites dans les discours officiels. L’interrogation initiale est centrée sur le « comment » celle-ci va naître et quelle sera la forme de ce nouveau-né. Au fil des missions et de la recherche, il fallut aussi chercher le « pourquoi » de ce projet politique et finalement nourrir sa justification. Lors de mon arrivée en stage, je fus frappée par la singularité du projet politique qui ne semblait répondre à aucun problème ni besoin (Muller, 2006). Le mot d’ordre de Christophe Ferrari à la vice-présidente à la forêt, l’agriculture et la montagne était qu’elle avait « carte blanche » tant sur les moyens que sur le contenu. Si cette politique montagne répond au contexte institutionnel et territorial, la montagne comme objet saisi politiquement relève d’un choix de la part des élus. Or, comme on l’a dit, ce choix ne semble a priorirépondre à aucune nécessité, du moins c’est l’impression qu’il nous est laissée par l’insipidité des discours. A l’aune d’un territoire qui a tant à faire avec ses transferts de compétences et de moyens, tant à penser pour se donner un sens, on se demande quelle place peut avoir une politique dont on ne connait les raisons exactes.
A cette étape, nous sommes loin d’un modèle stratégique défini par un objet planificateur, un projet « a priori » (Soubeyran, 2014). Et si nous sommes dans un autre modèle de penser l’action publique, nous n’en comprenons, dans tous les cas, ni le « pourquoi », ni la stratégie et encore moins le plan. L’objectif de mes missions était alors d’amener l’institution à définir les limites de cette politique, à donner cette impulsion afin qu’elle ait un « intérieur » et un « extérieur ». Cet objectif s’est décliné en plusieurs temps et types de travail.
Méthode utilisée pour collecter les matériaux : approche anthropologique et ethnologique du projet
La méthodologie de ce mémoire, dans le cas du carnet de bord, s’inspire de l’étude ethnographique. On s’inscrit dans la longue tradition sociologique de l’Ecole de Chicago des années 30-40 représentée notamment par les quelques William Isaac Thomas, Ernest Burgers, Robert Park puis du label qui en est issu, « l’interactionisme symbolique », dont faisaient partie Erving Goffman, Howard S. Becker, Anselm Strauss et d’autres (Chapoulie, 1996). Everett C. Hughes, sociologue se situant à l’intermédiaire entre les fondateurs de l’Ecole de Chicago et le label des interactionnistes, parle du travail de terrain comme « l’observation des gens in situ : il s’agit de les rencontrer là où ils se trouvent, de rester en leur compagnie. » (Hughes, 1956). Le travail du sociologue consistait à comprendre le rôle des personnes dans ces interactions.
Yves Winkin, dans l’Anthropologie de la communication(2001), définit le travail de terrain d’après trois « arts » : « art de voir, art d’être (avec), art d’écrire ». Le « savoir voir » consiste en notre capacité à être disponible à l’observation d’un lieu et d’un groupe. La disponibilité ne se résume pas au temps et à la concentration consacrés mais à ce que l’on soit « disposé à voir les autres sous un nouveau jour » (Hughes). Le « savoir être » ou « savoir être avec » est le comportement que l’on consent à avoir avec « l’observé ». C’est la capacité à se faire accepter par cet observé.
Le « savoir écrire » est l’ « art qui exige de savoir retraduire à l’attention d’un public tiers (tiers par rapport à celui que vous avez étudié) ».
Cette méthode ethnographique du travail de terrain est, comme on l’a dit, une inspiration pour cette recherche sans qu’elle ne soit pour autant respectée à la lettre. L’étude ethnographique au tour de la conception d’une politique est un terrain parfait mais ma position au sein de la métropole n’est pas celle du sociologue. Je joue moi même un rôle dans les interactions créées par cette idée de politique montagne. Je suis donc aussi un sujet de l’étude. Ma position, contrairement par exemple à celle d’une thésarde, n’a pas été définie comme « chercheuse » mais comme « chargée de missions », mon travail de recherche étant davantage une activité « personnelle », ce qui déroge à la règle de ces sociologues.
Aller découvrir le sens d’une politique publique ?
Politique publique, éléments de définition
L’objet de cette recherche est de comprendre le sens d’une politique publique en particulier. Afin de concevoir ce que peut signifier ce « sens », nous allons nous attarder quelque peu sur la notion de politique publique. Elle est une construction venant de nos institutions et elle modèle nos sociétés mais qu’est ce qui motive ces sociétés à concevoir des politiques ? Ou plutôt, à quels besoins celles-ci répondent-elles ? Nous allons parcourir ces questions en nous appuyant sur les écrits de Pierre Muller et notamment sur son ouvrage Les politiques publiques.
En premier temps, nous attendons une réponse au « pourquoi » des politiques publiques. Muller commence sa démonstration en en présentant une genèse. Elles sont issues du changement profond de la société. Le passage d’une société « traditionnelle » ou « territoriale » à une société « sectorielle » a augmenté considérablement ses capacités d’action sur elle-même. Par là on veut dire que la société territoriale fonctionnait selon une « logique horizontale », avec une faible division du travail et une division qui se faisait par espace et non par secteur. Elle était peu mobile et « composée d’unités territoriales relativement autonomes et capables d’assurer leur propre reproduction ». Pierre Muller, en citant Alain Touraine, ajoute que les conditions de reproduction des sociétés territoriales dépendent d’éléments extérieurs à elles-mêmes (les conditions météorologiques par exemple). La société sectorielle ne dépend plus d’un territoire mais d’un ensemble de filières. La sphère de la famille est séparée des activités de production. La production est, elle, divisée par un grand nombre de filières professionnelles. La menace pour une telle société est la « désintégration ». Si l’objectif d’une société reste l’assurance de sa reproduction, il va falloir gérer l’ensemble des interactions entre ces filières. Il y a donc désintégration si la société « ne trouve pas en elle-même les moyens de gérer les antagonismes intersectoriels ». Ces moyens ce sont les politiques publiques. Muller va plus loin en parlant de « paradoxe de l’incertitude » en ce qui concerne l’action de la société et des politiques publiques.
La société moderne arrive à créer ce qui peut la détruire (modification de l’écosystème, manipulation de l’atome etc.) (Soubeyran, 2014), ainsi au lieu de se protéger d’éléments extérieurs elle met en oeuvre « des moyens destinés à maîtriser l’environnement ». De nombreuses politiques publiques sont alors destinées à gérer les désajustements produits par l’industrie et par d’autres politiques sectorielles. La société sectorielle serait alors en perpétuel déséquilibre, génère en permanence des « problèmes », des « conflits », des « dysfonctionnements » ou des « effets pervers » qui devraient à leur tour faire l’objet de politiques publiques.
On comprend que la société actuelle, pensant s’être extraite des contraintes du milieu, ne définit plus son objectif naturel comme étant la subsistance des individus et doit donc le redéfinir. Quoi qu’il en soit, si une société donnée veut assurer sa reproduction elle doit suivre l’objectif qu’elle s’est fixée en régissant l’ensemble des interactions et des groupes. Si les politiques publiques sont les garantes de cette reproduction, celles-ci doivent à la fois être motrices et répondre à cet objectif fixé. Muller, pour définir de manière objective les composants d’une politique publique, cite Yves Mény et Jean-Claude Thoening qui retiennent cinq éléments fondateurs. Les mesures tangibles sont le premier élément, elles forment la « substance » de la politique (1). Elle est construite de décisions plus ou moins autoritaires (2). Elle s’inscrit ensuite dans un « cadre général d’action » ce qui autorise sa distinction avec de simples mesures (ce cadre général peut être conçu par le décideur ou être reconstruit a posterioripar le chercheur) (3). Une politique cible ensuite un ou plusieurs publics, ce sont des « individus, groupes ou organisations dont la situation est affectée par la politique publique. ». Ceux-là peuvent être actifs ou passifs dans son élaboration (4). Enfin, elle définit forcément des objectifs à atteindre (5).
On a présenté ici le squelette de ce que peut être une politique publique, on souhaite aller plus loin en comprenant comment est défini le fond, c’est-à-dire le sens de la politique.
Le sens d’une politique publique ?
Comme dit plus tôt, la politique publique répond à un problème ou à ce qui peut s’apparenter comme un désajustement. Cette politique et ce problème ne sont pas un « donné mais un construit de recherche. ». Cela signifie que dans une société donnée, il y a une somme de problèmes potentiellement traduisibles en politique publique, pour autant le mécanisme d’élaboration ne s’enclenche pas toujours. Tout dépend de la représentation qu’une société a du réel. En effet, la mise en place d’une politique n’est pas due à une intensité du problème mais à son changement de représentations. Par exemple, si la loi Veil à pu voir le jour à ce temps T c’est que la représentation de la condition de la femme était en évolution.
Muller oriente l’ensemble de sa démonstration autour de ce construit politique, elle est une « image de la réalité sur laquelle on veut intervenir. ». En citant Jean-Gustave Padioleau, Muller parle de « l’agenda politique » comme étant « l’ensemble des problèmes perçus appelant au débat public. ». On comprend alors qu’une action politique sur le réel dépend d’une contingence cognitive et normative. Le rôle de l’acteur est en ce cas fondamental dans l’élaboration.
Nous n’allons pas rentrer dans une analyse fine de ce que Muller appelle la « boîte noire » mais nous intéresser quelque peu. Elle représente l’ensemble des acteurs participant au « policy making ». Il introduit le terme de rationalité en affirmant que les acteurs « n’agissent pas en fonction d’un intérêt clairement identifié débouchant sur une stratégie cohérente. ». Leur fonctionnement n’est pas totalement rationnel, c’est-à-dire qu’ils ne choisissent pas la solution la plus optimale (ou s’en rapprochent), mais intègrent un ensemble d’informations techniques (« la réforme est-elle possible ? »), économique (« combien coûtera-t-elle ? »), sociale (« quelles oppositions va-t-elle susciter ? »), politique (« va-t-elle compromettre sa réélection ? »), éthique (« correspond-elle à ce qu’ils croient être juste ? », les éloignant de la décision rationnelle.
Certains expliquent ce manque de rationalité par une carence en hypothèses (H. Simon). Les acteurs analysent ces hypothèses de manière « séquentielle » les empêchant d’avoir une vision globale et d’analyser l’ensemble des cas de figure. D’autres s’éloignent de cette approche séquentielle (Lindblom) en comprenant une politique comme un processus « incrémental » qui se construit à partir de « négociation et d’arrangement mutuel ». Chaque acteur vient alors négocier avec ses propres représentations de l’action à mener, souvent mues par leurs intérêts particuliers (surtout lorsque la frontière privé public s’affine).
Limites au développement de la politique montagne
Méthodes développés et freins
On souhaite ici revenir sur les méthodes d’élaboration développées et sur les freins qu’elles ont pu rencontrer. A mon arrivée en stage, ma tutrice avait pour idée que l’on réalise un atelier où l’on y rassemblerait l’ensemble des maires dits de montagne afin de faire remonter leur parole. Sur les quatre mois de stage, la réalisation d’un atelier arrivait en dernier, avec en amont la réalisation d’un diagnostic devant nous aider à la réalisation de cet atelier. Comme écrit plus tôt, l’objectif de ce diagnostic était de pouvoir rapporter aux maires de la métropole (et non pas seulement les 34 classées montagne) un ensemble d’éléments pouvant les questionner sur ce que peut signifier une politique montagne au sein de la métropole grenobloise. Cette partie ayant aussi pour objectif de relever les freins à ces choix méthodologiques, la phase de diagnostic elle-même dû faire face à un certain nombre de blocages. Sa méthode peu habituelle pour les agents et élus métropolitains questionnait mais n’était pas la source du problème. Le fait que soit proposé d’aller à la rencontre des élus d’une part et des « habitants » de l’autre provoqua des craintes. En effet, la première partie du diagnostic ne posa pas de problèmes car elle se passait entre l’ordinateur et moi. La deuxième phase ne provoqua pas non plus de sursaut puisque il s’agissait notamment d’aller passer des entretiens avec des agents de la métropole. La zone de risque était donc moindre. En revanche, aller voir quelques maires et s’immerger dans quelques communes sembla faire rentrer l’équipe de la politique montagne dans une zone de risque. Afin de limiter cette zone de risque on me demanda alors de rédiger un cahier des charges et il fut lu et relu jusqu’à ce qu’il soit empreint du langage technique de la métropole. Il fut soumis au parapheur dont la liste des signataires remontait jusqu’au cabinet. Son temps de cheminement fut si long que lorsqu’il redescendit, les dates proposées pour les immersions furent dépassées et la démarche refusée. Dans cette phase de diagnostic on ne put donc pas aller rencontrer les maires, mais les immersions, malgré le refus, furent organisées. On pourrait mettre cette anecdote sur le compte du remaniement des services et sur le flou hiérarchique du moment, cependant elle n’est peut-être pas qu’une anecdote mais une constante basée sur la peur du risque. Cette peur du risque se retrouve à la fois dans ce besoin de planifier à l’extrême (Soubeyran, 2014) mais aussi dans ce malaise créé lorsque l’on sort de la zone de confort établie par l’institution. En effet, tout contact avec l’habitant ou même l’élu doit relever d’une longue démarche de préparation d’un cadre et d’une méthode très quadrillée. Pour le contact avec l’habitant on peut le constater avec le travail réalisé par le service participation qui prépare un ensemble d’ateliers, de forums très construits en amont. L’effet est alors retentissant lorsque l’on dit « Je vais aller dans ces communes, interroger les habitants sur un ensemble de sujets, voilà la méthode. ».
Ce besoin de planifier et cette peur du risque revint par la suite à de nombreuses reprises. Cet atelier que Y voulait réaliser en fin de stage ne put se faire aussi « légèrement ». Avant d’être accepté, Y dû écrire une méthode d’élaboration de la politique montagne en plusieurs phases avec un descriptif plus poussé pour la première phase. Après la période de diagnostic, nous avions proposé de faire une démarche de projets avec les habitants autour des problématiques ressorties de ce diagnostic. Cette démarche de projets aurait ensuite été proposée aux élus. Cela fut impensable. Nous proposions aussi que s’il devait y avoir des ateliers d’élus en première phase peut-être pourraient-ils être ouverts à un plus grand public. Il fut décidé, par le haut de la hiérarchie, que la première phase d’élaboration de la politique montagne serait composée de deux ateliers exclusivement avec les 49 maires des communes métropolitaines. Si cette méthode semble « soft » et restant dans la zone de non-risque puisqu’elle n’intègre que des éléments internes au fonctionnement métropolitain, le premier atelier bouscula et provoqua un stress insondable. Tout d’abord, en amont de cet atelier devant à l’origine se dérouler le 15 octobre 2015, l’équipe de « Des rives d’espaces » et moi devions aller à la rencontre des six maires dont la commune faisait partie du diagnostic, afin de le leur présenter. Encore une fois ces rencontres provoquèrent quelques appréhensions, il semblait y avoir de « l’enjeu » à ces rencontres.
Cependant, le succès du diagnostic donna de la légitimité à la démarche et ces rencontres se firent relativement facilement. De plus, chaque rencontre renforça le fait qu’il n’y avait pas réellement d’enjeu. Ensuite, l’atelier fut pour sa part un évènement redouté pour beaucoup. Si le contenu et le déroulé de l’atelier fit l’objet d’un débat continuel entre les différents membres de comité technique c’est l’existence même de cet atelier qui était craint. Concernant le contenu, à la base proposé par le collectif et moi, il dû être retravaillé jusqu’à ce qu’il génère le moins de risques possibles de « contestation » ou « flottement ». Cependant cette dose de planification n’a pas suffi à amoindrir les craintes. L’atelier devant se dérouler le 15 octobre fut dans un premier temps repoussé au 12 novembre pour une raison d’horaire. Puis la date du 12 novembre fut annulée compte-tenu d’un départ inattendu annoncé par Y. Une date ne pu être reposée que lorsque la nouvelle équipe arriva. Encore une fois il ne fut pas facile de faire accepter le déroulé de l’atelier dont la zone de risque semble varier entre la perception des uns et des autres. Il eut finalement lieu le 27 avril, comme présenté plus tôt. On ressentit lors de l’atelier et suite à celui-ci un grand soulagement de la part de la direction, de l’élue à la montagne et des techniciens sur son bon déroulement. Si le risque d’échec ou de soulèvement des élus était peut-être la cause de cette peur il y a d’autres éléments à prendre en compte. Tout d’abord on a pu entendre à plusieurs reprises que « pour les autres politiques on a déjà une base, des choses qui sont déjà en route parfois depuis longtemps, la politique montagne part de zéro » ce qui génère peut-être une forme de vertige. Ensuite sur le déroulé de l’atelier beaucoup d’agents internes ou externes à la métropole disaient avoir « déjà eu des expériences négatives de ce type d’atelier où les élus remettaient en question la méthode même de son cheminement. ».
Pour résumer la politique montagne, par son aspect « de petite nouvelle », elle représente par essence une zone d’inconfort et le format d’atelier pose lui aussi, pour de multiples raisons, un risque à l’échec ou à un résultat non-voulu.
Quelles influences pour la conception d’une politique montagne dans un contexte intercommunal ?
Inscrire une politique montagne dans l’agenda politique d’une intercommunalité naissante peut sembler anodin. Cependant en regardant dans les logiques stratégiques passées et encore présentes de l’État, on peut se poser la question de l’héritage politique et idéologique.
D’une posture interventionniste à la promotion de l’auto-développement : la montagne au coeur d’une évolution de paradigme
En France, l’entrée de la montagne en politique n’est pas nouvelle. D’après l’ouvrage de Françoise Gerbaux, l’inscription de la montagne dans l’agenda politique national s’est faite précisément l’année 1972. Cependant, elle commence par trois chapitres énumérant une approche de la montagne au sein des politiques dès le XIXème siècle. Cette approche ne prenait pas directement la montagne comme objet mais la voyait à travers trois secteurs spécifiques : la forêt, l’agriculture puis l’économie du tourisme et des énergies. On reviendra par la suite sur le contenu et les différentes approches de la montagne car c’est davantage le cadre institutionnel qui nous intéresse ici.
La posture de l’État avec la montagne : du XIXème siècle à 1981
C’est dans l’ouvrage de Bernard Debarbieux et Gilles Rudaz, Les faiseurs de montagne, que l’on captera la posture de l’État face aux espaces puis aux territoires de montagne. L’État a commencé et continuité à se préoccuper de la montagne, tout d’abord à travers les domaines décrits par F. Gerbaux, toujours parce que cela était dans son intérêt. Il commence par se construire un imaginaire de la montagne autour de la gestion forestière. Cela arrivait en réponse aux dégâts créés par la forte déforestation. On peut dire que l’État commence par se forger une vision environnementale et protectionniste de la montagne. Environnementale mais non forcément écologique, ou du moins territoriale en ne considérant pas, dans les premiers temps, l’habitant de la montagne. Celui-ci est même accusé d’être à l’origine de cette déforestation et de fait, la cause des catastrophes environnementales. Le comportement autoritaire de l’État envers ces populations déclencha des protestations et résistances. L’État dû changer ce comportement en s’intéressant de plus près à cet habitant. La montagne ne fut plus seulement un environnement mais aussi un territoire. De plus, il admet que ces populations sont garantes de la préservation du paysage. Il s’en aperçoit lorsque les populations commencent un mouvement de désertification pour les plaines et les vallées. Or, l’État comprend très vite que l’entretien du paysage c’est la conservation d’une ressource économique. Ce paysage entretenu depuis des siècles par l’agropastoralisme est générateur de tourisme. L’image que se fait l’État de la montagne doit ainsi être préservé à la fois selon des valeurs environnementales et économiques : « l’émigration et l’enfrichement de la montagne ont été perçus comme des menaces pour la biodiversité et les paysages, autrement dit des caractères de la montagne auxquels l’imaginaire touristique et environnementaliste a progressivement conféré de la valeur ».
Ainsi l’État n’est plus tout à fait autoritaire mais pourra être aussi paternaliste. Il va intervenir au niveau de l’agro-pastoralisme puis très vite va imposer des logiques de tourisme et de développement des énergies. Debarbieux et Rudaz résument ainsi l’argument que l’État entretient avec les territoires de montagne : « On retrouve là une conception de la montagne qui avait déjà triomphé dans les politiques forestières et de régulation hydraulique au XIXème siècle, et dans les politiques de protection de la nature et des paysages au XXème siècle : la montagne comme somme de ressources devant profiter au bien-être et au développement des populations locales. ». Qu’il se comporte de manière « autoritaire ou paternaliste », l’État est interventionniste.
Il agit au nom d’un bien-être et d’un développement local mais il est dans les faits centralisateur et opportuniste. il entretient donc une posture « interventionniste ». Son intervention sur les domaines du tourisme et de l’énergie est vécue comme une politique « colonisatrice » provoquant alors, comme pour la politique de reforestation, un profond rejet des populations locales. C’est ainsi que Debarbieux et Rudaz résument la posture de l’État : « Qu’elles soient autoritaires ou paternalistes, qu’elles soient motivées par des objectifs de croissance et de valorisation des ressources ou par le paradigme de l’État providence, elle traduisent toujours le souci de faire de la montagne une affaire d’État. Ce sont les États, aidés en cela par l’expertise scientifique, qui décident ce que sont les régions de montagne, les critères par lesquels il convient de les appréhender et les modalités de l’action à conduire à leur égard. En un mot, ce sont les administrations nationales et la classe politique qui configurent la montagne. ».
Jusqu’au départ de Charles De Gaulle, les populations locales percevront l’action de l’État comme colonialiste. Ce comportement s’incarne notamment dans le « Plan Neige » (1964) comme programme cohérent d’équipement et d’investissement. Il s’agissait de la désignation d’une douzaine d’opérations à développer. Cela était ressenti comme une « forte initiative étatique dans le développement des entreprises touristiques, politique d’aménagement guidée par une conception de la montagne comme gisement, faible prise en compte des caractéristiques locales, approche sectorielle du développement etc. » (Debarbieux, Rudaz).
Ce comportement colonialiste et cette vision du « développement à tout prix » voit un tournant avec l’élection de Georges Pompidou et notamment avec la désignation de Jacques Chirac comme ministre de l’Agriculture et du Développement Rural. Ils furent prises en compte les contestations des acteurs locaux en ce qui concerne le sur-développement des infrastructures de tourisme et le manque de considération pour le secteur agricole. F. Gerbaux poursuit en affirmant que c’est en 1972, avec donc l’arrivée de J. Chirac au ministère, que la montagne est entrée dans l’agenda politique. Cette mise sur agenda eut pour objectif de « répondre à un certain nombre de questions des leaders syndicaux » et pour « calmer les inquiétudes grandissantes des éleveurs principalement situés dans ces zones. ». Des négociations entre les leaders syndicaux et le commissariat à la Rénovation rurale et l’Institut d’études rurales montagnardes (INERM) aboutit une double loi du 3 et 4 janvier 1972 répondant aux objectifs de modernisation du pastoralisme et au maintien de « l’agriculture de peuplement ».
|
Table des matières
Remerciements
Introduction
Partie 1 :Etude de la naissance de la politique montagne métropolitaine
A.Eléments de contexte
1. Présentation de Grenoble-Alpes Métropole
a) L’institution
b) Le territoire de Grenoble-Alpes Métropole avant et après la fusion
2. Contexte du mémoire : ancrage fort dans le terrain
a) Imbrication entre mission et recherche
b) Méthode utilisée pour collecter les matériaux : approche anthropologique et ethnologique du projet
c) Méthode utilisée pour mettre en relief les matériaux : entretiens et travail bibliographique
3. Aller découvrir le sens d’une politique publique ?
a) Politique publique, éléments de définition
b) La politique montagne métropolitaine : hypothèses sur le sens
B.Carnet de bord
1. A la recherche de contenu
a) Discours politiques et techniques
b) Recherches et observations personnelles
c) Actes politiques
2. Les influents
a) Les acteurs
b) Le contexte de la montagne en politique dans la métropole
3. Limites au développement de la politique montagne
a) Méthodes développées et freins
b) Sujets en creux et problèmes de posture Transition
Partie 2 : Elaboration de la politique montagne : Quel(s) référentiel(s) ?
A.Une politique montagne à l’échelle métropolitaine : une nouvelle forme institutionnelle qui puise, pour la montagne, ses références dans des cadres institutionnels plus anciens ?
1.Quelles influences pour la conception d’une politique montagne dans un contexte intercommunal ?
a) D’une posture interventionniste à la promotion de l’auto développement : la montagne au coeur d’une évolution de paradigme
b) La politique montagne métropolitaine : une héritière de cette décentralisation du rapport à la montagne ?
2. Réflexion autour d’une politique montagne métropolitaine avec les PNR et territoires voisins : Quelles influences incitant à la conception deliens ville-montagne ?
a) Dépasser la dichotomie urbain-rural en coopération avec les PNR
b) Évolution de la stratégie frontalière autour des Alpes
c) Coopérer autour de l’objet « montagne » pour penser une future méga-métropole ?
3. Quelles influences dans la posture institutionnelle de la métropole ?
a) Retour sur les indices du rôle de la politique montagne dans la construction métropolitaine
b) Comprendre le fonctionnement intercommunal grenoblois
c) Une attitude des élu(e)s empreinte de l’héritage intercommunal grenoblois
Transition
B. L’intention de la politique montagne métropolitaine : un rapport innovant entre la politique et la montagne ?
1. La montagne : objet fédérateur ?
a) Un objet de dissensus peut-il être fédérateur ?
b) Des représentations trop diverses de la montagne pour qu’elle soit fédératrice ?
c) La montagne comme médium
2. La montagne de la politique montagne : vers un nouveau paradigme de l’action territoriale ?
a) Trois rapports possibles avec la montagne
b) Du passage du sectoriel au global
c) Une interprétation possible du médium qu’est la montagne
d) La montagne, un médium qui trouve très vite ses limites
3. A la recherche de l’élaboration du sens de la politique montagne : pourquoi ?
a) Une intention implicite : premier degré de compréhension
b) Une intention implicite : deuxième degré de compréhension
Conclusion de partie
Conclusion générale
Bibliographie
Annexes
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet