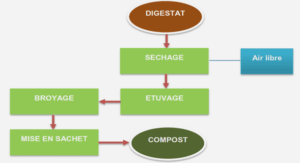Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
L’émergence d’un principe d’intégration à la Conférence de Stockholm de 1972 souffrant d’une absence d’opposabilité
La première formulation de ce principe, en droit international, intervient en 1972 avec la Conférence de Stockholm des Nations Unies. La déclaration issue de cette conférence affirme, dans son paragraphe 6, qu’il « faudra coordonner et harmoniser la réalisation [de la défense et de l’amélioration de l’environnement] avec des objectifs fondamentaux déjà fixés de paix et de développement économique et social dans le monde entier »30. Elle précise en outre, dans son principe 4, la « place importante » que doit revêtir la protection de la nature et notamment de la flore et de la faune sauvage dans la planification du développement économique31. Dans ce cadre, l’intégration va être entendue comme la prise en compte des paramètres environnementaux « dans des ensembles qui leur étaient totalement hostiles »32.
Ainsi, le souci d’intégration est très présent dans cette déclaration, mais l’objet de ce principe peut soulever quelques interrogations : s’agit-il d’une intégration de l’environnement ou de l’écologie qui est plébiscitée par ce texte ? La réponse est assez aisée. En effet, à la lecture du paragraphe 1 du préambule, on s’aperçoit que la définition donnée de l’environnement par la déclaration de Stockholm est très large et est composée de deux éléments : « l’élément naturel et celui que [l’homme] a lui-même créé » et qui sont « indispensables à son bien être et à la pleine jouissance de ses droits fondamentaux ».
On assiste à la naissance du concept d’environnement en droit international qui se présente alors comme une notion centrée sur le bien-être de l’homme qui s’étend de la lutte contre l’apartheid et la colonisation33 à la protection de la flore et de la faune sauvage34. Ainsi, l’écologie se trouve, elle aussi, incluse dans le concept plus large d’environnement au niveau international. Alexandre KISS et Jean-Didier SICAULT, dans leur analyse de cette déclaration, précisent que « cet agglomérat (…) d’idées mal soudées ensemble »35 est lié au souci de rattacher le droit à l’environnement aux droits de l’homme. Cependant, il faut souligner que cette première reconnaissance souffre de l’absence d’opposabilité de cette déclaration36. En effet, cette dernière correspond à un acte d’orientation et un programme d’action (et non un texte obligatoire) »37. Pour autant, son adoption n’a pas été vaine puisqu’elle a permis l’éclosion du principe d’intégration par sa reconnaissance par la communauté internationale. Cette prise de conscience a aussi été le socle de la protection de la faune et de la flore au niveau international38.
Ce principe d’intégration va, en droit international, connaître une mutation dans les années 1980 qui se poursuivra au début des années 1990. Une telle intégration ne va plus être recherchée en tant que telle, mais être présentée comme l’un des moyens concourant à la réalisation d’un objectif supérieur. Ce concept plus étendu a vu le jour dans un rapport de la Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement, mise en place par les Nations Unies en 1983, sous le vocable de développement soutenable39, 40.
La réaffirmati on constante des principes entérinés par la conférence des Nations unies sur l’environnement et l e développement de 1992
Le sommet mondial du développement durable, organisé à Johannesburg du 26 août au 4 septembre 2002, n’a pas apporté de réelles innovations, faute d’accord, et n’a seulement permis que la réaffirmation des principes dégagés dix ans auparavant à Rio de Janeiro55. Cependant, ce rappel des principes a été l’occasion de mettre en exergue, dans la déclaration finale, les trois piliers du développement durable que sont : le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement. Ces derniers sont présentés comme étant « interdépendants et se renforçant mutuellement ». Une fois de plus, l’intégration de ces trois éléments de base interdépendants est présentée comme l’un des moyens permettant de « produire » un développement durable56.
Les avis doctrinaux sur ce concept de développement durable divergent. Si certains auteurs n’y voient qu’un « slogan vide de contenu »57 ou « une utopie consensuelle, dessinant les contours idéaux où le développement économique, la cohésion sociale et la protection de l’environnement se confortent mutuellement dans un cercle vertueux »58, d’autres préfèrent y voir une réelle « matrice conceptuelle »59.
Cette dernière acception du concept de développement durable semble être corroborée, en droit international, par l’accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l’Organisation Mondiale du Commerce. Le préambule de ce dernier évoque le développement durable comme l’un des objectifs à atteindre par l’organisation60. Comme le souligne Marie-Pierre LANFRANCHI, cette référence suppose l’intégration des préoccupations environnementales dans les relations internationales de commerce61. Si le développement durable n’est inscrit que dans le préambule, il influence indéniablement, selon cet auteur, l’organe de règlement des différends de l’organisation. Il relève, par ailleurs, que cet organe a reconnu que les États membres « étaient libres d’établir leurs propres objectifs écologiques », qu’ils disposaient « d’une large autonomie pour déterminer leur propre politique d’environnement (y compris la relation entre l’environnement et le commerce) » ou encore qu’ils bénéficiaient d’un
droit autonome à établir un niveau de protection plus élevé que celui défini par les normes internationales existantes concernant la santé des personnes »62. Dans ce cadre, le concept de développement durable n’est pas directement opposable puisqu’il n’apparaît que dans le préambule de l’Accord de 1994. Cependant, il va servir de matrice » à la réflexion de l’organe de résolution des conflits nés de cet accord en permettant l’intégration des préoccupations environnementales dans les relations relatives au commerce international.
Le principe d’intégration a connu une double évolution parallèle car il n’est pas l’apanage du seul droit international et a été très largement développé par le droit communautaire.
La reconnaissance parallèle du principe d’intégration en droit communautaire
Dans le sillage du droit international, le droit communautaire a, lui aussi, reconnu l’existence du principe d’intégration. À l’instar du droit international, les prémices de cette reconnaissance sont à rechercher dès les années 1970 comme le démontre l’étude des programmes d’action communautaires en matière d’environnement (1). En parallèle de ces programmes, les traités communautaires sont venus renforcer la reconnaissance de ce principe et surtout apporter une définition plus affinée et une opposabilité plus étendue (2).
Une première reconnaissance par le biais de s programmes d’action communautaires en matièr e d’environnement
Le principe d’intégration est né, en droit communautaire, dans les premiers programmes d’action communautaires en matière d’environnement.
Le premier programme, établi pour la période entre 1973 et 1976, précise qu’il convient de tenir compte le plus tôt possible de l’incidence de tous les processus techniques de planification et de décision sur l’environnement »63. La formulation est assez proche de celle du principe 4 de la déclaration de Stockholm évoquée précédemment, notamment dans sa référence à la planification.
C’est avec le troisième plan d’action64 que se trouve clairement énoncée la nécessité du recours au principe. En effet, celui-ci précise, dans le huitième point de son introduction, qu’ « il convient que la Communauté recherche une intégration optimale des préoccupations de l’environnement dans la conception et le développement de certaines activités économiques en favorisant ainsi la création d’une stratégie globale. ».
Selon le préambule de ce programme, l’environnement recouvre deux réalités distinctes : l’amélioration de la qualité de la vie et l’utilisation aussi économe que possible des ressources naturelles. Il s’agit bien, ici aussi, d’un concept très nettement anthropocentrique qui recouvre toutefois les préoccupations écologiques comme le démontrent les dispositions relatives à la protection et à la gestion rationnelle de l’espace, du milieu et des ressources naturelles qui évoquent très largement les critères écologiques permettant d’atteindre les objectifs déterminés par le programme.
On peut constater que, dans ce programme, la vision selon laquelle le principe d’intégration est perçu comme un moyen d’atteindre un objectif de développement durable commence à émerger. En effet, le concept de développement durable fait une apparition timide dans les relations entre la Communauté européenne et les pays en développement, mais dans ce cadre la Communauté doit « favoriser les conditions d’un développement économique durable qui tienne compte de l’interdépendance entre le développement, l’environnement, la population et les ressources ». Avec le quatrième programme d’action65, le principe d’intégration sort de l’introduction pour être admis dans les orientations générales de la politique dans lesquelles un paragraphe complet lui est réservé, intitulé : « intégration avec d’autres politiques communautaires ». Il y est précisé que le principe d’intégration devient une obligation, non seulement pour la Communauté européenne, mais aussi pour les États membres dans le cadre de la réalisation de leurs politiques.
Le renforcement de ce princi pe dans le s traités communautaires
Il faudra attendre 1987 et l’Acte unique européen pour que le second paragraphe de l’article L. 130 R CEE stipule que « les exigences en matière de protection de l’environnement sont une composante des autres politiques de la Communauté ».
L’imprécision de cet énoncé ayant été largement reprochée à cette formulation69, le traité de Maastricht de 1992 est venu corriger cette situation en modifiant cet article et en lui substituant la formulation suivante : « les exigences en matière de protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques de la Communauté ».
Le traité d’Amsterdam a, en 1999, déplacé – et promu – les dispositions relatives au principe d’intégration à l’article 6 du traité CE dans la première partie réservée aux principes. Cet article précise dorénavant que « les exigences en matière de protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l’article 3 en particulier afin de promouvoir le développement durable ». Cette dernière innovation remet en perspective le développement durable et l’intégration perçue comme un moyen permettant d’atteindre ce résultat.
La reconnaissance du principe d’intégration tant en droit international que communautaire souffre, nous venons de le voir, de l’absence d’une réelle définition juridique claire sur l’étendue de ce concept. Christophe MARQUES70, s’appuyant sur les travaux de Sylvie CAUDAL-SIZARET71, a mis en évidence l’existence d’une dichotomie du principe d’intégration. Ainsi, selon l’auteur, le principe d’intégration se subdiviserait en exigence d’intégration et approche intégrée. On retrouve cette même distinction sous un vocable différent chez Gaëlle GUEGUEN-HALLOUET72 qui évoque cette dissociation sous le vocable d’intégration externe et d’intégration interne.
L’approche intégrée concerne la seule législation environnementale et requiert une approche globale basée sur une réflexion écosystémique permettant d’éviter l’isolement ou l’autarcie de certaines dispositions de cette branche spécifique. Elle permet, par exemple, que les problèmes liés aux pollutions soient traités dans leur ensemble.
L’exigence d’intégration, quant à elle, correspond à une vision plus classique qui conduit à prendre en compte les préoccupations environnementales (comprenant les préoccupations écologiques) dans les ensembles normatifs non environnementaux. C’est cette dernière acception qui correspond à l’objet de notre étude.
Cette exigence d’intégration a été formalisée en droit de l’urbanisme par la reconnaissance du concept de patrimoine commun de la nation et par la transposition du concept d’essence internationale de développement durable.
La difficile appréciation du concept patrimoine commun
La notion de patrimoine commun n’est pas aisée à définir d’autant, comme le précise Jérôme FROMAGEAU, que son analyse diachronique demeure limitée du fait de sa naissance récente73.
Elle est apparue en droit international à travers le discours à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (O.N.U.) du représentant de Malte, Arvid PARDO, prononcé en 196774. Du fait de l’intérêt suscité, la première formulation de ce concept, dans un texte international, interviendra en 1970 par le biais de la résolution 2749 (XXV) de l’Assemblée générale de l’O.N.U.75, position qui sera confirmée sur ce thème par l’article 136 de la convention de Montego Bay76 qui affirme que « la Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l’humanité »77. En 1979, l’accord concernant la Lune et les autres corps célestes précisait que la Lune et ses ressources constituaient le patrimoine commun de l’humanité.
On perçoit, dans ces deux textes, la double consistance de ce patrimoine qui est la fois basée sur des considérations écologiques (fonds marins, Lune) et environnementales (les ressources pouvant être extraites). Il n’y a donc pas en droit international de réelle définition de ce concept, mais uniquement l’affirmation que certains biens entrent dans ce patrimoine.
La vision française reprend cette approche. En effet, la mention de l’existence d’un patrimoine commun de la nation dans le Code de l’urbanisme relève de l’article 35 de la loi du 7 janvier 198378. Le législateur n’a pas souhaité apporter une définition juridique pour clarifier ce concept, que ce soit au moment de l’adoption de cette loi ou postérieurement et s’est borné à affirmer qu’il était composé du territoire français. Néanmoins, une liste d’éléments constitutifs du patrimoine commun de la nation est apparue à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement en 199579, complétée en 199680. Cet article précise que « les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation ». Le concept regroupe ainsi des composantes tant écologiques qu’environnementales. Pourtant, on ne saurait se satisfaire d’une liste pour définir un concept.
La difficulté de la définition juridique du concept de patrimoine commun provient notamment de son origine « privatiste ». Gérard CORNU définit le patrimoine, dans son acception civiliste, comme « englobant tous les droits d’ordre pécuniaire » d’une personne81 (constituant l’actif et le passif). L’acception publiciste du patrimoine, quant à elle, s’accommode mal de cette vision, tant il est vrai que certains éléments de la nature ne semblent pouvoir être appropriés. Comme l’évoquait déjà CICERON, « vous n’empêcherez pas le fleuve de couler, parce qu’il est bien commun à tout le genre humain »82. Concernant la nature, comme le décrit Martine RÉMOND-GOUILLOUD, on rencontre toutes sortes de biens qui entrent dans la composition du patrimoine commun et pouvant être qualifiés soit de chose commune ou « res communis qui désigne un volume, un contenant, tels l’air, la mer » ou de chose sans maître ou « res nullius [qui] désigne les espèces qui s’y trouvent, le contenu »83. Ainsi le parallèle entre les deux acceptions paraît difficile à maintenir.
Si l’on se réfère aux origines latines du mot patrimoine (patrimonium), on découvre qu’il signifie « biens hérités du père »84. La définition imagée de Martine RÉMOND-GOUILLOUD convient parfaitement à cette acception du patrimoine, éloignée de la perception pécuniaire civiliste. Elle décrit le patrimoine comme étant « un coffre, où chaque époque serre ses valeurs en vue de les perpétuer »85.
Cette vision trouve un écho particulier auprès de Michel PRIEUR qui établit une définition du patrimoine commun plus en phase avec la réalité juridique que celle qui consiste à se servir des bases du droit civil. Pour cet auteur, « le patrimoine commun représente un intérêt collectif à la préservation d’une richesse d’ordre culturel ou naturel, léguée par nos prédécesseurs et qu’il convient de transmettre intacte aux générations qui nous suivent »86. Ces deux approches sous-entendent la nécessaire protection des biens qui ont été mis dans le « coffre », qui sont considérés comme faisant partie du patrimoine commun. On s’éloigne ainsi de la nécessaire appropriation des biens constituant un patrimoine puisque la protection peut s’exercer même en l’absence de toute appropriation.
Le problème du rattachement du patrimoine commun au concept de nation
Le rattachement de ce patrimoine commun à la nation soulève, lui aussi, de nombreuses difficultés. En effet, le concept même de patrimoine suggère, selon la célèbre théorie de Charles AUBRY et Charles Frédéric RAU, l’existence d’un titulaire, puisque, pour ces auteurs, le patrimoine est une émanation du sujet de droit87. Le concept de patrimoine commun suppose donc que le titulaire dispose de la personnalité juridique. Or cette question soulève bien des interrogations pour la nation88 (tout comme l’humanité89) puisqu’il s’agit, ici, de prendre en compte les intérêts présents mais aussi ceux des générations à venir90. Ce qui permet à René-Jean DUPUY d’affirmer que le concept de patrimoine commun « repose sur une valeur mystique »91.
Si l’on se réfère à la définition du patrimoine commun donnée par Michel PRIEUR, éloignée de la perception purement civiliste, l’acquisition de la personnalité juridique par le titulaire de ce patrimoine ne semble plus être une absolue nécessité. En effet, l’auteur affirme que « si le patrimoine est commun, cela signifie qu’il n’y a pas un titulaire unique mais une sorte d’appropriation collective qui va nécessiter une représentation juridique au profit d’une entité agissant pour le compte de la collectivité »92. Ce qui suggère que la nation exerce le rôle de mandataire et non de titulaire, ce statut revenant aux citoyens composant la nation. Pour Jérôme FROMAGEAU, aussi, la notion de patrimoine commun rattaché à la nation implique que le patrimoine n’est pas rattaché à une personne déterminée93. Cette vision de la nation se rapproche de celle évoquée par Léon DUGUIT lorsqu’il affirme que la nation est moins une personne investie d’une conscience (..) qu’un milieu soudé par certains traits communs et spécifiques »94. Cette solution conduit à envisager le patrimoine commun comme indivis dont les bénéficiaires-titulaires seraient les membres présents et à venir de la collectivité formant la nation. On se rapproche alors de la théorie allemande du patrimoine d’affectation95. Selon cette théorie, l’unité du patrimoine ne dépend pas de la qualité de son titulaire mais du but auquel ce patrimoine est affecté96.
Michel PRIEUR ne consent qu’à opérer un seul parallèle entre la notion de patrimoine issue de la conception civiliste et celle de patrimoine commun, à savoir l’obligation « d’une gestion en bon père de famille ». Pourtant, Isabelle SAVARIT qualifie la notion de patrimoine commun de la nation de « potentiellement juridique »97. Il nous faut rechercher quels peuvent en être les effets.
|
Table des matières
Section 1 – Le principe d’intégration des préoccupations écologiques en droit de l’urbanisme : une effectivité nuancée
§1. Le processus de reconnaissance du principe d’intégration : des mouvements convergents
A. Une reconnaissance progressive en droit international
1. La lente émergence du principe d’intégration
a. L’émergence d’un principe d’intégration à la Conférence de Stockholm de 1972 souffrant d’une absence d’opposabilité
b. La consolidation du principe d’intégration et son rattachement au concept de développement durable à la conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement de 1992
2. La réaffirmation constante des principes entérinés par la conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement de 1992
B. La reconnaissance parallèle du principe d’intégration en droit communautaire
1. Une première reconnaissance par le biais des programmes d’action communautaires en matière d’environnement
2. Le renforcement de ce principe dans les traités communautaires
§2 . Les cadres conceptuels d’accueil du principe d’intégration en droit de l’urbanisme : patrimoine commun et développement durable
A. La contribution limitée du concept de « patrimoine commun de la Nation » en droit de l’urbanisme
1. L’introuvable définition
a. La difficile appréciation du concept patrimoine commun
b. Le problème du rattachement du patrimoine commun au concept de nation
2. La faible portée juridique
B. La modeste effectivité du concept de développement durable en droit de l’urbanisme
1. L’émergence tardive du concept en droit de l’urbanisme
2. La reconnaissance insatisfaisante par la charte de l’environnement
Section 2 – La technique juridique du zonage écologique : instrument privilégié de l’intégration en droit de l’urbanisme
§1. La technique juridique du zonage étendue à la protection écologique : une réalité polymorphe
A. L’application « originelle » de la technique du zonage par le droit de l’urbanisme
1. Une technique ancienne et prédominante dans l’application du droit de l’urbanisme
a. Le droit de l’urbanisme précurseur en matière de zonage
b. La permanence de l’utilisation de cette technique par le droit de l’urbanisme
2. Le paradigme de l’utilisation de la technique du zonage constitué par les documents d’urbanisme
a. Les critères d’identification des « documents d’urbanisme »
b. Des zonages créateurs de zonages
B. L’extension de la technique du zonage à la protection écologique
1. Un concept flexible de zonage dont le caractère écologique apparaît délicat à appréhender
a. Un concept flexible de zonage
b. Une qualification « écologique » délicate à appréhender
2. Le caractère polymorphe de la technique juridique du zonage écologique
§2. La technique juridique du zonage vecteur d’intégration des préoccupations écologiques en droit de l’urbanisme : l’influence de la décentralisation
A. Les fondements du principe d’intégration des préoccupations écologiques en droit de l’urbanisme antérieurs à la décentralisation
1. L’intégration au service de la protection écologique de la montagne et du littoral
a. La reconnaissance juridique de la sensibilité écologique de la montagne
b. La reconnaissance de la nécessaire protection du littoral
2. L’intégration née de la protection de certains espaces particuliers des départements et des communes renforcée par la décentralisation
a. La protection des périmètres sensibles de certains départements
b. L’instauration de zones d’environnement protégé dans les communes rurales
B. Le renforcement ultérieur du principe d’intégration des préoccupations écologiques en droit de l’urbanisme par le recours prédominant aux zonages écologiques
1. L’impact de la décentralisation
2. Le recours prédominant aux zonages écologiques
– PREMIÈRE PARTIE – L’INTÉGRATION PAR « GÉNÉRATION » DE ZONAGES ÉCOLOGIQUES EN DROIT DE L’URBANISME : UNE DÉCENTRALISATION LACUNAIRE
– CHAPITRE PREMIER – UNE DÉCENTRALISATION INCOMPLÈTE : L’ABSENCE DE TRANSFERT DE COMPÉTENCES POUR LA PROTECTION DE CERTAINS TERRITOIRES
Section 1 – La planification réglementaire imposée aux collectivités territoriales : les zonages écologiques de montagne et du littoral
§1. La création de « zonages écologiques principaux » en montagne et sur le littoral par le législateur
A. La prescription de zonages principaux aux communes : la difficile définition de l’applicabilité des lois montagne et littoral
1. Un mode de définition des zones de montagne détaché de la qualité intrinsèque du milieu
a. Une définition économique et géographique de secteurs constituant les zones de montagne
b. Le rattachement géographique des zones de montagne à des massifs
2. Un mode de définition des zones littorales prenant en compte le caractère écologique du milieu : le faible choix des communes
a. Un mode de définition des zones littoral reposant sur la contrainte des communes riveraines de la mer ou de certains étangs et lacs
b. Un mode de définition des zones littoral reposant sur la contrainte ou l’autodétermination des communes participant aux équilibres économiques et écologiques littoraux ?
B. Une protection imposée par une réglementation spécifique de l’urbanisme communal
1. L’urbanisation en continuité dans les zones de montagne et les communes littorales
a. Une obligation commune aux différents zonages
b. Des exceptions liées au développement économique de ces zones ou à certaines activités
2. Les obligations complémentaires prévues pour les zones littorales
a. Le respect du principe général d’équilibre
b. L’obligation des communes d’aménager des coupures d’urbanisme
§2. La sujétion des autorités locales dans l’édiction de zonages écologiques complémentaires
A. L’instauration par le législateur de zonages écologiques complémentaires contraignants
1. La mise en place de zonages écologiques spécifiques au milieu montagnard
a. L’inconstructibilité d’une bande de 300 mètres des rives de certains plans d’eau
b. La préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques montagnards
2. La mise en place de zonages écologiques littoraux plus contraignants
a. La bande des 100 mètres
b. Les espaces proches du rivage
B. L’instauration obligatoire de zonages écologiques complémentaires par la commune
1. L’obligation pour la commune de définir des zonages écologiques spécifiques
a. La compétence liée des communes dans la détermination des espaces boisés les plus significatifs
b. La compétence liée de la commune dans la détermination des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral
2. Les régimes dérogatoires, source de pouvoir discrétionnaire, des départements d’outre-mer prévus par la loi littoral
a. L’adaptation de la bande côtière : de faibles prescriptions
b. L’adaptation des espaces proches du rivage : l’absence de l’obligation d’urbanisation limitée
Section 2 – La planification stratégique mise en place par l’administration centrale : les zonages écologiques de protection d’espaces soumis à des enjeux particuliers
§1. La compétence de l’État dans la détermination de ces outils
A. Une application territoriale indépendante du découpage administratif existant
1. La compétence de l’État dans la définition de l’application territoriale des DTA : la planification de vastes espaces
2. La compétence de l’État dans la définition de l’application territoriale des S.M.V.M. : la planification d’espaces étroits
B. La participation des collectivités territoriales à la procédure
1. L’association des collectivités territoriales dans la procédure de mise en place d’une D.T.A
2. L’importance des communes dans la mise en place d’un S.M.V.M
§2. La compétence de l’État dans la prescription de règles contraignantes aux collectivités territoriales
A. La prescription de zonages aux règles particulières et l’adaptation des lois dans les zones montagne et littoral
par les D.T.A.
1. La prescription des orientations et des principaux objectifs de l’État en matière d’aménagement et de protection des espaces
2. L’adaptation des modalités d’application des lois montagne et littoral aux particularités locales
B. La prescription de zonages de protection et des limitations de l’urbanisme par les S.M.V.M.
1. La prescription de zonages écologiques
2. La possible prescription de zones limitant l’urbanisation
– CHAPITRE SECOND – UNE DÉCENTRALISATION IMPARFAITE : DE LA DÉPENDANCE DU DÉPARTEMENT À L’ENCADREMENT DE LA COMMUNE
Section 1 – Une décentralisation départementale « sous dépendance » en matière de protection des espaces naturels sensibles
§1. Une dépendance importante pour l’exercice d’un mode d’acquisition particulier : la préemption
A. Le département : un acteur principal dépendant
1. L’apparente liberté du département
a. Le département titulaire de plein droit
b. Le financement des prérogatives du département
2- Une dépendance importante
a. La soumission partielle aux documents d’urbanisme
b. Le régime des autorisations nécessaires à l’exercice de la politique des espaces naturels sensibles
B. Les autres acteurs du droit de préemption : l’influence du département
1. Des titulaires de second rang par volonté du département
a. Un titulaire du droit de préemption particulier : le conservatoire de l’espace littoral et des rivages
lacustres
b. Des titulaires secondaires nombreux et dépendants de la volonté du département
2. Les autres acteurs non-titulaires du droit de préemption : la confrontation avec le département
a. Le propriétaire d’un bien, déclencheur de la procédure de préemption
b. Les titulaires de droit de préemption concurrents
b.1. Le droit de préemption dans les zones d’aménagement différées
b.2. Le droit de préemption urbain
b.3. Le droit de préemption des espaces agricoles et naturels périurbains
§2. La dépendance partielle dans l’exercice d’un mode de protection double : de la domanialisation à la réglementation
A. La protection autonome par incorporation des espaces naturels sensibles au domaine public : la maîtrise foncière
1. L’imprécision des critères de détermination des espaces naturels sensibles pouvant faire l’objet d’une préemption
a. L’impossible définition de la nature des espaces concernés
b. Le déclin de l’obligation d’ouverture au public
2. Le respect de l’autonomie à travers le régime applicable aux biens concernés
a. L’incorporation au domaine public par application des critères jurisprudentiels
b. Les protections importantes liées à l’incorporation au domaine public et à la volonté du département
B. La protection autorisée pour la réglementation des espaces naturels sensibles : la préservation de la qualité des espaces
1. La protection des espaces sensibles non acquis par transfert autorisé de compétences des communes dépourvues de P.O.S. ou de P.L.U.
a. L’autorisation de la protection des espaces naturels sensibles sur l’ensemble du territoire du département
b. L’autorisation de la protection spécifique dans les zones de préemption
2. La réglementation difficile des espaces naturels acquis
a. La faible consistance des règles imposées par le code de l’urbanisme
b. Des modes de gestion des terrains acquis non prévus
Section 2 – Une décentralisation encadrée au détriment des communes
§1. Le choix de la commune dans la mise en place des zonages de protection des milieux naturels des P.L.U
A. L’autonomie de la commune dans la mise en place des zones de base : la création des zones naturelles
1. Les options initiales des communes
a. Le choix de l’organe
b. La détermination des ambitions de la commune dans le projet d’aménagement et de développement durable
2. La liberté de la commune dans la définition des zones et des prescriptions relatives à la protection écologique
a. Un choix important de protection par le zonage
a.1. Le P.O.S. et l’existence confuse de plusieurs zones naturelles
a.2. La clarification sémantique et contextuelle des zonages apportée par le P.L.U.
b. Les règles pouvant être affectées aux zones
b.1. Les prescriptions
b.2. Le coefficient d’occupation des sols
B. L’autonomie de la commune dans la mise en place de zonages complémentaires
1. La libre protection des espaces naturels
a. Les zonages de protection d’espaces naturels
b. Les zones de luttes contre le morcellement des espaces naturels
2. La libre protection des espaces « chlorophylliens »
a. La protection des espaces verts
b. La protection des espaces boisés classés
§2. L’encadrement de l’État dans la mise en place des zonages de protection des milieux naturels des P.L.U
A. L’encadrement du P.L.U. par l’État
1. L’encadrement de l’État dans l’élaboration d’un P.L.U.
a. La participation obligatoire de l’État : le « porter à connaissance »
b. La participation volontaire de l’État : l’association et la collaboration
2. L’intervention de l’État dans le temps
B. La soumission des communes à certains projets de l’État
1. La soumission de la commune à une déclaration d’utilité publique
a. L’objet de la déclaration d’utilité publique
b. La mise en conformité forcée du P.L.U.
2. La soumission de la commune à l’instauration d’une zone d’aménagement différé
a. L’objet de l’instauration de cette zone
b. Une mise en place de ces zones imposée aux communes
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE
– SECONDE PARTIE – L’INTÉGRATION PAR « INCORPORATION » DE ZONAGES ÉCOLOGIQUES EN DROIT DE L’URBANISME : UNE HIÉRARCHISATION COMPLEXE DES NORMES
– CHAPITRE PREMIER – UNE HIÉRARCHISATION ATYPIQUE DES ZONAGES ÉCOLOGIQUES EN DROIT DE L’URBANISME
Section 1 – L’identification d’une hiérarchie entre de nombreux zonages écologiques et le droit de l’urbanisme
§1. Une indépendance des législations relative entre les zonages écologiques non issus du Code de l’urbanisme et le droit de l’urbanisme
A. Un principe devant aboutir à une absence de liens entre les zonages écologiques étrangers au Code de l’urbanisme et le droit de l’urbanisme
1. Un principe jurisprudentiel d’application constante en droit de l’urbanisme
2. Un principe devant faire obstacle à l’existence de relations entre les zonages écologiques étrangers au Code de l’urbanisme et le droit de l’urbanisme
B. L’instauration de passerelles entre les législations en matière de zonage écologique et de droit de l’urbanisme
1. L’instauration de passerelles permettant un renforcement de l’application des normes internationales et communautaires
a. L’application du droit international et communautaire par l’instauration ou l’adaptation de zonages écologiques nationaux
a.1. L’application du droit international par l’adaptation de zonages écologiques nationaux
α. Les modalités de réception du droit international en droit interne
β. L’influence des modalités de réception du droit international sur l’instauration de zonages
écologiques
a.2. L’application du droit communautaire par l’instauration de zonages écologiques nationaux ….. 294Table des matières
α. Les modalités de réception du droit communautaire en droit interne
β. L’influence des modalités de réception du droit communautaire sur l’instauration de zonages écologiques
b. L’application indirecte de ces normes à travers l’instauration de passerelles entre les zonages écologiques internes et le droit de l’urbanisme
b.1. L’instauration de passerelles entre les zonages Natura 2000 et le droit de l’urbanisme
b.2. L’instauration de passerelles entre les zonages internes appliquant les normes internationales et le droit de l’urbanisme
2. La matérialisation des « passerelles » principalement dans les Code de l’urbanisme et de l’environnement
a. L’instauration de passerelles par le Code de l’urbanisme ou le Code de l’environnement
b. L’instauration concomitante de passerelles par les Code de l’urbanisme et de l’environnement
§2. Une hiérarchie partielle non pyramidale : l’existence de « points de contact » entre des normes issues de différentes branches du droit
A. La caractérisation de l’existence d’une hiérarchie
B. La remise en cause du modèle pyramidal classique par l’existence « de points de contact » entre le droit de l’urbanisme et les autres branches du droit
1. L’impossible identification du caractère pyramidal de la hiérarchie du droit de l’urbanisme
2. La caractérisation de l’existence d’une hiérarchie du droit de l’urbanisme en rhizome
Section 2 – La caractérisation d’une hiérarchie matérielle basée sur une formation du droit par degrés
§1. L’insuffisance des critères organique et formel pour caractériser la hiérarchie des zonages écologiques en droit de l’urbanisme
A. L’inapplicabilité d’un critère organique
1. L’inapplicabilité du fait de l’absence de hiérarchie des autorités décentralisées
2. L’inapplicabilité du fait de l’existence de co-auteurs d’actes juridiques
B. L’inapplicabilité du critère formel
1. L’inapplicabilité du critère basé sur la forme de l’acte
2. L’inapplicabilité du critère procédural
§2. Le nécessaire recours au critère matériel et à la théorie de la formation du droit par degrés pour caractériser la hiérarchie en droit de l’urbanisme
A. L’identification d’une hiérarchie matérielle impliquant la soumission des autorisations d’occuper le sol aux documents d’urbanisme et aux zonages écologiques
1. Le recours au concept matériel des normes
a. L’avènement doctrinal du critère matériel antérieurement à la Constitution du 4 octobre 1958
b. L’ordonnancement prévue par la Constitution du 4 octobre 1958 confirme l’établissement d’une hiérarchie matérielle des normes
2. La soumission des autorisations d’occupation du sol à l’ensemble des normes matérielles de la hiérarchie
a. La théorie de Roger BONNARD
b. L’application en droit de l’urbanisme : l’exemple de la soumission des permis de construire aux
dispositions des documents d’urbanisme locaux et des zonages écologiques
B. L’adjonction de la théorie de la formation du droit par degrés pour déterminer la place des normes dans la hiérarchie
1. L’existence d’un lien d’exécution entre les normes de la hiérarchie
a. La typologie de Jean-Claude VENEZIA
b. La caractérisation de l’existence de cette typologie dans la hiérarchie des zonages écologiques en droit de l’urbanisme
2. La pertinence du critère de concrétisation des normes dans l’affectation d’une valeur aux différentes normes de la hiérarchie
a. Une double concrétisation
a.1. La concrétisation géographique
a.2. La concrétisation sémantique
b. La concrétisation des normes comme moyen de déterminer leur valeur
– CHAPITRE SECOND – UNE LÉGALITÉ MULTIFORME DES NORMES DOMINÉE PAR LA DÉTERMINATION DE LEUR SUBSTANCE
Section 1 – L’établissement d’un rapport entre les différentes composantes de la hiérarchie en droit de l’urbanisme : une graduation complexe du lien normatif
§1. Une graduation complexe des normes issue d’un rapport normatif unique
A. Une double vision doctrinale du rapport normatif
1. La doctrine « classique » : la multiplicité des rapports normatifs
2. La doctrine « moderne » : l’unicité du rapport normatif
B. L’intensité du lien normatif : Une graduation importante et complexe
1. L’intensité variable du lien normatif : de la conformité à la prise en compte ou en considération
a. La forte intensité du lien de conformité
b. la récente définition jurisprudentielle de la prise en compte ou en considération
2. La complexité de l’approche du lien médian prédominant : la compatibilité
a. Une définition doctrinale constante
b. la difficile perception des frontières de cette notion
§2. Les variations complexes du lien normatif multiforme en droit de l’urbanisme basées sur la substance de la norme supérieure
A. La détermination du lien normatif en droit de l’urbanisme : une variation en fonction de sa substance
1. La difficile détermination de l’intensité des différents liens normatifs en droit de l’urbanisme
a. L’application très contraignante du lien normatif par le juge
b. L’application peu contraignante du lien normatif par le juge
2. La prédominance du lien de compatibilité dans la classification reposant sur le degré de complétude et de précision de la norme supérieure
B. L’aménagement de la hiérarchie des normes en droit de l’urbanisme par la limitation du rapport normatif à la seule norme supérieure : une « simplification » complexe
1. Un principe législatif non appliqué par la jurisprudence
2. La complexité de l’application de la limitation du rapport normatif à la seule norme supérieure pour les documents ayant valeur de D.T.A.
Section 2 – L’effectivité du rapport normatif entre les différentes normes de la hiérarchie : des variations dépendantes de l’État et de l’étendue du lien normatif
§1. L’effectivité non juridictionnelle du rapport normatif entre les documents locaux d’urbanisme et les zonages écologiques : la prééminence de l’État
A. Le rôle de l’État et de l’auteur des normes supérieures dans l’effectivité du rapport normatif avant son adoption
1. La recherche de l’effectivité du rapport normatif par l’obligation du « porter à connaissance » reposant sur l’État
2. La recherche de la participation de l’auteur de la norme supérieure
B. Le rôle de l’État garant dans l’effectivité du rapport normatif après son adoption
1. La fixation de différents délais pour garantir l’effectivité du rapport normatif par l’auteur du P.L.U
2. L’effectivité du rapport normatif assuré par l’État
§2. La création et la contestation du rapport normatif entre documents locaux d’urbanisme et zonages écologiques : la prééminence de la substance du lien normatif
A. L’autonomie dépendante de l’intensité du lien normatif de l’auteur dans l’élaboration des dispositions d’une norme
1. L’autonomie de l’auteur de la norme : une graduation du pouvoir discrétionnaire
a. La difficile mesure d’une graduation basée sur le degré de détermination de la norme supérieure
b. Le pouvoir discrétionnaire de l’auteur d’un P.L.U. oscillant en fonction des différentes mesures
envisagées et du contenu de la norme supérieure
2. La possible limitation du pouvoir discrétionnaire issue des conditions de mise en place de la norme : la codécision
B. L’étendue variable du contrôle du juge dépendant de l’intensité du lien normatif
1. Le contrôle normal du juge en présence de dispositions précises de la norme supérieure ou pour
l’appréciation de l’application de certains concepts
a. Le contrôle normal « classique » dans l’application de certaines dispositions des lois montagne et littoral
b. Le contrôle normal approfondi de la théorie du bilan pour les opérations complexes d’urbanisme
constituant une limitation du pouvoir discrétionnaire
2. Le contrôle restreint du juge pour les dispositions peu précises ou moins contraignantes des normes supérieures, la possible évolution du contrôle du lien normatif des documents d’urbanisme
a. L’application classique du contrôle restreint du contenu des documents d’urbanisme dans la confrontation avec la réalité de l’existant
b. La difficile perception de l’étendue du contrôle de la compatibilité
– CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE –
– CONCLUSION GÉNÉRALE –
– BIBLIOGRAPHIE –
Télécharger le rapport complet