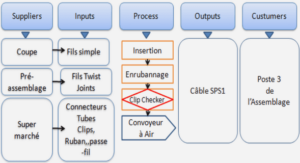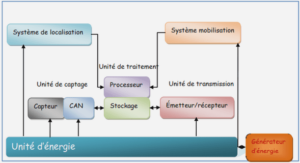L’ingénierie du vivant
Les normes et la spécificité de la connaissance du vivant
Si l’exigence vitaliste doit précéder la raison et la connaissance elle-même, comment une science du vivant est-elle alors possible ? La biologie contemporaine, avec l’avènement de a biologie moléculaire, a plutôt eu tendance à affiner l’analyse des constituants de l’organisme, ce qui à première vue entre en contradiction avec l’idée d’une reconnaissance de l’originalité de vivant. Comment, dans ce cas, l’objectivité de la connaissance rejoint-elle le vivant?
Les lois, dans la tradition scientifique, posent un monde dont la matière est inerte, et viennent éliminer, en cherchant à s’étendre au vivant, cette apparente capacité des organismes à normaliser leurs conditions d’existence. Ce chapitre viendra préciser cette tendance à travers la notion centrale de normativité biologique. Pour Canguilhem, le concept de normativité est incontournable si l’on veut conférer un sens à tout discours concernant le vivant. Il est en quelque sorte à la biologie ce qu’un axiome est à la géométrie; il est un point de départ dont on ne peut se passer pour penser la vie. Guillaume Le Blanc écrit à ce propos, dans Canguilhem et les normes, « L’analyse philosophique de la vie ne peut se faire qu’à partir du concept de norme. Le concept de norme renvoie inévitablement à l’idée de vie. Le binôme vie, norme est donc indissociable. La vie est l’idée que le concept de norme permet de ressaisir » (Le Blanc, 2007, p.7). Une lecture de Canguilhem ne peut donc pas faire l’économie de ce concept.
La porte d’entrée qu’emprunte Canguilhem afin de décrire cette normativité vitale est l’expérience de la maladie. D’où l’importance de sa thèse de médecine qui est aussi son œuvre la plus connue, l’Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique, qui montre notamment comment la maladie vient révéler l’effort du vivant qui consiste à instituer des normes et corrélativement à conférer un sens à son existence. Deux interrogations philosophiques sous-tendent cette œuvre : d’une part celle qui concerne les normes et le normal, et d’autre part la nature des rapports entre science et technique. On comprend dès lors l’intérêt authentiquement philosophique de Canguilhem pour la médecine, qui loin d’être comprise uniquement comme une science théorique, est aussi et surtout selon lui une technique prolongeant cet effort vital. La médecine, en tant qu’elle est située carrefour entre la science, la technique et le vivant, est donc particulièrement apte à éclairer le problème que nous avons soulevé.
Cette section ne prétendra pas à une analyse intégrale de cette partie centrale de l’œuvre de Canguilhem qu’est Le normal et le pathologique, mais visera plutôt à relever les thèses essentielles qu’elle contient concernant la connaissance objective de la vie. Nous débuterons en montrant en quoi l’expérience de la maladie vient en effet révéler la normativité qui est essentielle au vivant, tout en expliquant pourquoi la pratique médicale ne peut en faire abstraction. Nous caractériserons ensuite cette normativité sur un plan plus conceptuel, à partir des distinctions établies dans Le normal et le pathologique. Nous pourrons alors le lien avec le problème qui nous intéresse en examinant comment cette normativité vient s’articuler aux sciences du vivant, notamment en ce qui a trait à la physiologie. Nous verrons enfin, à partir de ces considérations, pourquoi la médecine, selon Canguilhem, doit plutôt être rapprochée de la technique que de la science.
L’expérience du malade
Le normal et le pathologique est un livre qui peut être considéré comme fondateur de la philosophie biologique de Canguilhem, car il marque le début d’une réflexion générale sur les relations entre les sciences et le vivant. Il contient deux études assez éloignées l’une de l’autre, soit l’Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique, thèse de doctorat de médecine publiée en 1943, et les Nouvelles réflexions concernant le normal et le pathologique, une série de textes publiée vingt ans plus tard dans le cadre d’une réédition de cette thèse. Nous nous attarderons pour commencer sur la première partie de l’Essai, qui porte sur l’analyse de ce que Canguilhem nomme le « dogme positiviste » de la médecine expérimentale.
Ce dogme, présenté à travers les écrits de Claude Bernard et d’Auguste Comte, consiste à affirmer, suivant le « principe de Broussais », que l’état normal et l’état pathologique ne diffèrent que par une variation quantitative. Emprunté au médecin français François Broussais (1772-1838), ce principe servira explicitement à Comte non seulement pour affirmer sa conception du vivant et de la maladie, mais aussi pour justifier sa philosophie politique27. Suivant ce principe, la maladie est avant tout conçue comme une altération mesurable s’éloignant, par l’excès ou par le manque, d’un juste milieu qui constituerait l’état normal. Or, il s’agit pour Canguilhem d’un « dogme positiviste » dans la mesure où le positivisme, tel que théorisé par Comte, cherche à fonder le discours philosophique sur les méthodes expérimentales de la science, en se débarrassant par le fait même de toute autre forme de spéculation. De même, Bernard et Comte entendent par ce principe écarter les appréciations qualitatives ou finalistes du discours médical afin d’en faire véritablement une science appliquée. Canguilhem montre qu’en défendant cette idée d’une identification du normal et du pathologique, Comte et Bernard entendent avant tout affirmer un primat de l’objectivité et de la rationalité scientifique dans la compréhension des maladies. Réduire la maladie à une mesure, c’est permettre une interprétation scientifique du corps malade conçu comme une machine défaillante.
La thèse que soutient ici Canguilhem est que dans la mesure où ils confèrent une priorité à la physiologie et à l’expérimentation, Comte et Bernard retirent par le fait même l’importance de l’expérience vécue du malade. En effet, en envisageant la médecine comme une science positive, tous deux sont moins enclins à voir dans la maladie un état qualitativement nouveau qu’une simple variation mesurable. Dans le cas d’Auguste Comte, la maladie est envisagée comme un outil de compréhension permettant à l’expérimentateur de déduire les « lois » d’une physiologie normale : « (…) l’étude scientifique des cas pathologiques devient un moment indispensable de toute recherche des lois de l’état normal » (Canguilhem, 2013, p. 27); alors que pour Claude Bernard, l’étude du normal constitue un moyen de trouver scientifiquement les moyens d’intervenir sur l’état pathologique : « Dans les sciences, c’est la théorie qui éclaire et domine la pratique. La thérapeutique rationnelle ne saurait être portée que par une pathologie scientifique et une pathologie scientifique doit se fonder sur la science physiologique » (Canguilhem, 2013, p.43). Dans les deux cas, la maladie ne diffère de l’état normal que par une variation quantitative, au même titre qu’un mécanisme ne sera plus fonctionnel s’il varie trop de son état standard. Une pathologie n’est plus alors qu’une défectuosité de l’organe analogue à la défectuosité d’une machine; elle peut être expliquée par la mesure et réparée par une approche rationnelle. Il résulte de ce point de vue que l’expérience subjective du malade, pour qui la maladie est essentiellement un état de bouleversements et d’angoisse, est évacuée au profit d’une méthode scientifique objectivante : « La conviction de pouvoir scientifiquement restaurer le normal est telle qu’elle finit par annuler le pathologique. La maladie n’est plus objet d’angoisse pour l’homme sain, elle est devenue objet d’étude pour le théoricien de la santé » (Canguilhem, 2013, p. 17).
Or, la caractérisation qualitative de la maladie via l’expérience vécue du malade est pour Canguilhem un fait irréductible. L’identification même de la maladie trouve toujours son origine dans une dépréciation subjective : « Le fait que santé et maladie fonctionnent comme des représentations « vulgaires » avant de pouvoir être érigées en concepts scientifiques, conduit la réflexion en deçà des discours, vers la réalité primitive de la maladie » (Le Blanc, 2007, p. 29). Ce n’est pas la science elle-même qui nous confère une représentation de la maladie, mais bien le sentiment d’un bouleversement qui précède toute analyse scientifique. D’ailleurs, ce n’est qu’une fois qu’il est tombé malade que l’individu, inversement, peut éprouver ce qu’est la santé. « La santé, écrit Canguilhem dans ses notes de cours, c’est l’innocence organique »28. Ce n’est donc d’abord que parce que l’être humain apprécie ou déprécie certains états que les concepts de maladie ou de santé acquièrent une signification. Canguilhem montre en ce sens que même Auguste Comte et Claude Bernard n’ont pu entièrement se passer de cet aspect qualitatif, « primitif », lorsqu’ils ont voulu identifier ce qui constituait une pathologie. Même lorsqu’une pathologie se prête bien à une analyse quantitative, comme dans le cas des expériences de Claude Bernard sur l’hyperglycémie, c’est néanmoins toujours par rapport à une norme préalable que l’on définit ce qui constituera des variations par rapport à l’état normal: « C’est par rapport à une mesure jugée valable et souhaitable – et donc par rapport à une norme – qu’il y a excès ou défaut. Définir l’anormal par le trop ou le trop peu, c’est reconnaître le caractère normatif de l’état dit normal » (Canguilhem, 2013, p. 25).
Cette difficulté relevée par Canguilhem est en partie attribuable à l’équivocité inhérente au concept de « normal », qui peut recouvrir à la fois deux sens distincts. Cette ambiguïté est relevée dans la seconde partie de l’Essai (Canguilhem, 2013, p. 89) ainsi que dans l’article « Le normal et le pathologique » paru dans La connaissance de la vie (Canguilhem, 2003, p. 200). « Normal » peut en effet désigner d’une part un état de fait, c’est-à-dire une simple moyenne statistique déterminée avec objectivité; et d’autre part une conformité à un idéal, c’est-à-dire la correspondance à une norme subjective. Le terme « normal » est ainsi souvent employé avec ambiguïté, comme le montre son usage courant. Si l’on affirme par exemple d’un comportement ou d’un état qu’il est « normal », on peut signifier par là qu’il correspond à la moyenne d’une certaine population, mais bien souvent une telle affirmation implique également une valorisation, parfois implicite, de cet état. Or, la médecine telle qu’elle est envisagée par Auguste Comte et Claude Bernard maintient la confusion entre ces deux définitions. Le besoin de fonder scientifiquement et objectivement la médecine pousse ces derniers à tenter de réduire l’état « normal » à un fait quantitatif, mais ce faisant ils ne font qu’ignorer le fait que c’est plutôt le normal en tant qu’idéal qui définit l’objet même de la thérapeutique et qui guide la pratique médicale. Objectiver la maladie conduit ainsi à faire abstraction de ce qui lui donne un sens, c’est-à-dire la dépréciation primitive, vécue, d’un certain état physique.
On retrouve donc ici encore cette pensée fondamentale de Canguilhem selon laquelle la connaissance objective du vivant rencontre son principal obstacle dans le fait que la vie consiste à valoriser certains aspects de l’expérience. S’il n’y avait que des états de faits, il n’y aurait ni maladie, ni médecine. Ni même de santé d’ailleurs, puisque le vivant serait indifférent aux transformations physico-chimiques de ses constituants. Canguilhem écrit ailleurs dans ses notes : « (…) les concepts de santé et de maladie sont concepts normatifs, car les façons de vivre qu’ils désignent ne sont pas des états, c’est-à-dire des faits, mais des prises de positions, c’est-à-dire des valeurs. »29 Voilà ce qui, précisément, problématise la connaissance du vivant et la rend fondamentalement différente des sciences physiques ou chimiques. En effet, comme nous le verrons maintenant, une norme se prête moins aux exigences d’une analyse que ne peut le faire par exemple une loi mécanique.
La normativité vitale
La conception de la maladie que nous avons décrite met en lumière une tension entre objectivité et subjectivité que nous avons déjà pu apercevoir au premier chapitre en traitant des lois de la nature posées par la philosophie mécaniste. Les lois de la Nature, dont l’idée même est née avec la science moderne, posent des états de fait. Elles caractérisent le monde par des principes généraux qui sont vrais de tout temps et en toute circonstance. L’idée de loi est ainsi la condition première d’une connaissance objective du monde physique. Les normes, cependant, diffèrent en ce qu’elles expriment ce qui pourrait être autrement. Elles confèrent un sens et « exigent » que les choses tendent vers ce sens. Comme l’écrit Guillaume Le Blanc, « si tout était normal dès le départ, les normes seraient remplacées par des lois » (Le Blanc, 2007, p.19). C’est pourquoi Canguilhem peut définir les normes comme étant, dans leur essence même, une insatisfaction à l’égard de l’expérience.
La « normativité vitale », c’est-à-dire la capacité de la vie à instaurer de nouvelles normes, est ce qui caractérise selon Canguilhem la vie en général. Ce qui est important de noter ici, c’est que cette normativité n’est pas seulement issue d’une volonté ou d’une conscience, mais est inhérente aux phénomènes biologiques eux-mêmes. Cette thèse est loin d’être banale, et Canguilhem en est conscient lorsqu’en la formulant il se défend d’être anthropomorphiste : « Nous ne prêtons pas aux normes vitales un contenu humain, mais nous nous demandons comment la normativité essentielle à la conscience humaine s’expliquerait si elle n’était pas de quelque façon en germe dans la vie » (Canguilhem, 2013, p. 103). Un phénomène aussi fondamental que la nutrition traduit par exemple déjà cette normativité d’ordre vital. D’un point de vue physico-chimique, aucune loi n’est violée lorsqu’un organisme subit un empoisonnement. Pourtant, d’un point de vue biologique, les changements physico-chimiques ayant alors lieu dans l’organisme sont tout sauf neutres; ils ont une valeur négative pour le vivant30. Or, cette finalité apparente ne réside pas seulement dans un jugement raisonné, mais est présente dans l’organisme lui-même. L’activité organique, dans sa relation à un milieu, déprécie ou apprécie des états de faits, et s’inscrit par le fait même dans le registre des normes plutôt que dans celui des lois. Traduire en termes quantitatifs la différence entre la nutrition et l’empoisonnement ne suffit pas à en comprendre le sens, il faut une appréciation subjective pour que l’on puisse qualifier tel phénomène d’empoisonnement et donc lui attribuer une valeur négative. On peut, pour bien comprendre cette nuance, faire une analogie avec les phénomènes acoustiques: tout agencement de sons est neutre du point de vue acoustique, au sens où tous sont égaux à l’égard des lois physiques. Il y a pourtant une différence qualitative entre une cacophonie, une fugue de Bach et le bruit d’un moteur d’avion. De même, la conformité des phénomènes biologiques à l’égard de lois générales de la physique et de la chimie n’empêche pas que l’on observe, même dans le métabolisme le plus primitif, une tendance; c’est-à-dire un mouvement chargé de sens qui correspond plus à des normes plus qu’à des lois.
Cette différence fondamentale entre la vie et la matière avait déjà été relevée en d’autres termes par Xavier Bichat, dans un passage auquel Canguilhem fait référence en plusieurs endroits31. Bien que Bichat ne parle pas en termes de normes, il souligne que le fait pathologique révèle un « besoin » de l’organisme de tendre vers un certain état plus que vers un autre, et que ce besoin révèle l’irréductibilité du vivant – et de la médecine – aux lois de l’inertie :
Il y a deux choses dans les phénomènes de la vie, 1° l’état de santé, 2° celui de maladie : de là deux sciences distinctes ; la physiologie, qui s’occupe des phénomènes du premier état ; la pathologie, qui a pour objet ceux du second. […] La physiologie est aux mouvements des corps vivants, ce que l’astronomie, la dynamique, l’hydraulique, l’hydrostatique, etc., sont à ceux des corps inertes ; or, ces dernières n’ont point de sciences qui leur correspondent comme la pathologie correspond à la première. Par la même raison, toute idée de médicament répugne dans les sciences physiques. Un médicament a pour but de ramener les propriétés à leur type naturel ; or, les propriétés physiques, ne perdant jamais ce type, n’ont pas besoin d’y être ramenées. (Cité dans : Canguilhem, 1989, p. 549)
|
Table des matières
Introduction
Première partie
Chapitre 1 – Méthode mécaniste et exigence vitaliste : Le problème des relations entre la connaissance et la vie
La philosophie mécaniste
La théorie cartésienne des « animaux-machines »
La connaissance et la vie
L’exigence vitaliste
Conclusion
Chapitre 2 – Les normes et la spécificité de la connaissance du vivant
L’expérience du malade
La normativité vitale
Conséquences pour les sciences du vivant
La médecine comme technique : une critique du positivisme
Conclusion
Chapitre 3 – L’analogie technique et la connaissance du vivant
Mécanisme et finalité
L’origine vitale des machines
Plasticité et rigidité : le continuum entre l’organisme et la machine
Le rôle des modèles techniques : du mécanisme à la cybernétique
Conclusion
Deuxième partie
Chapitre 4 – L’ingénierie du vivant
De l’étude du vivant à sa synthèse
Extraire la complexité du vivant
Un exemple de réduction de la complexité: la standardisation du vivant
Quelle vision de la technique pour la biologie de synthèse?
Conclusion
Chapitre 5 – Entre connaissance et savoir-faire
Le bricolage de l’ingénieur
La nature contre l’ingénieur?
La biologie de synthèse au-delà des machines
Plasticité et biologie de synthèse
Conclusion
Conclusion – Remettre le mécanisme à sa place « dans la vie et pour la vie »
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet