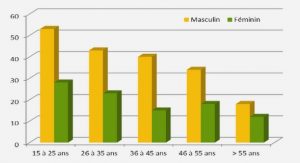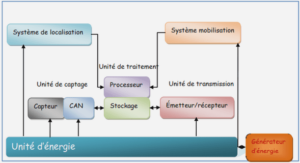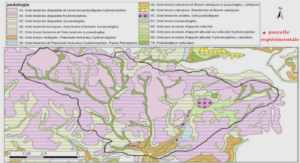Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Aux marges de l’anthropologie de la nature
Approches diverses des relations société-environnement
L’intérêt des anthropologues et des ethnologues français pour les questions des rapports entre les sociétés et leurs univers n’est pas récent ni « vierge » (Demeulenaere, 2017) et si l’historiographie se concentre sur le courant majeur porté par Philippe Descola et le laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France, d’autres courants ont abordé ce thème comme l’expose l’anthropologue Élise Demeulenaere (Ibid). Dans les années 1960, les débats en anthropologie sont dominés par les controverses entre marxisme et structuralisme et la notoriété de Claude Lévi-Strauss occulte les travaux portés par l’anthropologue Maurice Godelier qui s’intéresse entre autres aux conditions de reproduction des systèmes sociaux.
Parallèlement au Muséum national d’histoire naturelle, l’intérêt pour l’ethnobotanique est porté par Auguste Chevalier puis André-Georges Haudricourt. L’histoire de ce Laboratoire aujourd’hui, nommé Eco-anthropologie et d’ethnobiologie, est détaillée par Serge Bahuchet et Bernadette Lizet en 2003 (Bahuchet & Lizet, 2003), et plus récemment par Carole Brousse (Brousse, 2014). La dynamique portée par l’ethnobotaniste Roland Portères amène à la création du Journal d’agronomie tropicale et de botanique appliquée (JATBA) qui deviendra la Revue d’ethnoécologie et à un renouvellement des recherches. Si Claude Lévi-Strauss s’est intéressé aux ethnosciences, Jacques Barrau puis Claudine Friedberg, sensibilisés aux travaux de H. Conklin, vont en intégrant le laboratoire de Roland Portères reconceptualiser la méthodologie et le champ thématique à l’image des travaux de Claudine Friedberg sur les classifications. Si H. Conklin est l’initiateur de la démarche — partir des catégories sémantiques des indigènes pour étudier la connaissance qu’une société a de son environnement —, Claudine Friedberg la réactualise en lui apportant une dimension supplémentaire :
L’ethnoscience conjugue deux types d’analyses : selon l’une, il s’agit d’atteindre des catégories et des concepts implicites du point de vue de ceux qui les utilisent ; selon l’autre, on aborde les mêmes objets ou phénomènes à partir des catégories ou des concepts scientifiques. Pour distinguer ces deux approches, il semble préférable de parler d’analyse intérieure et extérieure n’impliquant aucune hypothèse à priori sur la nature de ce que l’on observe, plutôt que de se référer à l’opposition emic et etic ». (Friedberg, 1991a, p. 254).
partir des années 1980, plusieurs divergences apparaissent. L’ethnobotanique devient plus militante et associative, notamment emmenée par Pierre Lieutaghi qui va créer l’association Études Populaires et Initiatives (ÉPI) et mener une série d’enquêtes sur la médecine populaire par les plantes dans les Alpes-de-Haute-Provence. Il s’installe à Salagon, où il crée un musée et un séminaire dédiés à l’ethnobotanique. Carole Brousse (2014) en retraçant le parcours de ce dernier et son projet, souligne les divergences avec la discipline pratiquée au Muséum national d’histoire naturelle. L’école de Salagon va ouvrir ce champ aux amateurs passionnés, à d’autres institutions, mais aussi à d’autres thématiques délaissées par le MNHN. Ainsi, les définitions de l’ethnobotanique vont suivre dans le temps comme celle de P. Lieutaghi : « une ethnologie à velléités globales qui choisit de considérer les sociétés dans la plus large étendue possible de leurs relations avec le végétal et les milieux végétaux, dans la prise en compte des méthodes des sciences humaines aussi bien que des données naturalistes » (Lieutaghi, 200314, p. 42 citée par Brousse, 2014). Toutefois, il apparaît que l’ethnobotanique se veut très large et diversifiée allant d’une simple analyse de recettes à celle d’interactions bioculturelles, jusqu’à aujourd’hui, participer au développement des pays en promouvant de nouvelles espèces utiles tant alimentaires, matérielles, que pourvoyeuses de substances chimiques.
Parallèlement, au Collège de France, l’anthropologue Philippe Descola poursuit les travaux engagés par Maurice Godelier sur la dimension symbolique de la nature. Dès les années 1990, ses réflexions rejoignent les critiques sur la notion de nature et il formule alors des modèles analytiques des différents rapports entre les sociétés et leur environnement qu’il expose en 2005 dans son livre Par-delà nature et culture (Demeulenaere, 2017). Ces approches s’éloignent de celles issues de l’émulation de l’ethnoscience qui a conduit les recherches au sein du Muséum national d’histoire naturelle vers les questions de diversité bioculturelle et vers les politiques publiques et le développement durable (Ibid). D’autre part, le discours universaliste de P. Descola est un point fort de divergence à l’image de son approche autour de la catégorisation des objets naturels (Descola, 2005)
Catégorisation des objets naturels
Dans leurs travaux intitulés De quelques formes primitives de classification en 1903, le sociologue Emile Durkheim et l’anthropologue Marcel Mauss ont été les premiers à constater un découpage du monde en grandes catégories regroupant, les animaux, les plantes, les phénomènes naturels, mais aussi les hommes et leurs artefacts chez quelques ethnies australiennes (Durkheim & Mauss, 1903). Leur apport principal réside dans leur démonstration de l’existence d’une relation entre un système de classification et un système social. Ainsi, dans les sociétés étudiées, les systèmes de classification reflètent les systèmes de relations sociales dans lesquels ils sont (Friedberg, 1987). Les enquêtes sur les plantes et sur la perception de la couleur chez les Hanunóo (Conklin, 1955) sont considérées comme les plus marquantes pour l’ethnoscience. Dans ce dernier article, H. Conklin démontre que termes hanunóo des couleurs ne segmentent pas de la même manière le spectre de couleur que les termes de couleur en Occident. Ils intègrent des informations sensorielles supplémentaires, comme l’humidité et la sécheresse. En France, c’est Claude Lévi-Strauss qui n’utilisa jamais ce terme dans son ouvrage La pensée sauvage, mais qui s’en rapprocha le plus et qui aura une influence sur de nombreux travaux sur les classifications (Friedberg, 1987). En analysant les recherches menées par d’autres ethnologues, il montre l’étendue du savoir local que peuvent détenir les autochtones :
Un seul informateur séminole identifie 250 espèces et variétés végétales. On a recensé 350 plantes connues par les Indiens hopi, plus de 500 chez les Navaho. Le lexique botanique des Subanun qui vivent dans le sud des Philippines dépasse largement les 1000 termes et celui des Hanunoo, près de 2 000. M. Sillans a récemment publié un répertoire ethno-botanique de 1962, p. 16)
Le second apport de la réflexion de C. Lévi-Strauss est de mettre à mal la vision utilitariste de ces savoirs. Il avance que :
Les espèces animales et végétales ne sont pas connues, pour autant qu’elles sont utiles : elles sont décrétées utiles ou intéressantes, parce qu’elles sont d’abord connues. » (Levi-Strauss, 1962, p. 21)
Pour illustrer ses propos, il s’appuie notamment sur les travaux de Franck Speck qui a révélé chez Indiens du nord-est des États-Unis, une herpétologie15 d’une grande précision. Ils possèdent des termes distincts pour chaque genre de reptile et pour les espèces ou les variétés alors qu’ils n’offrent aucun intérêt économique, alimentaire et symbolique pour eux (Speck, 1923).
Dans les années 1960 et 1970, l’approche des classifications vernaculaires va connaître une nouvelle orientation qui va entraîner une scission dans la communauté de l’ethnoscience, avec d’un côté les universalistes et de l’autre les relativistes. Dans leur ouvrage Basic color termes, their universality and evolution, l’anthropologue Brent Berlin et le linguiste Paul Kay présentant leur étude sur les catégories de couleurs (Berlin & Kay, 1969) dessinent les tendances universalistes — la recherche d’universaux dans les systèmes classificatoires — qui vont animer l’ethnoscience. Quelques années après, Brent Berlin va poursuivre son travail sur les principes vernaculaires de classification botanique et zoologique partir des travaux chez les Tzeltals du Chiapas au Mexique (Berlin, 1992; Berlin et al., 1973). Pour les universalistes, les classifications vernaculaires des objets naturels possèdent des caractéristiques propres et notamment une structure hiérarchisée en six niveaux : unique beginner (englobant), life form (forme de vie), intermediate (intermédiaire), generic (générique), specific (spécifique), et varietal (variétal), finalement analogue de celle des taxinomies scientifiques.
Ces approches sont celles privilégiées par P. Descola (Descola, 2005). À l’opposé, les relativistes considèrent que les classifications vernaculaires ont un intérêt uniquement dans leur contexte socioécologique et qu’elles permettent d’appréhender les pratiques, les savoirs et les représentations. Ce courant a été défendu par l’ethnobiologiste Ralph Bulmer qui effectua un très long travail avec les Kalam en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Bulmer, 1967) et en Nouvelle-Zélande puis par l’ethnobiologiste Peter Dwyer (Dwyer, 2005). Si leurs débats marquèrent la phase II de l’ethnoscience (Hunn, 2007), encore aujourd’hui des différences se retrouvent dans la communauté scientifique. Comme le reconnaît Eugène Hunn qui a travaillé avec Brent Berlin, le travail de ce dernier est critiquable, mais il a eu le mérite de standardiser l’analyse du vocabulaire et d’apporter une base théorique. Se rapprochant plus des travaux de H. Conklin et de R. Bulmer, Claudine Friedberg apporta une vision complémentaire sur laquelle nous reviendrons en décomposant le processus classificatoire en trois aspects distincts : l’identification, la nomenclature et l’insertion dans un système de référence. Avec l’étude des systèmes de catégorisations et parallèlement l’émergence de l’écologie, les études sur les relations société-environnement vont s’orienter sur les savoirs détenus par les populations locales et les systèmes de gestion des ressources.
Science qui étudie les reptiles.
L’ethnoécologie et les savoirs locaux pour un renouvellement L’ethnoécologie : origine et définition
La troisième phase de l’histoire de l’ethnobiologie selon Eugène Hunn est l’« Ethnoecology » qui émerge dans les années 1970-1980 en conséquence de l’essor de l’écologie scientifique (Hunn, 2007). Toujours en relation étroite avec les sciences naturelles, les ethnobiologistes vont alors diversifier les objets d’études, du maïs à la dengue, tout en les replaçant dans leurs écosystèmes. Un des premiers à aborder cette thématique de l’ethnoécologie est l’écologue mexicain Victor Toledo (Toledo, 1992). Il attribue à H. Conklin la création du terme ethnoécologie et positionne cette discipline qui se veut plus englobante et holistique que l’ethnobiologie au croisement de plusieurs courants historiques, issus de l’ethnoscience, de l’agroécologie, de la géographie et enfin de l’ethnobiologie (Ibid). Se pose alors la question : ethnobiologie ou ethnoécologie ? Certains auteurs considèrent que ethnobiologie comprend ethnoécologie comme Roy Ellen qui emploie le terme ethnobiologie « comme raccourci » (Ellen, 2006, p. 16), d’autres estiment que les termes ethnoécologie et ethnobiologie comme interchangeables (Rist & Dahdouh-Guebas, 2006). Nous considérons l’ethnoécologie plus adéquate, car elle s’accompagne d’une vision plus holistique et dynamique de l’environnement en prenant en compte notamment leurs dimensions paysagères et les interactions entre les organismes.
Selon V. Toledo, l’ethnoécologie permet de lier la dimension cognitive et pratique puisqu’elle « explore les connexions entre le corpus (les symboles, les concepts, les perceptions de la nature) et la praxis (ensemble des opérations pratiques d’appropriation de la nature) dans le processus concret de production » (Toledo, 1992, p. 9). Pour cet auteur, le but de l’ethnoécologie est donc « l’évaluation écologique des activités intellectuelles et des pratiques qu’un certain groupe humain exécute lors de son appropriation des ressources naturelles » (Ibid, p. 10). Dans l’optique de questionner la durabilité de la gestion des ressources, il établit les quatre axes à détailler :
La description détaillée de l’écosystème (point de vue local et scientifique) La décodification du corpus de l’informateur
L’analyse des formes d’appropriations (praxis)
L’évaluation écologique des formes d’appropriation (impacts) (point de vue local et scientifique)
En 1999, l’anthropologue Virginia Nazarea complète ce cadrage en l’inscrivant dans la dimension locale et en insistant sur l’importance du contexte écologique, comme le résume l’expression « ethnoecology as situated knowledge16 » (Nazarea, 1999, p. 3). Par ailleurs, elle insiste sur le répertoire riche et varié de méthodes de l’ethnoécologie en faisant référence aux méthodes quantitatives émergentes (Atran et al., 1999; Reyes-García et al., 2007).
En France, au début, les études traitent de façon distincte des savoirs et des savoir-faire avant d’élargir le cadre d’analyse aux relations entre les connaissances, les pratiques et les représentations symboliques à l’intérieur des écosystèmes socioculturels et économiques dans lesquels ils se sont développés (Bahuchet, 2012). Parallèlement, l’ethnoécologie mobilise les savoirs scientifiques, de manière contextualisée à la fois géographiquement et socialement, lui permettant d’avoir accès à une grande accumulation d’observations nécessaires pour l’analyse à laquelle elle prétend et permet d’aborder les questions de gestion durable et de conservation des ressources et de la diversité biologique (Ellen, 2006; Nakashima & Roué, 2002). Si ces savoirs locaux sont intégrés à l’évaluation, aux contrôles et à la cogestion des populations animales et végétales et des milieux dans de nombreuses études, ils peuvent être sujets à controverse et viennent bousculer certains cadres.
Les savoirs locaux au cœur de l’ethnoécologie
Alors que les ethnosciences cherchent à analyser tous les domaines de la culture, les ethnoécologues opèrent un glissement vers des réflexions sur les modèles de gestion historique et les liens avec l’environnement au travers des savoirs naturalistes. Les systèmes de classification vont alors être considérés comme faisant partie des stratégies de survie des différents groupes face à leurs environnements. Cette compréhension démontre un intérêt croissant pour les savoirs écologiques mais fait émerger la question de nommer correctement ces savoirs comme le rappelle l’anthropologue Marie Roué : Doit-on parler de savoir écologique traditionnel (Traditional Ecological Knowledge, TEK), ou de savoir traditionnel (Traditional Knowledge, TK), comme on l’a fait dans les années 1980 au tout début du développement de ce champ et comme certains le font toujours ? Serait-il préférable d’abandonner cette désignation au profit d’une dénomination plus politisée, celle de savoir autochtone (Indigenous Knowledge, IK) ? Doit-on tout au contraire choisir une notion la plus neutre, celle de savoirs locaux (Local Knowledge, LK) ? » (Roué, 2012, p. 1)
Indigenous semble peu approprié pour la plupart des communautés rurales, groupes francophones ou pour évoquer les paysans, les pêcheurs, etc. car la dimension indigène renvoie à l’histoire coloniale (Roué, 2012). Marie Roué rappelle également l’histoire des différents cadres règlementaires qui ont servi à définir les communautés autochtones dans les colonies françaises et aujourd’hui à l’échelle mondiale (Ibid). Traditional Ecological Knowledge — TEK — et Local Knowledge — TK — sont les expressions employées dans un premier temps par les auteurs, à l’image de l’article d’E. Hunn, « What is TEK ? » en 1993, car elles mettent en avant la dimension historique et elles se concentrent sur le domaine de la nature (Hunn, 1993). Si l’expression « savoirs naturalistes locaux » apparaît alors comme la meilleure traduction pour TEK (Bérard et al., 2005) le cadre uniquement naturaliste doit cependant être dépassé, car ces savoirs ont une portée plus holistique (intégration des pratiques, des représentations). L’expression « savoirs locaux » que nous utiliserons par la suite apparaît dès lors la plus adéquate. De nombreuses définitions de savoirs locaux ont été proposées ; au vu du sujet et du cadre d’étude et en nous basant sur plusieurs auteurs (Berkes et al., 2000 ; Hunn, 1993 ; Roué, 2012), nous proposons de retenir la définition suivante :
—, lié à des pratiques (savoir-faire), à une éthique et à des représentations du monde (visible et invisible), portant sur les relations entre les humains, les non humains et leur monde. Ces savoirs locaux sont transmis de génération en génération comme un héritage culturel et ils évoluent par l’incorporation dans le tissu social et dans les pratiques de nouvelles techniques et d’innovations.
Pour répondre à la question « what is traditional ecological knowledge ? » Eugène Hunn, ne proposait pas une définition mais une réflexion sur ce qu’ils étaient ou n’étaient pas. Ils sont à la fois « locaux et fragiles […] c’est à la fois leur force et leur faiblesse » (Hunn, 1993, p. 14). Les connaissances – et le mode de vie — d’un groupe sont spécifiques à son environnement immédiat et ils ne seront pas largement partagés dans d’autres communautés. La fragilité vient de cette localisation, du contexte, de leurs acquisitions, de leurs transmissions et donc de la dynamique – positive ou négative — de la communauté qui les soutient, et qu’ils soutiennent. Le terme « traditional » qui revendique l’historicité de ces savoirs, peut être interprété de manière positive. Il ne reflète pas une connaissance statique (Heckler, 2004), mais une manière de savoir « way of knowing », c’est-à-dire un processus social d’apprentissage et de partage du savoir, propre à chaque culture autochtone, au cœur même de sa traditionnalité » (Posey, 1999, p. 4). Cette connaissance porte alors une signification juridique, sociale et participe à la construction d’une identité.
Les critiques faites sur le terme de traditionnel sont plus intense en France, car ce terme renvoie à une vision passéiste sur les notions de groupes primitifs, ou à une folklorisation et une muséification des groupes et de leurs modes de vie. Mais ces savoirs n’ont rien d’archaïsme et d’immobilisme, ils sont en réalité dynamiques (Bérard et al., 2005; Roué, 2012). La tradition n’est pas matérielle, tous les objets, les travaux, l’art, les rituels, les danses, les habits ou l’alimentation sont les incarnations des idées partagées par les peuples (Hunn, 1993) et tous ses aspects évoluent dans le temps. Pour reprendre les mots de M. Roué, ils sont donc plus que des savoirs disciplinaires, ils questionnent le rapport entre les savoirs des populations locales et la science. Bien qu’il y ait des fondations communes entre les TEK et certains aspects de l’écologie scientifique notamment dans la forte tendance à reconnaître et nommer les espèces animales et végétales et une correspondance, possiblement importante, entre les catégories locales et celle des scientifiques, les TEK divergent de la science (Ibid). Leurs transmissions se font principalement de personne à personne souvent de manière orale. Leur construction est presque uniquement empirique, se démarquant ainsi de la science occidentale déductive, qui aspire à une portée mondiale et universelle. Ces systèmes sont fondés sur une observation quotidienne et intime à l’échelle locale et d’une de vie, comme l’illustre très bien les travaux sur les pêcheurs du lagon de Marovo des îles Salomon de l’anthropologue Robert Johannes (Johannes, 1981a; Ruddle, 2008). Ils sont donc un luxe, car acquérir cette connaissance exigerait aux scientifiques des observations prolongées et exhaustives incompatibles avec les moyens de la grande majorité des biologistes occidentaux professionnels. Ils doivent alors venir en complément plutôt que d’être remplacés (Hunn, 1999). Mais cette prise en compte a connu différentes optiques – de l’utilitarisme à la cogestion — obligeant les ethnobiologistes à se positionner éthiquement et nécessitant la mise en place de cadre règlementaire pour construire une association entre chercheur et autochtones. C’est la dernière phase de l’ethnobiologie selon Hunn (2007), centralisée sur les communautés autochtones, leurs revendications et l’engagement des chercheurs.
Les travaux de Claudine Friedberg pour appréhender les classifications vernaculaires
Le travail sur les classifications est au cœur de l’ethnoscience et donc de l’ethnoécologie. Afin d’aborder et d’analyser au mieux les données, nous nous sommes appuyés sur les travaux de Claudine Friedberg. Pour elle, pratiques, représentations et interrelations influencent tous les aspects du processus classificatoire qui peut être considéré comme une mémoire de la société ou de la communauté. Pour notre recherche, les classifications vernaculaires ne sont pas l’objet de l’étude en soi, mais ce sont des révélateurs des pratiques, des savoirs et des représentations détenus par les informateurs et éventuellement partagés par le groupe de professionnels. Puisque nous posons l’hypothèse que les savoirs locaux nous permettent de mieux comprendre les enjeux autour de la ressource algale, alors « il est nécessaire de comprendre comment ces savoirs se construisent et s’organisent, comment ils rendent compte de la façon dont la réalité est perçue, conçue et vécue par chaque société. Ceci pose évidemment aussi la question de leur insertion dans le fonctionnement social. » (Friedberg, 1997, p. 6).
Il s’avère que les données collectées correspondent avec les éléments théoriques développés par Claudine Friedberg et dans d’autres travaux ethnoscientifiques comme ceux de Peter Dwyer, qui a observé que dans des contextes et pour des objectifs différents, les personnes regroupent les objets naturels de manières variées et qu’ils fonctionnent avec plusieurs classifications de la nature (Dwyer, 2005). Eugène Hunn (1993) fournit certaines précautions qui font échos à nos travaux. Il explique ainsi que les systèmes de classifications vernaculaires sont généralement moins détaillés que la classification linnéenne propre aux sciences biologiques et les dénominations ne sont pas obligatoirement standardisées. Il peut y avoir une « sur différenciation » pour certains constituants de l’environnement particulièrement importants et d’autres ne peuvent être précisés que dans un contexte particulier. Tous les auteurs soulignent que les idées qu’une société se fait de l’organisation et du fonctionnement du monde ne sont pas toujours faciles à mettre en évidence. De nombreux éléments sont implicites, mais il est nécessaire d’en tenir compte puisqu’ils influencent les pratiques et font sens pour le groupe et au sein de leurs savoirs (Friedberg, 1997).
Le texte qui suit s’appuie sur l’ensemble des travaux de Claudine Friedberg (Friedberg, 1968, 1974, 1991b, 2005) et tente de résumer sa pensée. Un objet, quel qu’il soit ne prend un sens qu’en fonction des autres objets, c’est-à-dire lorsqu’une place lui est attribuée dans un système de référence. Les objets naturels et leurs classifications ne sont donc qu’une partie de la démarche cognitive classificatoire. Ce processus classificatoire mobilise des mécanismes de différenciation et aussi de rapprochement entre des objets dans une même catégorie. Il s’agit d’établir des ressemblances entre eux, tout en les distinguant. Le processus est divisé en trois étapes : l’identification, la nomination et l’insertion dans un système de référence. Ces trois étapes se chevauchent et s’entremêlent puisque pour donner une place à un objet, il y a lieu d’abord de le reconnaître pour pouvoir en parler ; il faut le désigner par un nom, ce nom pouvant aussi bien déceler ce qui a permis de le reconnaître ainsi que le rôle qu’il joue dans la société, et la place occupée peut dépendre du système de nomenclature et d’identification.
Reconnaître et nommer
La reconnaissance permet de distinguer des entités dans l’ensemble des objets de la même catégorie, par exemple les plantes et de leur attribuer une dénomination. Cette étape n’a pas toujours lieu, en particulier dans les classifications populaires qui sont soumises à un souci de rapidité dans le repérage et l’identification et d’économie dans l’effort de mémorisation. Un parallèle peut être fait avec le principe de parcimonie19 en phylogénie. Claudine Friedberg identifie trois attitudes devant une plante également valable pour d’autres objets.
Elle peut être très familière et donc reconnue au premier coup d’œil dans ce cas-là, le système de reconnaissance ne fonctionne pas, car il n’est pas utile. À l’inverse, si la plante est inhabituelle, soit en raison de sa rareté ou bien que commune elle est rarement utilisée, le processus de reconnaissance est mobilisé. La détermination peut se faire par des critères propres à l’objet : elle est alors « prototypique ». Elle peut aussi se faire par rapprochement principalement sur des critères morphologiques avec d’autres objets de même nature : elle est alors « componentielle conceptuelle ». Dans ce cas, les critères de reconnaissance peuvent être fournis à posteriori ou il n’existe aucune explicitation des caractéristiques, « c’est comme ça que je l’ai toujours appelé » est un exemple de réponses obtenues. Le contexte peut aussi favoriser le regroupement par la morphologie externe s’il existe des différences fortes entre les objets. Une fois reconnu, l’objet peut-être nommé. Cette dénomination se fait en utilisant ce que C. Friedberg nomme des « termes de base » et des déterminants » et qu’elle illustre avec des exemples :
o composé : reine-des-prés
Des termes de base accompagnés d’un ou plusieurs déterminants : chêne + vert ou carotte rouge + longue + de Croissy.
Il n’y a pas nécessairement de correspondance entre la nomenclature scientifique et populaire. Ainsi, plusieurs cas existent. Pour plusieurs espèces phylogénétiques proches, différents termes de base ou un même nom de base avec des déterminants différents peuvent être employés. Par exemple, dans nos données, plusieurs espèces de Laminaires, des grandes algues brunes, ont comme même nom de base « tali » : Laminaria hyperborea est nommée « tali penn » et Laminaria digitata « tali du ». Dans ce dernier cas, il y a un rapprochement avec la nomenclature naturaliste : genre + espèce. Mais, un même terme de base seul comme « tali » peut regrouper un ensemble botanique très divers, par exemple « tali piko » désigne une petite algue rouge Chondrus crispus, bien différente des Laminaires. Enfin, il existe des cas particuliers, par exemple les plantes du genre Viola sont désignées sous le nom de violettes, mais Viola tricolor est appelée la « pensée sauvage ». L’attribution d’un même terme de base peut se fonder sur un rapprochement ou des distinctions concernant des caractéristiques morphologiques, biologiques, écologiques ou comportementales ou culturelles.
Afin d’éviter toute confusion avec le système de classification scientifique, en nous basant sur les propos d’Harold Conklin et de Claudine Friedberg, nous utiliserons la notion de « type d’algue » pour désigner « les plus petites unités végétales reconnues par les informateurs » (Friedberg, 1974, p. 321) et cela pour l’ensemble des parties du manuscrit qui abordent le point de vue des professionnels. Une fois nommé l’objet est inséré dans un système, établissant ainsi un ordre dans cette diversité.
De l’objet naturel à la ressource algale : construction scientifique de la catégorie algue
La démarche ethnoscientifique, exposée dans la partie précédente, nous invite à observer un objet à la fois du point de vue des populations locales et de celui des scientifiques. Bien que le cœur de ce travail soit les dénominations et les catégories des collecteurs d’algues ainsi que les pratiques et savoirs associés, il est nécessaire de clarifier, dans un premier temps, un point essentiel pour permettre une meilleure compréhension de nos propos : qu’est-ce que l’objet algue du point de vue des scientifiques ?
Nous allons retracer l’histoire de cet objet naturel, au travers de la littérature scientifique sur la biologie et l’écologie des algues et nous appuyer sur des entretiens réalisés avec des phycologues. Ces données seront mises en regard, discutées, croisées, dans les chapitres suivants avec les propos des collecteurs d’algues. Nous souhaitons montrer que la représentation des scientifiques sur cet objet naturel a évolué parallèlement à l’accroissement des connaissances et de l’intérêt qui lui a été porté : d’un objet naturel ignoré à une ressource à exploiter puis à une biodiversité à conserver, à gérer
Objet naturel, objet des naturalistes
Histoire de la construction d’une catégorie scientifique
Longtemps, les herbes marines ou les végétaux marins ont été ignorés au profit des végétaux et des animaux terrestres. Les systématiciens Guillaume Lecointre et Hervé Guyader nous donnent les grands jalons historiques de l’intérêt pour ces éléments marins (Lecointre & Le Guyader, 2001). Théophraste (372-287 av. J.-C.) est le premier à s’y intéresser, avec un regard naturaliste. Pline l’ancien (23-79 apr. J.-C.) reprendra ses travaux dans les 37 volumes de Historia naturalis. Il faudra ensuite attendre plus de mille ans pour voir émerger un réel questionnement sur les végétaux aquatiques. Comme le résume le naturaliste René-Antoine Réaumur : « les [plantes] terrestres, plus commodes à considérer se sont attirées la principale attention des botanistes » (Réaumur, 1711, p. 282). Durant le 18e siècle, l’essor des naturalistes révèle la diversité qui existe au sein de la nature et, avec eux, émerge alors l’idée qu’il existe une classification naturelle, une unicité qui prouverait un ordre intrinsèque (Ibid). Les érudits de l’époque vont alors s’employer à reconnaître, nommer et classer les objets naturels, ce qui fait écho aux trois étapes du processus cognitif décrites par Claudine Friedberg au sujet des classifications vernaculaires (Friedberg, 1990). La science des classifications — constituée par la taxinomie et la systématique24 — qui a pour tâche d’identifier, de décrire et d’inventorier les êtres vivants dans la nature présente et passée a introduit un nouveau regard sur le monde naturel.
Si Carl von Linné a établi une base en codifiant les sept niveaux hiérarchiques que l’on connaît aujourd’hui sous une forme légèrement modifiée — règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce — et le système de référence des dénominations — nom binomial genre et espèce .
La systématique cherche à dénombrer les espèces et à reconstituer par un ensemble de méthodes leur phylogénie c’est-à-dire les relations évolutives entre les divers organismes. La taxinomie a pour objet de nommer et de décrire les différents caractères des groupements d’espèces ou d’une espèce appelés « taxon » (Lecointre & Le Guyader, 2001). il demeure vague concernant les végétaux marins. Le naturaliste suédois nomme Algae « les organismes fixés au substrat et vivants en milieu aquatique » (Lecointre & Le Guyader, 2001), une définition bien trop vaste puisqu’elle inclut les végétaux aquatiques, mais aussi les éponges, les coraux, etc. L’organisation de l’univers des algues va s’accélérer avec les travaux du naturaliste Jean Vincent Félix Lamouroux en 1813 qui milite pour que les botanistes s’intéressent aux « thalassiophytes articulées ; mine neuve et riche à exploiter [dans laquelle] ils ne peuvent qu’y faire des découvertes intéressantes » (Lamouroux, 1813, p. 25). En 1813, ce proche de Jean-Baptiste Lamarck va proposer une classification des algues d’après leur couleur. L’idée est reprise et affinée par la communauté scientifique spécialisée et quatre grands groupes sont établis : Melanospermae (brun noir), Rhodospermae (rouge), Chlorospermae (vert) et Diatomaceae (doré) (Lecointre & Le Guyader, 2001). La phycologie25, la science étudiant les algues va se développer au 19e siècle grâce à de nombreux travaux26 (Dirk De Wit & Baudière, 1992), en conservant cette classification basée sur un paramètre physique — la couleur — jusque dans les années 1970. À cette période, de grands changements vont intervenir dans la systématique avec l’apport des outils de la génétique (analyse des séquences d’ADN), et de l’informatique (modèles mathématiques et capacité de traitement des informations). Une nouvelle pensée d’organisation du vivant et de classification scientifique va émerger. Elle propose de retrouver les parentés évolutives entre les espèces en les rassemblant en groupes monophylétiques, c’est-à-dire avec un ancêtre commun et avec la totalité de ces descendants (de Reviers, 2002.
Le Guyader, 2001). Les classifications scientifiques évoluent continuellement avec la découverte de nouvelles espèces et l’actualisation des connaissances. Nous nous baserons sur celle proposée par les systématiciens Sina Adl et ses collègues en 2012 (Adl et al., 2012). Dans leur classification, les algues sont réparties dans une dizaine de règnes. Comme l’illustre la figure 5, les macroalgues sont incluses dans les deux clades — un clade étant un groupe d’êtres vivants ayant un ancêtre commun — SAR27 et Archaeplastida, au sein des règnes Stramenopiles, Rhodophyceae, Chloroplastida et Glaucophyta. Les microalgues, très diversifiées sont incluses dans ces mêmes règnes, mais aussi dans d’autres comme Haptophyta, Telonema, Cryptophyta, etc. Les algues ne sont donc pas un groupe monophylétique puisque leur ancêtre commun (point de convergence des traits verts, rouge et gris sur la fig. 1) est partagé avec divers organismes vivants. Ainsi l’espèce verte Ulva, plus connue sous le nom de « laitue de mer », est biologiquement plus proche du chêne (Quercus spp.) que de Porphyra, le nori, une algue rouge qui lui ressemble du point de vue morphologique et vit à proximité (Pérez, 1997). Malgré tout, la catégorie algue a fait sens par le passé et survit tant dans la structuration des connaissances scientifiques que dans l’organisation institutionnelle de la recherche ; il s’agit d’une catégorie fonctionnelle. La meilleure preuve est qu’il existe des phycologues et de nombreux ouvrages et publications sur les algues (de Reviers, 2002; Pérez, 1997).
Le rapport de stage ou le pfe est un document d’analyse, de synthèse et d’évaluation de votre apprentissage, c’est pour cela rapport-gratuit.com propose le téléchargement des modèles complet de projet de fin d’étude, rapport de stage, mémoire, pfe, thèse, pour connaître la méthodologie à avoir et savoir comment construire les parties d’un projet de fin d’étude.
|
Table des matières
Introduction
Chapitre. 1 De la théorie au terrain : l’ethnoécologie pour appréhender une activité de collecte en milieu marin
1. Regard historique et théorique sur l’ethnoécologie
1.1. Genèse et évolution des « ethno-X »
1.2. Aux marges de l’anthropologie de la nature
1.3. L’ethnoécologie et les savoirs locaux pour un renouvellement
2. L’ethnoécologie comme cadre d’analyse de la récolte des algues en Bretagne aujourd’hui19
2.1. Posture de recherche
2.2. Les travaux de Claudine Friedberg pour appréhender les classifications vernaculaires
3. Méthodologie générale
3.1. Vivre sur place et observer
3.2. Entretien et enquête ethnobiologique au cœur du corpus
Chapitre. 2 De l’objet naturel à la ressource algale : construction scientifique de la catégorie algue
1. Objet naturel, objet des naturalistes
1.1. Histoire de la construction d’une catégorie scientifique
1.2. Quelle définition pour les algues ?
1.3. Diversité et facteurs écologiques
2. De l’algue à la forêt sous-marine : biologie et écologie des algues de Bretagne
2.1. Les Fucales : des premières ceintures au plus profond
2.2. Les algues vertes : peu de diversité mais en grande quantité
2.3. Les algues rouges : entre diversité et rareté
2.4. La grande forêt sous-marine des Laminaires
2.5. Espèces introduites
3. L’algue une ressource à valoriser et à conserver
3.1. Quand la nature devient une ressource
3.2. Des ressources à la gestion
3.3. Connaître, gérer, piloter les algues en Bretagne
Conclusion du chapitre 2
Chapitre. 3 L’histoire de la récolte des algues en Bretagne
1. Relier le passé et le présent par les dénominations et les catégorisations
2. Et tout commença par le goémon
2.1. Goémon, varech et sart
2.2. Le « bezhin » : l’autre nom breton de la littérature et ses déclinaisons
3. De la mer vers la terre : usages agricoles et domestiques du goémon
3.1. Le « goémon épave » et le « goémon noir »…
3.2. … indispensables à l’activité agricole
3.3. Goémons divers et autres usages domestiques
4. Le « tali » et le « liken » : récolte intensive et usages industriels
4.1. Le « tali » pour appréhender l’usage industriel du goémon
4.2. Prémisse d’un renouvellement : production de gélifiants à partir du « liken »
Conclusion du chapitre 3
Chapitre. 4 Sortir du passé pour dessiner le contemporain
1. Du paysan-goémonier…
1.1. Un mode de vie à la croisée des mondes terrestre et maritime
1.2. De paysan à exploitant agricole : transformation du mode vie terrestre
2. … aux professionnels des algues
2.1. Évolution de la récolte embarquée en deux étapes
2.2. La récolte des algues de rive, longtemps dans l’ombre des bateaux
3. Renouvellement du tissu social et rupture avec le passé
4. Une pratique qui s’organise : cadre légal et administratif
4.1. Construction de la profession et de ses institutions
4.2. Deux filières différentes
Conclusion du chapitre 4
Chapitre. 5 Collecteurs d’algues, des identités ?
1. Le « statut administratif », un mode de catégorisation
2. Construction de profils au sein des collecteurs d’algues
3. Goémonier embarqué, marin-pêcheur d’algues
3.1. Cercle d’interrelation
3.2. Apprendre et transmettre
3.3. Outils et activités du goémonier
4. Récoltant-occasionnel, l’algue comme revenu complémentaire
5. Récoltant-héritier, continuité et passion familiale
6. Récoltant-entrepreneur, une opportunité économique
7. Récoltant-alternatif, faire de la récolte un acte engagé
8. Des profils à compléter qui évoluent avec le temps
Conclusion du chapitre 5
Chapitre. 6 Pratiques manuelles ou mécanisées : la part de la main dans les perceptions sensorielles et dans les savoirs écologiques
1. Typologie des collecteurs, typologie des touchers
2. La main artisanale du récoltant : pluralités des modalités tactiles et savoirs écologiques
2.1. Chez le récoltant à pied, la vue et le toucher, assises du modèle sensoriel et du lexique
2.2. Connaître l’algue, son milieu et sa qualité : des perceptions sensorielles aux savoirs écologiques
3. La main mécanisée du goémonier : incorporation de l’outil et distanciation à l’algue
3.1. De la main commandant l’outil à la prothèse sensorielle
3.2. Le chant du moteur et la vue superlative pour une conjugaison sensorielle
Conclusion du chapitre 6
Chapitre. 7 Ordonner la diversité algale : savoirs et rapports au monde des collecteurs
1. Comment les collecteurs nomment et classent les algues ?
1.1. Résultats du travail d’enquête
1.2. Quatre registres de noms et une multitude de catégories
1.3. Base commune et évolutions temporelles
2. Différencier, repérer et reconnaître : les noms et les catégories reflet d’un savoir indispensable et précis
2.1. Plante et algue, des différences biologiques entre des niveaux de base
2.2. Où sont les algues ? En épave et sur l’estran
2.3. Jeu de formes et de couleurs pour reconnaître et nommer les algues
2.4. Empreinte du scientifique et savoirs naturalistes
3. Une classification à l’image des filières et des enjeux
3.1. Diversité des algues, diversité des usages et diversité des enjeux
3.2. Des nouveaux noms pour consommer des algues
3.3. L’influence des industriels sur les pratiques et les représentations
Conclusion du chapitre 7
Chapitre. 8 Nommer l’espace, comprendre les pratiques et les enjeux de gestion
1. Le coin, le potager et le jardin : hétérogénéité des rapports à la grève par les récoltants d’algues de rive
1.1. Des éléments structurels et fonctionnels du milieu côtier partagés
1.2. De la cueillette à l’horticulture intensive
1.3. Modes d’appropriations et tensions
2. Le caillou, le champ et la forêt : représentations et appropriations des espaces par les goémoniers embarqués
2.1. Deux journées en mer
2.2. Là où poussent les algues
2.3. Du caillou au champ
2.4. Travailler chaque lieu
2.5. Du « champ » exploité…
2.6. … à la « forêt », espace naturel récolté
Conclusion du chapitre 8
Chapitre. 9 La durabilité : aléa, jeux d’acteurs et cogestion
1. Un hiver 2013-2014 sans précédent
2. Les formes d’engagements des collecteurs à l’épreuve
2.1. Calme relatif sur l’estran
2.2. Panique à bord des goémoniers
3. L’émergence de savoirs hybrides ?
3.1. L’influence des industriels dans les engagements
3.2. Prévoir le futur : hybridation des savoirs locaux et des savoirs scientifiques
3.3. Des engagements composites et hybrides
4. L’intégration des savoirs : premier pas vers une cogestion
5. Jeux d’acteurs et mise en place de la cogestion
5.1. En 2014, les industriels mènent la barque
5.2. Une écologisation ou une adaptation des engagements ?
Conclusion du chapitre 9
Épilogue
Hyperborea : comprendre un conflit et faire émerger des enjeux
Un nouveau statut administratif pour une identité commune
Transmettre et apprendre le métier
Cultiver la mer
Conclusion générale
Bibliographie
Télécharger le rapport complet