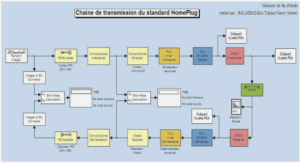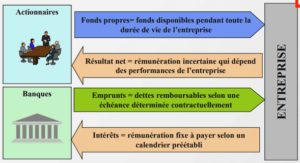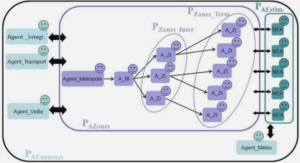Banalisation
Le syndrome du Taj Mahal
Je vais appeler ce phénomène « le syndrome du Taj Mahal », puisque c’est là qu’il s’est manifesté la première fois pour moi. Bien sûr, ce ne fut pas la dernière.
C’est un sentiment qui, lorsqu’il a fait surface, m’a fait culpabiliser. Avoir la chance de voir toutes ses « merveilles », comme dirait Arthur, mais de ne rien ressentir face à elles et de déjà se demander de quoi demain sera fait. Des mois de voyages, d’itinérance, dans le froid, dans la chaleur étouffante, à traverser des dizaines de frontières, des montagnes, des mers et des déserts, pour, une fois la Grande Porte franchie, se retrouver face à lui et se dire : « Bon, voilà le Taj Mahal. Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? ». Un rapide check-up pour vérifier que, oui, il est bien là, grand et tout blanc, comme sur les milliers de photos qu’on avait vues avant, avec en bonus cinquante-sept cars de touristes canardant le mausolée en mode rafale.
Mais quand même, quelle déception, j’aurais aimé ressentir cette euphorie grandir en moi au fur et à mesure que nous approchions, la voir exploser à la première vue du marbre blanc. Mais rien. Rien de rien.
Quelques jours plus tard nous chevauchons nos Bajaj Pulsar2 en direction du Népal. C’est le petit matin et il fait encore frais. Nous nous arrêtons sur un petit chemin perpendiculaire pour la première pause réglementaire des cinquante kilomètres. Miracle, un peu de silence. Et là, à la vision de ce champ3 en friche, couvert d’une herbe grasse portant encore la rosée de la nuit, recouvert d’une fine brume semblant léviter, la voilà : la boule d’euphorie, qui grossit, grossit, puis éclate.
« Quoi ? Alors rien devant le Taj Mahal et là, une p’tite brume et de l’herbe mouillée et c’est bon ? ». Ouais, à croire que les voyageurs que nous sommes portent leur attention sur d’autres choses, sur des petits détails, des situations, des sons, des goûts, des couleurs que les lunettes infra-merveilles du touriste de la carte postale ne détectent pas.
Bus
Confort précaire
Après m’être fait transférer de bus en bus sans rien comprendre par des chauffeurs échangeant de l’argent autour de moi, j’arrive enfin à Bago, au sud du Myanmar. Un taxi-scooter m’avoue qu’il n’y a rien à voir ici, mis à part un monastère bouddhiste où il peut m’amener pour un prix exorbitant. Direction la gare, je n’ai pas envie de m’attarder ici, et Arthur est déjà dans le nord, je peux peut-être le rattraper en allant directement à Nyangswhe, à proximité du lac Inle. Pas de chance. Le prochain train pour le nord part dans seize heures. À quelques kilomètres se trouve la gare routière, me dit-on au guichet. En effet, après une vingtaine de minute de marche, j’aperçois un homme, assis derrière un bureau en bois et abrité sous un parasol Pepsi qui vend des tickets de bus. C’est ma chance, un convoi pour Nyangshwe passe par ici, il a déjà une heure de retard et d’après le vendeur, arrivera dans une ou deux heures. Celui-ci essaye dans un anglais approximatif de me dire quelque chose, ça le fait rire, une blague sûrement. Je ne comprends pas il abandonne et note au stylo bille sur mon billet « extra-seat ». Un siège en classe supérieure ? Pour le même prix ? Parfait !
Trois heures plus tard le bus arrive. J’ai hâte de m’engouffrer dans mon siège et de dormir, le voyage s’annonce long. À ma surprise et malgré la dizaine de passager descendant du bus avec leurs bagages, le véhicule semble plein à craquer. Extra-seat. C’est louche. Je monte, montre mon ticket au chauffeur en soulignant du doigt la mention ajoutée au stylo bille. Ah, surprise. Mon extra-seat n’est pas le genre de siège où, lorsqu’on s’avachit dedans vous prend l’envie de soupirer « Ah ! Il est extra ce siège ! ». En fait ça ressemble plus à une des chaises de la dînette que ma petite cousine a eue pour Noël, le genre qui réunit menton et genoux au même endroit. Et tout ça placé dans l’allée centrale, devant deux Espagnols – qui vont au même endroit que moi – qui tirent des sacrées têtes, destinés au même sort, à ces quinze heures de trajet, sans voir la route et au milieu des regards amusés des Birmans. Derrière moi, les deux Espagnols qui ont râlé tout le trajet et devant moi, un jeune homme qui n’a pas bronché. À chaque arrêt, c’est-à-dire toutes les vingt à trente minutes, je décale un peu plus son siège vers l’avant du bus, puisqu’il est le dernier des extra-seats, jusqu’à pouvoir m’allonger en position de foetus entre lui et l’espagnol grognon. Le plus étrange ici, c’est que j’ai bien dormi.
On arrive vers quatre heures et demie du matin. On nous fait descendre à un carrefour, enfin !
C’est à ce moment-là que le chauffeur et son copain nous précisent que Nyangshwe est encore à treize kilomètres.
Culture-voyage
Adaptation et intégration
Le slow travel, les notions d’itinérance et d’indétermination qu’il sous-entend, est un mode de vie, une culture à part entière. Les singularités de cette culture sont sans doute sa temporalité et sa spatialité. Elle implique un mouvement constant, sans objectif, sur un territoire et un temps indéfinis. En un sens elle est une culture nomade, mais la dimension d’errance dont elle est dotée l’en différencie.
Pour les individus de la culture-voyage, « le vrai voyage, c’est d’y aller. Une fois arrivé le voyage est fini »1 au contraire des nombreux voyageurs et touristes qui « commencent par la fin ».
J’estime que le voyage devient un mode de vie lorsque s’établit une routine, chaque jour adaptée à des contextes différents. Cette capacité d’adaptation s’acquiert au fur et à mesure de l’expérience, elle n’est pas innée. De la même manière, on ne naît pas dans la culture-voyage, mais on l’adopte.
Cette culture particulière, itinérante, vit à travers les autres cultures, cherchant leurs interstices et porosités pour établir ses bases, s’en détacher et se mouvoir vers la suivante. C’est ce processus d’acclimatation culturelle, déployé pour s’intégrer, qui devient notre mode de vie.
La culture-voyage peut alors être perçue comme interculturelle. Une petite part d’elle résidant hypothétiquement dans les différences de chacune.
Désenchantement
La carte postale
Les temples de Bagan ne sont pas constamment enveloppés d’une brume mystique. Le Taj Mahal est plus beau en photo. L’Everest n’est pas inaccessible et les plages de Thaïlande ne sont pas désertes.
Le syndrome de la carte postale est celui de la désillusion. Notre vision du monde est aujourd’hui filtrée par les Rise et Amaro1 des écrans à travers lesquels nous vivons. C’est le drame d’un imaginaire constamment abreuvé, bon gré mal gré, d’informations visuelles erronées ou falsifiées, embellies et détournées, sorties de leurs contextes et qui participent à la formation de préjugés et d’attentes, du paysage proprement touristique.
Le remède à ça est peut-être l’Inconnu, permettant l’approche d’un lieu avec équanimité. L’imaginaire de l’Inconnu existe, mais l’infinité d’images dont il est composé le rendent flou. Impossible alors d’avoir des attentes, et sans attentes, pas de déception.
Arthur ?
« C’est vrai que moi, tout ce qui est monuments historiques, ce que tu trouves dans les guides, ça me blase un peu. Parce que t’as vu d’autres merveilles ailleurs mais surtout parce que tu as compris que c’était pas le plus important dans ta façon de voyager. Tu voyages pas pour ça mais pour un ensemble et le problème c’est que le tourisme met en valeur pratiquement que cet aspect du voyage : les sites touristiques, les merveilles du monde. On voyage pour aller voir des merveilles.Et ça fausse complètement le rapport qu’on peut avoir à un voyage, qui peut être beaucoup plus complet en fait.
Et c’est vrai que quand on en fait tous un « pataquès », qu’on fait une énormité d’un truc comme le Taj Mahal, parce que c’est à voir, on est forcément déçu. C’est pas LA chose à voir en Inde, y en a tellement d’autre qu’en fait c’est peu de chose le Taj Mahal ».Il est d’accord.
Duo
Pour le meilleur et pour le pire
Dans les pages d’un livre ayant appartenu à C.McCandless on peut lire, entre deux lignes, « hapiness only real when shared ». Vis-à-vis du voyage, le bonheur est-il plus réel lorsqu’il est partagé ?
Le voyage lui-même prend plus de puissance, puisqu’il existe alors au sein de plusieurs individus partageant une mémoire commune. Cela me rappelle une discussion que j’ai eu avec Arthur et que l’on a évoquée pendant l’entretien : « Si tu en parles [du voyage] aux gens, personne pourra s’y identifier, tu seras seul avec ton souvenir. Et le fait de savoir que quelqu’un l’a partagé avec toi, et a ce souvenir aussi, ça participe à la mémoire, et ça participe au plaisir sur la durée »2.
Cet aspect-là donne une autre temporalité au voyage, au-delà du temps qui lui est imparti. Le voyage, même après sa fin physique, continue d’exister à travers l’interaction du duo. Le duo, lui-même, prospère et avec, la relation particulière formée et entretenue pendant le voyage, positive ou négative.
Le plus important dans le voyage en duo, c’est sans aucun doute le choix du partenaire, dont la réussite en appelle assez grandement à la chance.
L’accord est bilatéral, l’un ne suit pas l’autre mais les deux avancent bien d’un même pas. Les décisions sont communes et les risques partagés. En ce sens, voyager à deux peut être une contrainte, « ça c’est aussi quelque chose qui m’a stressé du fait qu’on voyage à deux. C’est qu’il arrive quelque chose à l’autre.[…] c’est horrible, le risque que tu prends, je le prends pour toi ». La responsabilité envers l’autre est implicite. Ce lien forme néanmoins un cocon protecteur, sécurisant. « Le voyage en duo ça permet d’être moins stressé, de prendre le truc plus tranquillement […]. À deux t’as presque deux fois moins de choses à penser en termes d’organisation. Et il peut rien t’arriver. C’est un confort ».
J’ai voyagé avec une cousine, un ami, partagé des bouts de chemins avec des inconnus, plusieurs fois, mais sur de courtes durées. Avec Arthur, ça a été sept mois sans interruption, sept jours par semaine, à souvent partager la même chambre, le même sol. Ça aurait pu être un enfer, mais ça ne l’a jamais été, et je n’ai pas d’explication à ça. Disons qu’on est « bien tombés », qu’on a eu de la chance. Le résultat évident de ces sept mois à temps plein en duo est la naissance d’un lien dépassant la valeur d’une simple mémoire partagée et sa force atteint son paroxysme dans un état de symbiose. Dans notre cas, ce phénomène s’est fait ressentir dans les conversations, de plus en plus concises, directes, mais aussi et surtout dans les silences, plus fréquents, traduisant une entente commune.
Fatigue
Épuisement de la libido voyageuse
L’heure, la date, les kilomètres parcourus. Perdu dans le temps et dans l’espace. La chambre n’a pas de fenêtre. Une boîte sombre et poisseuse meublée d’un seul lit. Les mauvais souvenirs sont souvent ceux que l’on retient le moins, pourtant j’ai des frissons quand j’y repense, que je m’y revois, de haut.
J’ai mal au crâne. Cela me rappelle les klaxons des motos et rickshaws du pays. Une heure de silence. Je l’attendais depuis si longtemps, le dédale de ruelles crasseuses de Varanasi après la pluie me l’avait offert, mais ce martèlement, incessant, qui prend le relais. Il fait terriblement chaud et humide. L’air me dégoûte. J’ai froid. Arthur passe de temps en temps dans la chambre, je crois qu’on échange quelques mots. Je me rendors d’un sommeil sans rêve, avant de me réveiller, toutes les demi-heures peut-être ? Les intestins en vrac, le cerveau en purée.
« Faut que j’aille à l’hôpital. On ira demain. Non, faut que j’y aille aujourd’hui, y a quelque chose qui va pas, c’est sûr. Il est 22h, on ira demain, on peut pas y aller maintenant. » 22h. De quel jour ? « On est pas le matin ? Ou on est déjà le soir ? ».
Il me semble que c’est à ce moment-là que je panique, que je me sens en danger. Et Arthur m’a dit plus tard qu’il était inquiet lui aussi, et il s’inquiète pas d’un rien. Cette fatigue, physique, morale, est une des pires ennemies du voyageur. Parce que ce jour-là, j’ai eu envie de rentrer. De retrouver un lit avec des draps propres, de prendre une douche chaude et de manger les lasagnes que maman a cuisinées exprès. J’ai entendu que l’Inde, parfois, faisait cet effet-là. C’est comme si toutes les informations qu’on se prend dans la tête – les moteurs, les klaxons, la foule, les animaux, les couleurs, les trous sur le trottoir, sur la chaussée, le rickshaw qui arrive de la droite et le scooter d’en face, … – saturaient les sens, un par un. Alors je me suis perdu, et j’ai perdu le goût, pendant un instant, de voyager.
Film
Chalo
Partir sans but c’est bien, mais rien n’empêche de voyager avec un projet d’arrière-plan. Documentaire photographique, vidéographique, essai d’écriture, projet artistique, étude sociologique, psychologique ou philosophique, le champ du possible est large et varié.
Partir avec un projet c’est d’abord se donner la possibilité de réaliser une chose qui tient à coeur, ce n’est pas forcément un prétexte au voyage mais plutôt un complément qui peut le crédibiliser. Comme l’exprime Arthur, ce fut notre cas : « […] je voulais pas que ça soit une fuite [le voyage] donc j’ai fait en sorte qu’on créé ce projet de film et ça a était la base de ma décision, j’y vais et je réalise quelque chose ».
Nous sommes donc partis équipés d’une petite caméra de type Gopro, d’un caméscope doté d’un zoom puissant et d’un appareil photo numérique associé à un objectif à focale fixe de 50 mm. Autant dire pas grand-chose. Pas de micro, ni de trépied, ni d’ailleurs d’aucune connaissance technique ou pratique. Mais qu’importe, nous avons filmé, tout et rien, apprenant chaque jour des erreurs de la veille, perfectionnant nos cadrages et réglages – du moins c’est ce que nous pensions.
Notre première erreur est due à notre manque de préparation, je dirais même plus, à l’inexistence de notre préparation. Franchement, se retrouver avec deux formats d’images après dix mois de prises de vues : pas très professionnel. La seconde, je ne saurais vraiment l’expliquer. Le voyage, l’expérience vécue est simplement plus forte : « Le film était secondaire, on filmait beaucoup, mais pas tous les jours. Des fois on filmait pour se donner bonne conscience ».
Le montage final, proposé en annexe, est un aperçu de ce qu’a pu être notre voyage, c’est notre manière de le partager, mais au-delà, c’est une tentative de retranscription du genre de sentiment qu’un périple de ce genre peut procurer, la diversité des territoires, des cultures traversées, des rencontres, etc. C’est un appel, un « levez-vous ! », une ode au voyage « vécu »2. D’ailleurs le film s’appelle Chalo, l’équivalent du « Let’s go ! » anglais en hindi, et est disponible en annexe, à la fin de ce mémoire.
Homogénéisation
Vers une mono-culture ?
La mondialisation désigne un processus de rapprochement des hommes et de leurs activités, une dynamique capitaliste présente dans le monde entier. En toile de fond, c’est un phénomène d’homogénéisation qui, lentement mais sûrement, tend à uniformiser nos cultures et comportements sur le modèle occidental, origine du mouvement.
Voyager à travers le monde permet de constater et d’expérimenter ce phénomène, dont la vitesse de propagation et la force ne cessent de croître depuis la deuxième moitié du XXème siècle.
Le développement du tourisme à l’échelle mondiale a profondément changé l’esprit des lieux, remodelés à la manière occidentale, avec par exemple de célèbres enseignes de restauration – McDonald en Inde –, d’hôtellerie – Rhadisson à Katmandhu – ou commerces de proximité – 7-eleven en Thaïlande – remplaçant des activités locales. Il me semble que la finalité de ces gestes n’a pour objectif que de recréer un environnement familier pour des touristes cherchant de la distraction plus que de l’exotisme. Dans le dessin animé Corto Maltese en Sibérie1, on voit Hong-Kong au début des années vingt, ses maisons en bois, couvertes de tuiles de terre cuite, le port où mouillent par dizaines de magnifiques jonques aux voiles rouge pourpre. J’aurais aimé m’y rendre à cette époque. Aujourd’hui Hong-Kong est à mes yeux une mégalopole comme les autres. Des gratte-ciels à s’en donner des torticolis, une densité monstrueuse, un territoire artificiel et peu attractif à mon goût, semblable à des dizaines d’autres villes.
« Je peux pas m’empêcher de penser que c’est dommage que la mondialisation soit arrivée partout, le monde est en train de s’uniformiser et il te reste plus que les paysages, alors que c’est les gens qui font le voyage. […] c’est un peu peinant que tout ça soit arrivé dans ces lieux parce que les gens se ressemblent de plus en plus, t’as du mal à discerner les cultures ».
En un sens l’uniformisation du monde a tué le voyage. Bien sûr, il est encore possible, mais les destinations catalysant une réelle curiosité sont perles rares. « Toute la question est de savoir s’il reste des destinations ouvertes à la curiosité. Or, plus elles sont organisées, balisées par le marketing touristique de la destination, moins elles sont ouvertes à la curiosité » explique Marin de Viry, auteur de l’ouvrage Tous touristes. La possibilité d’un « ailleurs » se dissipe, et parallèlement l’effet de surprise généré par l’inconnu, tous deux éléments moteurs du voyage.
Imaginaire
Avant, pendant et après le voyage
L’imaginaire du voyage est avant tout l’appréhension d’un univers que l’on se construit par l’usage de références personnelles ou externes. Pour Michel Onfray, chaque voyage commence chez soi, sur son fauteuil et un livre sur les genoux. Charles Baudelaire, Théophile Gautier, Georges Orwell, Jules Vernes, Jack London, Nicolas Bouvier, Sylvain Tesson, la liste est longue. Un apport de connaissances diverses est important pour tout voyage, mais est loin d’être une nécessité. Pour certains, le voyage ne débutera qu’à l’aéroport, pour d’autres, au bas de leur porte, les rêveurs l’auront débuté il y a bien longtemps.
De manière subjective, je dirai que la volonté de préparer ainsi un voyage est un risque de conditionnement créant des attentes et souvent par la suite, des déceptions.
Aujourd’hui, les nouvelles technologies nous donnent un aperçu précis du monde, de ses lieux les plus reculés, de ses habitants et cultures diverses. C’est un peu comme si le suspens, le charme de l’inconnu avait disparu. Chaque jour et partout, l’imaginaire est gavé d’images : sur internet, dans le métro, dans la rue, les journaux ou encore à la télévision, mais aussi au travers de l’oralité, de discussions, de récits de voyages, entendus ici et là. C’est à ce dernier médium que je me fie à la fois le plus et le moins, en tentant de déceler, de façon superficielle je l’admets, à quel type de voyageur j’ai à faire.
Question de genre
Voyager en tant que femme
Je dois dire que je rencontre quelques difficultés à aborder ce sujet. Évoquer le fait même qu’il puisse y avoir une différence entre voyageuse et voyageur me semble anormal. Internet regorge pourtant de blogs de voyageuses, s’essayant à des articles intitulés « L’art de voyager en tant que femme », « voyager seule quand on est une femme » ou encore « Oser voyager seule ». Ce que j’y lis s’applique autant aux hommes qu’aux femmes : faire attention à son comportement, à la manière de s’habiller, à ce qu’on mange et boit, etc. Je dirais qu’il y a aujourd’hui autant de femmes que d’hommes voyageant seuls sur de grande durée. Il est vrai que les femmes ne peuvent pas se rendre dans certains endroits où les hommes ont accès. Cependant l’inverse se vérifie aussi. Le contact avec les hommes est plus complexe pour elles dans certains pays, comme le contact avec les femmes sera plus complexe pour un homme.
Quelques mots d’Arthur autour de la question de genre en voyage : « […] tout est taillé pour l’homme. Le monde est fait pour nous, l’Europe peut être pour hommes et femmes mais il y aura toujours un penchant pour l’homme. Ça doit être chiant pour elles… ».
Elles seront en effet les premières et les plus directement contraintes par les convenances sociales des pays visités. Dans les pays où les femmes se battent encore pour leurs droits les plus fondamentaux, je pense ici à l’Inde ou l’Iran, les voyageuses occidentales ont avant tout le statut de touristes. De ce fait leurs manquements éventuels à ce qu’une femme peut ou ne peut pas faire dans ces pays vont être abordés avec plus de tolérance. Ainsi on peut dire que le voyage n’est pas la copie conforme d’une discrimination homme/femme.
Les principaux problèmes rencontrés par les femmes en voyage semblent principalement dus au regard des hommes et à la place de la femme dans les sociétés traversées. Je me souviens cette jeune femme suisse que nous avons rencontrée en Iran. Elle nous racontait que les hommes ne lui adressaient pas la parole, l’ignorant totalement et ne communiquant qu’avec son ami. Ce genre de discrimination peut avoir lieu n’importe où, pays occidentaux compris. Il ne faut pas en faire une généralité, même si ces comportements seront plus courants dans certaines régions du monde. En revanche, cette jeune suisse n’avait aucun problème à parler avec des jeunes femmes iraniennes, ce qui a été très rare pour nous. Cependant, remis dans leur contexte, ces situations ne devraient pas nous surprendre : en Iran, hommes et femmes ne partagent pas les mêmes rames de métro, ne prient pas dans le même espace et fréquentes majoritairement des individus du même sexe. Us et coutumes qui s’appliquent bien sûr aux étrangers.
|
Table des matières
Préface
Carte
Abécédaire
altérité
arthur
autostop
banalisation
bus
culture-voyage
dégoût
désenchantement
duo
enfant voyageur
fatigue
film
géographie personnelle
homogénéisation
imaginaire
individualisation
jaipur
k-way
kafka
lenteur
liberté
low-tech
lucknow
marchandage
marcher
modernité(s)
nuit n°87
origine
paysage
photographie
postures de voyageurs
question de genre
risque(s)
sac à dos
sensations
solo
spontanéité
temporalité(s)
užice
voyage
wagon
x
xinjiapo
yangoon
zahedan
zéphyr
Annexes
entretien avec Arthur
entretien avec Sophie
chalo
Bibliographie
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet