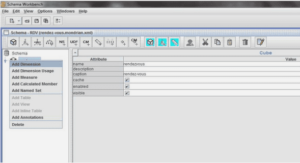Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
L’historique des réseaux Fixes-Mobiles-Internet (F-M-I-) dans la zone d’étude
Les TIC constituent aujourd’hui le socle du monde à venir en ce sens qu’ils peuvent permettre d’optimiser les connaissances, le savoir-faire ainsi que la productivité de beaucoup d’autres secteurs en plus de lui-même. Dans ce sens elles pourraient par effets de répercussion et d’entraînement sur les autres secteurs socioéconomiques, contribuer plus ou moins à l’amélioration des conditions de vie des populations. C’est à partir de là que nous aurons alors atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Le secteur des TIC ne saurait cependant innover s’il doit évoluer sans boussole, ni baromètre. De ce fait, les africains vont adopter de nouvelles stratégies en matières de dotations technologiques et de réglementations pour réorganiser ce secteur. Ainsi l’état des lieux des réseaux Fixes, Mobiles et Internet vont être présenté pour chaque pays du cadre référentiel.
Dynamique des TIC et développement durable en Afrique de l’Ouest : cadre illustratif de six pays Pour des comparaisons entre pays nous plaçons les courbes de l’évolution du taux de pénétration de ces pays cités à titre illustratifs (graphique 2) en annexe 1. Là-bas également, nous situons le graphique 3 qui représente l’évolution du nombre de leurs abonnés haut débit. Est considéré comme un accès Internet haut débit un accès à Internet offrant un débit d’au moins 500 kbps.
●Au Bénin (Confer Boko, 2012 ; et Kossi, 2014)
-Les réformes du secteur des télécommunications
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de désengagement de l’Etat des secteurs productifs de l’économie, le Bénin a initié un certain nombre de réformes depuis 1994 notamment celle de la libéralisation du secteur des télécommunications. L’objectif principal visé par cette réforme était d’une part, d’ouvrir ce secteur productif à la concurrence et, d’autre part, d’encourager et de favoriser la participation des investisseurs du secteur privé au développement des télécommunications modernes. Par ailleurs, le Bénin s’est doté d’un document de politique sectorielle du secteur des TIC adopté en novembre 1994. Ce document a été révisé et actualisé en décembre 2008. La vision du Gouvernement de ce secteur stratégique repose sur deux piliers essentiels que sont : l’e-gouvernement et l’e-business. Pour soutenir cette stratégie, un projet dénommé « e-Bénin » appuyé par la Banque Mondiale a été élaboré et est actuellement en cours d’exécution. Dans le plan d’actions de ce projet figure en bonne place des projets tels que la gouvernance électronique, l’élaboration des textes d’application et des lois spécifiques sur le commerce électronique, la cybersécurité et la cybercriminalité.
-Le cadre juridique, réglementaire et institutionnel du secteur des TIC
Le secteur des télécommunications au Bénin est régi par l’ordonnance n°2002-002 du 31 janvier 2002 portant principes fondamentaux du régime des télécommunications en République du Bénin. Bref, sur le plan juridique et réglementaire, il existe un éventail de lois et décrets portant réglementation de ce secteur. L’opérateur historique des télécommunications est l’Office des Postes et Télécommunications (OPT).
-Le marché des TIC au Bénin
Le marché béninois des télécommunications est très concurrentiel. Les segments de marché qui s’y développent sont : la téléphonie fixe, la téléphonie mobile et l’Internet. Sur le segment de la téléphonie fixe, Bénin Télécoms SA, opérateur historique exerce un monopole. Sur le segment mobile, nous avons 5 opérateurs qui animent le marché. Donc, la concurrence est effective sur ce marché. Le réseau conventionnel fixe du Bénin est caractérisé par les réseaux locaux de câbles téléphoniques qui ont été réaménagés dans les principales villes ; ainsi qu’une téléphonie communautaire qui a vu son développement axé sur le publiphone et les télé-centres privés. Le nombre de publiphones est passé de 797 en 2004 à 707 en 2006, soit environ 90 lignes publiques hors activité. Par ailleurs, la téléphonie rurale reste encore peu développée malgré les efforts de déploiement des équipements de VSAT5 par Bénin Télécoms S.A. Le système VSAT de télécommunications par satellite comprend 19 stations et un HUB. Sur l’ensemble du réseau, juste un petit nombre de station est fonctionnelle.
Depuis 2000, le Bénin a connus la libéralisation du secteur des télécommunications. L’OPT opérateur historique est depuis 2005 scinder en deux : La poste et BENINTECOMS. Les sociétés de GSM qui se partagent le marché sont au nombre de 4 : LIBERCOM, AREEBA, BBCOM et TELECEL. Décembre 2006, le Bénin compte 77 342 lignes fixes, le nombre de demande en instance est près de 51000 lignes conventionnelles et la télé densité est environ 0, 98%. Par rapport aux télécommunications internationales, le Centre de Transit International (CTI) de type MT20 THOMSON installé à Cotonou et celui de Porto-Novo de type EWSD gèrent l’ensemble du trafic téléphonique international en utilisant les supports de transmission que sont : la Station Terrienne dotée d’une antenne de type Standard A émettant en double polarisation A et B et orientée sur le satellite INTELSAT VI F3, les liaisons de transmission par faisceaux hertziens numériques avec les pays limitrophes (Nigéria, Togo), le Câble Sous-Marins (CSM) et la Station Radio communications Maritimes et Terrestres (Station Radio maritime). Les deux Centre de Transit International sont reliés par des circuits numériques en Fibres Optiques. Bénin Télécoms S.A. dispose également d’une artère de transmission longue distance en fibre optique qui est mise en service en 2001 entre Cotonou et Parakou sur environ 5VSAT: Very Small Aperture Terminal. Terminal d’émission réception par satellite, de dimension. Il permet d’échanger les données à bas ou moyen débit, en utilisant une fraction étroite de la capacité du satellite (Dictionnaire des médias, 1998).
450 km à laquelle sont reliés les centraux téléphoniques numériques de Parakou et de Savalou. En ce qui concerne les artères de transmission, le taux de numérisation est de 100 % sur le réseau national et le nombre total d’abonnés raccordés est de 77 342 au 31 décembre 2006. Le nombre d’abonnés est passé à 152 715 lignes en 2011, soit un taux de pénétration allant de 0,98% à 1,68% sur la période 2006 à 2011 grâce à l’utilisation des technologies semi-mobiles telles que le CDMA.
Au Bénin, la première entrée dans le réseau de communications mobiles fut d’abord celle de l’Opérateur Libercom GSM (Opérateur historique) bâti par l’OPT aujourd’hui Bénin Télécoms SA en 1995, sur la base de la technologie AMPS (réseaux analogiques). Ce réseau ne couvrait que Cotonou Porto Novo et Ouidah. Bien que les télécommunications soient encore largement sous monopole étatique, le secteur de la téléphonie cellulaire a été libéralisé à partir de 1997. Outre Libercom, filiale de Bénin Télécoms SA, en 1999, les premières licences furent accordées à deux opérateurs : Moov (ex Télécel) et Areeba (ex Bénincell). Ces derniers ont démarré leurs activités commerciales en 2000. En décembre 2003, Bell Bénin Communications est autorisé. En 2007, Globacom de Global Limited est autorisé et est en cours de déploiement. Ce qui porte le nombre d’opérateurs GSM à ce jour aux 5 principaux opérateurs de téléphonie, à savoir : Bénin Télécoms SA, SPACETEL Bénin SA (MTN), ETISALAT Bénin SA (MOOV), GLO Mobile Bénin (GLO) et Bell Bénin Communications (BBCOM). S’agissant de la téléphonie mobile, le nombre d’abonnés s’est nettement accru passant de 1050 en 1995 à 7 765 206 lignes en 2011, soit un taux de pénétration mobile de 85,33% en 2011 contre 0,02% en 1995.
Le Bénin s’est connecté pour la première fois à l’Internet dans le cadre de la préparation du sixième sommet de la francophonie qui s’est tenu à Cotonou, Bénin, en décembre 1995. Il est l’un des premiers pays africains francophones à se connecter sur le réseau. Il disposait d’une passerelle d’accès de 64 kbps. En 1998, cette bande passante fut augmentée à 128 kbps grâce au projet américain Le land Initiative. Ce n’est qu’en juillet 2001 qu’elle augmentera à nouveau pour atteindre un Mbps, alors que les autres pays de la sous régions se situent déjà au-delà de cette capacité. Cinq fournisseurs d’accès offrant des services au grand public sont actuellement opérationnels (dont quatre privés). La population des internautes ne dépasse pas un pourcent de la population, alors que les abonnés aux services des fournisseurs d’accès locaux tournent autour de 7000. La distribution géographique de l’internet est très déséquilibrée car le service réellement n’est disponible que dans les grandes villes, dont Cotonou qui héberge autour de 90% des internautes.
En 2003, il a été dénombré dans le secteur privé au Bénin, environ 7603 télé-centres offrant sur le plan national des services afférents à l’accès Internet et à la formation en informatique et en Internet. Le 7 mai 2003, intervint l’inauguration du câble SAT-3. À cette occasion, une nouvelle connexion internationale de 45 Mbps a été ajoutée aux 2 Mbps existants, portant ainsi la bande passante à 47 Mbps. Elle n’est pour l’instant accessible que depuis Cotonou et n’a pas encore été redistribuée dans le reste du pays. L’OPT a obtenu au mois de Septembre un prêt de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) dont le montant s’élève à 9 milliards de F CFA. Ce prêt est destiné à financer le projet d’établissement de liens en fibre optique (en utilisant la technologie SDH) entre le Bénin et les pays voisins de l’UEMOA. Ces 3 câbles, dont le coût a été révisé et approche les 12 milliards de FCFA, vont totaliser 760 kilomètres et relier Cotonou aux réseaux des opérateurs Burkinabé, Nigérien et Togolais. Avant l’exploitation du câble, le Bénin était connecté au BACKBONE Internet par des liaisons VSAT qui ne lui donnaient pas l’occasion d’exploiter une large bande passante. En dehors de Bénin Télécoms plusieurs opérateurs privés fournissent l’accès Internet soit par réseau téléphonique commuté (RTC), soit par boucle locale radio, soit par satellite VSAT ou soit par ADSL une des dernières technologies mises en service par Bénin Télécoms. La situation de la connectivité jusqu’à fin décembre 2006 au niveau de Bénin Télécoms SA fait état de : 6007 abonnés par liaison RTC, 154 par liaison ADSL, 21 par liaisons Spécialisées Wireless, 17 liaisons spécialisées et autres. Entre 2000 et 2005 le nombre d’abonnés RTC a connu une augmentation entre les deux périodes. Le nombre a décru entre 2005 et 2006 passant de 6461 à 6007.
LE SEGMENT THEORIQUE
Nous retiendrons dans cette sous partie, le segment littéraire suivant : ceux ayant un lien avec l’emploi ; et ensuite ceux mettant en exergue la fracture numérique.
Le débat sur la question de l’emploi et l’informel par l’avènement des TIC
L’introduction de plus en plus intensive de l’information dans les activités s’est inévitablement accompagnée d’un débat consistant à savoir si les TIC sont “ créatrices ” (externalités positives) ou “ prédatrices ” (externalités négatives) d’emplois. Les TIC suppriment-elles des emplois ? En créent-elles? Ou sont-elles pratiquement neutre, c’est-à-dire sans effets significatifs sur le marché du travail? Dans certains pays, elles en créeraient beaucoup contrairement à d’autres. La contribution des TIC à la formation de la croissance économique et à la création d’emplois dans les pays industrialisés est conséquente, comme l’attestent les chiffres produits par l’UIT en 1997. Dans l’Union Européenne, cette contribution était en moyenne de 15% pour la croissance économique et 25% pour la création d’emplois. Aux États-Unis, elles étaient respectivement de l’ordre de 28,3% et 10,5%. La même source (UIT, 1997) signale par ailleurs que le secteur des TIC est devenu, en termes de valeur de marché, le deuxième secteur de l’économie mondiale.
Pour tenter de trancher ce débat d’école, certains auteurs comme Ossama (2001), invitent à dépasser la vision qui plaide systématiquement pour ou contre l’une des deux thèses. Ils préconisent d’apprécier plutôt le ratio entre les emplois créés et les emplois supprimés. Or, selon d’autres analystes, cette vision médiane ferait ressortir un ratio positif. Tout au moins, précisent-ils, pour ce qui concerne les pays industrialisés et certains pays émergents comme l’Inde, le Singapour et les Philippines où de telles études ont été déjà menées.
Le constat général est que les transformations technologiques majeures comme celles que nous vivons en ce moment, entraînent toujours une mutation significative de la structure de l’emploi. Tandis que des emplois disparaissent ici, là se créent de nouvelles opportunités de travail, parfois issues juste de la transformation des emplois tantôt disparus. Ce phénomène tout à fait classique durerait au moins depuis la révolution industrielle. Selon Sinha (1994), toute étude sérieuse portant sur l’impact des TIC par rapport aux emplois se doit toutefois de tenir compte de la conjoncture économique du pays concerné et de la qualité des infrastructures et équipements mis en place. Jusqu’ici, les emplois éventuellement disparus, quand c’est le cas, sont plus le fait de politiques de restructuration au sein des entreprises concernées que le fait de l’utilisation de nouveaux moyens techniques et technologiques. Peut-être, le faible niveau de développement et donc de numérisation de l’économie permet-il encore de maintenir ce compromis favorable entre la modernisation des activités et la préservation des emplois. Peut-être aussi, ce compromis résulte-t-il plus de la nature même des sociétés africaines, beaucoup plus soucieuses de petits boulots de subsistances (afin de disposer tout juste du minimum de consommation) que l’obsession pour des emplois d’avenir (plus enrichissants et plus bénéfiques, mais plus difficile à obtenir en Afrique). Les informations recueillies au cours de nos investigations, sans être entièrement représentatives de l’ensemble du secteur des Télécommunications modernes, fournissent néanmoins une brève appréciation du poids économique et social en termes d’emplois en Côte d’Ivoire et ailleurs en Afrique de l’Ouest. Sur cette base, la suppression systématique de certains business issus des branches du secteur des TIC constituerait un risque élevé de chômage et de dommages collatéraux. Si elle permet d’appréhender quelque peu le poids social et économique du secteur des TIC, l’approche strictement comptable en termes de données financières et de nombre d’emplois répertoriés, n’est en revanche pas suffisante pour saisir son rôle véritable dans l’ensemble de la mécanique économique et sociale. Il est donc nécessaire de distinguer, comme le suggèrent certains auteurs (par exemple Jacquet, 2001), la production des TIC au sens d’outputs d’une part, et d’autre part, au sens d’inputs. Cette approk2che nous semble plus intéressante, car dépassant le cadre des chiffres, elle intègre les paramètres de l’observation et du constat des faits que l’arithmétique ne parvient pas toujours à saisir.
Pour d’autres chercheurs par contre, au-delà du caractère relativement nouveau de cette problématique par rapport au contexte dominant de la société de l’information et de la mondialisation qui en amplifie le champ, l’engouement pour cette réflexion tient aussi à une question de démarche dialectique et scientifique. En effet, si progressivement l’on commence à admettre l’importance des TIC dans les dynamiques actuellement en œuvre et spécialement dans les activités humaines, l’on est néanmoins en droit de s’interroger sur la nature et le sens de la relation entre TIC et développement. En d’autres termes, il se pose la question de la causalité entre ces deux éléments. Les TIC constituent-elles un moteur (position en amont ou « Backward ») de stimulation des activités socioéconomiques pour favoriser l’émergence et à long terme le développement? Ou au contraire, sont-elles le résultat du développement (position en aval ou « Forward »)? Leur relation relèverait-elle plutôt d’une corrélation à caractère concomitante ou variable selon les circonstances? À contrario, évoluent-ils séparément et donc cette relation serait-elle neutre? L’absence de preuves scientifiques assez pointue accentue les controverses et la polémique des débats de la situation TIC en Afrique.
Outre le débat sur l’emploi et l’informel un autre a vu le jour avec l’avènement des TIC en Afrique, c’est celui qui porte sur la fracture numérique.
Les discussions théoriques sur la question de la fracture numérique et des autres fossés infrastructurels
De manière globale, dans tout endroit du monde, les conditions d’accès aux ressources ne sont pas toujours identiques selon le statut social des individus et les actifs disponibles. De même, les activités, les emplois et les richesses ne sont pas répartis de façon homogène sur le territoire national. Certaines régions sont bien dotées tandis que d’autres le sont moins ou pas du tout. Or, la tendance habituelle des professionnels-entrepreneurs est de s’installer dans les régions bénéficiant déjà d’un fort potentiel en termes d’infrastructures, de marchés, de débouchés et de savoir-faire. Tenant compte de ces aspects dans le contexte de pays de l’Afrique de l’Ouest, nous observons que la polarisation et le développement de grande villes ou capitales (Abidjan, Dakar, Ouagadougou, Cotonou, Bamako, Abuja, etc.), se nourrissent continuellement d’acquis initiaux, et aujourd’hui des nouveaux produits des TIC. Dans ce sens, l’inégalité d’accès aux réseaux et services technologiques caractérisant la fracture numérique ne serait pas la cause première des inégalités socioéconomiques et territoriales actuellement constatées S’intéressant de près à la région ouest africaine, l’observation des politiques de dotations en infrastructures et équipements de développement révèle une très forte disparité entre les grandes villes, surtout la capitale économique et le reste du pays. Indépendamment du déséquilibre traditionnel en matériels et équipements que bénéficiait déjà dans les capitales, s’est ajouté un nouveau déséquilibre. Il s’agit de la fracture numérique qui traduit le fossé digital, c’est-à-dire l’inégalité entre les entités à jouir des TIC, et donc de bénéficier de ses opportunités. De même qu’au plan mondial, nous redoutons l’élargissement du fossé digital entre pays industrialisés et PED, de même il est à craindre qu’au niveau national, entre la capitale et le reste du pays, cela se creuse tout autant, aggravant les inégalités initiales de développement.
De même que l’analphabétisme constitue un lourd handicap dans le monde ordinaire de l’écriture et de la lecture, de même dans le monde du numérique et de l’informationnel, l’incapacité à se servir convenablement des produits technologiques est de plus en plus pénalisant pour les personnes et entités dites « anumériques ». Ces derniers, notamment les analphabètes du XXIème siècle en matière de connaissances en TIC, peuvent être partout et dans toutes les catégories socioprofessionnelles. Or la maîtrise à la fois de l’ordinateur, de l’Internet et de certains logiciels est devenue un critère de sélection ou filtre pour plusieurs employeurs. Et naturellement, ces atouts peuvent dorénavant faire la différence entre des candidats à un poste d’emploi. Pour joindre cela au vocabulaire des économistes analysant le marché du travail, nous pourrions parler là de critère d’aptitudes informatiques qui a lieu lors du recrutement pour traduire la présomption de compétence et de stock de connaissances du capital humain. Or, il est quasiment certain que beaucoup de personnes dans les zones rurales, où il n’existe pas encore des structures de formation en informatique et électronique, ignorent cet aspect conjoncturel et actuel. En outre, la familiarisation aux produits des TIC est aussi importante pour les étudiants, les enseignants, les chercheurs et toutes personnes souhaitant accroître ses connaissances à fin d’être plus compétitifs. Bien des élus locaux ignorent jusqu’à ce jour que l’absence de réseaux et services de télécommunications dans leur ville peut expliquer qu’il n’y ait pas certains services minimum tels que les banques et les assurances. Et que l’un dans l’autre, cela expliquerait en plus que des fonctionnaires se refusent à y travailler, et que par ricochet leurs villes soient économiquement peu dynamique et socialement peu fréquentée, et donc en marge du développement.
Par ailleurs un autre problème lié à la logique des entreprises privées vient accentuer la pénalité des zones ou entité peu nantis [Confer la théorie des jeux de l’entreprise, analysée par Devillé (2001)]. En effet, le souci d’optimisation du profit de tout agent économique l’amène à s’intéresser aux zones les plus attractives ou celles prometteuses à l’avenir. Autrement dit, les endroits à faible densité de population (y compris de faible pouvoir d’achat) et ne possédant pas un fort potentiel d’acquis économique sont délaissés. Car, pour tout investisseur avisé, le principe de grand nombre de la clientèle reste un point important dans sa prise de décision d’investir ici ou là.
Certes, il est déplorable de constater que seules les grandes villes d’Afrique, surtout les capitales, concentrent l’essentiel des outils de développement et polarisent autour d’elles la plupart des activités socioéconomiques. Mais, des enseignements sont à tirer de la situation. Dans cette perspective nous rapportons les propos de Pecqueur (2000), à savoir : « La polarisation fait explicitement référence à la physique des champs magnétiques avec les notions de gravitation et d’attraction. La présence d’une activité économique en un lieu déterminé polarise d’autres activités, elle attire du pouvoir d’achat et crée cumulativement des emplois. Lorsqu’un pôle d’activité existe, il propage autour de lui une dynamique de développement. Cela signifie que la répartition des activités sur le territoire économique n’est ni aléatoire, ni égalitaire.». N’est pas là une manière d’inciter les entités à prendre des initiatives en matière d’investissements dans les activités supposées être des piliers pour stimuler la croissance économique.
Le débat véhicule aussi un paradoxe. Le paradoxe pour nous tient à ce que certains auteurs affirment, d’une part, qu’un territoire peut-être bien doté en équipements de TIC sans pour autant être plus attractif qu’une autre entité. D’autre part, ils admettent que de nos jours, sans les TIC, tout territoire court le risque d’être marginaliser, toutes choses pouvant fragiliser son tissu socioéconomique. Faudrait-il voir dans ce paradoxe l’idée d’un rôle capital des acteurs locaux dont les actions en vers l’implantation des TIC seraient déterminantes pour conditionner le succès ou l’échec de leur progrès local? C’est fort vraisemblable si l’on se réfère à cette affirmation de Eveno (1997) : « Une technologie n’est jamais capable de déclencher une mutation sociale ou économique. C’est plutôt l’inverse qui se produit. C’est-à-dire que c’est plutôt un contexte social, culturel, politique, économique qui rend possible la diffusion d’une innovation technique. Ce n’est qu’à ce prix qu’une technique devient innovation, c’est à partir du moment où elle devient pertinente vis-à-vis d’un contexte donné et qui lui donne tout son sens.».
Analysant de leur côté la relation des TIC et la dispersion spatiale des activités, Brousseau et Rallet (1999) pensent que les nouvelles technologies n’apparaissent pas comme des facteurs premiers de localisation des activités, contrairement aux économies d’agglomération, aux infrastructures publiques ainsi qu’aux engins de transport (les aéroports, les routes, les chemins de fer, les ponts et les moyens de leurs utilisations). Ils estiment toutefois que les TIC peuvent dans une certaine mesure affecter les schémas de localisation ou de délocalisation des activités pour discriminer des territoires par rapports à d’autres. Poursuivant leur analyse, ils font remarquer que si les biens et services du secteur des TIC sont une condition nécessaire, en revanche elles ne sont pas une condition suffisante du développement durable. Ils conclurent alors en disant que c’est leur pénurie qui s’oppose au développement et non leur existence.
Pour d’autres, une approche méthodologique permettrait de mieux comprendre la question, car certaines lacunes existantes rendent encore plus difficile la compréhension. Celui-ci consiste à savoir si les TIC ont un effet sur la localisation des entreprises, sur les migrations des individus, sur l’organisation spatiale et économique, et finalement sur les inégalités territoriales. Ce débat, à l’instar du précédent, nourrit également beaucoup de controverses. Pour les uns, l’effet structurant des TIC est difficile à cerner, et même serait un mythe. L’adéquation entre qualité infrastructurelle et aménagement du territoire est ici mise en doute. Offner (1993) soulignait à ce sujet que: « Rechercher l’influence de la mise en service d’un équipement sur l’économie d’un territoire pose de redoutables problèmes méthodologiques. Les travaux empiriques rigoureux ne conclurent, au mieux, qu’à une amplification et une accélération de tendances préexistantes.». Plus explicite, Bakis (1995) note que : « Il devient clair aujourd’hui que nous devons travailler à une nouvelle problématique afin de dépasser les limites de la précédente et d’intégrer les évolutions techniques, économiques et sociales. Avec le déplacement de l’axe problématique que nous proposons pour l’économie des télécommunications, on ne s’achemine plus vers la recherche d’un “ effet structurant ” des télécommunications sur les espaces, mais vers la démonstration des interactions géoéconomiques nouvelles, permises par l’insertion des télécommunications à tous les niveaux dans le monde actuel. L’approche est plus modeste et plus réaliste.».
Il craint en même temps un revers de la médaille dans la mesure où il ajoute par ailleurs que les potentialités des télécommunications sur la diffusion des activités ne se réalisent probablement pas sans un catalyseur volontaire. Si les organismes d’aménagement du territoire semblent tout à fait désignés pour devenir ces acteurs régulateurs et créatifs, les opérateurs de télécommunications auront à assurer un rôle particulier dans une collaboration étroite avec les aménageurs, notamment pour le montage d’opérations pilotes et la garantie d’un fonctionnement parfait des systèmes mis en œuvre afin de répondre aux besoins des aménageurs et des élus.». Selon d’autres explications, il convient d’emblée d’écarter une réduction usuelle, mais inopportune, du problème : il ne s’agit pas de traiter seulement de la localisation des activités, mais de façon plus large du fonctionnement spatial des activités, que leur localisation évolue rapidement ou soit relativement figée. Le fonctionnement du système productif peut en effet évoluer à localisation constante, par modification du contenu des activités localisées, et de leurs interdépendances et échanges […] Un moyen de communication tend à jouer de moins en moins sur les localisations au-fur-et-à-mesure qu’il se développe ne signifie nullement qu’il soit sans effet sur l’espace. Il peut au contraire induit tout un mode nouveau de fonctionnement spatial, permettre des localisations inédites, rendre techniquement et économiquement accessibles des zones jusqu’alors laissées à l’écart et les mettre en relation les unes avec les autres, selon des schémas nouveaux de partages et de complémentarités des tâches (Savy, 1995).
D’autres auteurs, en réplique aux propos des précédents, admettent tout simplement le rôle essentiel du secteur des TIC dans l’aménagement territorial. C’est le cas de Bensaїd (1990) qui stipule que « La localisation des hommes et des entreprises dans les zones fragiles passe impérativement aujourd’hui par un nouveau type de désenclavement et par la capacité de ces zones à proposer un environnement moderne, attractif, culturel, riche de possibilités de toute nature. Ce nouveau désenclavement, cette modernité, ne sont pas le seul fait du chemin de fer, de l’avion et de la voiture qui ne font circuler que les hommes et les marchandises. Ils consistent, au XXIème siècle, à faire circuler l’information organisée en services plus ou moins complexes […].Cette information, incontournable, si l’on veut être rentable, productif et compétitif représente pour l’aménagement du territoire un défi à relever.».
Principales méthodes de mesure de l’impact des TIC
Qu’entendons-nous par « impact » dans le cadre des statistiques ? Le mot « impact », d’après dictionary.com, peut, entre autres, avoir la signification « d’influence, d’effet ou de force exercée par une idée, un concept, une technologie ou une idéologie nouveaux ». Pour le dictionnaire en ligne Merriam-Webster : « un contact énergique ou une attaque ou une force imprimée par une chose sur une autre : un effet sensible ou majeur (par exemple, l’impact de la science sur notre société). Il ressort de ces définitions que l’« impact » peut être un concept fort ou faible, étroit ou large. Par exemple, on peut comparer, d’un côté, l’impact de TIC sur une entreprise donnée et, de l’autre, l’impact de l’utilisation généralisée des TIC par le secteur des entreprises. Nous pouvons aussi classer les impacts selon d’autres critères : impact social/ économique, positif/ négatif, à court/ long terme, voulu/ involontaire, direct/ indirect ou intermédiaire/ final. Les mesures des impacts reflèteront ces classifications avec peut-être en plus une distinction : subjectif ou perceptions/ objectif.
|
Table des matières
ABSTRACT
INTRODUCTION
CHAPITRE 1. ENJEUX DE LA DIFFUSION DES TIC SUR LE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE DE L’OUEST
1.1. L’état des lieux des TIC dans les pays illustratifs de l’Afrique de l’Ouest
1.2. Les entraves au développement et les implications stratégiques de la technologie dans des secteurs piliers d’activités de l’économie sous régionale
CHAPITRE 2. L‘ÉTAT DE CONNAISSANCES THEORIQUES ET EMPIRIQUES SUR LES TIC
2.1. Le segment théorique
2.2. Le segment d’approches empiriques
CHAPITRE 3. DÉTERMINANTS DE LA DEMANDE TI ET IMPACT DE LA TECHNOLOGIE SUR L’INDICATEUR DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE PAYS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
3.1. Approches descriptives du modèle DGI et du marché de la téléphonie
3.2. Approches analytiques
CONCLUSION GÉNÉRALE
RÉFÉRENCES
Télécharger le rapport complet