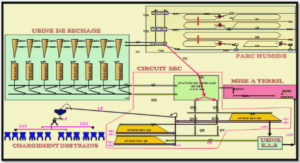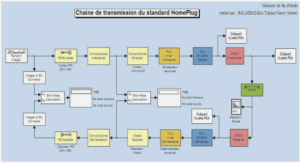Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
L’Analyse des Similitudes (ADS)
L’analyse des similitudes (ADS) est une analyse des cooccurrences entre les formes lexicales contenues dans un corpus, présentée sous forme graphique. Cette technique issue de la théorie des graphes (Flament, 1981 ; Vergès & Bouriche, 2001) permet de représenter la structure d’un corpus par la schématisation des relations de proximité lexicales (cooccurrence), mettant ainsi en évidence les liens entre les formes (mots) dans l’unité de découpage que constitue un segment de texte (Marchand & Ratinaud, 2012 ; Loubère, 2016, 2018).
L’objectif de l’ADS est d’étudier la proximité et les relations entre les éléments d’un ensemble, sous forme d’arbres maximum : le nombre de liens entre deux items évo-luant « comme le carré du nombre de sommets » (Flament & Rouquette, 2003 p.88), l’ADS cherche à réduire le nombre de ces liens pour aboutir à « un graphe connexe et sans cycle » (Degenne & Vergès, 1973 p.473) » (Marchand & Ratinaud, 2012, p. 688).
Le nombre de liens évolue comme le « carré du nombre de sommets » (Flament & Rouquette, 2003, p. 88), mais la quantité d’information devenant problématique quant au traitement d’un grand nombre de relations lexicales, la modélisation a recours à l’emploi de l’arbre maximum, qui synthétise les relations les plus fortes (Loubère, 2018).
Cette technique consiste en la suppression du lien le plus faible dans chaque clique (boucle de 3 sommets, [chaque sommet ici constitué par une forme]), en cas d’égalité, c’est le lien pointant vers le sommet de plus faible fréquence qui est éliminé. » (Lou-bère, 2018, p. 91).
Elle permet ainsi de visualiser, par la matérialisation des relations les plus fortes en fonction de leur fréquence, les associations lexicales, sous forme de réseau, qui structurent les textes. Outre l’identification de ces relations de cooccurrence, le logiciel IRaMuTeQ permet de mettre en évidence les communautés lexicales (ou espaces lexicaux) ainsi constituées en les matérialisant par des halos de couleurs qui rendent compte de l’ensemble des relations de cooccurrence associées aux formes les plus fréquentes qui peuvent être considérées comme des mots-pivot. Cette fonctionnalité permet de donner des directions dans l’étude des profi-lages lexicaux (Longhi, 2018).
L’ADS est particulièrement utile lorsque l’on cherche à dégager des espaces lexicaux com-muns à l’intérieur des corpus, à observer des régularités et donne la possibilité d’approcher le contenu discursif en se focalisant sur des phénomènes de convergence des discours.
S’agissant de leur mise en forme, nous avons parfois eu recours au logiciel libre Gephi26 (Blondel et al., 2008) pour retravailler les graphes élaborés par IRaMuTeQ afin de les rendre plus lisibles, lorsque cela s’avérait nécessaire.
L’analyse factorielle des correspondances (AFC)
L’Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) est une méthode d’analyse de données, que l’on doit au statisticien J.-P. Benzécri (Beaudoin, 2016) et qui permet de mesurer et mo-déliser les degrés d’associations de plusieurs variables (Loubère, 2018). Pour l’analyse de discours, l’AFC est majoritairement fondée sur un tableau lexical entier (Lebart & Salem, 1994 ; Lebart et al., 1991) croisant les mots sélectionnés avec une partition choisie a priori par l’utilisateur (textes, locuteurs, dates, thématiques, etc.). Elle s’applique à un tableau de contingence croisant les modalités de la variable étudiée avec le lexique. L’algorithme pro-cède d’abord au calcul du Chi2, et décompose ensuite les distances obtenues en une succes-sion hiérarchisée d’axes factoriels. Cette méthode permet d’obtenir des représentations syn-thétiques portant à la fois sur les distances calculées entre les variables et leurs modalités telles qu’elles s’expriment lexicalement (Longhi, 2018).
Son intérêt principal réside dans sa capacité à permettre l’observation à partir de vastes ta-bleaux de données difficilement saisissables, des structures simples, représentées sur deux axes orthogonaux, qui rendent compte des oppositions les plus structurantes du corpus au re-gard de variables déterminées :
Elle « permet d’obtenir des représentations synthétiques portant à la fois sur les dis-tances calculées entre les textes et celles que l’on peut calculer entre les unités tex-tuelles qui les composent. Les typologies obtenues sur chacun des deux ensembles mis en correspondance, sont intiment liées et peuvent être mise en relation grâce à des re-présentations simultanées sur les premiers axes factoriels » (Salem, 2009, p.19).
Elle recèle par conséquent un intérêt heuristique fort car elle rend possible une visualisation synthétique des rapports entre les formes et le corpus (compris comme un ensemble de textes enrichis de métadonnées renvoyant au contexte d’énonciation : locuteurs, genre, date, thèmes, etc.). Elle permet ainsi d’établir des rapprochements entre lexique et éléments contextuels dont l’interprétation peut « fournir des clés à l’analyse ». (Longhi, 2018, p.67) Ce faisant elle matérialise par des distances, les oppositions les plus structurantes du corpus par rapport à des variables déterminées.
DES DISCOURS SITUES AUX HORIZONS NORMATIFS
Cette amorce via la théorie des objets discursifs permet de donner une cohérence théorique et méthodologique à cet objet d’étude construit par succession d’opportunités. Celui-ci a présen-té des défis considérables pour l’analyse, en raison principalement des différences significa-tives qu’il existe entre les configurations socio-discursives ainsi articulées. Nous assumons ce parti pris, et ce pour deux raisons principales. D’abord, d’un point de vue politique, il inscrit notre travail en dialogue avec une demande et un contexte social. Les terrains que constituent nos corpus ont ainsi contribué à infléchir nos ambitions initiales, en raison de leur caractère fondamentalement situé et de la démarche inductive dont procède la méthodologie ici privilé-giée. Ensuite, d’un point de vue méthodologique, en vertu de la possibilité que ce parti pris offre de mener une observation contrastive. Enfin d’un point de vue théorique, car la décons-truction des représentations de la participation citoyenne, du quartier et du bien-être, telles qu’elles apparaissent dans un contexte très localisé, dans le cadre de dispositifs et de configu-rations sociales spécifiques, nous permet de poser l’hypothèse qu’elles partagent des caracté-ristiques communes, imputables, selon nous, au contexte de transformation de l’action pu-blique sous l’effet de la gouvernance européenne et à la structuration progressive de deux impératifs normatifs : « l’impératif délibératif » (Blondiaux & Sintomer, 2002) ou « délibéra-lisme » (Dacheux & Goujon, 2016) et « l’impératif de durabilité » (Génard & Neuwels, 2016) ou durabilisme. Ces inflexions sont susceptibles de participer, d’une part à une relecture de la citoyenneté et d’autre part à la structuration d’un nouvel horizon normatif consensuel articulé à la cohésion sociale.
La présente étude se fixe donc pour objectif de comprendre les déterminants, les évolutions et les enjeux actuels de la gouvernance urbaine à partir de la compréhension de la participation citoyenne en contexte local. En effet, il existerait, selon nous, une corrélation entre l’influence croissante qu’exerce le système de la gouvernance en tant que mode d’administration des so-ciétés et le succès grandissant de la participation citoyenne institutionnalisée. Le développe-ment des procédures participatives à l’initiative des pouvoirs publics serait ainsi le signe d’une profonde transformation des modalités de la décision publique locale, et de la gouver-nance néolibérale, toutes deux travaillées par deux impératifs normatifs en cours de stabilisa-tion : « l’impératif délibératif » (Blondiaux & Sintomer, 2002) ou « délibéralisme » (Dacheux Goujon, 2016) et « l’impératif de durabilité » (Genard & Neuwels, 2016) ou durabilisme. Elles seraient de plus révélatrices, si ce n’est de transformations, du moins d’un élargissement des conceptions de la citoyenneté. Néanmoins ces deux impératifs normatifs, tels qu’ils s’imposent aujourd’hui à l’action publique et aux citoyens, sont-ils plutôt imputables à la por-tée croissante de contre-discours opposés à la gouvernance néolibérale ou doivent-ils être compris comme les témoins d’une adaptation de cette dernière pour faire face à la fois aux critiques dont elle est l’objet et aux défis lancés par les crises pluridimensionnelles qui traver-sent actuellement les sociétés occidentales ? Délibéralisme et durabilisme semblent être générés paradoxalement tant par la progression de la gouvernance néolibérale, qui se traduit par la mise en œuvre de nouvelles techniques et modes d’administration des sociétés, que par des discours critiques, déjà anciens, portés à son encontre, que la crise financière de 2008 et le durcissement de la crise écologique auraient contribuer à renouveler. La portée de ces discours favoriserait le recours à des pratiques de gestion visant à replacer l’humain au cœur de la décision politique. Or, les rôles et usages faits de ces deux impératifs sont susceptibles de varier considérablement en fonction des contextes, des communautés d’acteurs, de discours et des configurations sociales dans lesquels les dis-positifs sont déployés. Il en résulte que la lisibilité des imaginaires politiques et des horizons normatifs dans lesquels l’impératif délibératif et l’impératif de durabilité sont susceptibles de s’insérer, sont largement complexifiés et ne semblent pas pouvoir recouvrir des institutions de sens homogènes. Ce brouillage rend toute tentative de genèse et de définition délicate en de-hors de la prise en compte des contextes sociaux, que nous jugeons déterminants. Nous postu-lons ainsi que seule une étude contextualisée permet, si ce n’est une compréhension, du moins une mise en perspective de la portée ambivalente du délibéralisme et du durabilisme, dès lors qu’ils s’incarnent concrètement dans des dispositifs participatifs.
Nous nous proposons par conséquent d’étudier ces appropriations à partir de trois dispositifs participatifs en contexte local : les conseils citoyens, la presse associative de quartier et les indicateurs de bien-être co-construits avec les habitants. A partir d’une attention portée aux représentations de la participation, du quartier et du bien-être, l’étude contrastive de ces dis-positifs participatifs, permet :
– d’expliciter, en contexte, la nature des liens entre gouvernance et participation institu-tionnalisée ;
de décrire plusieurs formes et modalités de participation citoyenne ;
de distinguer les enjeux et usages communicationnels qu’elle peut recouvrir, notamment s’agissant de la fabrique des territoires.
Une seconde hypothèse peut dès lors être formulée : les dispositifs participatifs, en tant qu’instruments des politiques publiques, relèvent de systèmes communicationnels qui ont pour but de fournir des réponses innovantes aux nouveaux besoins de gestion de territoires urbains, entre concurrence territoriale, résilience, identité locale et renouveau démocratique. Mais cette instrumentation de l’action publique doit aussi composer avec l’existence d’une participation citoyenne qui n’est pas de son initiative. Cette participation, plus ou moins spon-tanée et conquise peut venir concurrencer les narrations territoriales produites par les pouvoirs publics et répond à des enjeux variés, selon les dispositifs et les configurations sociales dans lesquelles elle prend corps. Tenter de comprendre les ressorts de la participation citoyenne localisée interroge ainsi directement les modes de fabrique des représentations des territoires de vie et de citoyennetés localisées.
Le cadre épistémologique, méthodologique et hypothétique posé, nous pouvons à présent en-tamer le parcours interprétatif en tentant d’abord de délimiter, en amont de l’ancrage politique, social et spatio-temporel de nos corpus, le périmètre dans lequel les procédures participatives et les indicateurs de bien-être se sont vu promus au rang de nouvelle donne politique. En effet, la prise en compte de l’ancrage des dispositifs dans un contexte institutionnel en mutation, celui de la mise en œuvre des politiques publiques et de leur évaluation, vient soutenir cette mise en perspective en les posant, de facto, comme instrumentation de l’action publique. Ce faisant, nous nous intéressons aux transformations de l’État et de l’action publique sous le triple effet de la mondialisation, des logiques gestionnaires qui animent les processus d’intégration régionaux et de la domination d’une topique néolibérale.
LES TRANSFORMATIONS DE L’ÉTAT ET DE L’ACTION PUBLIQUE A L’ERE DU NEOLIBERALISME
L’installation progressive du néolibéralisme en tant que forme constituante de la régulation des rapports économiques et sociaux sous l’effet de la mondialisation et la financiarisation de l’économie a entraîné un profond remaniement, transitoire, des modes de « gouverne »27 pré-cédents (Duchastel, 2004). Si ces transformations n’ont pas pris la même tournure selon les contextes nationaux, il n’en demeure pas moins que leur orientation programmatique émane d’une communauté de sens (Sarfati, 2007, 2008) relativement homogène : celle des experts économiques (Cusso & Gobin, 2008) évoluant dans le giron des grands organismes écono-miques et financiers internationaux tels que le Fonds Monétaire International (FMI), l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), la Banque Mon-diale, etc. (Duchastel, 2004 ; Cusso & Gobin, 2008). La pénétration de ces idées dans les ap-pareils étatiques a pu ensuite compter, selon les configurations, tantôt sur le relais favorable des chefs d’Etats, tantôt sur celui de hauts fonctionnaires, mais aussi, s’agissant de l’Union Européenne, sur la transposition de mesures réglementaires communautaires dans la législation des Etats membres (Gobin 2004 ; Gobin & Deroubaix, 2010). Ce néolibéralisme doctri-nal a donc pu s’imposer de manière volontariste ou subie.
Ainsi, « en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, ce sont les chefs politiques (Margaret Thatcher et Ronald Reagan) qui s’en sont faits les champions alors que dans la France de François Mitterrand ou le Canada de Brian Mulroney, le programme néo-libéral a semblé s’imposer de l’extérieur comme pur produit de la fatalité » (Duchas-tel, 2004, p. 2).
Dans ce cas, c’est l’impérieuse nécessité ressentie d’adapter les politiques nationales à une réalité économique perçue comme exogène, d’abord celle de l’apparition du chômage de masse dans le sillon de la crise économique produite par le choc pétrolier de 1973, puis plus généralement de la globalisation de l’économie, qui a conduit à l’adoption du néolibéralisme. Son avènement s’est accompagné de transformations dans la gouvernementalité des Etats, notamment s’agissant du pilotage des politiques publiques et par conséquent de ses instru-ments, au premier rang desquels figurent les outils statistiques. Les inflexions que connaissent ces derniers sont particulièrement éloquentes quant aux transformations en cours des axiolo-gies dominantes. En effet, la statistique est révélatrice d’une façon de penser, de se représenter la société, de façons d’agir sur elle par l’élaboration d’une quantification adéquate, adaptée aux usages voulus (Desrosières, 2003, 2008). En tant qu’opération de quantification, « vue comme l’ensemble des conventions socialement admises et des opérations de mesure », elle crée « une nouvelle façon de penser, de représenter, d’exprimer le monde et d’agir sur lui. » (Desrosières, 2014, p.39). Il existe par conséquent une corrélation entre les formes d’État qui se sont succédé et les outils statistiques dont elles se sont dotées pour gouverner.
L’HISTORICITE DES INSTRUMENTS DE PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES : UNE PE-RIODICITE QUI COÏNCIDE AVEC LES CRISES ECONOMIQUES
L’évolution du rôle des indicateurs quantitatifs dans la manière de gouverner s’inscrit selon A. Desrosières dans « une périodicisation des formes d’État depuis le XVIIIe siècle » (Desro-sières, 2014, p.37). Leur typologie est donc intimement liée à la façon dont sont socialement construites les conceptualisations de la société, de l’économie, des formes de l’action pu-blique, des procédures de quantification et de modélisation qu’elles mobilisent. On comprend donc que les évolutions des formes de l’État ont également modifié les outils statistiques utili-sés dans le pilotage des politiques publiques.
Les grandes crises économiques sont, tout à la fois, représentées par des indicateurs statis-tiques et à l’origine de vastes phénomènes de recomposition du paysage de ces indicateurs. Elles sont des moments où les statistiques sont intensément mobilisées pour rendre compte de la situation. Mais les crises ont aussi la « capacité apriorique » d’ébranler un ordre du discours dominant (Canu & Bonnet, 2017) et elles seraient en cela censées ouvrir des moments de dé-bats, lors desquels le rôle de l’État, sa régulation et ses objectifs sont profondément repensés.
chacune de ces crises est corrélée l’émergence de façons nouvelles de penser et de quanti-fier les rapports sociaux. Ces conceptions sont le fruit d’une construction sociale complexe impliquant des logiques de concurrence pour la visibilité, l’imposition d’une représentation du monde ou d’un ordre de discours dominants (Bourdieu, 2001 ; Canu & Bonnet, 2017). Dans ce processus de construction, la statistique occupe une position particulière car elle est à la fois révélatrice des transformations axiologiques et instrument de leur diffusion, puis de leur imposition. En effet, les nouveaux modèles d’action, issus de ces moments et processus de redéfinition « impliquent de nouvelles variables et de nouveaux systèmes d’observation » (Desrosières, 2014, p.85). Nécessitant des opérations de catégorisation et de commensuration (Thevenot, 1983), la statistique, comme plus généralement toutes les formes de quantification […] transforme le monde par son existence même, par sa diffusion et ses usages argumen-tatifs, scientifiques, politiques ou journalistiques » (Desrosières, 2014 p.39).
Cela implique également que « une fois les procédures de quantification codifiées et routini-sées, leurs produits sont réifiés » (Ibid., p.29) et ont par conséquent tendance à s’imposer comme une évidence.
Cette portée refondatrice des crises est mise en relief d’un point de vue socio-historique par A. Desrosières qui établit une corrélation étroite entre la transformation des instruments statis-tiques et le rôle qui a successivement été donné à l’État au cours des deux derniers siècles. Il distingue une succession de cinq formes d’État, chacune d’elle ayant mobilisé des outils sta-tistiques spécifiques : l’État ingénieur, l’État libéral, l’État keynésien, l’État providence et l’État néolibéral. Leur apparition successive coïncide avec les crises économiques et sociales qui ont traversé le XIXème et le XXème siècle.
DU KEYNESIANISME AU NEOLIBERALISME
Ainsi, la crise de 1880 a vu naître la statistique du travail et de l’emploi pour quantifier et me-surer les conséquences de la crise en termes de pauvreté et de chômage. Ces statistiques sont venues outiller une législation visant à protéger les travailleurs et leur pouvoir d’achat, drama-tiquement affectés par la crise. Celle de 1930, quant à elle, a institutionnalisé les politiques keynésiennes : fondées sur la perception d’un équilibre macroéconomique entre l’offre et la demande globale, elles impliquent de faire jouer un rôle clé aux dépenses gouvernementales. C’est dans ce contexte qu’est apparue la comptabilité nationale, aujourd’hui remise en cause, visant à prendre en compte l’ensemble des flux monétaires. Ce rôle clé de l’État s’accompagne du développement de l’État providence ou « Welfare State », dont les mesures de protection mutualistes et solidaristes mises en œuvre (assurances chômages, allocations familiales, retraites, assurance-maladie) « contribuent à amortir les baisses de revenus et de consommation entraînées mécaniquement par les crises économiques » (Desrosières, 2014, p.89). Cette vision du rôle de l’État qui a prospéré en France durant la période dite des 30 Glorieuses (1945-1975), repose donc sur une axiologie politique et macroéconomique selon laquelle des mesures de corrections et de compensations doivent être apportées au marché afin de garantir une allocation des ressources plus équitable. Elle implique de déterminer des cri-tères de répartition, imprégnés d’une éthique de justice sociale, redistributive, en vue de trou-ver un optimum dans la fonction de bien-être social (Guibet-Lafaye, 2006). L’économie peut dès lors se trouver subordonnée à des critères moraux, éthiques et politiques et les choix gouvernementaux entrent ainsi en résonance avec les thèmes de la lutte contre les inégalités so-ciales en matière de consommation mais aussi l’accès à l’éducation, à la santé, à la culture. Les statistiques, tributaires d’une représentation d’un monde social fortement marqué par le salariat et divisé en classes, sont structurées en fonction de catégories socioprofessionnelles. Ces dernières sont héritières d’une vision marxiste alors répandue des rapports sociaux en termes de classes ou de groupes sociaux. Elles ont été abondamment mobilisées par la statis-tique publique, les universitaires et les instituts de sondages.
La crise pétrolière de 1973 a été l’opportunité une remise en cause totale de la modélisation antérieure. Les politiques keynésiennes ainsi que l’État providence sont discrédités et cette critique est largement liée à la montée en puissance, dans le domaine de l’économie politique, de la théorie néoclassique des anticipations rationnelles (Muth, 1961 ; Lucas, 1972 ; Lucas & Sargent, 1981)28, particulièrement mobilisée en Europe par le thatchérisme (Duchatel, 2004). Très anti-keynésienne, elle véhicule une critique du rôle de l’État, plus particulièrement de l’État providence, en cherchant à démontrer l’inefficacité économique des mesures discré-tionnaires keynésiennes.
Cette période correspond à celle d’une « idéalisation des mécanismes marchands supposés efficients et autorégulés » (Desrosières, 2014, p.89) et elle oriente ainsi les choix de financia-risation de l’économie supposée traduire de la façon la plus transparente possible, les anticipa-tions rationnelles des agents. Elle justifie aussi des mesures de dérégulation, avec une montée en puissance du court-termisme des décisions au détriment des idées de prévision et de plani-fication à long-terme. L’État providence caractérisé par son interventionnisme et son modèle redistributif, a ainsi cédé le pas à un Etat néolibéral (Duchastel, 2004 ; Gobin, 2004 ; Desro-sières, 2014 ; Dardot & Laval, 2014), sous l’effet des mesures prévues par ce que l’on nomme couramment « le Consensus de Washington » (Duchastel, 2004 ; Wacquant, 2010)29. Ce pro-gramme néolibéral prévoit principalement des mesures de déréglementation, d’équilibre bud-gétaire, de privatisation et de libéralisation commerciale qui ont eu pour conséquence de transformer considérablement le rôle attribué à l’Etat. Il a notamment eu tendance à renforcer sa dimension sécuritaire (Wacquant, 2009, 2010). En Europe, cette transformation du rôle de l’État est également à mettre en relation avec la structuration du marché unique européen, la mise en place de l’Union Économique et Monétaire et la création de la monnaie unique euro-péenne. Avec l’abandon du droit régalien de battre monnaie, on observe un déplacement du centre du pouvoir, avec un rôle clé désormais attribué à la Banque Centrale Européenne.
LE SUCCES DU NEOLIBERALISME DANS LA REGULATION DES ESPACES TRANSNATIO-NAUX : LA GOUVERNANCE NEOLIBERALE EUROPEENNE
Cette conception technique et juridique de la régulation repose sur le postulat d’une complexi-fication des rapports de pouvoirs, sous l’effet notamment de la mondialisation, caractérisée par la montée en puissance au sein des espaces transnationaux, d’organismes publics et privés dont les compétences normatives (édiction, promulgation des normes) entrent en concurrence avec celles jusqu’alors presque exclusivement dévolues aux Etats-Nations (Duchastel, 2004 ; Cusso & Gobin, 2008 ; Gobin & Déroubaix, 2010).
Il existe désormais une zone transfrontalière au sein de laquelle se déroulent des négociations et se prennent des décisions portant sur des sujets, des questions ou des problèmes qui ne peuvent plus être pris en charge uniquement par les États nations. Les gouvernements ne peuvent tout simplement plus gérer les conséquences de l’interdépendance du monde. Le champ d’action où doivent s’appliquer des politiques s’élargit, devient perméable. La différence entre questions domestiques et internatio-nales devient de plus en plus difficile à discerner » (Duchastel, 2004, p.12).
Cette montée en puissance de la mise en « agenda international » des questions et décisions politiques auparavant régulées à un niveau national, a été particulièrement visible avec la création de l’Union Européenne, dans laquelle le droit communautaire est placé au sommet de la pyramide de l’ordre juridique des États membres (Gobin & Déroubaix, 2010). De fait, en 2003 déjà, 60 % des décisions législatives nationales étaient en grande partie du droit com-munautaire dérivé (Cassen, 2003 cité par Gobin, 2004, p.86). Une part de plus en plus impor-tante des prérogatives et compétences des Etats s’avère aujourd’hui partagée au sein d’un système politique hybride » (Ibid., p.86), formé par les institutions de l’UE, les institutions européennes et internationales non-communautaires et les institutions politiques et adminis-tratives nationales, de façon de plus en plus imbriquée. Depuis l’adoption du traité sur la Sta-bilité, la Coordination et la Gouvernance (TSCG), entré en vigueur en 2013, ce processus d’inter-influence entre les Etats membres et l’UE, dans la fabrication des normes, s’est trouvé parachevé en rendant supplétives, subsidiaires, les constitutions nationales et ce uniquement dans la mesure où elles n’entrent pas en conflit avec la constitution européenne. De fait, de-puis l’adoption du traité de Lisbonne en 2007, les affaires européennes sont devenues des questions de politiques internes et la définition des compétences exclusives des Etats membres devient de plus en plus complexe.
L’Union Européenne apparaît donc, en raison notamment de l’influence qu’elle exerce sur les contextes législatifs des Etats membres, comme un « agent de la diffusion du modèle de la gouvernance » (Gobin, 2004, p.91) et du néolibéralisme en Europe. Elle est en cela un des principaux acteurs, aux côtés des grandes organisations financières internationales, « du re-modelage des conceptions de ce que doit être une société et le rôle du pouvoir politique au sein de celle-ci » (Ibid, p.91). La construction européenne, outre le fait d’avoir placé la créa-tion d’un marché commun au fondement de sa raison d’être, repose sur une conception de l’économie de marché ouverte « où la concurrence est libre et non-faussée »33, actualisant l’axiologie de la « main invisible » 34 et de la concurrence pure et parfaite comme condition d’efficacité tant de l’allocation des ressources que de la régulation des intérêts particuliers. Cela dit, à la différence du libéralisme, le néolibéralisme stipule que l’Etat doit être un ins-trument de dérégulation, pour garantir l’efficience des marchés. L’imposition progressive en Europe, après 1989, de cette vision néoclassique de l’économie et néolibérale des rapports sociaux a eu pour conséquence d’entraîner une transformation du rôle de l’État. Elle a aussi contribué à l’altération progressive de l’expression des droits politiques et sociaux, tels que l’État providence avait contribué à les consacrer, afin de les mettre en conformité avec la doxa néolibérale35 (Gobin, 2004 ; Duchastel, 2004 ; Desrosières 2014).
La complexification des relations de pouvoir, leur interdépendance36 et les impératifs de régu-lation du marché européen seraient à l’origine de la mise en place d’un nouveau modèle de régulation, dans lequel l’État, dont la souveraineté et l’autorité se font de plus en plus limitées, apparaît comme un partenaire parmi d’autres. Ce modèle est à présent couramment désigné sous le vocable de gouvernance :
dans le contexte contemporain, on utilise souvent le terme de gouvernance pour rendre compte des dispositifs servant à définir ces règles, normes et procédures né-cessaires au fonctionnement des divers systèmes organisationnels. La gouvernance répondrait au besoin de régulation qui se manifeste à divers niveaux dans la nouvelle économie politique des sociétés contemporaines » (Duchastel, 2004, p.6).
J. Duchastel identifie trois traditions dans l’usage académique de la notion de gouvernance. La première provient de la micro-économie (Williamson, 1975) et la gouvernance y est utili-sée pour décrire les rapports, en terme de coûts de transaction, entre internalisation et externa-lisation de la sous-traitance dans les entreprises. Elle a ensuite pris le sens de « bonnes » pra-tiques administratives au sein de l’entreprise : transparence, imputabilité et participation des actionnaires aux prises de décision. La deuxième tradition est ancrée dans la sociologie ur-baine (Gremion, 1979) où la gouvernance remplace le concept de gouvernement local pour désigner les actions stratégiques de divers acteurs (politiques, économiques et sociaux) entre-prises dans le contexte de la démocratie locale et des négociations autour des enjeux urbains37. Enfin, c’est son utilisation dans le domaine des sciences politiques (Rosenau, 1997) qui con-fère à la gouvernance son sens le plus répandu, dans le contexte de la mondialisation et de l’affaiblissement des États nations. Elle désigne alors « les nouvelles modalités de la gouverne politique dans un contexte de décentration dans l’exercice du pouvoir » (Duchastel, 2004, p.6).
Ces trois traditions nourrissent les conceptualisations et les pratiques de la gouvernance en tant que technique d’administration. Cependant, sa circulation croissante et sa substitution au principe de gouvernement en élargissent considérablement le périmètre.
Ainsi, dans l’ordre du gouvernement, la gouvernance est un mode de gouverne qui correspond au rôle régulateur minimal accordé à l’État par la doctrine néolibérale. Ce rôle se réduit à dé-finir des règles techniques et juridiques assurant le libre déploiement de la logique du marché. La gouvernance consiste dès lors à garantir le bon fonctionnement des organisations en énon-çant des règles plus ou moins contraignantes, sous forme de normes, de chartes, de procédures, de règlement, supposées répondre aux principes de la bonne administration. Celle-ci se rap-porte tacitement à une gestion entrepreneuriale idéale : la transparence, l’imputabilité, la res-ponsabilité. Résolument technocratique, elle n’intègre pas les finalités politiques qui font réfé-rence à un univers hors-système. L’usage de plus en plus courant de ce terme pour désigner l’action d’organismes étatiques tend en conséquence à substituer à l’idée de gouvernement celle de gouvernance, « provoquant ainsi une « neutralisation » du premier terme, un évidage de son contenu proprement politique » (Duchastel, 2004, p.7). Mais cette neutralité est dog-matique puisqu’elle participe d’une vision technocratique et experte de la régulation des acti-vités sociales (Cusso & Gobin, 2008). Dominé par le registre de l’expertise gestionnaire, le débat, le dissensus, les conflits politiques seraient rendus caducs, par la production et l’application de normes, techniques, à même de parvenir à une situation d’équilibre, d’efficacité. L’administration et la gestion primeraient ainsi sur l’ordre du débat et du conflit et il s’agirait dès lors de « faire primer l’administration des choses contre le gouvernement des hommes » (Gobin, 2004, p. 89). Le caractère technocratique et juridique de la gouver-nance la rend réplicable à tous les niveaux du système dont les composantes, interdépendantes, seraient toutes orientées vers l’exécution d’objectifs communs.
LES CHANGEMENTS DE LA GOUVERNEMENTALITE DE LA SOCIETE ET DE LA CONCEPTION DE L’ÉTAT : LE CAS DE DEUX METHODES DE PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES
Cette domination de la gouvernance néolibérale coïncide avec la généralisation de l’usage des outils statistiques, non plus seulement exclusivement s’agissant du contrôle des marchés et la régulation des flux monétaires, mais pour toutes les politiques publiques, désormais assujet-ties à un contrôle de régularité gestionnaire. Ce mode de régulation nécessite la mise en place d’instruments spécifiques qui viennent outiller la gouvernance et donner une consistance ad-ministrative à cette régulation par les bonnes pratiques. Nous nous intéresserons spécifique-ment à deux pratiques, le New Public Management (NPM) et à sa déclinaison à l’échelle communautaire sous le nom de Méthode Ouverte de Coordination (MOC). Celle-ci est parti-culièrement utilisée comme instrument d’harmonisation des politiques publiques à l’échelle de l’UE.
D’abord utilisé dans les années 1980 et 1990 en Grande Bretagne (Hood, 1995 ; Lascoumes & Le Galès, 2004) le NPM s’impose progressivement en France avec la Loi Organique relative aux Lois de Finances (dite « LOLF ») en 2001 (Desrosières, 2014). La loi LOLF réorganise la présentation du budget de l’État, selon les objectifs à atteindre et non plus seulement selon les moyens attribués. Ces objectifs doivent être explicités et quantifiés, afin que le Parlement ne se contente plus de voter des dépenses, mais puisse aussi vérifier la réalisation des objectifs et les performances des services. Elle s’appuie sur un grand nombre d’indicateurs de perfor-mance des administrations car le NPM impose une obligation d’évaluation des politiques pu-bliques à l’aune de critères largement dictés par l’efficacité économique et les objectifs d’équilibre budgétaires issus du monde de la comptabilité entrepreneuriale.
Mais la détermination de critères d’évaluation des politiques publiques pose un certain nombre de problèmes. En effet, contrairement au secteur marchand, il est impossible de s’appuyer sur des critères comptables classiques tels que la « part de marché » ou la rentabili-té pour juger de leur capacité à satisfaire les besoins des usagers ou leur efficacité (Desro-sières, 2014). Si auparavant, la prise en compte de l’engagement relatif à l’exécution de mis-sions de service public et l’organisation hiérarchique des services publics suffisaient à garantir cette responsabilité, depuis les années 1980, ce « sens civique » (Ibid., p.45) du service public a été jugé insuffisant pour évaluer l’utilisation des ressources publiques.
Les nouveaux objectifs d’efficacité et de performance dont le NPM est porteur ont donc con-duit à la recherche d’indicateurs quantifiés susceptibles de tenir un rôle comparable à celui des instruments comptables auxquels les entreprises marchandes ont recours pour contrôler et réguler leurs activités (comptabilités analytiques, comptes d’exploitation, bilans). Dans cette perspective, les indicateurs ne peuvent pas être uniquement monétaires, car le plus souvent, les effets des services publics (école, santé, sécurité, diplomatie, défense, etc.) ne sont pas exprimables en ces termes. Depuis les années 2000, un processus de définition de ces critères est en cours, fruit de tâtonnements et d’expérimentation, notamment dans le cadre de la MOC, tant au niveau local (État et collectivités territoriales) que global (l’Union Européenne, no-tamment), accompagnant ainsi un processus d’harmonisation38 des politiques publiques euro-péennes.
Ce double processus de définition et d’harmonisation des politiques publiques est accompa-gné de la diffusion de techniques dites de « benchmarking ». La MOC, utilisée par l’UE pour orienter et harmoniser les politiques sociales qui ne relèvent pas de domaines économiques et monétaires, en constitue un bon exemple. Non contraignante, elle a été définie comme un ins-trument de la Stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi (2000) en faveur de la compétitivité des territoires, entendue comme la « capacité à améliorer durablement le ni-veau de vie de ses habitants et à leur procurer un haut niveau d’emploi et de cohésion sociale »39. Elle avait pour objectif de faire de l’UE l’économie de la connaissance la plus compéti-tive du monde en dix ans (Delaplace, 2011). Elle prend place dans des domaines qui relèvent encore de la compétence des États membres tels que l’emploi, la protection sociale, l’inclusion sociale, l’éducation, la jeunesse et la formation. Elle se base principalement sur : l’identifica-tion et la définition en commun d’objectifs à remplir (adoptés par le Conseil) ; la définition commune d’instruments de mesure (statistiques, indicateurs, lignes directrices) et le « ben-chmarking », c’est-à-dire la comparaison des performances des États membres et l’échange des meilleures pratiques. Elle invite en cela à la mise en place d’une coopération concurren-tielle entre les territoires.
Elle repose sur la publication de palmarès de performances classant les Etats et autres collec-tivités territoriales selon divers indicateurs quantitatifs (Desrosières, 2014). La comparaison, fournie par les palmarès, serait ainsi susceptible de faire ressortir les « bonnes pratiques » (Gobin, 2004) et donc d’engager un cercle vertueux en faveur de la réalisation des objectifs de croissance et d’emploi durable.
La LOLF et la MOC confèrent donc un rôle clé aux indicateurs statistiques, l’une pour le sui- du budget de l’État, l’autre pour le pilotage indirect des politiques sociales européennes (Desrosières, 2014) et chacune d’elle rend compte des contraintes qui pèsent désormais sur les Etats ainsi que de la transformation de leurs prérogatives. Cette expertise du chiffre, calcula-toire et économique traduit : une monopolisation et une autoréférentialité progressives de l’expertise acceptable par les savoirs endogènes à l’économie, dès lors qu’on traite d’un sujet/d’une actuali-té relevant de ce domaine, au détriment de ceux qui proviennent d’autres univers et qui empruntent à d’autres axiologies » (Canu & Bonnet, 2017, p.13).
L’autorité du chiffre a ainsi tendance à éclipser du périmètre des négociations d’autres formes d’autorité sociale ou politique. Le politique devient factuel, objectivable et calculable, le débat social contradictoire est affaibli au profit de cette ingénierie gestionnaire qui se présente comme objective, neutre et efficace. La force du modèle repose sur son caractère évolutif : les indicateurs quantitatifs peuvent être critiqués sans pour autant discréditer un système toujours prêt à se transformer, sous l’effet de la gouvernance par les bonnes pratiques. Les indicateurs sont en effet supposés perfectibles, au vu de l’expérience (Desrosières, 2014)40.
La gouvernance et ses instruments diluent en même temps qu’elle la transforme la notion de responsabilité, celle du service public et de l’intérêt général, notions dont la culture législative et administrative française reste encore empreinte. On lui préfère désormais le terme « ac-countability » qui subordonne la responsabilité à l’obligation de rendre compte des actions dans leur dimension opérationnelle en termes d’évaluation des résultats et des performances. Le concept d’« accountability » issu du management des entreprises articule ainsi une dimen-sion technique et morale (Pezet, 2007 ; Desrosières, 2014) et produit une intériorisation ainsi qu’une réification des contraintes économiques et budgétaires régissant les choix des organi-sations (Pezet, 2007). Dans cette perspective, l’État devient un agent économique parmi d’autres : la tendance à la décentralisation et à la démultiplication de l’État en agences plus ou moins autonomes et gérées comme de quasi entreprises en est révélatrice.
L’IMPACT DE LA GOUVERNANCE SUR LA LEGITIMITE DU POUVOIR DEMOCRATIQUE
Les transformations du rôle de l’État sous l’effet de la mondialisation et de la multiplication des organismes décisionnels ont pour effet de bouleverser sa légitimité et le lien de représen-tativité unissant les citoyens aux instances décisionnelles. Elles affectent considérablement le régime de légitimité démocratique libéral fondé sur la représentation et donnent lieu à une crise politique que J. Duchastel (2004) qualifie de tri-dimensionnelle : elle se manifeste par une crise de régulation, de légitimation et de représentation. Ainsi, la crise de la régulation révèle au grand jour que l’État n’est plus détenteur du monopole de la régulation politique de la société car il doit composer avec un nombre croissant de sources alternatives de production de la norme. La crise de la représentation met quant à elle en évidence une fragmentation de la société qui ne trouverait plus dans la nation et/ou l’État le principe unificateur de son iden-tité. Enfin, la crise de légitimité témoigne de l’incapacité de la communauté nationale à garan-tir la validité de l’action étatique. Elle est aussi liée au désaveu des instances censées animer le fonctionnement démocratique (partis, parlement, médias, etc.) affaiblies, en partie, par le manque d’indépendance, de transparence et le technocratisme.
le système international est en voie de substituer au principe de souveraineté des États, possédant un territoire délimité et une compétence exclusive dans la conduite de leurs affaires, un principe de partage de souveraineté dans un espace déterritoria-lisé (Duchastel, 2004, p.27) ».
Si les processus d’intégration régionaux portés par les organisations transnationales, telles que l’Union Européenne, ont tendance à accélérer les transferts de souveraineté et de compétences en dehors des Etats, ils ne sont toutefois pas effectivement accompagnés d’un transfert de légitimité démocratique. La compréhension de ces bouleversements donne lieu à des ap-proches plurielles de la gouvernance, de la place de la citoyenneté et de la société civile.
L’IMPACT DE LA GOUVERNANCE SUR LES REPRESENTATIONS DE LA SOCIETE CIVILE ET DE LA CITOYENNETE
La gouvernance n’est pas perçue de manière homogène et elle donne lieu à des représenta-tions différenciées. Elles sont en effet susceptibles de varier selon qu’une axiologie « scep-tique » ou « globaliste » (Held et al., 2000) soit mobilisée pour sa compréhension. Si ces deux représentations partagent le constat de transformations majeures dans l’économie politique des sociétés, elles varient dans l’appréhension qui est faite de ces phénomènes. Ces deux axio- logies se présentent comme une polarité formée d’un côté par des positions « réalistes » face au fonctionnement de ce qu’il est convenu d’appeler le système mondialisé, considérant que les idéaltypes de démocratie et de souveraineté n’ont jamais été transposés parfaitement dans le fonctionnement des Etats-Nations et d’un autre, des positions plus « globalistes », qui met-tent l’accent sur les innovations institutionnelles que ces changements charrient.
De la sorte, si on s’attache à illustrer la gouvernance sous un angle « globaliste », on peut aus-si considérer que sa montée en puissance coïncide et accompagne une remise en cause de la construction historique de l’homogénéité de la nation (Duchastel, 2004 ; Citron, 2017 ), à la-quelle contribuent les nouveaux mouvements sociaux dans leur pluralité et leur diversité, lorsqu’ils sont animés d’une volonté de prise en compte de particularismes locaux, culturels, des minorités, des enjeux environnementaux, etc. Les contextes des mobilisations peuvent tendre à remettre en cause les frontières, qui, en ce qui concerne la circulation des idées, par-fois des hommes, et surtout des capitaux, apparaissent de plus en plus poreuses.
La conséquence en est que la légitimité abstraite fondée sur l’existence d’une nation uniforme est de plus en plus remise en question » (Duchastel, 2004, p.15).
Les deux catégories fondamentales du régime démocratique et de l’architecture institution-nelle moderne que sont la société civile et la citoyenneté s’en trouvent à leur tour transfor-mées. En effet, en dépit de leur rôle constitutif dans les démocraties modernes (Chartier, 1990), la société civile et la citoyenneté ne font pas toujours l’objet de définitions univoques.
Elles ont eu tendance à se présenter à l’évidence sans pour autant recevoir une dé-finition précise. Ce sont pourtant ces catégories qui ressurgissent depuis un certain nombre d’années dans le discours des acteurs, alors que les institutions politiques modernes sont questionnées. Il y a là un certain paradoxe » (Duchastel, 2004, p.18).
L’ERE DU CITOYEN PLURIEL
La citoyenneté est probablement la catégorie la mieux définie mais elle est aussi celle qui su-bit les transformations les plus radicales en termes de représentation, sans qu’elles soient né-cessairement suivies de traductions juridiques. Dans le processus d’institutionnalisation poli-tique de la modernité, elle a joué un rôle central dans la légitimation du pouvoir de l’État dé-mocratique, car le citoyen est fondamentalement défini, notamment par la philosophie poli-tique et le droit constitutionnel, comme un sujet politique. C’est en effet la volonté expresse commune des citoyens formant une « communauté nationale » qui est invoquée en tant que principe de légitimation de « l’agir » politique (Ibid.). Cette expression est matérialisée par un statut juridique qui garantit l’exercice de droits politiques, la participation civique quel que soit le degré d’implication du citoyen à la gestion de la chose publique. Le degré et les formes de cette participation varient en fonction des modèles de démocratie et des formes de régimes. Les modèles démocratiques mettent l’accent plus ou moins sur la représentation ou l’administration directe, de la démocratie représentative à la démocratie directe. Les formes de régime donnent plus ou moins d’importance aux divers niveaux de gouvernement, natio-naux, régionaux ou locaux, de la république à la fédération. Les droits et libertés civils, les garanties juridiques et les droits politiques constituent ainsi le socle minimal de la citoyenneté démocratique.
D’abord comprise comme un statut juridique avalisant l’appartenance à une communauté na-tionale, puis comme ensemble de droits et de libertés de nature civile, juridique ou politique, la citoyenneté démocratique tend à être bouleversée sous l’effet conjoint des processus d’intégration communautaires et régionaux, mais aussi des transformations de l’activisme. La citoyenneté est de plus en plus perçue comme un ensemble de droits afférant à des conditions particulières, relevant d’identités multiples, qui articulent à merci les échelons locaux ou glo-baux. Elle s’est ainsi peu à peu élargie et son élargissement correspond peu ou prou à la re-connaissance progressive d’une part de droits et libertés civiles, puis politiques pour des caté-gories qui en étaient auparavant exclues (non-propriétaires, femmes, étrangers ?44), d’autre part, de « nouvelles générations » de droits, sociaux, culturels et catégoriels. Ces mouvements sont autant de tentatives de remise en cause progressive de la coupure libérale (Beauvois, 2005) entre la société civile, le social et le politique.
Mais cette remise en cause des fondements sociaux de la participation politique s’effectue en partie au détriment de catégories sociales auparavant structurantes pour l’animation de la con-flictualité démocratique. L’affaiblissement de la légitimité des syndicats, entraîné par l’apparition du chômage de masse, les choix et réformes politiques visant à limiter leur rôle représentatif, peut en partie expliquer, par exemple, que le travailleur soit de plus en plus écarté des affaires politiques. Cet affaiblissement coïncide avec la reconnaissance de catégo-ries sociales plus souples, plus labiles, plus contingentes, non statutaires. Ainsi, si les do-maines relevant du politique tendent à s’élargir sous l’effet des nouveaux mouvements so-ciaux (sexualité, conjugalité, pratiques de consommation, les modes de vie), cet élargissement semble s’effectuer au détriment du développement d’un pouvoir social adossé aux statuts et catégories socio-professionnelles qui structuraient auparavant les représentations de la société. Le citoyen n’est plus seulement un agent politique mais apparaît dès lors comme une méta-catégorie englobant une pluralité d’acteurs sociaux.
Dans le contexte de la mondialisation, la citoyenneté est pensée à l’extérieur des frontières nationales, on parle par exemple régulièrement d’une citoyenneté européenne (Gobin, 2002 ; Pelabay, 2006). En outre, il est régulièrement fait appel à la citoyenneté dès lors qu’il apparaît nécessaire de mettre en évidence une responsabilité individuelle. C’est le cas s’agissant de la crise environnementale, qui tend à encourager cette vision dénationalisée et dé-instituée de la citoyenneté. C’est aussi le cas quand il s’agit d’adopter des comportements civiques, soli-daires, responsables, des « gestes citoyens ». C’est enfin le cas pour le militantisme à ten-dance altermondialiste. Le « citoyen du monde » ne considère pas nécessairement les frontières nationales comme pertinentes, dès lors que l’engagement qu’il fait sien ne peut s’exprimer exclusivement dans ce cadre45. Ces mouvements interviennent selon des formes de transversalités qui échappent au principe d’institutionnalisation verticale des organisations politiques modernes et ils se caractérisent par le déplacement du lieu des luttes sociales. Si, lorsqu’ils trouvent à se matérialiser dans les espaces physiques, ces nouveaux mouvements sociaux se territorialisent, ils sont susceptibles de renvoyer à des géographies qui ne se rédui-sent pas à l’espace national. Ils sont tantôt locaux, nationaux, internationaux ou globaux et ont tendance à converger. Les « mouvements des places » (Pleyers & Capitaine, 2016) fournissent ce titre une illustration de ce déplacement d’une forme de militantisme pour laquelle, l’État-nation cesse d’être central. À l’égal des mouvements altermondialistes, ces mouvements de-viennent globaux, au sens où leurs acteurs savent articuler un combat ciblé avec une vision planétaire dans laquelle la gouvernance néolibérale et les logiques de marché sont identifiés comme les horizons normatifs à mettre à mal. Ils s’en distinguent toutefois par la relation nouvelle qu’ils entretiennent avec la politique en s’essayant à construire de nouveaux espaces pour sa pratique et par la place qu’ils accordent à l’éthique, à l’exigence de justice sociale, de dignité, de démocratie et d’horizontalité 46.
Si cette articulation local/global n’est pas récente 47, les transformations de la citoyenneté, l’insuffisance du statut de travailleur à garantir une reconnaissance sociale48 (Honneth, 2008), le développement d’Internet et des réseaux sociaux numériques (Cardon 2011, Granjon et al., 2011 ; Cardon & Granjon, 2013, Ducos et al., 2018), la mondialisation, les processus d’intégration régionaux et les enjeux environnementaux (etc.), tendent à lui conférer d’une part, une portée croissante, d’autre part une influence en dehors des réseaux militants.
l’opposé, les mouvements dits « NIMBY » (Not In My Back Yard) semblent plutôt relever d’une forme de ségrégation sociale de l’espace. Celle-ci est opérée par des populations géné-ralement aisées et elle dénote une appropriation particulière de l’espace vécu et de l’acte.
|
Table des matières
Partie I. Le sens des discours en contextes : une approche conceptuelle, contextuelle et variationnelle
Chapitre 1. Aborder la circulation des idées à partir de discours situés, de la doxa néolibérale à la participation des habitants
1.1. Dénaturaliser le sens commun
1.2. Des configurations socio-discursives insérées dans des dispositifs communicationnels
Chapitre 2. Le discours comme pratique sociale : une approche contrastive et variationnelle des discours
2.1. Le discours : une pratique sociale et socialement située
2.2. Entre analyse « du » et « de » discours : une approche écologique des discours
2.3. Du discours au corpus, la constitution des observables
2.4. Critères et constitution des corpus
2.5. Les outils d’analyse statistiques
2.6. Des discours situés aux horizons normatifs
Partie II. De la gouvernance néolibérale à sa timide inflexion
Chapitre 3. Les transformations de l’État et de l’action publique à l’ère du néolibéralisme
3.1. L’historicité des instruments de pilotage des politiques publiques : une périodicité qui coïncide avec les crises économiques
3.2. Du keynésianisme au néolibéralisme
3.3. Le succès du néolibéralisme dans la régulation des espaces transnationaux : la gouvernance néolibérale européenne
3.4. Les changements de la gouvernementalité de la société et de la conception de l’État : le cas de deux méthodes de pilotage des politiques publiques
3.5. La crise de 2008 et la réactualisation des discours critiques : vers une inflexion délibérative de la gouvernance néolibérale ? .
Chapitre 4. L’impact de la gouvernance sur la légitimité du pouvoir démocratique
4.1. L’impact de la gouvernance sur les représentations de la société civile et de la citoyenneté
4.2. L’ère du citoyen pluriel
4.3. La société civile organisée autour d’intérêts particuliers
4.4. Le rôle de la construction européenne dans la diffusion du modèle de la gouvernance : la démocratie participative et la gouvernance, une relation privilégiée ?
4.5. Les transformations de la gouverne locale : entre gouvernance et démocratie participative
Partie III. Penser et dire la participation : entre « démocratie d’élevage » et « démocratie sauvage »
Chapitre 5. La participation un sous-champ de recherche transversal et dynamique
5.1. Un objet évolutif et polymorphe : les temps des études en matière de participation
5.2. La démocratie participative : un syntagme empli de paradoxes et d’ambiguïtés
5.3. Le paradigme délibératif et « l’agir communicationnel » : l’échange rationnel d’arguments comme fondement de l’autodétermination des citoyens
5.4. Un ancrage spécifique dans le domaine du développement et de la gestion de l’urbain. Vers la gouvernance urbaine
5.5. Chercheurs, techniciens et habitants, la place des savoirs et des expertises dans la gouvernance des dispositifs participatifs
Chapitre 6. Le cas d’un dispositif participatif dans le cadre de la Politique de la ville : lesconseils citoyens
6.1. Un contexte local : les conseils-citoyens de la métropole toulousaine
6.2. Un dispositif de gouvernance à l’architecture complexe
6.3. Du terrain au corpus : retour sur les modalités de constitution des observables
6.4. Configurations des conseils et des séances .
Chapitre 7. « Paroles et agir » autorisés des conseils citoyens
7.1. Des espaces discursifs de délibération sous contraintes
7.2. Un « agir communicationnel » institutionnellement normé
7.3. Un « agir communicationnel » en deçà du contrat de ville : horizontalité et réticularité.
Partie IV. La fabrique des images du territoire : entre discours et contre-discours
Chapitre 8. Territoire, pouvoir et citoyenneté
8.1. L’espace public local : le rôle des médias dans l’entretien de la territorialité
8.2. Les médias locaux : histoires et fonctions différenciées
8.3. Communication publique et territoires : entre communication choisie et communication subie, les images de la ville au prisme des médias
8.4. Des territoires pas comme les autres, les enjeux communicationnels des quartiers populaires
Chapitre 9. (Re) présenter le quartier et « l’agir » local : les médiatisations du quartier
9.1. Constitution et composition des corpus
9.2. Quartier, banlieue et cité : des objets discursifs proches, mais non synonymes
9.3. Les médiatisations du quartier dans les presses quotidienne nationale et régionale
9.4. La presse régionale, resserrement de focale : diversification des images du quartier
Chapitre 10. La presse de quartier : entre redéfinition des identités et contre-pouvoirs locaux
10.1. Les associations, des actrices centrales du quartier
10.2. Les journaux des associations d’habitants, défense des habitants et écho des enjeux de la démocratie locale
10.3. Un journal de quartier populaire : militantisme associatif et éducation populaire
10.4. Faire parler les habitants
10.5. Donner corps au « vivre-ensemble » : partages et transmission, animations du quartier
10.6. Une thématique transversale : la scolarité
10.7. Mobiliser les habitants : deux figures de la participation à l’échelle du quartier
10.8. Un lecture événementielle : le cas des Coursives d’Empalot et des Echos de
Rangueil .
Chapitre 11. Variations des objets discursifs « citoyen » et « habitant » en contexte local
11.1. Dans les conseils citoyens : l’habitant, une figure prépondérante
11.2. Dans la presse associative : l’habitant, un citoyen in situ
Partie V. Définir et agir pour le bien-être de tous, la participation aux prises de l’impératif de durabilité.
Chapitre 12. Les indicateurs de bien-être entre durabilité et cohésion sociale : la construction d’un nouvel horizon normatif ?
12.1. Le bien-être : de la notion au concept
12.2. Le bien-être et les indicateurs : d’une critique du PIB à de nouveaux indicateurs sociaux
12.3. Que mesure-t-on lorsque l’on mesure le bien-être ?
12.4. La participation et le bien-être : des relations complexes
12.5. Le référentiel SPIRAL : vers une définition partagée du bien-être et un monde pensé en terme d’équilibre
Chapitre 13. Les post-it du bien-être : une approche territoriale et sociale du bien-être ?
13.1. Une configuration spécifique, issue d’une instance de démocratie participative métropolitaine
13.2. L’expérimentation du Codev : constitution du corpus et retours sur l’expérience
Chapitre 14. Le bien-être : entre consensualité et poids du social
14.1. Portrait lexical du « test SPIRAL » : les relations aux autres et les ambivalences du « vivre-ensemble »
14.2. Portrait lexical « questionnaire Codev » : une civilité commune, une lexicalisation différente
14.3. Des appropriations différenciées du bien-être
14.4. Agir entre trivialité et généralité
14.5. Des valeurs communes et un niveau « d’agir » essentiellement circonscrit sur l’individu :
14.6. Le bien-être des membres du Codev
14.7. Synthèse et éléments de comparaison
Conclusion
La participation : une acclimatation de la gouvernance néolibérale ou changement de paradigme ?
La co-construction des imaginaires territoriaux
Vers un statut social habitant ? Le « droit à la ville » en question
Des usages communicationnels pluriels et parfois antagonistes
De la démocratie participative à la démocratie collaborative : aplanissement des responsabilités, individualisation et partenariat, vers une généralisation de la gouvernance ?
Bibliographie
Télécharger le rapport complet