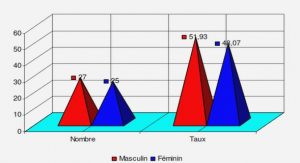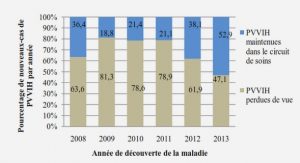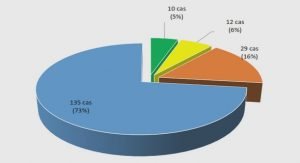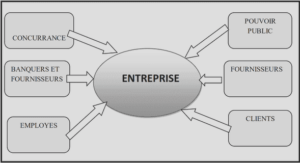Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Les systèmes d’informations : leurs usagers et leurs apprentissages.
Dans ce deuxième chapitre, l’auteure cherche à clarifier la notion d’usager de l’information et à aborder les besoins de formation à la recherche documentaire.
A cet effet, dans un premier temps, elle a défini qui sont les usagers de l’informatique en général et plus particulièrement les usagers des CDI. Puis, dans un second temps, elle a dressé un panorama non exhaustif des recherches menées sur le sujet dans les établissements scolaires ou non.
Selon elle, l’usager de l’information est la personne qui consomme, qui utilise des systèmes d’informations et qui réfléchit à ses modes d’usages. En particulier, dans un centre de documentation, les usagers sont nombreux (élèves-enseignants de discipline- professeur-documentalistes). Et toujours selon son opinion, déterminer une seule et unique typologie des usagers du CDI est donc difficilement envisageable.
Toutefois, à partir de ses lectures et de ses expériences sur le terrain, dans sa thèse, l’auteure a élaboré une grille pour identifier l’usager de l’information à travers cinq dimensions que sont : sa fonction dans l’établissement, les outils documentaires qu’il utilise, les pratiques de recherches et de lectures de l’information qu’il mobilise, le contexte de son usage et la finalité de ses recherches. Les usages et les usagers de l’information offrent ainsi un vaste champ d’études. C’est alors que l’auteure a dressé un panorama non exhaustif des recherches et études menées sur le sujet. Elles s’y intéressent sous des aspects éducatifs, cognitifs, etc…Aussi, elles révèlent une certaine proximité entre les champs disciplinaires concernés. Toutes ont pour objectif principal de faciliter l’accès à l’information et à la connaissance. Dans cette optique, la conception des produits multimédias adaptés aux besoins des utilisateurs demeurent une priorité.
Néanmoins, même avec le meilleur outil de recherche documentaire possible, le nécessaire apprentissage d’une démarche de recherche documentaire reste indispensable.
Par voie de conséquence, l’auteure a fait un petit rappel sur la conception de l’acte pédagogique au fil du temps depuis Socrate, en passant par Montaigne, Bossuet, Fénelon, les encyclopédies de Rousseau, Dewey, jusqu’à Durkheim.
Et, toujours sur cette idée de l’acte d’apprendre, elle a mis en relief l’opinion de Chaptal (1999) qui trace l’histoire des fondements théoriques des technologies éducatives et la question de l’efficacité des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement scolaire. Pour cela, il fait le lien avec les théories pédagogiques dont trois ont été successivement dominants : les modèles behavioristes, cognitifs et constructivistes.
Comme le propos du travail de Chaptal consiste à observer et à essayer d’appréhender les usages et les apprentissages aux TIC, il ne s’agit donc pas seulement de tenter de comprendre l’acte d’apprendre mais aussi d’évoquer les caractéristiques d’un apprentissage avec un instrument.
C’est donc avec les travaux de Rabardel (1995) que l’auteure a défini au mieux les actions instrumentées des hommes. Ce qui l’a ensuite, d’une part, amené à discuter de la pédagogie de la documentation où il s’agit de faire un bilan à la fois des savoirs disciplinaires et des savoirs documentaires. Tous deux sont nécessaires à la recherche documentaire.
D’une autre part, elle a développé sur quelques lignes quelques travaux de sciences cognitives dans le domaine des activités mentales des usagers des systèmes hypermédias et plus particulièrement ceux de concepteurs de multimédias. Entre autres, elle a cité ceux d’Bruillard et Vivet (1994) sur les recherches en EIAO (Enseignement Interactif d’ Apprentissage avec Ordinateur), ceux deTricot, Pierre-Demarcy et El Boussarghini (1998) sur l’activité mentale des utilisateurs d’un hypermédia, ceux de Dinet, Rouet, Passerault ( 1998) sur la compatibilité des outils de recherches avec les stratégies cognitives des élèves et finalement ceux de Rouet et Tricot ( 1995)sur les activités de recherche d’informations susceptibles de guider la conception des systèmes hypertextes.
Bref, ceux- là ne sont que des théories qui visent à concevoir les systèmes multimédias les mieux adaptés aux processus cognitifs de leurs usages. Mais, il est à noter que le principal objectif de l’auteure était de définir la formation adéquate à l’utilisation des systèmes hypermédias au CDI afin que l’élève devienne constructeur de son savoir.
CDI et TIC : quelle alliance ?
Dans ce troisième chapitre, l’auteure a mis en exergue la question des TIC dans les CDI ou plus précisément, elle tente d’exposer les apports des TIC au CDI et de la possible alliance TIC-CDI.
Ainsi, elle a surtout fait savoir que depuis l’intégration des TIC au CDI, outre les bouleversements dans la gestion et l’organisation des CDI, des bouleversements pédagogiques aussi ont émergé. Il s’agit alors de former les élèves à la maitrise de la recherche documentaire. Ce qui remet en question le statut et les missions du documentaliste mais aussi la place de la documentation dans le système scolaire.
En effet, l’auteure ajoute que notre époque assiste à une abstraction et à une multiplication des informations qui changent le rapport au savoir. Et, l’action de s’informer devient une nouvelle forme éducative, une innovation. Par la même occasion, le couple information-documentation devient un véritable outil pour aider les élèves à vivre dans une société changeante. Le lieu par excellence pour qu’ils apprennent dans un premier temps à s’informer, puis pour qu’ils s’informent seuls est donc celui du CDI.
Autrement, l’introduction des TIC constitue un premier facteur innovant et le professeur-documentaliste apparait comme le moteur de l’innovation. De plus, le travail d’équipe entre le professeur-documentaliste et enseignant de discipline permet de faire bénéficier d’une innovation à toute une classe et pas seulement quelques élèves présents au CDI.
De ce fait, parler d’innovation au CDI impose d’en aborder plusieurs sortes (institutionnelles, organisationnelles, sociales) et de ne pas seulement en évoquer une seule, comme l’innovation technologique.
Et si aujourd’hui, d’après l’auteure, le CDI est considéré en lui-même comme une innovation, c’est en grande partie dû à la présence des TIC. A eux deux, ils offrent de nouveaux modes d’apprentissage et de rapports sociaux et engendrent par la même occasion d’autres sortes d’innovations permettant d’annoncer une véritable innovation pédagogique.
Dispositif de recherche
Avant d’entamer avec l’étude de cas proprement dite, l’auteure a commencé son travail par un recueil des données auprès des documentalistes de collèges de France afin d’établir un état des lieux d’une part des TIC dans les CDI et de leurs usages, d’autre part, des CDI et leurs professionnels.
Les données ont été recueillies à l’aide de méthodes quantitatives et qualitatives. Les statistiques proviennent des résultats de questionnaires ou de dépouillements bibliographiques de certains Plans Académiques de Formations (PAF) et d’inter CDI, la revue des centres de documentation et d’information de l’enseignement secondaire en France. Quant aux données qualitatives, elles sont, pour la plupart, issues d’entretiens et de lectures.
Il est à faire remarquer qu’ en 1998 les résultats obtenus de ces investigations, dans le travail de l’auteure, n’ont été présentés qu’ à titre indicatif mais qui cependant permettent d’attirer l’attention sur le dynamisme des centres de documentation et d’information de collège de France et de leur personnel dans le domaine des nouvelles technologies.
Ce qui l’a conduit, ensuite, à effectuer l’étude de cas coordonnés menée sur deux années scolaires de 1997 à 1999 dans des CDI d’établissements scolaires contrastés. Chaque étude a fait l’objet d’une attention particulière.
Pour Van der Maren (1999), l’étude de cas vise à établir des théories, mais à partir d’une seule situation. Il explique « A partir d’un récit¸ des traces d’un passé proche ou lointain, ou d’un enregistrement de ce qui vient de se produire, on examine comment les choses se sont déroulées pour essayer de les comprendre, c’est-à-dire d’en dégager des régularités, des structures, des enchaînements ».
De la sorte, dans chacun des CDI étudiés, une situation spécifique a été mise en avant.
C’est alors que pour chacun des CDI observés, les objectifs, les contextes, les processus de mise en œuvre pour obtenir les informations et les résultats que l’auteure a énoncés et développés sont à caractère longitudinal et qualitatif.
La méthodologie utilise essentiellement les techniques du questionnaire, de l’entretien et de l’observation. L’étude de documents y est peu utilisée.
Questionnaires
Les questionnaires d’enquêtes à destination des professeurs-documentalistes ont été établis en fonction de renseignements précis à collecter.
En effet, le premier questionnaire intitulé « l’espace CDI »a eu pour objectif de recenser le personnel présent au CDI, le fonds documentaire et l’équipement du CDI.
Quant au second questionnaire, il s’est intéressé en partie aux professeurs documentalistes et à leurs pratiques des TIC. Le but y a été de percevoir leur état d’esprit concernant l’intégration des TIC dans leur pratique professionnelle et notamment dans les formations à la maitrise de l’information qu’ils proposent aux collégiens.
Entretiens
Dans un premier temps, les entretiens ont été entrepris avec les professeurs – documentalistes puis avec les élèves en petits groupes d’autre part.
D’une façon générale, les questions du canevas d’entretien, de type semi-directifs, adressées aux professeurs – documentalistes abordent la vie quotidienne du CDI, les relations qu’ils entretiennent avec l’ensemble des acteurs de l’établissement scolaire, leurs opinions quant à la diffusion des TIC dans les CDI, les comportements des élèves au CDI et leurs usages des TIC, etc.
Puis, des entretiens dirigés avec les élèves, systématiquement enregistrés, d’une durée d’environ 15 à 20 minutes, ont aussi été menés avec des groupes de 4 à 6 élèves au sein des CDI eux-mêmes. Et ce choix de l’entretien de groupe est motivé par le gain de temps et le phénomène d’interaction qui s’y produit et qui en sont conséquentes. D’ailleurs, De Ketele et Roegiers (1993) confirme bien ces raisons lorsqu’ils ont exprimés que « les interviews de groupe peuvent se révéler intéressante, soit pour des raisons de gain de temps, soit parce que les effets recherches se situent davantage au niveau des interactions entre différentes personnes que dans des faits précis ».
Autrement, la grille d’entretien intitulée « Connaissances et usages des TIC au CDI » est constituée de questions sur la culture générale en informatique des élèves, leurs connaissances des logiciels documentaires, des cédéroms et du réseau Internet. Bref, il s’agit de mieux appréhender les compétences et les différents usages des jeunes en matière d’outils informatiques présents au CDI.
Observations
Si l’interview a eu pour objet principal le discours des acteurs concernés, l’observation, quant à elle s’intéresse à leurs comportements observables, notamment et surtout ceux des élèves, dans cette étude.
En effet, les séances d’observation menées dans chacun des CDI de collèges choisis ont porté sur des séances de formation à la maitrise de l’information effectuées avec les élèves en présence du professeur-documentaliste et éventuellement d’un enseignant de discipline. Pour chacune d’entre elles, elle durait une heure environ, a été quelquefois enregistrée et prise en notes.
Ainsi, les principales finalités ont été de rassembler un maximum de renseignements concernant à la fois le déroulement des travaux et les attitudes des différents acteurs.
Détermination du terrain
Tout au long de son étude, l’auteure a effectuée des visites ponctuelles dans 3 CDI de collèges (X, Y, Z) et régulièrement dans 4 autres (Alpha, A, B, C).
Son but est ici d’expliquer de quelle façon se sont déroulées ses investigations dans chacun des CDI. Puis, afin de rendre compte de chaque étude, un plan similaire au plan ci- après a été adopté. En effet, l’étude de cas y est dans un premier temps décrite chronologiquement. La situation de départ, les acteurs et les grandes étapes de son déroulement y sont successivement abordés par la suite.
En outre, elle a choisi de garder le nom de ces établissements parisiens ou de la banlieue parisienne dans l’anonymat et les a désignés par une lettre capitale.
|
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : LA THESE MERE
1. Présentation de la thèse- mère
2. Problématique et hypothèse
3. Cadre théorique
3.1. Les TIC au collège : de l’innovation à l’intégration.
3.2. Les systèmes d’informations : leurs usagers et leurs apprentissages.
3.3. CDI et TIC : quelle alliance ?
4. Dispositif de recherche
4.1. Questionnaires
4.2. Entretiens
4.3. Observations
4.4. Détermination du terrain
4.5. Résultats
4.6. Analyse critique
DEUXIEME PARTIE : LA REPLICATION
1. Cadre théorique
2. Problématique reformulée
3. Hypothèse
4. Méthodologie
4.1. Description de la recherche
4.2. Description des participants
4.3. Instruments de mesure
5. Exposition des données recueillies
5.1. Le personnel, le fonds documentaire et l’équipement du CDI
5.2. La formation des documentalistes aux TIC et leurs pratiques pédagogiques dans ce domaine
5.3. L’état des lieux des usages des TIC au CDI
6. Discussions des données recueillies
6.1. Récapitulation du contexte de l’étude
6.2. Discussions par rapport aux résultats
CONCLUSION GENERALE
ANNEXES
Télécharger le rapport complet