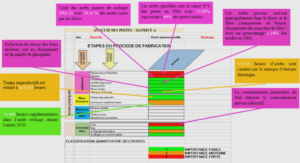L’érosion est un processus complexe vieux comme le monde. Elle concerne l’arrachement, le transfert et la sédimentation de particules par l’eau, le vent ou la gravité. Depuis longtemps, l’érosion façonne les reliefs et construit les plaines, lesquelles nourrissent la majorité des populations du monde. En agglomérant des peuples autour des villages, chaque civilisation a créé les conditions favorables au ruissellement, à l a dégradation des sols et à l’accélération de l’érosion. Ce dernier phénomène n’apparaît pas de manière homogène dans toute la Casamance mais il est prouvé qu’aujourd’hui les processus de dégradation physique du sol s’accentuent. L’élément qui fait peut être le plus défaut, c’est l’absence de volonté politique nationale fondée sur une véritable compréhension du problème. Ce manque d’intérêt politique, s’identifie même dans la Commune de Djibidione où les ressources naturelles sont les plus gravement endommagées. Malgré de vastes dégâts dus à l’érosion, certains n’ont toujours pas de plan valable pour prendre au soin du sol. Face aux risques liés à l’érosion, les anciennes sociétés rurales ont élaboré empiriquement des stratégies permettant de conserver les sols et de maintenir la productivité des terres. Mais lorsque la population et ses besoins évoluent trop vite, se développe une crise à l a fois socio-économique et érosive à la quelle la société tente de répondre par la mise au point de nouvelles techniques d’aménagement plus intensives et plus durables. Lutter contre l’érosion est donc une activité humaine forte ancienne, remise à l’ordre du jour par l’occupation incontrôlée des sols et par la mise en culture de terres particulièrement sensibles à ce phénomène.
Synthèse des travaux antérieurs
Depuis plusieurs années, la littérature spécialisée rend compte de plusieurs travaux étudiant les facteurs et les mesures de lutte contre l’érosion du sol. Dans ce contexte, le Sénégal offre un domaine trop vaste aux chercheurs pour l’étude de la pluviométrique dans son ensemble. C’est ainsi que P aul Pélissier (1966) a senti l’intérêt d’étudier les pratiques culturales en se basant sur les zones climatiques de ce pays. Cependant, il a laissé la vallée du fleuve Sénégal en dehors de son champ d’investigation, s’attachant aux 2/3 de la population installée du Cayor à la Casamance. Là, le milieu naturel en se modifiant avec la latitude révèle trois grands ensembles: le domaine sahélo-soudanien qui va des lisières méridionales du de lta du Sénégal aux abords de la vallée du S aloum: c’est le bassin de l’arachide; ensuite le domaine soudanien, entre le fleuve Saloum et le Fleuve Gambie; et le domaine subguinéen en Casamance où l’unité naturelle contraste avec la diversité ethnique. Hudson (1965 et 1983) au Zimbabwe, puis Elwell et Stocking (1975) sur des sols ferralitiques bien structurés trouvent de meilleures relations entre l’érosion et l’énergie des pluies au-dessus d’un certain seuil d’intensité (I > 25 mm/h). Ces auteurs ont observé que seules les pluies intenses entrainent l’érosion. Nous pouvons cependant penser que toutes les pluies laissent une trace en dégradant la surface du sol. Même si toutes les pluies ne ruissellent pas, elles favorisent la naissance de croûtes peu perméables et accélèrent le ruissellement lors des averses suivantes. Pierre Birot (1981) évoque le fait que dans le milieu tropical soumis à des fortes averses, l’énergie cinétique est plus considérable dans les processus d’érosion à la surface des continents. Tidiane Sané (2003) dans sa thèse évalue les contraintes d’ordre climatique qui pèsent non seulement sur le fonctionnement des écosystèmes naturels mais également sur les activités humaines, notamment sur l’agriculture et l’élevage dans la mesure où les productions agricoles et la productivité des activités pastorales dépendent largement des conditions climatiques. Il n ote que la péjoration pluviométrique de ces trente dernières années a profondément influencée ces activités dont l’évolution chaotique s’est répercutée sur le fonctionnement des sociétés qui pour des questions de survie, ont développé des stratégies, qui pour la plupart, menacent l’équilibre environnemental.
Du point de vue géologique, Assane Seck (1955) dans sa revue de géographie physique souligne le fait que les sols de la moyenne Casamance sont formés par les grès argileux du moi-pliocène, mais ils sont très variés dans le détail et dans leur répartition. Cela nous fait penser à Vieillefon (1977) lorsqu’il évoque le fait que les zones alluviales récentes ont été comblées par des apports considérables de sédiments liés à des phases érosives intenses dans les bassins versants des fleuves tropicaux, en particulier au cours des dernières phases du Quaternaire. Pour justifier cela, il a pris comme référence l’étude pédagogique de la séquence de Balingore (en basse Casamance) en la divisant en deux milieux: les mangroves et les tannes.
Au point de vue pédologique, Horton (1945) en évoquant les origines du ruissellement met l’accent sur la capacité du sol à absorber et à laisser passer l’eau. Pour lui le ruissellement naît lorsque l’intensité des pluies est supérieure à la capacité d’infiltration du sol ou lorsque l’espace poreux du sol est saturé. Vieillefon (1975) d ans sa n otice explicative de la carte pédologique de la Basse Casamance a d’abord précisé les raisons qui lui ont poussé à réaliser cette carte avant de choisir l’échelle du 1/100000 pour la présentation de la carte afin de prendre en compte le degré d’évolution et de différenciation des sols de la Basse Casamance. Chauvel (1977) a bien décrit la structure des sols ferrallitiques en Casamance (Sénégal). En effet, au niveau macroscopique, les horizons B apparaissent très rouges et sont constitués d’un assemblage de petits granules soudés les uns aux autres, ou bien micro-agrégats. Des études plus détaillées menées par Chauvel (1977) montrent que ces cristallites sont associées par des composés mal cristallisés du fer. Ces sols sont très riches en argiles associées en agrégats qui constituent de véritables pseudo sables. R obert (1996) constate une répartition zonale des sols ferrallitiques selon l’importance des pluies. Pour lui, lorsque la pluviométrie devient inférieure à 1200mm, la structure micronodulaire n’est plus stable. Les assemblages d’argile sont dissociés et les particules peuvent être entrainées. Le sol devient alors peu perméable et on passe de sols ferrallitiques à des sols ferrugineux tropicaux qui, par entrainement d’argile, peuvent devenir plus sableux.
Du point de vue géomorphologique, le Sénégal a fait l’objet d’études scientifiques par nombreux auteurs. En effet, Tricart (1965) s’est très tôt intéressé à la géomorphologie de l’Afrique de l’Ouest. Il a observé des surfaces planes immensément développées et, le plus souvent très faiblement inclinées. Selon lui, ces niveaux d’érosion qui tranchent les couches métamorphiques des divers précambriens, la rudesse de certaines pentes fait penser au recul des versants. La Casamance où le Sénégal recense les premières et les dernières pluies de l’année, préoccupe beaucoup les chercheurs. C’est là où le pays reçoit les plus fortes pluies. C’est pourquoi Vieillefon (1977), en étudiant les sols des mangroves et des tannes de la basse Casamance, affirme que l’action de la marée et de l’alternance climatique saisonnière a une influence sur la circulation de l’eau qui rend compte de deux domaines :
• celui de la fraction mangrove de la séquence, au régime de submersion biquotidien à bimensuel, au battement de la nappe de faible amplitude ;
• celui de la fraction tanne, au régime de submersion annuel, entrainant, en saison sèche, un approfondissement notable de la nappe et la pénétration corrélative du f ont d’aération ou d’oxydation.
Sur le plan anthropique, plusieurs chercheurs se sont intéressés aux facteurs qui conditionnent la destruction des sols surtout ferralitiques et ferrugineux, sols par excellence de la Casamance. Au paravent ces sols ont présenté des propriétés physiques (porosité, aération, perméabilité) très favorables, dues à leur structure micronodulaire. Ces sols perméables sont donc peu sensibles à l’érosion pluviale. Mais l’action de l’homme et de l’animal donne au sol une autre posture inquiétante. En effet, l’érosion qui se manifeste dans la plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest dont appartient le Sénégal, préoccupe les chercheurs. C’est pourquoi Coitepas (1956) en présentant les premiers résultats des mesures de l’érosion en moyenne Casamance(Sénégal) a montré que le climat, le sol, la pente et surtout l’agriculture sont les principaux facteurs de l’érosion. Pour lui, la lutte contre ce fléau fait part de la prise de plusieurs mesures que sont :
❖ le défrichement restreint aux parcelles dont la pente est inférieure à 1% ;
❖ l’orientation des parcelles suivant les lignes de niveau ;
❖ la culture en bandes altérées d’une largeur maximale de 50m ;
❖ la limitation du nombre de façons culturales à la machine .
Dans cette même logique, Birot. P (1981) en évoquant l’intérêt que porte le couvert végétal dans la protection du sol tient en compte le rôle des animaux fouisseurs et des termites qui selon lui créent des conditions d’infiltration et de stockage de l’eau, ou de ralentissement du processus d’érosion. Les résultats présentés par Roose et al (1981) apportent à leur tour des données comparables sur des modifications de la dynamique des sols ferrallitiques et ferrugineux d’Afrique Occidentale sous l’influence de la mise en culture.
Problématique
L’érosion des sols participe à plusieurs grands problèmes environnementaux qui perturbent la planète. Des milliards de tonnes de sable se perdent sous l’effet d’une érosion accélérée due à l’action du vent et de l’eau, et de modifications indésirables de la structure du sol (FAO, 1983). La verte Casamance, une des régions les plus pluvieuses du Sénégal (1302mm de pluies en moyenne par an), n’est pas épargnée de la menace générale de l’érosion observée à l’échelle Ouest africaine voire même internationale. Or les sols de cette région Sud du Sénégal sont presque recouverts d’un manteau d’arbres et d’arbustes, d’une litière de feuilles mortes et en décomposition, ou d’un épais tapis herbacé qui peuvent protéger le sol de l’impact de la pluie ou des rafales de vent. Quel est donc le principal agent de l’enlèvement de la couche pédologique au niveau de notre milieu d’étude ?
D’après le Bulletin Pédagogique de la FAO, «l’érosion éolienne se produit lorsque la surface du sol est relativement dépourvue d’aspérités et le couvert végétal est rare.» Cela nous laisse croire qu’il existe un principal agent érosif au niveau de la Commune de Djibidione. En fait le ruissellement lié à des précipitations entraîne le départ de terres par érosion de façon spectaculaire en creusant de profondes ravines ou plus discrètement en emportant les éléments fertiles du sol et parfois des semences. Les épisodes de crue engendrent des processus d’érosion qui modèlent les paysages fluviaux et peuvent représenter une menace pour la pérennité des sols le long du marigot de Baïla. Si l’érosion hydrique est en grande partie responsable de la destruction du sol et du relief, quels sont donc les facteurs qui accélèrent ce processus ? Dans la Commune de Djibidione, localité de la région de Ziguinchor plus précisément dans le département de Bignona, les versants sont caractérisés par des pentes longues, ce qui peut augmenter l’ampleur de l’érosion. L’une des raisons de l’instabilité des sols tient à l a prédominance de particules grossières qui se détachent facilement sous le martèlement de la pluie. C’est pourquoi Pierre Birot (1981) en comparant les types de sols met l’accent sur l’usage par saltation pluviale qui selon lui est maximale pour les sables, par opposition des argiles. Dans le contexte actuel où la vulnérabilité du sol a facilité la destruction de la couche pédologique, y a-t-il d’autres facteurs d’érosion? La Casamance, région limitrophe de la forêt tropicale humide, a longtemps été perçue comme un «grenier agricole» qui peut potentiellement subvenir à la forte demande alimentaire d’un pays tel que le Sénégal. Dans notre milieu d’étude, la sécheresse ainsi que la pression exercée sur les ressources naturelles, l’état des systèmes de culture ont accéléré la dégradation de l’environnement de la dite Commune. A cet effet, la destruction du couvert végétal ne provoque-t-elle pas une vive érosion ? L’homme qui, par maladresse et par des pratiques inadaptées sur les versants, est le facteur principal conditionnant l’intensité de l’érosion. Les défrichements qu’il opère sur les forêts et les parcours naturels, le surpâturage, les labours mécanisés dans le sens des pentes facilitent le ruissellement et par conséquent l’érosion et ses effets indésirables pour l’environnement. Face à ce fléau, il convient dès lors de mettre sur place différentes stratégies de lutte antiérosive et de protection des ressources naturelles. Dans cette dynamique, la population locale constitue la principale force appuyée par le pouvoir publique et les partenaires au développement.
|
Table des matières
Introduction générale
Première partie : Présentation du milieu
Chapitre I : Le cadre physique
1. Les unités géomorphologies
1.1. La géologie
1.1.1. Le bassin continental
1.1.2. Le bassin maritime
1.2. Les unités morpho-pédologiques
1.2.1. Les bas fonds
1.2.2. Les versants
1.2.3. Le plateau
2. Le climat
2.1. Les facteurs généraux
2.2. Les éléments du climat
2.2.1. Les vents
2.2.2. Les précipitations
2.2.3. L’insolation
2.2.4. Les températures
2.2.5. L’humidité relative
2.2.6. L’évaporation
3. Les ressources hydriques
3.1. Les eaux souterraines
3.2. Les eaux de surface
4. La végétation
4.1. La forêt claire humide
4.2. La forêt claire sèche
4.3. La savane très boisée
4.4. La forêt secondaire
Chapitre II : Le cadre démographique
1. Evolution de la population
2. Structure de la population
3. Répartition démographique
Chapitre III : Le cadre économique
1. L’agriculture
1.1. La gestion foncière
1.2. Types de cultures pratiquées
1.3. Mécanisation des pratiques culturales
1.3.1. Matériel agricole
1.3.2. Exploitation des terres
2. L’élevage
3. La pêche
Deuxième partie : L’érosion des sols
Chapitre I : Facteurs de l’érosion
1. Les facteurs naturels
1.1. Variabilité temporaire et spatiale des pluies
1.2. Déclivité de la pente
1.3. Variation du niveau d’eau courante
2. Les facteurs anthropiques
2.1. Les activités humaines
2.1.1. Les systèmes de culture
2.1.2. Les systèmes de récolte
2.1.3. Le système pastoral
2.1.4. Les aménagements routiers
2.2. La dégradation du couvert forestier
2.2.1. Le défrichement
2.2.2. L’exploitation abusive de la forêt
Chapitre II: Les manifestations de l’érosion des sols
1. L’érosion pluviale
1.1. L’érosion diffuse
1.2. L’érosion concentrée
2. L’érosion fluviale
Chapitre III : Impacts de l’érosion des sols
1. Surface abandonnée
2. Dégradation des routes
3. Ensablement des bas fonds
3.1 Dans les mares naturelles
3.2. Dans les rizières
3.3. Dans le lit du cours d’eau
4. Recul des berges du marigot de Baïla
Troisième partie: Les stratégies de lutte contre l’érosion des sols et leurs limites
Chapitre I: Les stratégies de lutte contre l’érosion des sols
1. Les mesures agronomiques
1.1. Les cultures intermédiaires
1.2. Le paillage
1.3. Les cultures à travers la pente
1.4. Le décompactage ou le sous-solage du sol
1.5. La rotation des cultures et la jachère
1.6. L’association des cultures
2. Les mesures hydrauliques
2.1. Les diguettes
2.2. Le découpage du parcellaire
2.3. Les murettes
2.4. Les mares ou bassins de régulation
3. Les mesures forestières
3.1. La protection du couvert végétal
3.1.1. Les comités de lutte contre les feux de brousse
3.1.2. Les réserves naturelles
3.2. Le reboisement
Chapitre II : Limites des mesures de lutte anti-érosive
1. Surexploitation de la forêt
2. Intensité des précipitations
3. Insuffisance des moyens et des capacités d’action
4. Absence de cadres de concertation et de sensibilisation publique
5. Insuffisance des études relatives à l a mise en ouvre des projets d’aménagement antiérosif
6. Longueur du versant
Conclusion générale